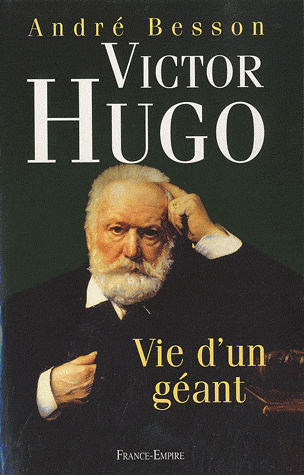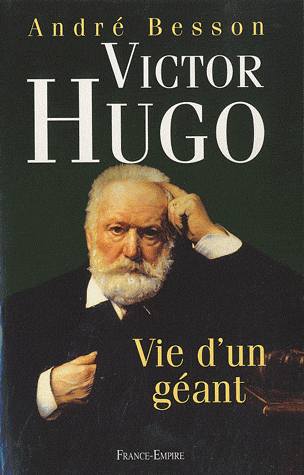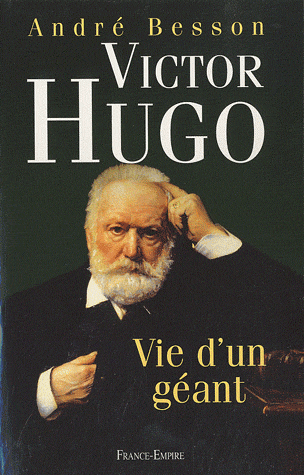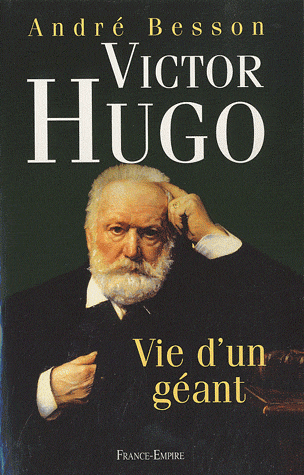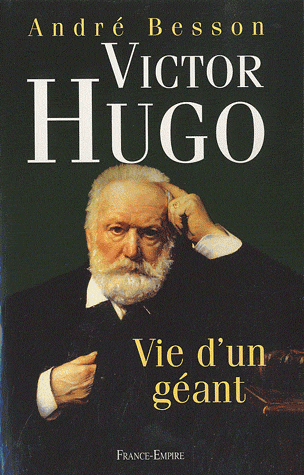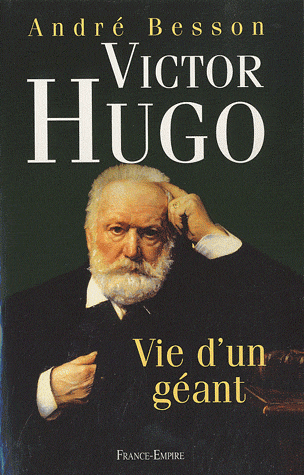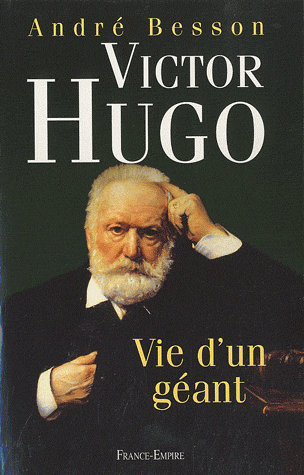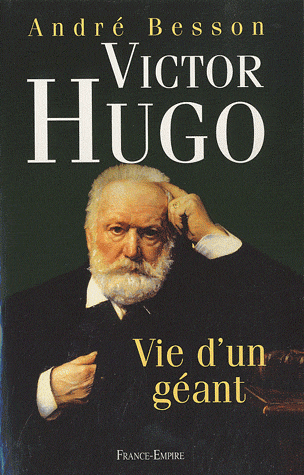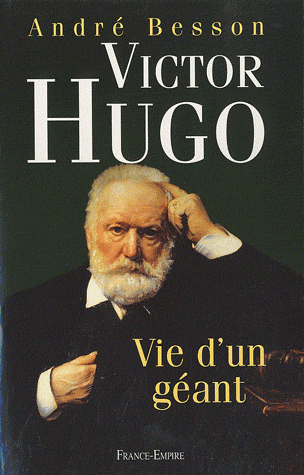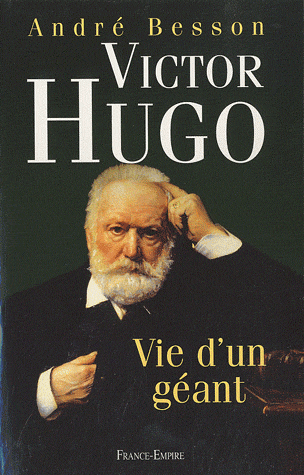afrique alphabet amour ange anime banniere scintillante belle belle image blog bonne cadeau
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· BELLE IMAGES creas divers (7102)
· Cadres (2571)
· Cadeau des amis et amies recu merci (2210)
· Femmes (1498)
· Visage de femme (1611)
· Stars (1230)
· TUBE COOKIE (1017)
· GIF ANIMAUX ANIMES (1136)
· FOND D ECRAN CHIEN (664)
· GIF SCTILLANT (617)
dog
Par Anonyme, le 22.01.2026
❤️coucou? ?️
je te souhaite une trés bonne année 2026 et surtout une excellente santé
que du bonheur por toi
Par 2026 39, le 01.01.2026
slt, 07.59.36.30.63 wattsap telegram
livr eur spécialiser dans la cocaine , weed ,shit,calipuff qualiter du p
Par Anonyme, le 19.12.2025
slt, 07.59.36.30.63 wattsap telegram
livr eur spécialiser dans la cocaine , weed ,shit,calipuff qualiter du p
Par Anonyme, le 19.12.2025
slt, 07.59.36.30.63 wattsap telegram
livr eur spécialiser dans la cocaine , weed ,shit,calipuff qualiter du p
Par Anonyme, le 19.12.2025
· tatouage et peinture
· FOND D ECRAN D ILES PARADISIAQUES
· FOND D ECRAN TIGRE
· parchemin
· mdr
· recette pate a sel
· ongles jaunes
· tuning
· gifs scintillant
· tatouage et peinture
· recette pour la colle
· fond d ecran
· chevaux
· gagnant du loto
· scintillant
Statistiques
Date de création : 07.05.2008
Dernière mise à jour :
30.06.2017
122498 articles
POEME VICTOR HUGO
a villequier
Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres,
Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux ;
Maintenant que je suis sous les branches des arbres,
Et que je puis songer à la beauté des cieux ;
Maintenant que du deuil qui m’a fait l’âme obscure
Je sors, pâle et vainqueur,
Et que je sens la paix de la grande nature
Qui m’entre dans le cœur ;
Maintenant que je puis, assis au bord des ondes,
Ému par ce superbe et tranquille horizon,
Examiner en moi les vérités profondes
Et regarder les fleurs qui sont dans le gazon ;
Maintenant, ô mon Dieu ! que j’ai ce calme sombre
De pouvoir désormais
Voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l’ombre
Elle dort pour jamais ;
Maintenant qu’attendri par ces divins spectacles,
Plaines, forêts, rochers, vallons, fleuve argenté,
Voyant ma petitesse et voyant vos miracles,
Je reprends ma raison devant l’immensité ;
Je viens à vous, Seigneur, père auquel il faut croire ;
Je vous porte, apaisé,
Les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire
Que vous avez brisé ;
Je viens à vous, Seigneur ! confessant que vous êtes
Bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant !
Je conviens que vous seul savez ce que vous faites,
Et que l’homme n’est rien qu’un jonc qui tremble au vent ;
Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le firmament ;
Et que ce qu’ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement ;
Je conviens à genoux que vous seul, père auguste,
Possédez l’infini, le réel, l’absolu ;
Je conviens qu’il est bon, je conviens qu’il est juste
Que mon cœur ait saigné, puisque Dieu l’a voulu !
Je ne résiste plus à tout ce qui m’arrive
Par votre volonté.
L’âme de deuils en deuils, l’homme de rive en rive,
Roule à l’éternité.
Nous ne voyons jamais qu’un seul côté des choses ;
L’autre plonge en la nuit d’un mystère effrayant.
L’homme subit le joug sans connaître les causes.
Tout ce qu’il voit est court, inutile et fuyant.
Vous faites revenir toujours la solitude
Autour de tous ses pas.
Vous n’avez pas voulu qu’il eût la certitude
Ni la joie ici-bas !
Dès qu’il possède un bien, le sort le lui retire.
Rien ne lui fut donné, dans ses rapides jours,
Pour qu’il s’en puisse faire une demeure, et dire :
C’est ici ma maison, mon champ et mes amours !
Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient ;
Il vieillit sans soutiens.
Puisque ces choses sont, c’est qu’il faut qu’elles soient ;
J’en conviens, j’en conviens !
Le monde est sombre, ô Dieu ! l’immuable harmonie
Se compose des pleurs aussi bien que des chants ;
L’homme n’est qu’un atome en cette ombre infinie,
Nuit où montent les bons, où tombent les méchants.
Je sais que vous avez bien autre chose à faire
Que de nous plaindre tous,
Et qu’un enfant qui meurt, désespoir de sa mère,
Ne vous fait rien, à vous !
Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue ;
Que l’oiseau perd sa plume et la fleur son parfum ;
Que la création est une grande roue
Qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un ;
Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent,
Passent sous le ciel bleu ;
Il faut que l’herbe pousse et que les enfants meurent ;
Je le sais, ô mon Dieu !
Dans vos cieux, au delà de la sphère des nues,
Au fond de cet azur immobile et dormant,
Peut-être faites-vous des choses inconnues
Où la douleur de l’homme entre comme élément.
Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre
Que des êtres charmants
S’en aillent, emportés par le tourbillon sombre
Des noirs événements.
Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses
Que rien ne déconcerte et que rien n’attendrit.
Vous ne pouvez avoir de subites clémences
Qui dérangent le monde, ô Dieu, tranquille esprit !
Je vous supplie, ô Dieu ! de regarder mon âme,
Et de considérer
Qu’humble comme un enfant et doux comme une femme
Je viens vous adorer !
Considérez encor que j’avais, dès l’aurore,
Travaillé, combattu, pensé, marché, lutté,
Expliquant la nature à l’homme qui l’ignore,
Éclairant toute chose avec votre clarté ;
Que j’avais, affrontant la haine et la colère,
Fait ma tâche ici-bas,
Que je ne pouvais pas m’attendre à ce salaire,
Que je ne pouvais pas
Prévoir que, vous aussi, sur ma tête qui ploie,
Vous appesantiriez votre bras triomphant,
Et que, vous qui voyiez comme j’ai peu de joie,
Vous me reprendriez si vite mon enfant !
Qu’une âme ainsi frappée à se plaindre est sujette,
Que j’ai pu blasphémer,
Et vous jeter mes cris comme un enfant qui jette
Une pierre à la mer !
Considérez qu’on doute, ô mon Dieu ! quand on souffre,
Que l’œil qui pleure trop finit par s’aveugler.
Qu’un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre,
Quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler.
Et qu’il ne se peut pas que l’homme, lorsqu’il sombre
Dans les afflictions,
Ait présente à l’esprit la sérénité sombre
Des constellations !
Aujourd’hui, moi qui fus faible comme une mère,
Je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts.
Je me sens éclairé dans ma douleur amère
Par un meilleur regard jeté sur l’univers.
Seigneur, je reconnais que l’homme est en délire,
S’il ose murmurer ;
Je cesse d’accuser, je cesse de maudire,
Mais laissez-moi pleurer !
Hélas ! laissez les pleurs couler de ma paupière,
Puisque vous avez fait les hommes pour cela !
Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre
Et dire à mon enfant : Sens-tu que je suis là ?
Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes,
Le soir, quand tout se tait,
Comme si, dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes,
Cet ange m’écoutait !
Hélas ! vers le passé tournant un oeil d’envie,
Sans que rien ici-bas puisse m’en consoler,
Je regarde toujours ce moment de ma vie
Où je l’ai vue ouvrir son aile et s’envoler !
Je verrai cet instant jusqu’à ce que je meure,
L’instant, pleurs superflus !
Où je criai : L’enfant que j’avais tout à l’heure,
Quoi donc ! je ne l’ai plus !
Ne vous irritez pas que je sois de la sorte,
O mon Dieu ! cette plaie a si longtemps saigné !
L’angoisse dans mon âme est toujours la plus forte,
Et mon cœur est soumis, mais n’est pas résigné.
Ne vous irritez pas ! fronts que le deuil réclame,
Mortels sujets aux pleurs,
Il nous est malaisé de retirer notre âme
De ces grandes douleurs.
Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires,
Seigneur ; quand on a vu dans sa vie, un matin,
Au milieu des ennuis, des peines, des misères,
Et de l’ombre que fait sur nous notre destin,
Apparaître un enfant, tête chère et sacrée,
Petit être joyeux,
Si beau, qu’on a cru voir s’ouvrir à son entrée
Une porte des cieux ;
Quand on a vu, seize ans, de cet autre soi-même
Croître la grâce aimable et la douce raison,
Lorsqu’on a reconnu que cet enfant qu’on aime
ait le jour dans notre âme et dans notre maison,
Que c’est la seule joie ici-bas qui persiste
De tout ce qu’on rêva,
Considérez que c’est une chose bien triste
De le voir qui s’en va !
a ma fille
Ô mon enfant, tu vois, je me soumets.
Fais comme moi : vis du monde éloignée ;
Heureuse ? non ; triomphante ? jamais.
— Résignée ! —
Sois bonne et douce, et lève un front pieux.
Comme le jour dans les cieux met sa flamme,
Toi, mon enfant, dans l’azur de tes yeux
Mets ton âme !
Nul n’est heureux et nul n’est triomphant.
L’heure est pour tous une chose incomplète ;
L’heure est une ombre, et notre vie, enfant,
En est faite.
Oui, de leur sort tous les hommes sont las.
Pour être heureux, à tous, — destin morose ! —
Tout a manqué. Tout, c’est-à-dire, hélas !
Peu de chose.
Ce peu de chose est ce que, pour sa part,
Dans l’univers chacun cherche et désire:
Un mot, un nom, un peu d’or, un regard,
Un sourire !
La gaîté manque au grand roi sans amours ;
La goutte d’eau manque au désert immense.
L’homme est un puits où le vide toujours
Recommence.
Vois ces penseurs que nous divinisons,
Vois ces héros dont les fronts nous dominent,
Noms dont toujours nos sombres horizons
S’illuminent !
Après avoir, comme fait un flambeau,
Ébloui tout de leurs rayons sans nombre,
Ils sont allés chercher dans le tombeau
Un peu d’ombre.
Le ciel, qui sait nos maux et nos douleurs,
Prend en pitié nos jours vains et sonores.
Chaque matin, il baigne de ses pleurs
Nos aurores.
Dieu nous éclaire, à chacun de nos pas,
Sur ce qu’il est et sur ce que nous sommes ;
Une loi sort des choses d’ici-bas,
Et des hommes !
Cette loi sainte, il faut s’y conformer,
Et la voici, toute âme y peut atteindre :
Ne rien haïr, mon enfant ; tout aimer,
Ou tout plaindre !
am froment meurice
Nous sommes frères: la fleur
Par deux arts peut être faite.
Le poëte est ciseleur;
Le ciseleur est poëte.
Poëtes ou ciseleurs,
Par nous l’esprit se révèle.
Nous rendons les bons meilleurs,
Tu rends la beauté plus belle.
Sur son bras ou sur son cou,
Tu fais de tes rêveries,
Statuaire du bijou,
Des palais de pierreries!
Ne dis pas: -Mon art n’est rien…-
Sors de la route tracée,
Ouvrier magicien,
Et mêle à l’or la pensée!
Tous les penseurs, sans chercher
Qui finit ou qui commence,
Sculptent le même rocher:
Ce rocher, c’est l’art immense.
Michel-Ange, grand vieillard,
En larges blocs qu’il nous jette,
Le fait jaillir au hasard;
Benvenuto nous l’émiette.
Dont jamais la loi ne change,
La miette de Cellini
Vaut le bloc de Michel-Ange.
Tout est grand; sombre ou vermeil,
Tout feu qui brille est une âme.
L’étoile vaut le soleil;
L’étincelle vaut la flamme.
splendeurs
A présent que c’est fait, dans l’avilissement
Arrangeons-nous chacun notre compartiment
Marchons d’un air auguste et fier ; la honte est bue.
Que tout à composer cette cour contribue,
Tout, excepté l’honneur, tout, hormis les vertus.
Faites vivre, animez, envoyez vos foetus
Et vos nains monstrueux, bocaux d’anatomie
Donne ton crocodile et donne ta momie,
Vieille Egypte ; donnez, tapis-francs, vos filous ;
Shakespeare, ton Falstaff ; noires forêts, vos loups ;
Donne, ô bon Rabelais, ton Grandgousier qui mange ;
Donne ton diable, Hoffmann ; Veuillot, donne ton ange ;
Scapin, apporte-nous Géronte dans ton sac ;
Beaumarchais, prête-nous Bridoison ; que Balzac
Donne Vautrin ; Dumas, la Carconte ; Voltaire,
Son Frélon que l’argent fait parler et fait taire ;
Mabile, les beautés de ton jardin d’hiver ;
Le Sage, cède-nous Gil Blas ; que Gulliver
Donne tout Lilliput dont l’aigre est une mouche,
Et Scarron Bruscambille, et Callot Scaramouche.
Il nous faut un dévot dans ce tripot payen ;
Molière, donne-nous Montalembert. C’est bien,
L’ombre à l’horreur s’accouple, et le mauvais au pire.
Tacite, nous avons de quoi faire l’empire ;
Juvénal, nous avons de quoi faire un sénat.
II
Ô Ducos le gascon, ô Rouher l’auvergnat,
Et vous, juifs, Fould Shylock, Sibour Iscariote,
Toi Parieu, toi Bertrand, horreur du patriote,
Bauchart, bourreau douceâtre et proscripteur plaintif,
Baroche, dont le nom n’est plus qu’un vomitif,
Ô valets solennels, ô majestueux fourbes,
Travaillant votre échine à produire des courbes,
Bas, hautains, ravissant les Daumiers enchantés
Par vos convexités et vos concavités,
Convenez avec moi, vous tous qu’ici je nomme,
Que Dieu dans sa sagesse a fait exprès cet homme
Pour régner sur la France, ou bien sur Haïti.
Et vous autres, créés pour grossir son parti,
Philosophes gênés de cuissons à l’épaule,
Et vous, viveurs râpés, frais sortis de la geôle,
Saluez l’être unique et providentiel,
Ce gouvernant tombé d’une trappe du ciel,
Ce césar moustachu, gardé par cent guérites,
Qui sait apprécier les gens et les mérites,
Et qui, prince admirable et grand homme en effet,
Fait Poissy sénateur et Clichy sous-préfet.
III
Après quoi l’on ajuste au fait la théorie
« A bas les mots ! à bas loi, liberté, patrie !
Plus on s’aplatira, plus ou prospérera.
Jetons au feu tribune et presse, et cætera.
Depuis quatrevingt-neuf les nations sont ivres.
Les faiseurs de discours et les faiseurs de livres
Perdent tout ; le poëte est un fou dangereux ;
Le progrès ment, le ciel est vide, l’art est creux,
Le monde est mort. Le peuple ? un âne qui se cabre !
La force, c’est le droit. Courbons-nous. Gloire au sabre !
A bas les Washington ! vivent les Attila ! »
On a des gens d’esprit pour soutenir cela.
Oui, qu’ils viennent tous ceux qui n’ont ni coeur ni flamme,
Qui boitent de l’honneur et qui louchent de l’âme ;
Oui, leur soleil se lève et leur messie est né.
C’est décrété, c’est fait, c’est dit, c’est canonné
La France est mitraillée, escroquée et sauvée.
Le hibou Trahison pond gaîment sa couvée.
IV
Et partout le néant prévaut ; pour déchirer
Notre histoire, nos lois, nos droits, pour dévorer
L’avenir de nos fils et les os de nos pères,
Les bêtes de la nuit sortent de leurs repaires
Sophistes et soudards resserrent leur réseau
Les Radetzky flairant le gibet du museau,
Les Giulay, poil tigré, les Buol, face verte,
Les Haynau, les Bomba, rôdent, la gueule ouverte,
Autour du genre humain qui, pâle et garrotté,
Lutte pour la justice et pour la vérité ;
Et de Paris à Pesth, du Tibre aux monts Carpathes,
Sur nos débris sanglants rampent ces mille-pattes.
V
Du lourd dictionnaire où Beauzée et Batteux
Ont versé les trésors de leur bon sens goutteux,
Il faut, grâce aux vainqueurs, refaire chaque lettre.
Ame de l’homme, ils ont trouvé moyen de mettre
Sur tes vieilles laideurs un tas de mots nouveaux,
Leurs noms. L’hypocrisie aux yeux bas et dévots
A nom Menjaud, et vend Jésus dans sa chapelle ;
On a débaptisé la honte, elle s’appelle
Sibour ; la trahison, Maupas ; l’assassinat
Sous le nom de Magnan est membre du Sénat ;
Quant à la lâcheté, c’est Hardouin qu’on la nomme ;
Riancey, c’est le mensonge, il arrive de Rome
Et tient la vérité renfermée en son puits ;
La platitude a nom Montlaville-Chapuis ;
La prostitution, ingénue, est princesse ;
La férocité, c’est Carrelet ; la bassesse
Signe Rouher, avec Delangle pour greffier.
Ô muse, inscris ces noms. Veux-tu qualifier
La justice vénale, atroce, abjecte et fausse ?
Commence à Partarieu pour finir par Lafosse.
J’appelle Saint-Arnaud, le meurtre dit : c’est moi.
Et, pour tout compléter par le deuil et l’effroi,
Le vieux calendrier remplace sur sa carte
La Saint-Barthélemy par la Saint-Bonaparte.
Quant au peuple, il admire et vote ; on est suspect
D’en douter, et Paris écoute avec respect
Sibour et ses sermons, Trolong et ses troplongues.
Les deux Napoléon s’unissent en diphthongues,
Et Berger entrelace en un chiffre hardi
Le boulevard Montmartre entre Arcole et Lodi.
Spartacus agonise en un bagne fétide ;
On chasse Thémistocle, on expulse Aristide,
On jette Daniel dans la fosse aux lions ;
Et maintenant ouvrons le ventre aux millions !
a la mere de l enfant mort
Oh ! vous aurez trop dit au pauvre petit ange
Qu’il est d’autres anges là-haut,
Que rien ne souffre au ciel, que jamais rien n’y change,
Qu’il est doux d’y rentrer tôt ;
Que le ciel est un dôme aux merveilleux pilastres,
Une tente aux riches couleurs,
Un jardin bleu rempli de lys qui sont des astres,
Et d’étoiles qui sont des fleurs ;
Que c’est un lieu joyeux plus qu’on ne saurait dire,
Où toujours, se laissant charmer,
On a les chérubins pour jouer et pour rire,
Et le bon Dieu pour nous aimer ;
Qu’il est doux d’être un cœur qui brûle comme un cierge,
Et de vivre, en toute saison,
Près de l’enfant Jésus et de la Sainte Vierge
Dans une si belle maison !
Et puis vous n’aurez pas assez dit, pauvre mère,
A ce fils si frêle et si doux,
Que vous étiez à lui dans cette vie amère,
Mais aussi qu’il était à vous ;
Que, tant qu’on est petit, la mère sur nous veille,
Mais que plus tard on la défend ;
Et qu’elle aura besoin, quand elle sera vieille,
D’un homme qui soit son enfant ;
Vous n’aurez point assez dit à cette jeune âme
Que Dieu veut qu’on reste ici-bas,
La femme guidant l’homme et l’homme aidant la femme,
Pour les douleurs et les combats ;
Si bien qu’un jour, ô deuil ! irréparable perte !
Le doux être s’en est allé !… —-
Hélas ! vous avez donc laissé la cage ouverte,
Que votre oiseau s’est envolé !
souvenir de la nuit du 4
L’enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ;
On voyait un rameau bénit sur un portrait.
Une vieille grand’mère était là qui pleurait.
Nous le déshabillions en silence. Sa bouche,
Pâle, s’ouvrait ; la mort noyait son oeil farouche ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis.
Il avait dans sa poche une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies.
Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ?
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend.
L’aïeule regarda déshabiller l’enfant,
Disant : -Comme il est blanc ! approchez donc la lampe.
Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe !
Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des coups
De fusil dans la rue où l’on en tuait d’autres.
- Il faut ensevelir l’enfant, dirent les nôtres.
Et l’on prit un drap blanc dans l’armoire en noyer.
L’aïeule cependant l’approchait du foyer
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides.
Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides
Ne se réchauffe plus aux foyers d’ici-bas !
Elle pencha la tête et lui tira ses bas,
Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre.
- Est-ce que ce n’est pas une chose qui navre !
Cria-t-elle ; monsieur, il n’avait pas huit ans !
Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents.
Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre,
C’est lui qui l’écrivait. Est-ce qu’on va se mettre
A tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !
On est donc des brigands ! Je vous demande un peu,
Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu’ils m’ont tué ce pauvre petit être
Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus.
Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte
Cela n’aurait rien fait à monsieur Bonaparte
De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! -
Elle s’interrompit, les sanglots l’étouffant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l’aïeule .
- Que vais-je devenir à présent toute seule ?
Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd’hui.
Hélas ! je n’avais plus de sa mère que lui.
Pourquoi l’a-t-on tué ? je veux qu’on me l’explique.
L’enfant n’a pas crié vive la République. -
Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas,
Tremblant devant ce deuil qu’on ne console pas.
Vous ne compreniez point, mère, la politique.
Monsieur Napoléon, c’est son nom authentique,
Est pauvre, et même prince ; il aime les palais ;
Il lui convient d’avoir des chevaux, des valets,
De l’argent pour son jeu, sa table, son alcôve,
Ses chasses ; par la même occasion, il sauve
La famille, l’église et la société ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l’été,
Où viendront l’adorer les préfets et les maires
C’est pour cela qu’il faut que les vieilles grand’mères,
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps
Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.
15 fevrier 1843
Aime celui qui t’aime, et sois heureuse en lui.
— Adieu ! — sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre !
Va, mon enfant béni, d’une famille à l’autre.
Emporte le bonheur et laisse-nous l’ennui !
Ici, l’on te retient ; là-bas, on te désire.
Fille, épouse, ange, enfant, fais ton double devoir.
Donne-nous un regret, donne-leur un espoir,
Sors avec une larme ! entre avec un sourire !
a la fenetre pendant la nuit
Les étoiles, points d’or, percent les branches noires ;
Le flot huileux et lourd décompose ses moires
Sur l’océan blêmi ;
Les nuages ont l’air d’oiseaux prenant la fuite ;
Par moments le vent parle, et dit des mots sans suite,
Comme un homme endormi.
Tout s’en va. La nature est l’urne mal fermée.
La tempête est écume et la flamme est fumée.
Rien n’est hors du moment,
L’homme n’a rien qu’il prenne, et qu’il tienne, et qu’il garde.
Il tombe, heure par heure, et, ruine, il regarde
Le monde, écroulement.
L’astre est-il le point fixe en ce mouvant problème ?
Ce ciel que nous voyons fut-il toujours le même ?
Le sera-t-il toujours ?
L’homme a-t-il sur son front des clartés éternelles ?
Et verra-t-il toujours les mêmes sentinelles
Monter aux mêmes tours ?
II
Nuits, serez-vous pour nous toujours ce que vous êtes ?
Pour toute vision, aurons-nous sur nos têtes
Toujours les mêmes cieux ?
Dis, larve Aldebaran, réponds, spectre Saturne,
Ne verrons-nous jamais sur le masque nocturne
S’ouvrir de nouveaux yeux ?
Ne verrons-nous jamais briller de nouveaux astres ?
Et des cintres nouveaux, et de nouveaux pilastres
Luire à notre œil mortel,
Dans cette cathédrale aux formidables porches
Dont le septentrion éclaire avec sept torches,
L’effrayant maître-autel ?
A-t-il cessé, le vent qui fit naître ces roses,
Sirius, Orion, toi, Vénus, qui reposes
Notre œil dans le péril ?
Ne verrons-nous jamais sous ses grandes haleines
D’autres fleurs de lumière éclore dans les plaines
De l’éternel avril ?
Savons-nous où le monde en est de son mystère ?
Qui nous dit, à nous, joncs du marais, vers de terre
Dont la bave reluit,
À nous qui n’avons pas nous-mêmes notre preuve,
Que Dieu ne va pas mettre une tiare neuve
Sur le front de la nuit ?
III
Dieu n’a-t-il plus de flamme à ses lèvres profondes ?
N’en fait-il plus jaillir des tourbillons de mondes ?
Parlez, Nord et Midi !
N’emplit-il plus de lui sa création sainte ?
Et ne souffle-t-il plus que d’une bouche éteinte
Sur l’être refroidi ?
Quand les comètes vont et viennent, formidables,
Apportant la lueur des gouffres insondables,
À nos fronts soucieux,
Brûlant, volant, peut-être âmes, peut-être mondes,
Savons-nous ce que font toutes ces vagabondes
Qui courent dans nos cieux ?
Qui donc a vu la source et connaît l’origine ?
Qui donc, ayant sondé l’abîme, s’imagine
En être mage et roi ?
Ah ! fantômes humains, courbés sous les désastres !
Qui donc a dit : — C’est bien, Éternel. Assez d’astres.
N’en fais plus. Calme-toi ! —
L’effet séditieux limiterait la cause ?
Quelle bouche ici-bas peut dire à quelque chose :
Tu n’iras pas plus loin ?
Sous l’élargissement sans fin, la borne plie ;
La création vit, croît et se multiplie ;
L’homme n’est qu’un témoin.
L’homme n’est qu’un témoin frémissant d’épouvante.
Les firmaments sont pleins de la sève vivante
Comme les animaux.
L’arbre prodigieux croise, agrandit, transforme,
Et mêle aux cieux profonds, comme une gerbe énorme,
Ses ténébreux rameaux.
Car la création est devant, Dieu derrière.
L’homme, du côté noir de l’obscure barrière,
Vit, rôdeur curieux ;
Il suffit que son front se lève pour qu’il voie
À travers la sinistre et morne claire-voie
Cet œil mystérieux.
IV
Donc ne nous disons pas : — Nous avons nos étoiles. —
Des flottes de soleils peut-être à pleines voiles
Viennent-ils en ce moment ;
Peut-être que demain le Créateur terrible,
Refaisant notre nuit, va contre un autre crible
Changer le firmament.
Qui sait ? que savons-nous ? sur notre horizon sombre,
Que la création impénétrable encombre
De ses taillis sacrés,
Muraille obscure où vient battre le flot de l’être,
Peut-être allons-nous voir brusquement apparaître
Des astres effarés ;
Des astres éperdus arrivant des abîmes,
Venant des profondeurs ou descendant des cimes,
Et, sous nos noirs arceaux,
Entrant en foule, épars, ardents, pareils au rêve,
Comme dans un grand vent s’abat sur une grève
Une troupe d’oiseaux ;
Surgissant, clairs flambeaux, feux purs, rouges fournaises,
Aigrettes de rubis ou tourbillons de braises,
Sur nos bords, sur nos monts,
Et nous pétrifiant de leurs aspects étranges,
Car dans le gouffre énorme il est des mondes anges
Et des soleils démons !
Peut-être en ce moment, du fond des nuits funèbres,
Montant vers nous, gonflant ses vagues de ténèbres
Et ses flots de rayons,
Le muet Infini, sombre mer ignorée,
Roule vers notre ciel une grande marée
De constellations !
querelle du serail
Ciel ! après tes splendeurs, qui rayonnaient naguères,
Liberté sainte ; après toutes ces grandes guerres,
Tourbillon inouï ;
Après ce Marengo qui brille sur la carte,
Et qui ferait lâcher le premier Bonaparte
A Tacite ébloui ;
Après ces messidors, ces prairials, ces frimaires,
Et tant de préjugés, d’hydres et de chimères,
Terrassés à jamais ;
Après le sceptre en cendre et la Bastille en poudre,
Le trône en flamme ; après tous ces grands coups de foudre
Sur tous ces grands sommets :
Après tous ces géants, après tous ces colosses,
S’acharnant malgré Dieu, comme d’ardents molosses,
Quand Dieu disait : va-t’en !
Après ton océan, République française,
Où nos pères ont vu passer Quatrevingt-treize
Comme Léviathan ;
Après Danton, Saint-Just et Mirabeau, ces hommes,
Ces titans, aujourd’hui cette France où nous sommes
Contemple l’embryon,
L’infiniment petit, monstrueux et féroce,
Et, dans la goutte d’eau, les guerres du volvoce
Contre le vibrion !
Honte ! France, aujourd’hui, voici ta grande affaire :
Savoir si c’est Maupas ou Morny qu’on préfère,
Là-haut, dans le palais ;
Tous deux ont sauvé l’ordre et sauvé les familles ;
Lequel l’emportera ? l’un a pour lui les filles,
Et l’autre, les valets.
pauline roland
Elle ne connaissait ni l’orgueil ni la haine ;
Elle aimait ; elle était pauvre, simple et sereine ;
Souvent le pain qui manque abrégeait son repas.
Elle avait trois enfants, ce qui n’empêchait pas
Qu’elle ne se sentît mère de ceux qui souffrent.
Les noirs évènements qui dans la nuit s’engouffrent,
Les flux et les reflux, les abîmes béants,
Les nains, sapant sans bruit l’ouvrage des géants,
Et tous nos malfaiteurs inconnus ou célèbres,
Ne l’épouvantaient point ; derrière ces ténèbres,
Elle apercevait Dieu construisant l’avenir.
Elle sentait sa foi sans cesse rajeunir
De la liberté sainte elle attisait les flammes
Elle s’inquiétait des enfants et des femmes ;
Elle disait, tendant la main aux travailleurs :
La vie est dure ici, mais sera bonne ailleurs.
Avançons ! – Elle allait, portant de l’un à l’autre
L’espérance ; c’était une espèce d’apôtre
Que Dieu, sur cette terre où nous gémissons tous,
Avait fait mère et femme afin qu’il fût plus doux ;
L’esprit le plus farouche aimait sa voix sincère.
Tendre, elle visitait, sous leur toit de misère,
Tous ceux que la famine ou la douleur abat,
Les malades pensifs, gisant sur leur grabat,
La mansarde où languit l’indigence morose ;
Quand, par hasard moins pauvre, elle avait quelque chose,
Elle le partageait à tous comme une soeur ;
Quand elle n’avait rien, elle donnait son coeur.
Calme et grande, elle aimait comme le soleil brille.
Le genre humain pour elle était une famille
Comme ses trois enfants étaient l’humanité.
Elle criait : progrès ! amour ! fraternité !
Elle ouvrait aux souffrants des horizons sublimes.
Quand Pauline Roland eut commis tous ces crimes,
Le sauveur de l’église et de l’ordre la prit
Et la mit en prison. Tranquille, elle sourit,
Car l’éponge de fiel plaît à ces lèvres pures.
Cinq mois, elle subit le contact des souillures,
L’oubli, le rire affreux du vice, les bourreaux,
Et le pain noir qu’on jette à travers les barreaux,
Edifiant la geôle au mal habituée,
Enseignant la voleuse et la prostituée.
Ces cinq mois écoulés, un soldat, un bandit,
Dont le nom souillerait ces vers, vint et lui dit
- Soumettez-vous sur l’heure au règne qui commence,
Reniez votre foi ; sinon, pas de clémence,
Lambessa ! choisissez. – Elle dit : Lambessa.
Le lendemain la grille en frémissant grinça,
Et l’on vit arriver un fourgon cellulaire.
- Ah ! voici Lambessa, dit-elle sans colère.
Elles étaient plusieurs qui souffraient pour le droit
Dans la même prison. Le fourgon trop étroit
Ne put les recevoir dans ses cloisons infâmes
Et l’on fit traverser tout Paris à ces femmes
Bras dessus bras dessous avec les argousins.
Ainsi que des voleurs et que des assassins,
Les sbires les frappaient de paroles bourrues.
S’il arrivait parfois que les passants des rues,
Surpris de voir mener ces femmes en troupeau,
S’approchaient et mettaient la main à leur chapeau,
L’argousin leur jetait des sourires obliques,
Et les passants fuyaient, disant : filles publiques !
Et Pauline Roland disait : courage, soeurs !
L’océan au bruit rauque, aux sombres épaisseurs,
Les emporta. Durant la rude traversée,
L’horizon était noir, la bise était glacée,
Sans l’ami qui soutient, sans la voix qui répond,
Elles tremblaient. La nuit, il pleuvait sur le pont
Pas de lit pour dormir, pas d’abri sous l’orage,
Et Pauline Roland criait : mes soeurs, courage !
Et les durs matelots pleuraient en les voyant.
On atteignit l’Afrique au rivage effrayant,
Les sables, les déserts qu’un ciel d’airain calcine,
Les rocs sans une source et sans une racine ;
L’Afrique, lieu d’horreur pour les plus résolus,
Terre au visage étrange où l’on ne se sent plus
Regardé par les yeux de la douce patrie.
Et Pauline Roland, souriante et meurtrie,
Dit aux femmes en pleurs : courage, c’est ici.
Et quand elle était seule, elle pleurait aussi.
Ses trois enfants ! loin d’elle ! Oh ! quelle angoisse amère !
Un jour, un des geôliers dit à la pauvre mère
Dans la casbah de Bône aux cachots étouffants :
Voulez-vous être libre et revoir vos enfants ?
Demandez grâce au prince. – Et cette femme forte
Dit : – J’irai les revoir lorsque je serai morte.
Alors sur la martyre, humble coeur indompté,
On épuisa la haine et la férocité.
Bagnes d’Afrique ! enfers qu’a sondés Ribeyrolles !
Oh ! la pitié sanglote et manque de paroles.
Une femme, une mère, un esprit ! ce fut là
Que malade, accablée et seule, on l’exila.
Le lit de camp, le froid et le chaud, la famine,
Le jour l’affreux soleil et la nuit la vermine,
Les verrous, le travail sans repos, les affronts,
Rien ne plia son âme ; elle disait : – Souffrons.
Souffrons comme Jésus, souffrons comme Socrate. -
Captive, on la traîna sur cette terre ingrate ;
Et, lasse, et quoiqu’un ciel torride l’écrasât,
On la faisait marcher à pied comme un forçat.
La fièvre la rongeait ; sombre, pâle, amaigrie,
Le soir elle tombait sur la paille pourrie,
Et de la France aux fers murmurait le doux nom.
On jeta cette femme au fond d’un cabanon.
Le mal brisait sa vie et grandissait son âme.
Grave, elle répétait : « Il est bon qu’une femme,
Dans cette servitude et cette lâcheté,
Meure pour la justice et pour la liberté. »
Voyant qu’elle râlait, sachant qu’ils rendront compte,
Les bourreaux eurent peur, ne pouvant avoir honte
Et l’homme de décembre abrégea son exil.
« Puisque c’est pour mourir, qu’elle rentre ! » dit-il.
Elle ne savait plus ce que l’on faisait d’elle.
L’agonie à Lyon la saisit. Sa prunelle,
Comme la nuit se fait quand baisse le flambeau,
Devint obscure et vague, et l’ombre du tombeau
Se leva lentement sur son visage blême.
Son fils, pour recueillir à cette heure suprême
Du moins son dernier souffle et son dernier regard,
Accourut. Pauvre mère ! Il arriva trop tard.
Elle était morte ; morte à force de souffrance,
Morte sans avoir su qu’elle voyait la France
Et le doux ciel natal aux rayons réchauffants
Morte dans le délire en criant : mes enfants !
On n’a pas même osé pleurer à ses obsèques ;
Elle dort sous la terre. – Et maintenant, évêques,
Debout, la mitre au front, dans l’ombre du saint lieu,
Crachez vos Te Deum à la face de Dieu !
o