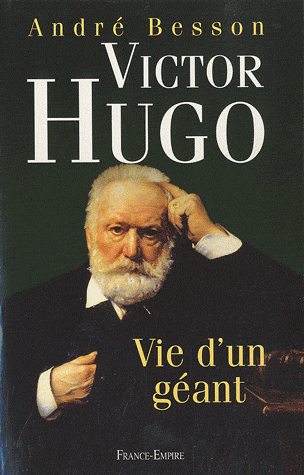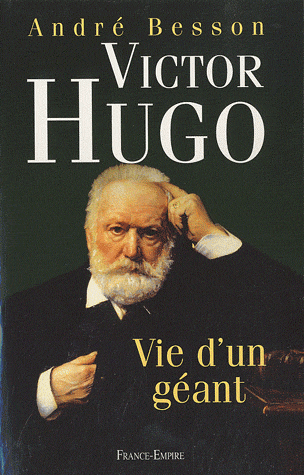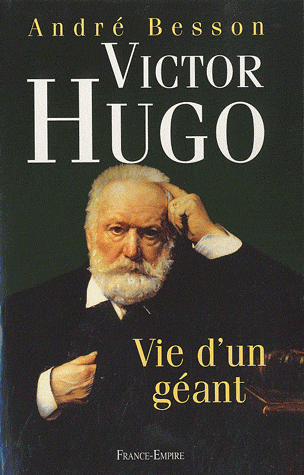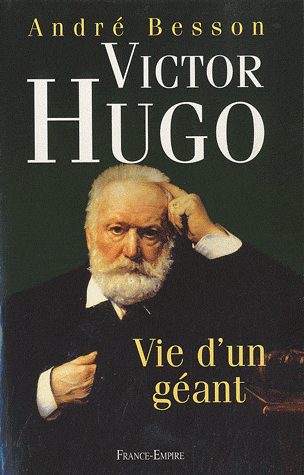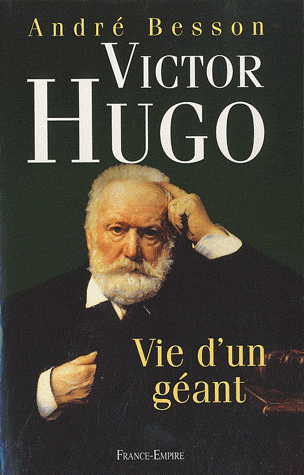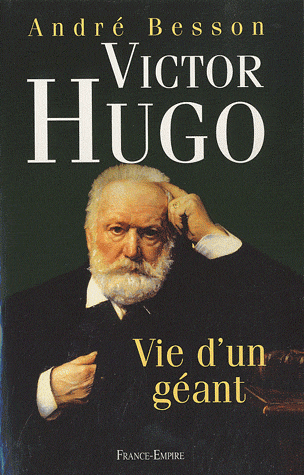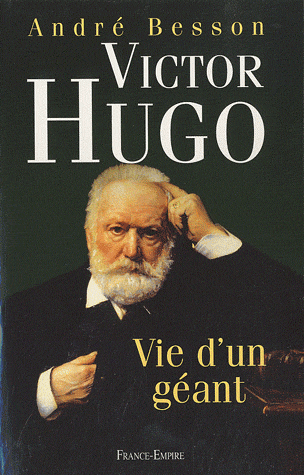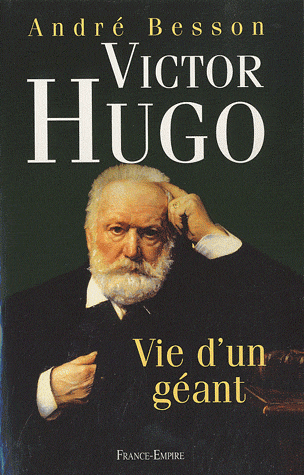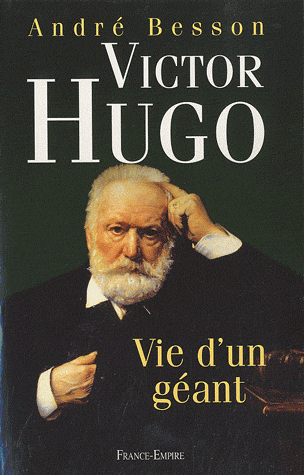afrique alphabet ange automne avatars chat animé banniere bannières barre belle belle image bleu blinkie
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· BELLE IMAGE CREATION DIVERS BIS (6781)
· CADRE (2357)
· VISAGE DE FEMME (1531)
· Femme (1324)
· Stars (1120)
· Tube cookie (1037)
· FOND D ECRAN DRAGON (575)
· Gif scintillant (556)
· FOND D ECRAN ANGE (418)
· Gif animaux animés (1052)
- · victor hugo poeme a.m.froment-meurice
- · une terre au flanc maigre victor hugo analyse
- · une terre au flanc maigre analyse
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
· tube parchemin
· oiseau gif anime
· belle image
· oiseau gif anime
· generateur de texte defilant
· gif chien
· fond d ecran
· fond d ecran
· BELLE IMAGE
· LES PREMIERS ORDINATEURS
· gif chat
· Coloriage blanche neige
· FOND D'ECRAN CHOPPER ET HARLEY
· cadeau de http://mamiebabou.centerblog.net/ merci
· FOND D ECRAN CHATS
Statistiques
Date de création : 09.08.2009
Dernière mise à jour :
31.01.2016
113496 articles
POEME VICTOR HUGO
les femmes sont sur terre
Les femmes sont sur la terre
Pour tout idéaliser;
L’univers est un mystère
Que commente leur baiser.
C’est l’amour qui, pour ceinture,
A l’onde et le firmament,
Et dont toute la nature,
N’est, au fond, que l’ornement.
Tout ce qui brille, offre à l’âme
Son parfum ou sa couleur;
Si Dieu n’avait fait la femme,
Il n’aurait pas fait la fleur.
A quoi bon vos étincelles,
Bleus saphirs, sans les yeux doux?
Les diamants, sans les belles,
Ne sont plus que des cailloux;
Et, dans les charmilles vertes,
Les roses dorment debout,
Et sont des bouches ouvertes
Pour ne rien dire du tout.
Tout objet qui charme ou rêve
Tient des femmes sa clarté;
La perle blanche, sans Ève,
Sans toi, ma fière beauté,
Ressemblant, tout enlaidie,
A mon amour qui te fuit,
N’est plus que la maladie
D’une bête dans la nuit.
mes bras pressait ta taille frele
Mon bras pressait ta taille frêle
Et souple comme le roseau;
Ton sein palpitait comme l’aile
D’un jeune oiseau.
Longtemps muets, nous contemplâmes
Le ciel où s’éteignait le jour.
Que se passait-il dans nos âmes?
Amour! amour!
Comme un ange qui se dévoile,
Tu me regardais, dans ma nuit,
Avec ton beau regard d’étoile,
Qui m’éblouit.
les oiseaux
Je rêvais dans un grand cimetière désert;
De mon âme et des morts j’écoutais le concert,
Parmi les fleurs de l’herbe et les croix de la tombe.
Dieu veut que ce qui naît sorte de ce qui tombe.
Et l’ombre m’emplissait.
Autour de moi, nombreux,
Gais, sans avoir souci de mon front ténébreux,
Dans ce champ, lit fatal de la sieste dernière,
Des moineaux francs faisaient l’école buissonnière.
C’était l’éternité que taquine l’instant.
Ils allaient et venaient, chantant, volant, sautant,
Égratignant la mort de leurs griffes pointues,
Lissant leur bec au nez lugubre des statues,
Becquetant les tombeaux, ces grains mystérieux.
Je pris ces tapageurs ailés au sérieux;
Je criai: — Paix aux morts! vous êtes des harpies.
— Nous sommes des moineaux, me dirent ces impies.
— Silence! allez-vous en! repris-je, peu clément.
Ils s’enfuirent; j’étais le plus fort. Seulement,
Un d’eux resta derrière, et, pour toute musique,
Dressa la queue, et dit: — Quel est ce vieux classique
Comme ils s’en allaient tous, furieux, maugréant,
Criant, et regardant de travers le géant,
Un houx noir qui songeait près d’une tombe, un sage,
M’arrêta brusquement par la manche au passage,
Et me dit: — Ces oiseaux sont dans leur fonction.
Laisse-les. Nous avons besoin de ce rayon.
Dieu les envoie. Ils font vivre le cimetière.
Homme, ils sont la gaîté de la nature entière;
Ils prennent son murmure au ruisseau, sa clarté
A l’astre, son sourire au matin enchanté;
Partout où rit un sage, ils lui prennent sa joie,
Et nous l’apportent; l’ombre en les voyant flamboie;
Ils emplissent leurs becs des cris des écoliers;
A travers l’homme et l’herbe, et l’onde, et les halliers,
Ils vont pillant la joie en l’univers immense.
Ils ont cette raison qui te semble démence.
Ils ont pitié de nous qui loin d’eux languissons;
Et, lorsqu’ils sont bien pleins de jeux et de chansons;
D’églogues, de baisers, de tous les commérages
Que les nids en avril font sous les verts ombrages,
Ils accourent, joyeux, charmants, légers, bruyants,
Nous jeter tout cela dans nos trous effrayants;
Et viennent, des palais, des bois, de la chaumière,
Vider dans notre nuit toute cette lumière!
Quand mai nous les ramène, ô songeur, nous disons:
— Les voilà!- tout s’émeut, pierres, tertres, gazons;
Le moindre arbrisseau parle, et l’herbe est en extase;
Le saule pleureur chante en achevant sa phrase;
Ils confessent les ifs, devenus babillards;
Ils jasent de la vie avec les corbillards;
Des linceuls trop pompeux ils décrochent l’agrafe;
Ils se moquent du marbre; ils savent l’orthographe;
Et, moi qui suis ici le vieux chardon boudeur,
Devant qui le mensonge étale sa laideur,
Et ne se gène pas, me traitant comme un hôte,
Je trouve juste, ami, qu’en lisant à voix haute
L’épitaphe où le mort est toujours bon et beau,
Ils fassent éclater de rire le tombeau.
premier mai
Tout conjugue le verbe aimer. Voici les roses.
Je ne suis pas en train de parler d’autres choses ;
Premier mai ! l’amour gai, triste, brûlant, jaloux,
Fait soupirer les bois, les nids, les fleurs, les loups ;
L’arbre où j’ai, l’autre automne, écrit une devise,
La redit pour son compte et croit qu’il l’improvise ;
Les vieux antres pensifs, dont rit le geai moqueur,
Clignent leurs gros sourcils et font la bouche en cœur ;
L’atmosphère, embaumée et tendre, semble pleine
Des déclarations qu’au Printemps fait la plaine,
Et que l’herbe amoureuse adresse au ciel charmant.
À chaque pas du jour dans le bleu firmament,
La campagne éperdue, et toujours plus éprise,
Prodigue les senteurs, et dans la tiède brise
Envoie au renouveau ses baisers odorants.
Tous ces bouquets, azurs, carmins, pourpres, safrans,
Dont l’haleine s’envole en murmurant : Je t’aime !
Sur le ravin, l’étang, le pré, le sillon même,
font des taches partout de toutes les couleurs ;
Et, donnant les parfums, elle a gardé les fleurs ;
Comme si ses soupirs et ses tendres missives
Au mois de mai, qui rit dans les branches lascives,
Et tous les billets doux de son amour bavard,
Avaient laissé leur trace aux pages du buvard!
Les oiseaux dans les bois, molles voix étouffées,
Chantent des triolets et des rondeaux aux fées;
Tout semble confier à l’ombre un doux secret;
Tout aime, et tout l’avoue à voix basse; on dirait
Qu’au nord, au sud brûlant, au couchant, à l’aurore,
La haie en fleur, le lierre et la source sonore,
Les monts, les champs, les lacs et les chênes mouvants
Répètent un quatrain fait par les quatre vents.
magnitudo parvi
Le jour mourait ; j’étais près des mers, sur la grève.
Je tenais par la main ma fille, enfant qui rêve,
Jeune esprit qui se tait !
La terre, s’inclinant comme un vaisseau qui sombre,
En tournant dans l’espace allait plongeant dans l’ombre ;
La pâle nuit montait.
La pâle nuit levait son front dans les nuées ;
Les choses s’effaçaient, blêmes, diminuées,
Sans forme et sans couleur ;
Quand il monte de l’ombre, il tombe de la cendre ;
On sentait à la fois la tristesse descendre
Et monter la douleur.
Ceux dont les yeux pensifs contemplent la nature
Voyaient l’urne d’en haut, vague rondeur obscure,
Se pencher dans les cieux,
Et verser sur les monts, sur les campagnes blondes,
Et sur les flots confus pleins de rumeurs profondes,
Le soir silencieux !
Les nuages rampaient le long des promontoires ;
Mon âme, où se mêlaient ces ombres et ces gloires,
Sentait confusément
De tout cet océan, de toute cette terre,
Sortir sous l’oeil de Dieu je ne sais quoi d’austère,
D’auguste et de charmant !
J’avais à mes côtés ma fille bien-aimée.
La nuit se répandait ainsi qu’une fumée.
Rêveur, ô Jéhovah,
Je regardais en moi, les paupières baissées,
Cette ombre qui se fait aussi dans nos pensées
Quand ton soleil s’en va !
Soudain l’enfant bénie, ange au regard de femme,
Dont je tenais la main et qui tenait mon âme,
Me parla, douce voix !
Et, me montrant l’eau sombre et la rive âpre et brune,
Et deux points lumineux qui tremblaient sur la dune :
— Père, dit-elle, vois !
Vois donc, là-bas, où l’ombre aux flancs des coteaux rampe,
Ces feux jumeaux briller comme une double lampe
Qui remuerait au vent !
Quels sont ces deux foyers qu’au loin la brume voile ?
— L’un est un feu de pâtre et l’autre est une étoile ;
Deux mondes, mon enfant !
II
*
Deux mondes ! — l’un est dans l’espace,
Dans les ténèbres de l’azur,
Dans l’étendue où tout s’efface.
Radieux gouffre ! abîme obscur !
Enfant, comme deux hirondelles,
Oh, si tous deux, âmes fidèles,
Nous pouvions fuir à tire-d’ailes,
Et plonger dans cette épaisseur
D’où la création découle,
Où flotte, vit, meurt, brille et roule
L’astre imperceptible à la foule,
Incommensurable au penseur ;
Si nous pouvions franchir ces solitudes mornes ;
Si nous pouvions passer les bleus septentrions,
Si nous pouvions atteindre au fond des cieux sans bornes
Jusqu’à ce qu’à la fin, éperdus, nous voyions,
Comme un navire en mer croît, monte et semble éclore,
Cette petite étoile, atome de phosphore,
Devenir par degrés un monstre de rayons ;
S’il nous était donné de faire
Ce voyage démesuré,
Et de voler, de sphère en sphère,
A ce grand soleil ignoré ;
Si, par un archange qui l’aime,
L’homme aveugle, frémissant, blême,
Dans les profondeurs du problème,
Vivant, pouvait être introduit ;
Si nous pouvions fuir notre centre,
Et, forçant l’ombre où Dieu seul entre,
Aller voir de près dans leur antre
Ces énormités de la nuit ;
Ce qui t’apparaîtrait te ferait trembler, ange !
Rien, pas de vision, pas de songe insensé,
Qui ne fût dépassé par ce spectacle étrange,
Monde informe, et d’un tel mystère composé,
Que son rayon fondrait nos chairs, cire vivante,
Et qu’il ne resterait de nous dans l’épouvante
Qu’un regard ébloui sous un front hérissé !
*
O contemplation splendide !
Oh ! de pôles, d’axes, de feux ;
De la matière et du fluide,
Balancement prodigieux !
D’aimant qui lutte, d’air qui vibre,
De force esclave et d’éther libre,
Vaste et magnifique équilibre !
Monde rêve ! idéal réel !
Lueurs ! tonnerres ! jets de souffre !
Mystère qui chante et qui souffre !
Formule nouvelle du gouffre !
Mot nouveau du noir livre ciel !
Tu verrais ! — un soleil, autour de lui des mondes,
Centres eux-mêmes, ayant des lunes autour d’eux ;
Là, des fourmillements de sphères vagabondes ;
Là, des globes jumeaux qui tournent deux à deux ;
Au milieu, cette étoile, effrayante, agrandie ;
D’un coin de l’infini formidable incendie,
Rayonnement sublime ou flamboiement hideux !
Regardons, puisque nous y sommes !
Figure-toi ! figure-toi !
Plus rien des choses que tu nommes !
Un autre monde ! une autre loi !
La terre a fui dans l’étendue ;
Derrière nous elle est perdue !
Jour nouveau ! nuit inattendue !
D’autres groupes d’astres au ciel !
Une nature qu’on ignore,
Qui, s’ils voyaient sa fauve aurore,
Ferait accourir Pythagore
Et reculer Ézéchiel !
Ce qu’on prend pour un mont est une hydre ; ces arbres
Sont des bêtes ; ces rocs hurlent avec fureur ;
Le feu chante ; le sang coule aux veines des marbres.
Ce monde est-il le vrai ? le nôtre est-il l’erreur ?
O possibles qui sont pour nous impossibles !
Réverbérations des chimères invisibles !
Le baiser de la vie ici nous fait horreur.
Et, si nous pouvions voir les hommes
Les ébauches, les embryons,
Qui sont là ce qu’ailleurs nous sommes,
Comme, eux et nous, nous frémirions
Rencontre inexprimable et sombre !
Nous nous regarderions dans l’ombre
De monstre à monstre, fils du nombre
Et du temps qui s’évanouit ;
Et, si nos langages funèbres
Pouvaient échanger leurs algèbres,
Nous dirions : —Qu’êtes-vous, ténèbres ? -
Ils diraient : —D’où venez-vous, nuit ? -
*
Sont-ils aussi des cœurs, des cerveaux, des entrailles ?
Cherchent-ils comme nous le mot jamais trouvé ?
Ont-ils des Spinosa qui frappent aux murailles,
Des Lucrèce niant tout ce qu’on a rêvé,
Qui, du noir infini feuilletant les registres,
Ont écrit : Rien, au bas de ces pages sinistres ;
Et, penchés sur l’abîme, ont dit : —L’oeil est crevé ! -
Tous ces êtres, comme nous-même,
S’en vont en pâles tourbillons ;
La création mêle et sème
Leur cendre a de nouveaux sillons ;
Un vient, un autre le remplace,
Et passe sans laisser de trace ;
Le souffle les crée et les chasse ;
Le gouffre en proie aux quatre vents,
Comme la mer aux vastes lames,
Mêle éternellement ses flammes
A ce sombre écroulement d’âmes,
De fantômes et de vivants !
L’abîme semble fou sous l’ouragan de l’être.
Quelle tempête autour de l’astre radieux !
Tout ne doit que surgir, flotter et disparaître,
Jusqu’à ce que la nuit ferme à son tour ses yeux ;
Car, un jour, il faudra que l’étoile aussi tombe,
L’étoile voit neiger les âmes dans la tombe,
L’âme verra neiger les astres dans les cieux !
*
Par instant, dans le vague espace,
Regarde, enfant ! tu vas la voir !
Une brusque planète passe ;
C’est d’abord au loin un point noir ;
Plus prompte que la trombe folle,
Elle vient, court, approche, vole ;
A peine a lui son auréole,
Que déjà, remplissant le ciel,
Sa rondeur farouche commence
A cacher le gouffre en démence,
Et semble ton couvercle immense,
O puits du vertige éternel !
C’est elle ! éclair ! voilà sa livide surface
Avec tous les frissons de ses océans verts !
Elle apparaît, s’en va, décroît, pâlit, s’efface,
Et rentre, atome obscur, aux cieux sombres couverts,
Et tout s’évanouit, vaste aspect, bruit sublime… —
Quel est ce projectile inouï de l’abîme ?
O boulets monstrueux qui sont des univers !
Dans un éloignement nocturne,
Roule avec un râle effrayant
Quelque épouvantable Saturne
Tournant son anneau flamboyant ;
La braise en pleut comme d’un crible ;
Jean de Patmos, l’esprit terrible,
Vit en songe cet astre horrible
Et tomba presque évanoui ;
Car, rêvant sa noire épopée,
Il crut, d’éclairs enveloppée,
Voir fuir une roue, échappée
Au sombre char d’Adonaï !
Et, par instants encor, — tout va-t-il se dissoudre ? —
Parmi ces mondes, fauve, accourant à grand bruit,
Une comète aux crins de flamme, aux yeux de foudre,
Surgit, et les regarde, et, blême, approche et luit ;
Puis s’évade en hurlant, pâle et surnaturelle,
Traînant sa chevelure éparse derrière elle,
Comme une Canidie affreuse qui s’enfuit.
Quelques-uns de ces globes meurent ;
Dans le semoun et le mistral
Leurs mers sanglotent, leurs flots pleurent ;
Leur flanc crache un brasier central.
Sphères par la neige engourdies,
Ils ont d’étranges maladies,
Pestes, déluges, incendies,
Tremblements profonds et fréquents ;
Leur propre abîme les consume ;
Leur haleine flamboie et fume ;
On entend de loin dans leur brume
La toux lugubre des volcans.
*
Ils sont ! ils vont ! ceux-ci brillants, ceux-là difformes,
Tous portant des vivants et des créations !
Ils jettent dans l’azur des cônes d’ombre énormes,
Ténèbres qui des cieux traversent les rayons,
Où le regard, ainsi que des flambeaux farouches
L’un après l’autre éteints par d’invisibles bouches,
Voit plonger tour à tour les constellations !
Quel Zorobabel formidable,
Quel Dédale vertigineux,
Cieux ! a bâti dans l’insondable
Tout ce noir chaos lumineux ?
Soleils, astres aux larges queues,
Gouffres ! ô millions de lieues !
Sombres architectures bleues !
Quel bras a fait, créé, produit
Ces tours d’or que nuls yeux ne comptent,
Ces firmaments qui se confrontent,
Ces Babels d’étoiles qui montent
Dans ces Babylones de nuit ?
Qui, dans l’ombre vivante et l’aube sépulcrale,
Qui, dans l’horreur fatale et dans l’amour profond,
A tordu ta splendide et sinistre spirale,
Ciel, où les univers se font et se défont ?
Un double précipice à la fois les réclame.
-Immensité ! — dit l’être. —Éternité ! — dit l’âme.
A jamais ! le sans fin roule dans le sans fond.
*
L’inconnu, celui dont maint sage
Dans la brume obscure a douté,
L’immobile et muet visage,
Le voile de l’éternité,
A, pour montrer son ombre au crime,
Sa flamme au juste magnanime,
Jeté pêle-mêle à l’abîme
Tous ses masques, noirs ou vermeils ;
Dans les éthers inaccessibles,
Ils flottent, cachés ou visibles ;
Et ce sont ces masques terribles
Que nous appelons les soleils !
Et les peuples ont vu passer dans les ténèbres
Ces spectres de la nuit que nul ne pénétra ;
Et flamines, santons, brahmanes, mages, guèbres,
Ont crié : Jupiter ! Allah ! Vishnou ! Mithra !
Un jour, dans les lieux bas, sur les hauteurs suprêmes,
Tous ces masques hagards s’effaceront d’eux-mêmes ;
Alors, la face immense et calme apparaîtra !
III
*
Enfant ! l’autre de ces deux mondes,
C’est le cœur d’un homme ! — parfois,
Comme une perle au fond des ondes,
Dieu cache une âme au fond des bois.
Dieu cache un homme sous les chênes ;
Et le sacre en d’austères lieux
Avec le silence des plaines,
L’ombre des monts, l’azur des cieux !
O ma fille, avec son mystère
Le noir envahit pas à pas
L’esprit d’un prêtre involontaire,
Près de ce feu qui luit là-bas !
Cet homme, dans quelque ruine,
Avec la ronce et le lézard,
Vit sous la brume et la bruine,
Fruit tombé de l’arbre hasard !
Il est devenu presque fauve ;
Son bâton est son seul appui.
En le voyant, l’homme se sauve ;
La bête seule vient à lui.
Il est l’être crépusculaire.
On a peur de l’apercevoir ;
Pâtre tant que le jour l’éclaire,
Fantôme dès que vient le soir.
La faneuse dans la clairière
Le voit quand il fait, par moment,
Comme une ombre hors de sa bière,
Un pas hors de l’isolement.
Son vêtement dans ces décombres,
C’est un sac de cendre et de deuil,
Linceul troué par les clous sombres
De la misère, ce cercueil.
Le pommier lui jette ses pommes ;
Il vit dans l’ombre ensevelit ;
C’est un pauvre homme loin des hommes,
C’est un habitant de l’oubli ;
C’est un indigent sous la bure,
Un vieux front de la pauvreté,
Un haillon dans une masure,
Un esprit dans l’immensité !
*
Dans la nature transparente,
C’est l’oeil des regards ingénus,
Un penseur à l’âme ignorante,
Un grave marcheur aux pieds nus !
Oui, c’est un cœur, une prunelle,
C’est un souffrant, c’est un songeur,
Sur qui la lueur éternelle
Fait trembler sa vague rougeur.
Il est là, l’âme aux cieux ravie,
Et près d’un branchage enflammé,
Pense, lui-même par la vie
Tison à demi consumé.
Il est calme en cette ombre épaisse ;
Il aura bien toujours un peu
D’herbe pour que son bétail paisse,
De bois pour attiser son feu.
Nos luttes, nos chocs, nos désastres,
Il les ignore ; il ne veut rien
Que, la nuit, le regard des astres,
Le jour, le regard de son chien.
Son troupeau gît sur l’herbe unie ;
Il est là, lui, pasteur, ami,
Seul éveillé, comme un génie
A côté d’un peuple endormi.
Ses brebis, d’un rien remuées,
Ouvrant l’oeil près du feu qui luit,
Aperçoivent sous les nuées
Sa forme droite dans la nuit ;
Et, bouc qui bêle, agneau qui danse,
Dorment dans les bois hasardeux
Sous ce grand spectre Providence
Qu’ils sentent debout auprès d’eux.
*
Le pâtre songe, solitaire
Pauvre et nu, mangeant son pain bis ;
Il ne connaît rien de la terre
Que ce que broute la brebis.
Pourtant, il sait que l’homme souffre ;
Mais il sonde l’éther profond.
Toute solitude est un gouffre,
Toute solitude est un mont.
Dès qu’il est debout sur ce faîte,
Le ciel reprend cet étranger ;
La Judée avait le prophète,
La Chaldée avait le berger.
Ils tâtaient le ciel l’un de l’autre ;
Et, plus tard, sous le feu divin,
Du prophète naquit l’apôtre,
Du pâtre naquit le devin.
La foule raillait leur démence ;
Et l’homme dut, aux jours passés,
A ces ignorants la science,
La sagesse à ces insensés.
La nuit voyait, témoin austère,
Se rencontrer sur les hauteurs,
Face à face dans le mystère,
Les prophètes et les pasteurs.
— Où marchez-vous, tremblants prophètes ?
— Où courez-vous, pâtres troublés ?
Ainsi parlaient ces sombres têtes,
Et l’ombre leur criait : Allez !
Aujourd’hui, l’on ne sait plus même
Qui monta le plus de degrés
Des Zoroastres au front blême
Ou des Abrahams effarés.
Et, quand nos yeux, qui les admirent,
Veulent mesurer leur chemin,
Et savoir quels sont ceux qui mirent
Le plus de jour dans l’oeil humain,
Du noir passé perçant les voiles,
Notre esprit flotte sans repos
Entre tous ces compteurs d’étoiles
Et tous ces compteurs de troupeaux.
*
Dans nos temps, où l’aube enfin dore
Les bords du terrestre ravin,
Le rêve humain s’approche encore
Plus près de l’idéal divin.
L’homme que la brume enveloppe,
Dans le ciel que Jésus ouvrit,
Comme à travers un télescope
Regarde à travers son esprit.
L’âme humaine, après le Calvaire,
A plus d’ampleur et de rayon ;
Le grossissement de ce verre
Grandit encor la vision.
La solitude vénérable
Même aujourd’hui l’homme sacré
Plus avant dans l’impénétrable,
Ecrire un commentaire
J'aime
le rouet d omphale
Il est dans l’atrium, le beau rouet d’ivoire.
La roue agile est blanche, et la quenouille est noire;
La quenouille est d’ébène incrusté de lapis.
Il est dans l’atrium sur un riche tapis.
Un ouvrier d’Égine a sculpté sur la plinthe
Europe, dont un dieu n’écoute pas la plainte.
Le taureau blanc l’emporte. Europe, sans espoir,
Crie, et baissant les yeux, s’épouvante de voir
L’Océan monstrueux qui baise ses pieds roses.
Des aiguilles, du fil, des boîtes demi-closes,
Les laines de Milet, peintes de pourpre et d’or,
Emplissent un panier près du rouet qui dort.
Cependant, odieux, effroyables, énormes,
Dans le fond du palais, vingt fantômes difformes,
Vingt monstres tout sanglants, qu’on ne voit qu’à demi,
Errent en foule autour du rouet endormi:
Le lion néméen, l’hydre affreuse de Lerne,
Cacus, le noir brigand de la noire caverne,
Le triple Géryon, et les typhons des eaux,
Qui, le soir, à grand bruit, soufflent dans les roseaux;
De la massue au front tous ont l’empreinte horrible;
Et tous, sans approcher, rôdant d’un air terrible,
Sur le rouet, où pend un fil souple et lié,
Fixent de loin, dans l’ombre, un oeil humilié.
o souvenirs printemps aurore
Ô souvenirs ! printemps ! aurore !
Doux rayon triste et réchauffant !
- Lorsqu’elle était petite encore,
Que sa soeur était tout enfant… -
Connaissez-vous sur la colline
Qui joint Montlignon à Saint-Leu,
Une terrasse qui s’incline
Entre un bois sombre et le ciel bleu ?
C’est là que nous vivions. – Pénètre,
Mon coeur, dans ce passé charmant ! -
Je l’entendais sous ma fenêtre
Jouer le matin doucement.
Elle courait dans la rosée,
Sans bruit, de peur de m’éveiller ;
Moi, je n’ouvrais pas ma croisée,
De peur de la faire envoler.
Ses frères riaient… – Aube pure !
Tout chantait sous ces frais berceaux,
Ma famille avec la nature
Mes enfants avec les oiseaux ! -
Je toussais, on devenait brave ;
Elle montait à petits pas,
Et me disait d’un air très-grave :
- J’ai laissé les enfants en bas.
Qu’elle fût bien ou mal coiffée,
Que mon coeur fût triste ou joyeux,
Je l’admirais. C’était ma fée,
Et le doux astre de mes yeux !
Nous jouions toute la journée.
Ô jeux charmants ! chers entretiens !
Le soir, comme elle était l’aînée,
Elle me disait : – Père, viens !
- Nous allons t’apporter ta chaise,
- Conte-nous une histoire, dis ! -
Et je voyais rayonner d’aise
Tous ces regards du paradis.
Alors, prodiguant les carnages,
J’inventais un conte profond
Dont je trouvais les personnages
Parmi les ombres du plafond.
Toujours, ces quatre douces têtes
Riaient, comme à cet âge on rit,
De voir d’affreux géants très-bêtes
Vaincus par des nains pleins d’esprit.
J’étais l’Arioste et l’Homère
D’un poëme éclos d’un seul jet ;
Pendant que je parlais, leur mère
Les regardait rire, et songeait.
Leur aïeul, qui lisait dans l’ombre,
Sur eux parfois levait les yeux,
Et, moi, par la fenêtre sombre
J’entrevoyais un coin des cieux !
le poete sen va dans les champs
Le poète s’en va dans les champs ; il admire,
Il adore ; il écoute en lui-même une lyre ;
Et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs,
Celles qui des rubis font pâlir les couleurs,
Celles qui des paons même éclipseraient les queues,
Les petites fleurs d’or, les petites fleurs bleues,
Prennent, pour l’accueillir agitant leurs bouquets,
De petits airs penchés ou de grands airs coquets,
Et, familièrement, car cela sied aux belles :
- Tiens ! c’est notre amoureux qui passe ! disent-elles.
Et, pleins de jour et d’ombre et de confuses voix,
Les grands arbres profonds qui vivent dans les bois,
Tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables,
Les saules tout ridés, les chênes vénérables,
L’orme au branchage noir, de mousse appesanti,
Comme les ulémas quand paraît le muphti,
Lui font de grands saluts et courbent jusqu’à terre
Leurs têtes de feuillée et leurs barbes de lierre,
Contemplent de son front la sereine lueur,
Et murmurent tout bas : C’est lui ! c’est le rêveur !
le poeme eploré se lamende
Le poëme éploré se lamente; le drame
Souffre, et par vingt acteurs répand à flots son âme;
Et la foule accoudée un moment s’attendrie,
Puis reprend: -Bah! l’auteur est un homme d’esprit,
— Qui, sur de faux héros lançant de faux tonnerres,
— Rit de nous voir pleurer leurs maux imaginaires.
— Ma femme, calme-toi; sèche tes yeux, ma soeur.-
La foule a tort: l’esprit c’est le coeur; le penseur
Souffre de sa pensée et se brûle à sa flamme.
Le poëte a saigné le sang qui sort du drame;
Tous ces êtres qu’il fait l’étreignent de leurs noeuds;
Il tremble en eux, il vit en eux, il meurt en eux;
Dans sa création le poëte tressaille;
Il est elle; elle est lui; quand dans l’ombre, il travaille,
Il pleure, et s’arrachant les entrailles, les met
Dans son drame, et, sculpteur, seul sur son noir sommet
Pétrit sa propre chair dans l’argile sacrée;
Il y renaît sans cesse, et ce songeur qui crée
Othello d’une larme, Alceste d’un sanglot,
Avec eux pêle-mêle en ses oeuvres éclôt.
Dans sa genèse immense et vraie, une et diverse,
Lui, le souffrant du mal éternel, il se verse,
Sans épuiser son flanc d’où sort une clarté.
Ce qui fait qu’il est dieu, c’est plus d’humanité.
Il est génie, étant, plus que les autres, homme.
Corneille est à Rouen, mais son âme est à Rome;
Son front des vieux Catons porte le mâle ennui.
Comme Shakspeare est pâle! avant Hamlet, c’est lui
Que le fantôme attend sur l’âpre plate-forme,
Pendant qu’à l’horizon surgit la lune énorme.
Du mal dont rêve Argan, Poquelin est mourant;
Il rit: oui, peuple, il râle! Avec Ulysse errant,
Homère éperdu fuit dans la brume marine.
Saint Jean frissonne: au fond de sa sombre poitrine,
L’Apocalypse horrible agite son tocsin.
Eschyle! Oreste marche et rugit dans ton sein,
Et c’est, ô noir poëte à la lèvre irritée,
Sur ton crâne géant qu’est cloué Prométhée.
o je fus comme fou
Oh ! je fus comme fou dans le premier moment,
Hélas ! et je pleurai trois jours amèrement.
Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance,
Pères, mères, dont l’âme a souffert ma souffrance,
Tout ce que j’éprouvais, l’avez-vous éprouvé ?
Je voulais me briser le front sur le pavé ;
Puis je me révoltais, et, par moments, terrible,
Je fixais mes regards sur cette chose horrible,
Et je n’y croyais pas, et je m’écriais : Non !
— Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom
Qui font que dans le cœur le désespoir se lève ? —
Il me semblait que tout n’était qu’un affreux rêve,
Qu’elle ne pouvait pas m’avoir ainsi quitté,
Que je l’entendais rire en la chambre à côté,
Que c’était impossible enfin qu’elle fût morte,
Et que j’allais la voir entrer par cette porte !
Oh ! que de fois j’ai dit : Silence ! elle a parlé !
Tenez ! voici le bruit de sa main sur la clé !
Attendez ! elle vient ! laissez-moi, que j’écoute !
Car elle est quelque part dans la maison sans doute !