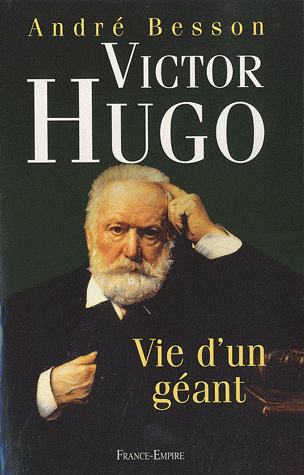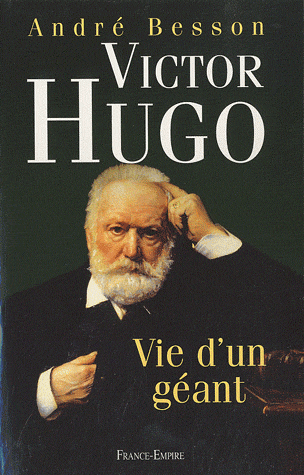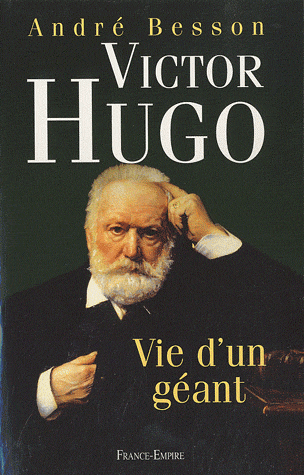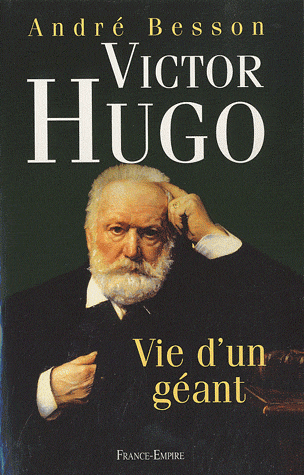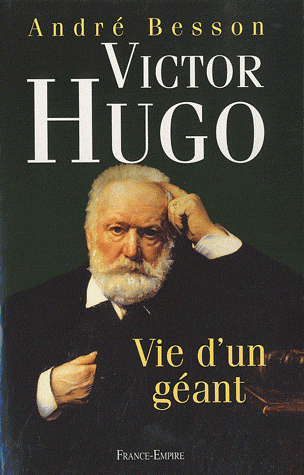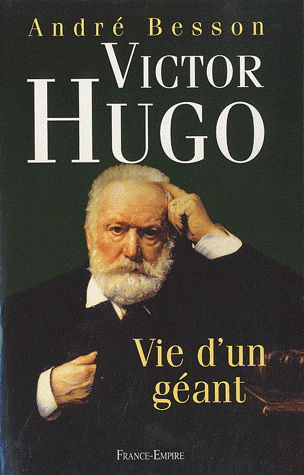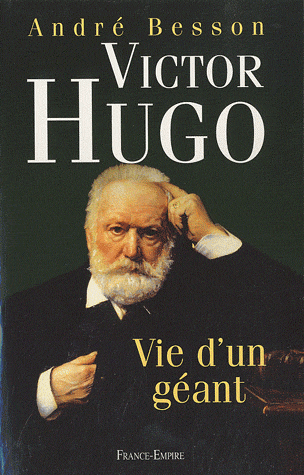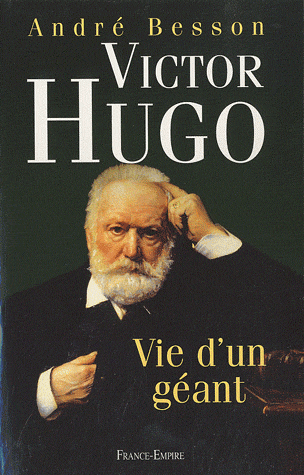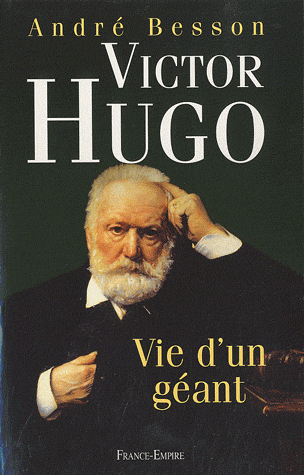afrique alphabet ange automne avatars chat animé banniere bannières barre belle belle image bleu blinkie
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· BELLE IMAGE CREATION DIVERS BIS (6781)
· CADRE (2357)
· VISAGE DE FEMME (1531)
· Femme (1324)
· Stars (1120)
· Tube cookie (1037)
· FOND D ECRAN DRAGON (575)
· Gif scintillant (556)
· FOND D ECRAN ANGE (418)
· Gif animaux animés (1052)
- · victor hugo poeme a.m.froment-meurice
- · une terre au flanc maigre victor hugo analyse
- · une terre au flanc maigre analyse
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
· tube parchemin
· oiseau gif anime
· belle image
· oiseau gif anime
· generateur de texte defilant
· gif chien
· fond d ecran
· fond d ecran
· BELLE IMAGE
· LES PREMIERS ORDINATEURS
· gif chat
· Coloriage blanche neige
· FOND D'ECRAN CHOPPER ET HARLEY
· cadeau de http://mamiebabou.centerblog.net/ merci
· FOND D ECRAN CHATS
Statistiques
Date de création : 09.08.2009
Dernière mise à jour :
31.01.2016
113496 articles
POEME VICTOR HUGO
en ecoutant les oiseaux
Oh! Quand donc aurez-vous fini, petits oiseaux,
De jaser au milieu des branches et des eaux,
Que nous nous expliquions et que je vous querelle?
Rouge-gorge, verdier, fauvette, tourterelle,
Oiseaux, je vous entends, je vous connais. Sachez
Que je ne suis pas dupe, ô doux ténors cachés,
De votre mélodie et de votre langage.
Celle que j’aime est loin et pense à moi; je gage,
O rossignol dont l’hymne, exquis et gracieux,
Donne un frémissement à l’astre dans les cieux,
Que ce que tu dis là, c’est le chant de son âme.
Vous guettez les soupirs de l’homme et de la femme,
Oiseaux; Quand nous aimons et quand nous triomphons,
Quand notre être, tout bas, s’exhale en chants profonds,
Vous, attentifs, parmi les bois inaccessibles,
Vous saisissez au vol ces strophes invisibles,
Et vous les répétez tout haut, comme de vous;
Et vous mêlez, pour rendre encor l’hymne plus doux,
A la chanson des coeurs, le battement des ailes;
Si bien qu’on vous admire, écouteurs infidèles,
Et que le noir sapin murmure aux vieux tilleuls:
-Sont-ils charmants d’avoir trouvé cela tout seuls!-
Et que l’eau, palpitant sous le chant qui l’effleure,
Baise avec un sanglot le beau saule qui pleure;
Et que le dur tronc d’arbre a des airs attendris;
Et que l’épervier rêve, oubliant la perdrix;
Et que les loups s’en vont songer auprès des louves!
-Divin!- dit le hibou; le moineau dit: -Tu trouves?-
Amour, lorsqu’en nos coeurs tu te réfugias,
L’oiseau vint y puiser; ce sont ces plagiats,
Ces chants qu’un rossignol, belles, prend sur vos bouches,
Qui font que les grands bois courbent leurs fronts farouches,
Et que les lourds rochers, stupides et ravis,
Se penchent, les laissant piller le chènevis,
Et ne distinguent plus, dans leurs rêves étranges,
La langue des oiseaux de la langue des anges.
saint arnaud
Cet homme avait donné naguère un coup de main
Au recul de la France et de l’esprit humain ;
Ce général avait les états de service
D’un chacal, et le crime aimait en lui le vice.
Buffon l’eût admis, certes, au rang des carnassiers.
Il avait fait charger le septième lanciers,
Secouant les guidons aux trois couleurs françaises,
Sur des bonnes d’enfants, derrière un tas de chaises ;
Il était le vainqueur des passants de Paris ;
Il avait mitraillé les cigares surpris
Et broyé Tortoni fumant, à coups de foudre ;
Fier, le tonnerre au poing, il avait mis en poudre
Un marchand de coco près des Variétés ;
Avec quinze escadrons, bien armés, bien montés,
Et trente bataillons, et vingt pièces de douze,
Il avait pris d’assaut le perron Sallandrouze ;
Il avait réussi même, en fort peu de temps,
A tuer sur sa porte un enfant de sept ans ;
Et sa gloire planait dans l’ouragan qui tonne
De l’égout Poissonnière au ruisseau Tiquetonne.
Tout cela l’avait fait maréchal. Nous aussi,
Nous étions des vaincus, je dois le dire ici ;
Nous étions douze cents ; eux, ils étaient cent mille.
Or ce Verrès croyait qu’on devient Paul-Emile.
Pendant que Beauharnais, l’être ignorant le mal,
Affiche aux trois poteaux d’un chiffre impérial
Son nom hideux, dégoût des lèvres de l’histoire ;
Pendant qu’un bas empire éclôt sous un prétoire
Et s’étale, amas d’ombre où rampent les serpents,
Fumier de trahison, de dot, de guet-apens,
Dont n’auraient pas voulu les poules de Carthage;
Pendant que de la France on se fait le partage ;
Pendant que des milliers d’innocents égorgés
Pourrissent, par le ver du sépulcre rongés ;
Pendant que les proscrits, que la chiourme accompagne,
Cheminant deux à deux dans les sabots du bagne,
Vieillards, enfants brûlés de fièvre, sans sommeil,
Vont à Guelma casser des pierres au soleil ;
Pendant qu’à Bône on meurt et qu’en Guyane on tombe,
Et qu’ici, chaque jour, nous creusons une tombe,
Ce sbire galonné du crime, ce vainqueur,
De la fraude et du vol sinistre remorqueur,
Cet homme, bras sanglant de la trahison louche,
Ce Mars Mandrin ayant pour Jupiter Cartouche,
S’était dit : « Bah ! la France oublie. Un vrai laurier !
Et l’on n’osera plus sur mes talons crier.
En guerre ! Il n’est pas bon que la gloire demeure
Au charnier Montfaucon ; nous avons à cette heure
Trop de Dix-huit Brumaire et trop peu d’Austerlitz ;
Lorsque nous secouons nos drapeaux, de leurs plis
Ils ne laissent tomber sur nous que des huées ;
Au lieu des vieillards morts et des femmes tuées,
Il est temps qu’il se dresse autour de nous un peu
De fanfare et d’orgueil, chantant dans le ciel bleu ;
Or, voici que la guerre à l’orient se lève !
Je ne suis que couteau, je puis devenir glaive.
On me crache au visage aujourd’hui, mais demain
J’apparaîtrai, superbe, éclatant, surhumain,
Vainqueur, dans une illustre et splendide fumée,
Et duc de la mer Noire et prince de Crimée,
Et je ferai voler ce mot : Sébastopol,
Des tours de Notre-Dame au dôme de Saint-Paul !
Le vieux monstre Russie, aux regards longs et troubles,
Qui fascine l’Europe avec des yeux de roubles,
Je le prendrai, j’irai le saisir dans son trou,
Et je rapporterai sur mon poing ce hibou.
On verra sous mes pieds fondre le czar qui croule.
Paris m’admirera de la Bastille au Roule ;
On me battra des mains au fond des vieux faubourgs ;
Les gamins marqueront le pas à mes tambours
La porte Saint-Denis tirera des fusées ;
Et, quand je passerai, du haut de ses croisées
Le boulevard Montmartre applaudira. Partons.
Effaçons d’un seul trait tuerie, exils, pontons,
Et jetons cette poudre aux yeux froids de l’histoire.
Je m’en irai Massacre et reviendrai Victoire ;
Je serai parti chien, je reviendrai lion.
En guerre ! »
Tu mettrais Atlas sur Pélion,
Tu ferais plus qu’aucun dont l’homme se souvienne,
Tu forcerais Moscou, Pétersbourg, Berlin, Vienne,
Tu tordrais dans tes mains ainsi que des serpents
Tous les fleuves domptés, tremblants, soumis, rampants,
Le Don, le Nil, le Tibre, et le Rhin basaltique,
Tu prendrais la mer Noire avec la mer Baltique,
On te verrait, vainqueur, au front des escadrons,
Précédé des tambours et suivi des clairons,
Parmi les plus fameux marcher le plus insigne,
Que tu ne ferais pas décroître d’une ligne
L’épaisseur du carcan qui pend à l’échafaud !
Que tu n’ôterais pas une lettre au fer chaud
Que l’histoire, quand vient l’heure de comparaître,
Imprime au dos du lâche et sur le front du traître !
On est ivre parfois quand on a bu du sang.
Nul ne sait le destin. Fais ton rêve, passant !
L’éternel océan nous regarde, et sanglote.
Il prit ce qu’il voulut dans l’armée et la flotte ;
Il reçut le baiser de Néron le Petit,
Gagna Toulon, sa ville, et partit. Il partit,
Traînant des millions après lui dans ses coffres,
Entouré de banquiers qui lui faisaient des offres,
En satrape persan, en proconsul romain,
Son bâton de velours et d’aigles dans sa main,
Emportant pour sa table un service de Chine,
Suivi de vingt fourgons, brodé jusqu’à l’échine,
Empanaché, doré, magnifique, hideux.
Un jour, on déterra l’un de ceux de l’an deux,
Un vieux républicain, le général Dampierre ;
On le trouva couché tout armé sous la pierre,
Et portant, fier soldat que nul n’avait vu fuir,
L’épaulette de laine et la dragonne en cuir.
Il partit, tout trempé d’eau bénite ; et ce reître
Partout sur son chemin baisait la griffe au prêtre ;
Car cette hypocrisie est le genre actuel ;
Le crime, qui jadis bravait le rituel,
L’ancien vieux crime impie à présent dégénère
En clins d’yeux qu’à Tartuffe adresse Lacenaire
Le brigand est béni du curé, point ingrat ;
Papavoine aujourd’hui se confesse à Mingrat ;
Le bedeau Poulmann sert la messe. – Ah ! je l’avoue,
Quand un bandit sincère, entier, sentant la roue,
Honnête à sa façon, bonne fille, complet,
Se déclare bandit, s’annonce ce qu’il est,
Fuit les honnêtes gens, sent qu’il les dépareille,
Et porte carrément son crime sur l’oreille,
Mon Dieu ! quand un voleur dit : je suis un voleur,
Quand un pauvre histrion de foire, un avaleur
De sabres, au milieu d’un torrent de paroles,
Un arracheur de dents, avec ses bottes molles,
Orné de galons faux et de poil de lapin,
Quand un drôle ingénu, qui peut-être est sans pain,
Met sa main dans ma poche et m’empoigne ma montre,
Quand, le matin, poussant ma porte qu’il rencontre,
Il entre, prend ma bourse et mes couverts d’argent,
Et, si je le surprends à même et pataugeant,
Me dit : c’est vrai, monsieur, je suis une canaille ;
Je ris, et je suis prêt à dire : qu’il s’en aille
Amnistie au coquin qui se donne pour tel !
Mais quand l’assassinat s’étale sur l’autel
Et que sous une mitre un prêtre l’escamote ;
Quand un soldat féroce entre ses dents marmotte
Un oremus infâme au bout d’un sacrebleu ;
Quand on fait devant moi cette insulte au ciel bleu
De faire Magnan saint et Canrobert ermite ;
Quand le carnage prend des airs de chattemite,
Et quand Jean l’Ecorcheur se confit en Veuillot ;
Quand le massacre affreux, le couteau, le billot,
Le rond-point la Roquette et la place Saint-Jacques,
Tout ruisselants de sang, viennent faire leurs pâques ;
Quand les larrons, après avoir coupé le cou
Au voyageur, et mis ses membres dans un trou,
Vont au lieu saint ouvrir et piller la valise ;
Quand j’attends la caverne et quand je vois l’église ;
Quand le meurtre sournois qui chourina sans bruit
La loi, par escalade et guet-apens, la nuit,
Et qui par la fenêtre entra dans nos demeures,
Prend un cierge, se signe, ânonne un livre d’heures,
Offre sa pince au Dieu sous qui l’Horeb tremblait,
Et de sa corde à nœuds se fait un chapelet,
Alors, ô cieux profonds ! ma prunelle s’allume,
Mon pouls bat sur mon cœur comme sur une enclume,
Je sens grandir en moi la colère, géant,
Et j’accours éperdu, frémissant, secouant
Sur ces horreurs, à l’âme humaine injurieuses,
Dans mes deux mains, des fouets de strophes furieuses !
Stamboul, lui prodiguant galas, orchestre et bal,
Lui fit fête, Capoue où manquait Annibal.
Ce bandit rayonna quelque temps dans des gloires
Byzance illumina pour lui ses promontoires.
Au cirque Franconi, quand vient le dénouement,
Quand la toile de fond se lève brusquement
Et que tout le décor n’est plus qu’une astragale,
On voit ces choses-là dans un feu de Bengale.
Et, pendant ces festins et ces jeux, on brûla,
Les russes, Silistrie, et les anglais, Kola.
Le moment vint ; l’escadre appareilla ; les roues
Tournèrent ; par ce tas de voiles et de proues,
Dont l’âpre artillerie en vingt salves gronda,
L’infini se laissa violer. L’armada,
Formidable, penchant, prête à cracher le soufre,
Les gueules des canons sur les gueules du gouffre,
Nageant, polype humain, sur l’abîme béant,
Et, comme un noir poisson dans un filet géant,
Prenant l’ouragan sombre en ses mille cordages,
S’ébranla ; dans ses flancs, les haches d’abordages,
Les sabres, les fusils, le lourd tromblon marin,
La fauve caronade aux ailerons d’airain
Se heurtaient ; et, jetant de l’écume aux étoiles,
Et roulant dans ses plis des tempêtes de toiles,
Frégate, aviso, brick, brûlot, trois-ponts, steamer,
Le troupeau monstrueux couvrit la vaste mer.
La flotte ainsi marchait en ordre de bataille.
Ô mouches ! il est temps que cet homme s’en aille.
Venez ! Souffle, ô vent noir des moustiques de feu !
Hurrah ! les inconnus, les punisseurs de Dieu,
L’obscure légion des hydres invisibles,
L’infiniment petit, rempli d’ailes horribles,
Accourut ; l’âpre essaim des moucherons, tenant
Dans un souffle, et qui fait trembler un continent,
L’atome, monde affreux peuplant l’ombre hagarde,
Que l’œil du microscope avec effroi regarde,
Vint, groupe insaisissable et vague où rien ne luit,
Et plana sur la flotte énorme dans la nuit.
Et les canons, hurlant contre l’homme, molosses
De la mort, les vaisseaux, titaniques colosses,
Les mortiers lourds, volcans aux hideux entonnoirs,
Les grands steamers, dragons dégorgeant des flots noirs,
Tous ces géants tremblaient au sein des flots terribles
Sous ce frémissement d’ailes imperceptibles !
Et le lugubre essaim, vil, céleste, infernal,
Planait, plaisait toujours, attendant un signal.
Terre ! dit la vigie. Et l’on toucha la rive.
La gloire, qui parfois, jusqu’aux bandits arrive,
Apparut, et cet homme entrevit les combats,
Les tentes, les bivouacs, et, tout au fond, là-bas,
Vous couvrant de son ombre, horreurs atténuées,
L’immense arc de triomphe au milieu des nuées.
Il débarqua. L’essaim planait toujours. Hurrah !
C’est l’heure. Et le Seigneur fit signe au choléra.
La peste, saisissant son condamné sinistre,
A défaut du césar acceptant le ministre,
Dit à la guerre pâle et reculant d’effroi .
- Va-t’en. Ne me prends pas cet homme. Il est à moi.
Et cria de sa voix où siffle une couleuvre :
- Bataille, fais ta tâche et laisse-moi mon œuvre.
Alors, suivant le doigt qui d’en haut l’avertit,
L’essaim vertigineux sur ce front s’abattit ;
Le monstre aux millions de bouches, l’impalpable,
L’infini, se rua sur le blême coupable ;
Les ténèbres, mordant, rongeant, piquant, suçant,
Entrèrent dans cet homme, et lui burent le sang,
Et l’enfer, le tordant vivant dans ses tenailles,
Se mit à lui manger dans l’ombre les entrailles.
Et dans ce même instant la bataille tonna,
Et cria dans les cieux : Wagram ! Ulm ! Iéna !
En avant, bataillons, dans la fière mêlée !
Peuples ! ceci descend de la voûte étoilée,
Et c’est l’histoire, et c’est la justice de Dieu ;
Pendant que, sous des flots de mitraille, au milieu
Des balles, bondissaient vers le but électrique
Les highlanders d’Ecosse et les spahis d’Afrique,
Tandis que, s’excitant et s’entre-regardant,
Le chasseur de Vincennes et le zouave ardent
Rampaient et gravissaient la montagne en décombres,
Tandis que Mentschikoff et ses grenadiers sombres
A travers les obus, sur l’âpre escarpement,
Voyaient, plus effarés de moment en moment,
Monter vers eux ce tas de tigres dans les ronces,
Et que les lourds canons s’envoyaient des réponses,
Et qu’on pouvait, fût-on serf, esclave ou troupeau,
Tomber du moins en brave à l’ombre d’un drapeau,
Lui, l’homme frémissant du boulevard Montmartre,
Ayant son crime au flanc, qui se changeait en dartre,
Les boulets indignés se détournant de lui,
Vil, la main sur le ventre, et plein d’un sombre ennui,
Il voyait, pâle, amer, l’horreur dans les narines,
Fondre sous lui sa gloire en allée aux latrines.
Il râlait ; et, hurlant, fétide, ensanglanté,
A deux pas de son champ de bataille, à côté
Du triomphe, englouti dans l’opprobre incurable,
Triste, horrible, il mourut. Je plains ce misérable.
Ici, spectre ! Viens là que je te parle. Oui,
Puisque dans le néant tu t’es évanoui
Sous l’œil mystérieux du Dieu que je contemple,
Puisque la mort a fait sur toi ce grand exemple,
Et que, traînant ton crime, abject, épouvanté,
Te voilà face à face avec l’éternité,
Puisque c’est du tombeau que la prière monte,
Que tu n’es plus qu’une ombre, et que Dieu sur la honte
De ton commencement met l’horreur de ta fin,
Quoique au-dessous du tigre esclave de la faim,
Tu me serres le cœur, bandit, et je t’avoue
Que je me sens un peu de pitié pour ta boue,
Que je frémis de voir comme mon Dieu te suit,
Et que, plusieurs ici, qui sommes dans la nuit,
Nous avons fait un signe avec notre front pâle,
Quand l’ange Châtiment, qui, penché sur ton râle,
Te gardait, et tenait sur toi ses yeux baissés,
S’est tourné vers nous, spectre, en disant : Est-ce assez ?
quelqu un
Donc un homme a vécu qui s’appelait Varron,
Un autre Paul-Emile, un autre Cicéron ;
Ces hommes ont été grands, puissants, populaires,
Ont marché, précédés des faisceaux consulaires,
Ont été généraux, magistrats, orateurs ;
Ces hommes ont parlé devant les sénateurs
Ils ont vu, dans la poudre et le bruit des armées,
Frissonnantes, passer les aigles enflammées ;
La foule les suivait et leur battait des mains
Ils sont morts ; on a fait à ces fameux romains
Des tombeaux dans le marbre, et d’autres dans l’histoire.
Leurs bustes, aujourd’hui, graves comme la gloire,
Dans l’ombre des palais ouvrant leurs vagues yeux,
Rêvent autour de nous, témoins mystérieux ;
Ce qui n’empêche pas, nous, gens des autres âges,
Que, lorsque nous parlons de ces grands personnages,
Nous ne disions : tel jour Varron fut un butor,
Paul-Émile a mal fait, Cicéron eut grand tort,
Et lorsque nous traitons ainsi ces morts illustres,
Tu prétends, toi, maraud, goujat parmi les rustres,
Que je parle de toi qui lasses le dédain,
Sans dire hautement : cet homme est un gredin !
Tu veux que nous prenions des gants et des mitaines
Avec toi, qu’eût chassé Sparte aussi bien qu’Athènes !
Force gens t’ont connu jadis quand tu courais
Les brelans, les enfers, les trous, les cabarets,
Quand on voyait, le soir, tantôt dans l’ombre obscure,
Tantôt devant la porte entrouverte et peu sûre
D’un antre d’où sortait une rouge clarté,
Ton chef branlant couvert d’un feutre cahoté.
Tu t’es fait broder d’or par l’empereur bohème.
Ta vie est une farce et se guinde en poëme.
Et que m’importe à moi, penseur, juge, ouvrier,
Que décembre, étranglant dans ses poings février,
T’installe en un palais, toi qui souillais un bouge !
Allez aux tapis francs de Vanvre et de Montrouge,
Courez aux galetas, aux caves, aux taudis,
Les échos vous diront partout ce que je dis
- Ce drôle était voleur avant d’être ministre ! -
Ah ! tu veux qu’on t’épargne, imbécile sinistre !
Ah ! te voilà content, satisfait, souriant !
Sois tranquille. J’irai par la ville criant :
Citoyens ! voyez-vous ce jésuite aux yeux jaunes ?
Jadis, c’était Brutus. Il haïssait les trônes,
Il les aime aujourd’hui. Tous métiers lui sont bons
Il est pour le succès. Donc, à bas les Bourbons,
Mais vive l’empereur ! à bas tribune et charte !
II déteste Chambord, mais il sert Bonaparte.
On l’a fait sénateur, ce qui le rend fougueux.
Si les choses étaient à leur place, ce gueux
Qui n’a pas, nous dit-il en déclamant son rôle,
Les fleurs de lys au coeur, les aurait sur l’épaule !
elle etait pale et poutant rose
Elle était pâle, et pourtant rose,
Petite avec de grands cheveux.
Elle disait souvent : Je n’ose,
Et ne disait jamais : Je veux.
Le soir, elle prenait ma Bible
Pour y faire épeler sa sœur,
Et, comme une lampe paisible,
Elle éclairait ce jeune cœur.
Sur le saint livre que j’admire,
Leurs yeux purs venaient se fixer ;
Livre où l’une apprenait à lire,
Où l’autre apprenait à penser !
Sur l’enfant, qui n’eût pas lu seule,
Elle penchait son front charmant,
Et l’on aurait dit une aïeule
Tant elle parlait doucement !
Elle lui disait : —Sois bien sage ! -
Sans jamais nommer le démon ;
Leurs mains erraient de page en page
Sur Moïse et sur Salomon,
Sur Cyrus qui vint de la Perse,
Sur Moloch et Leviathan,
Sur l’enfer que Jésus traverse,
Sur l’éden où rampe Satan !
Moi, j’écoutais… — O joie immense
De voir la sœur près de la sœur !
Mes yeux s’enivraient en silence
De cette ineffable douceur.
Et dans la chambre humble et déserte
Où nous sentions, cachés tous trois,
Entrer par la fenêtre ouverte
Les souffles des nuits et des bois,
Tandis que, dans le texte auguste,
Leurs cœurs, lisant avec ferveur,
Puisaient le beau, le vrai, le juste,
Il me semblait, à moi, rêveur,
Entendre chanter des louanges
Autour de nous, comme au saint lieu,
Et voir sous les doigts de ces anges
Tressaillir le livre de Dieu !
elle etait dechaussee elle etait decoiffee
Elle était déchaussée, elle était décoiffée,
Assise, les pieds nus, parmi les joncs penchants;
Moi qui passais par là, je crus voir une fée,
Et je lui dis: Veux-tu t’en venir dans les champs?
Elle me regarda de ce regard suprême
Qui reste à la beauté quand nous en triomphons,
Et je lui dis: Veux-tu, c’est le mois où l’on aime,
Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds?
Elle essuya ses pieds à l’herbe de la rive;
Elle me regarda pour la seconde fois,
Et la belle folâtre alors devint pensive.
Oh! comme les oiseaux chantaient au fond des bois!
Comme l’eau caressait doucement le rivage!
Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts,
La belle fille heureuse, effarée et sauvage,
Ses cheveux dans ses yeux, et riant au travers.
crepuscule
L’étang mystérieux, suaire aux blanches moires,
Frissonne ; au fond du bois la clairière apparaît ;
Les arbres sont profonds et les branches sont noires ;
Avez-vous vu Vénus à travers la forêt ?
Avez-vous vu Vénus au sommet des collines ?
Vous qui passez dans l’ombre, êtes-vous des amants ?
Les sentiers bruns sont pleins de blanches mousselines ;
L’herbe s’éveille et parle aux sépulcres dormants.
Que dit-il, le brin d’herbe ? et que répond la tombe ?
Aimez, vous qui vivez ! on a froid sous les ifs.
Lèvre, cherche la bouche ! aimez-vous ! la nuit tombe ;
Soyez heureux pendant que nous sommes pensifs.
Dieu veut qu’on ait aimé. Vivez ! faites envie,
Ô couples qui passez sous le vert coudrier.
Tout ce que dans la tombe, en sortant de la vie,
On emporta d’amour, on l’emploie à prier.
Les mortes d’aujourd’hui furent jadis les belles.
Le ver luisant dans l’ombre erre avec son flambeau.
Le vent fait tressaillir, au milieu des javelles,
Le brin d’herbe, et Dieu fait tressaillir le tombeau.
La forme d’un toit noir dessine une chaumière ;
On entend dans les prés le pas lourd du faucheur ;
L’étoile aux cieux, ainsi qu’une fleur de lumière,
Ouvre et fait rayonner sa splendide fraîcheur.
Aimez-vous ! c’est le mois où les fraises sont mûres.
L’ange du soir rêveur qui flotte dans les vents,
Mêle, en les emportant sur ses ailes obscures,
Les prières des morts aux baisers des vivants.
a madama dg de g
Jadis je vous disais: — Vivez, régnez, Madame!
Le salon vous attend! le succès vous réclame!
Le bal éblouissant pâlit quand vous partez!
Soyez illustre et belle! aimez! riez! chantez!
Vous avez la splendeur des astres et des roses!
Votre regard charmant, où je lis tant de choses,
Commente vos discours légers et gracieux.
Ce que dit votre bouche étincelle en vos yeux.
Il semble, quand parfois un chagrin vous alarme,
Qu’ils versent une perle et non pas une larme.
Même quand vous rêvez, vous souriez encor,
Vivez, fêtée et fière, ô belle aux cheveux d’or!
Maintenant vous voilà pâle, grave, muette,
Morte, et transfigurée, et je vous dis: — Poëte!
Viens me chercher! Archange! être mystérieux!
Fais pour moi transparents et la terre et les cieux!
Révèle-moi, d’un mot de ta bouche profonde,
La grande énigme humaine et le secret du monde!
Confirme en mon esprit Descarte ou Spinosa!
Car tu sais le vrai nom de celui qui perça,
Pour que nous puissions voir sa lumière sans voiles,
Ces trous du noir plafond qu’on nomme les étoiles!
Car je te sens flotter sous mes rameaux penchants;
Car ta lyre invisible a de sublimes chants!
Car mon sombre océan, où l’esquif s’aventure,
T’épouvante et te plaît; car la sainte nature,
La nature éternelle, et les champs, et les bois,
Parlent de ta grande âme avec leur grande voix!
claire
Quoi donc ! la vôtre aussi ! la vôtre suit la mienne !
Ô mère au cœur profond, mère, vous avez beau
Laisser la porte ouverte afin qu’elle revienne,
Cette pierre là-bas dans l’herbe est un tombeau !
La mienne disparut dans les flots qui se mêlent ;
Alors, ce fut ton tour, Claire, et tu t’envolas.
Est-ce donc que là-haut dans l’ombre elles s’appellent,
Qu’elles s’en vont ainsi l’une après l’autre, hélas ?
Enfant qui rayonnais, qui chassais la tristesse,
Que ta mère jadis berçait de sa chanson,
Qui d’abord la charmas avec ta petitesse
Et plus tard lui remplis de clarté l’horizon,
Voilà donc que tu dors sous cette pierre grise !
Voilà que tu n’es plus, ayant à peine été !
L’astre attire le lys, et te voilà reprise,
Ô vierge, par l’azur, cette virginité !
Te voilà remontée au firmament sublime,
Échappée aux grands cieux comme la grive aux bois,
Et, flamme, aile, hymne, odeur, replongée à l’abîme
Des rayons, des amours, des parfums et des voix !
Nous ne t’entendrons plus rire en notre nuit noire.
Nous voyons seulement, comme pour nous bénir,
Errer dans notre ciel et dans notre mémoire
Ta figure, nuage, et ton nom, souvenir !
Pressentais-tu déjà ton sombre épithalame ?
Marchant sur notre monde à pas silencieux,
De tous les idéals tu composais ton âme,
Comme si tu faisais un bouquet pour les cieux !
En te voyant si calme et toute lumineuse,
Les cœurs les plus saignants ne haïssaient plus rien.
Tu passais parmi nous comme Ruth la glaneuse,
Et, comme Ruth l’épi, tu ramassais le bien.
La nature, ô front pur, versait sur toi sa grâce,
L’aurore sa candeur, et les champs leur bonté ;
Et nous retrouvions, nous sur qui la douleur passe,
Toute cette douceur dans toute ta beauté !
Chaste, elle paraissait ne pas être autre chose
Que la forme qui sort des cieux éblouissants,
Et de tous les rosiers elle semblait la rose,
Et de tous les amours elle semblait l’encens.
Ceux qui n’ont pas connu cette charmante fille
Ne peuvent pas savoir ce qu’était ce regard
Transparent comme l’eau qui s’égaye et qui brille
Quand l’étoile surgit sur l’océan hagard.
Elle était simple, franche, humble, naïve et bonne ;
Chantant à demi-voix son chant d’illusion,
Ayant je ne sais quoi dans toute sa personne
De vague et de lointain comme la vision.
On sentait qu’elle avait peu de temps sur la terre,
Qu’elle n’apparaissait que pour s’évanouir,
Et qu’elle acceptait peu sa vie involontaire ;
Et la tombe semblait par moments l’éblouir.
Elle a passé dans l’ombre où l’homme se résigne ;
Le vent sombre soufflait ; elle a passé sans bruit,
Belle, candide, ainsi qu’une plume de cygne
Qui reste blanche, même en traversant la nuit !
Elle s’en est allée à l’aube qui se lève,
Lueur dans le matin, vertu dans le ciel bleu,
Bouche qui n’a connu que le baiser du rêve,
Ame qui n’a dormi que dans le lit de Dieu !
Nous voici maintenant en proie aux deuils sans bornes,
Mère, à genoux tous deux sur des cercueils sacrés,
Regardant à jamais dans les ténèbres mornes
La disparition des êtres adorés !
Croire qu’ils resteraient ! quel songe ! Dieu les presse.
Même quand leurs bras blancs sont autour de nos cous,
Un vent du ciel profond fait frissonner sans cesse
Ces fantômes charmants que nous croyons à nous.
Ils sont là, près de nous, jouant sur notre route ;
Ils ne dédaignent pas notre soleil obscur,
Et derrière eux, et sans que leur candeur s’en doute,
Leurs ailes font parfois de l’ombre sur le mur.
Ils viennent sous nos toits ; avec nous ils demeurent ;
Nous leur disons : Ma fille ! ou : Mon fils ! ils sont doux,
Riants, joyeux, nous font une caresse, et meurent. —
Ô mère, ce sont là les anges, voyez-vous !
C’est une volonté du sort, pour nous sévère
Qu’ils rentrent vite au ciel resté pour eux ouvert ;
Et qu’avant d’avoir mis leur lèvre à notre verre,
Avant d’avoir rien fait et d’avoir rien souffert,
Ils partent radieux ; et qu’ignorant l’envie,
L’erreur, l’orgueil, le mal, la haine, la douleur,
Tous ces êtres bénis s’envolent de la vie
À l’âge où la prunelle innocente est en fleur !
Nous qui sommes démons ou qui sommes apôtres,
Nous devons travailler, attendre, préparer ;
Pensifs, nous expions pour nous-même ou pour d’autres ;
Notre chair doit saigner, nos yeux doivent pleurer.
Eux, ils sont l’air qui fuit, l’oiseau qui ne se pose
Qu’un instant, le soupir qui vole, avril vermeil
Qui brille et passe ; ils sont la parfum de la rose
Qui va rejoindre aux cieux le rayon du soleil !
Ils ont ce grand dégoût mystérieux de l’âme
Pour notre chair coupable et pour notre destin ;
Ils ont, êtres rêveurs qu’un autre azur réclame,
Je ne sais quelle soif de mourir le matin !
Ils sont l’étoile d’or se couchant dans l’aurore,
Mourant pour nous, naissant pour l’autre firmament ;
Car la mort, quand un astre en son sein vient éclore,
Continue, au delà, l’épanouissement !
Oui, mère, ce sont là les élus du mystère,
Les envoyés divins, les ailés, les vainqueurs,
À qui Dieu n’a permis que d’effleurer la terre
Pour faire un peu de joie à quelques pauvres cœurs.
Comme l’ange à Jacob, comme Jésus à Pierre,
Ils viennent jusqu’à nous qui loin d’eux étouffons,
Beaux, purs, et chacun d’eux portant sous sa paupière
La sereine clarté des paradis profonds.
Puis, quand ils ont, pieux, baisé toutes les plaies,
Pansé notre douleur, azuré nos raisons,
Et fait luire un moment l’aube à travers nos claies,
Et chanté la chanson du ciel dans nos maisons,
Ils retournent là-haut parler à Dieu des hommes,
Et, pour lui faire voir quel est notre chemin,
Tout ce que nous souffrons et tout ce que nous sommes,
S’en vont avec un peu de terre dans la main.
Ils s’en vont ; c’est tantôt l’éclair qui les emporte,
Tantôt un mal plus fort que nos soins superflus.
Alors, nous, pâles, froids, l’œil fixé sur la porte,
Nous ne savons plus rien, sinon qu’ils ne sont plus.
Nous disons : — À quoi bon l’âtre sans étincelles ?
À quoi bon la maison où ne sont plus leurs pas ?
À quoi bon la ramée où ne sont plus les ailes ;
Qui donc attendons-nous s’ils ne reviendront pas ? —
Ils sont partis, pareils au bruit qui sort de lyres.
Et nous restons là, seuls, près du gouffre où tout fuit,
Tristes ; et la lueur de leurs charmants sourires
Parfois nous apparaît vaguement dans la nuit.
Car ils sont revenus, et c’est là le mystère ;
Nous entendons quelqu’un flotter, un souffle errer,
Des robes effleurer notre seuil solitaire,
Et cela fait alors que nous pouvons pleurer.
Nous sentons frissonner leurs cheveux dans notre ombre ;
Nous sentons, lorsqu’ayant la lassitude en nous,
Nous nous levons après quelque prière sombre,
Leurs blanches mains toucher doucement nos genoux.
Ils nous disent tout bas de leur voix la plus tendre :
Mon père ! encore un peu ! ma mère ! encore un jour !
M’entends-tu ? Je suis là, je reste pour t’attendre
Sur l’échelon d’en bas de l’échelle d’amour.
Je t’attends pour pouvoir nous en aller ensemble.
Cette vie est amère, et tu vas en sortir.
Pauvre cœur, ne crains rien, Dieu vit ! la mort rassemble.
Tu redeviendras ange ayant été martyr.-
Oh ! quand donc viendrez-vous ? vous retrouver, c’est naître
Quand verrons-nous, ainsi qu’un idéal flambeau,
La douce étoile mort, rayonnante, apparaître
À ce noir horizon qu’on nomme le tombeau ?
Quand nous en irons-nous où vous êtes, colombes !
Où sont les enfants morts et les printemps enfuis,
Et tous les chers amours dont nous sommes les tombes,
Et toutes les clartés dont nous sommes les nuits ?
Vers ce grand ciel clément où sont tous les dictames,
Les aimés, les absents, les êtres purs et doux,
Les baisers des esprits et les regards des âmes,
Quand nous en irons-nous ? quand nous en irons-nous ?
Quand nous en irons-nous où sont l’aube et la foudre ?
Quand verrons-nous, déjà libres, hommes encor,
Notre chair ténébreuse en rayons se dissoudre,
Et nos pieds faits de nuit éclore en ailes d’or ?
Quand nous enfuirons-nous dans la joie infinie
Où les hymnes vivants sont des anges voilés,
Où l’on voit, à travers l’azur de l’harmonie,
La strophe bleue errer sur les luths étoilés ?
Quand viendrez-vous chercher notre humble cœur qui sombre ?
Quand nous reprendrez-vous à ce monde charnel,
Pour nous bercer ensemble aux profondeurs de l’ombre,
Sous l’éblouissement du regard éternel ?
elle avait pris ce pli dans son age enfantin
Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin
De venir dans ma chambre un peu chaque matin;
Je l’attendais ainsi qu’un rayon qu’on espère;
Elle entrait, et disait: Bonjour, mon petit père ;
Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s’asseyait
Sur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait,
Puis soudain s’en allait comme un oiseau qui passe.
Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse,
Mon oeuvre interrompue, et, tout en écrivant,
Parmi mes manuscrits je rencontrais souvent
Quelque arabesque folle et qu’elle avait tracée,
Et mainte page blanche entre ses mains froissée
Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers.
Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts,
Et c’était un esprit avant d’être une femme.
Son regard reflétait la clarté de son âme.
Elle me consultait sur tout à tous moments.
Oh! que de soirs d’hiver radieux et charmants
Passés à raisonner langue, histoire et grammaire,
Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère
Tout près, quelques amis causant au coin du feu !
J’appelais cette vie être content de peu !
Et dire qu’elle est morte! Hélas! que Dieu m’assiste !
Je n’étais jamais gai quand je la sentais triste ;
J’étais morne au milieu du bal le plus joyeux
Si j’avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux.
a villequier
Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres,
Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux ;
Maintenant que je suis sous les branches des arbres,
Et que je puis songer à la beauté des cieux ;
Maintenant que du deuil qui m’a fait l’âme obscure
Je sors, pâle et vainqueur,
Et que je sens la paix de la grande nature
Qui m’entre dans le cœur ;
Maintenant que je puis, assis au bord des ondes,
Ému par ce superbe et tranquille horizon,
Examiner en moi les vérités profondes
Et regarder les fleurs qui sont dans le gazon ;
Maintenant, ô mon Dieu ! que j’ai ce calme sombre
De pouvoir désormais
Voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l’ombre
Elle dort pour jamais ;
Maintenant qu’attendri par ces divins spectacles,
Plaines, forêts, rochers, vallons, fleuve argenté,
Voyant ma petitesse et voyant vos miracles,
Je reprends ma raison devant l’immensité ;
Je viens à vous, Seigneur, père auquel il faut croire ;
Je vous porte, apaisé,
Les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire
Que vous avez brisé ;
Je viens à vous, Seigneur ! confessant que vous êtes
Bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant !
Je conviens que vous seul savez ce que vous faites,
Et que l’homme n’est rien qu’un jonc qui tremble au vent ;
Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le firmament ;
Et que ce qu’ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement ;
Je conviens à genoux que vous seul, père auguste,
Possédez l’infini, le réel, l’absolu ;
Je conviens qu’il est bon, je conviens qu’il est juste
Que mon cœur ait saigné, puisque Dieu l’a voulu !
Je ne résiste plus à tout ce qui m’arrive
Par votre volonté.
L’âme de deuils en deuils, l’homme de rive en rive,
Roule à l’éternité.
Nous ne voyons jamais qu’un seul côté des choses ;
L’autre plonge en la nuit d’un mystère effrayant.
L’homme subit le joug sans connaître les causes.
Tout ce qu’il voit est court, inutile et fuyant.
Vous faites revenir toujours la solitude
Autour de tous ses pas.
Vous n’avez pas voulu qu’il eût la certitude
Ni la joie ici-bas !
Dès qu’il possède un bien, le sort le lui retire.
Rien ne lui fut donné, dans ses rapides jours,
Pour qu’il s’en puisse faire une demeure, et dire :
C’est ici ma maison, mon champ et mes amours !
Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient ;
Il vieillit sans soutiens.
Puisque ces choses sont, c’est qu’il faut qu’elles soient ;
J’en conviens, j’en conviens !
Le monde est sombre, ô Dieu ! l’immuable harmonie
Se compose des pleurs aussi bien que des chants ;
L’homme n’est qu’un atome en cette ombre infinie,
Nuit où montent les bons, où tombent les méchants.
Je sais que vous avez bien autre chose à faire
Que de nous plaindre tous,
Et qu’un enfant qui meurt, désespoir de sa mère,
Ne vous fait rien, à vous !
Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue ;
Que l’oiseau perd sa plume et la fleur son parfum ;
Que la création est une grande roue
Qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un ;
Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent,
Passent sous le ciel bleu ;
Il faut que l’herbe pousse et que les enfants meurent ;
Je le sais, ô mon Dieu !
Dans vos cieux, au delà de la sphère des nues,
Au fond de cet azur immobile et dormant,
Peut-être faites-vous des choses inconnues
Où la douleur de l’homme entre comme élément.
Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre
Que des êtres charmants
S’en aillent, emportés par le tourbillon sombre
Des noirs événements.
Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses
Que rien ne déconcerte et que rien n’attendrit.
Vous ne pouvez avoir de subites clémences
Qui dérangent le monde, ô Dieu, tranquille esprit !
Je vous supplie, ô Dieu ! de regarder mon âme,
Et de considérer
Qu’humble comme un enfant et doux comme une femme
Je viens vous adorer !
Considérez encor que j’avais, dès l’aurore,
Travaillé, combattu, pensé, marché, lutté,
Expliquant la nature à l’homme qui l’ignore,
Éclairant toute chose avec votre clarté ;
Que j’avais, affrontant la haine et la colère,
Fait ma tâche ici-bas,
Que je ne pouvais pas m’attendre à ce salaire,
Que je ne pouvais pas
Prévoir que, vous aussi, sur ma tête qui ploie,
Vous appesantiriez votre bras triomphant,
Et que, vous qui voyiez comme j’ai peu de joie,
Vous me reprendriez si vite mon enfant !
Qu’une âme ainsi frappée à se plaindre est sujette,
Que j’ai pu blasphémer,
Et vous jeter mes cris comme un enfant qui jette
Une pierre à la mer !
Considérez qu’on doute, ô mon Dieu ! quand on souffre,
Que l’œil qui pleure trop finit par s’aveugler.
Qu’un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre,
Quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler.
Et qu’il ne se peut pas que l’homme, lorsqu’il sombre
Dans les afflictions,
Ait présente à l’esprit la sérénité sombre
Des constellations !
Aujourd’hui, moi qui fus faible comme une mère,
Je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts.
Je me sens éclairé dans ma douleur amère
Par un meilleur regard jeté sur l’univers.
Seigneur, je reconnais que l’homme est en délire,
S’il ose murmurer ;
Je cesse d’accuser, je cesse de maudire,
Mais laissez-moi pleurer !
Hélas ! laissez les pleurs couler de ma paupière,
Puisque vous avez fait les hommes pour cela !
Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre
Et dire à mon enfant : Sens-tu que je suis là ?
Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes,
Le soir, quand tout se tait,
Comme si, dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes,
Cet ange m’écoutait !
Hélas ! vers le passé tournant un oeil d’envie,
Sans que rien ici-bas puisse m’en consoler,
Je regarde toujours ce moment de ma vie
Où je l’ai vue ouvrir son aile et s’envoler !
Je verrai cet instant jusqu’à ce que je meure,
L’instant, pleurs superflus !
Où je criai : L’enfant que j’avais tout à l’heure,
Quoi donc ! je ne l’ai plus !
Ne vous irritez pas que je sois de la sorte,
O mon Dieu ! cette plaie a si longtemps saigné !
L’angoisse dans mon âme est toujours la plus forte,
Et mon cœur est soumis, mais n’est pas résigné.
Ne vous irritez pas ! fronts que le deuil réclame,
Mortels sujets aux pleurs,
Il nous est malaisé de retirer notre âme
De ces grandes douleurs.
Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires,
Seigneur ; quand on a vu dans sa vie, un matin,
Au milieu des ennuis, des peines, des misères,
Et de l’ombre que fait sur nous notre destin,
Apparaître un enfant, tête chère et sacrée,
Petit être joyeux,
Si beau, qu’on a cru voir s’ouvrir à son entrée
Une porte des cieux ;
Quand on a vu, seize ans, de cet autre soi-même
Croître la grâce aimable et la douce raison,
Lorsqu’on a reconnu que cet enfant qu’on aime
ait le jour dans notre âme et dans notre maison,
Que c’est la seule joie ici-bas qui persiste
De tout ce qu’on rêva,
Considérez que c’est une chose bien triste
De le voir qui s’en va !