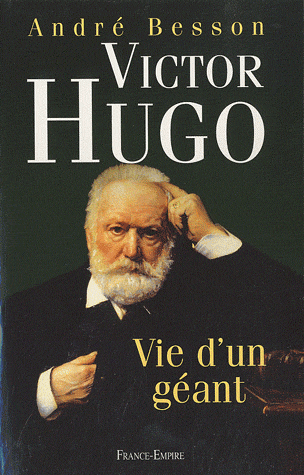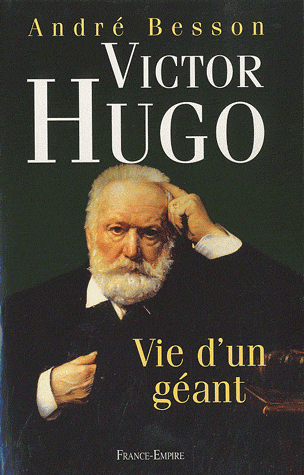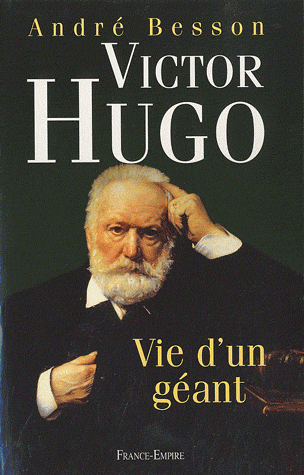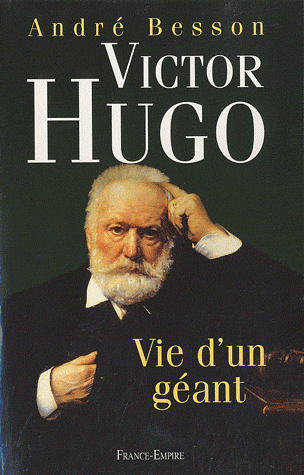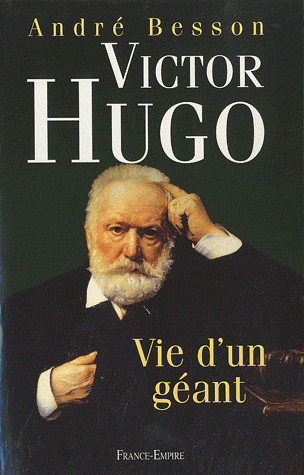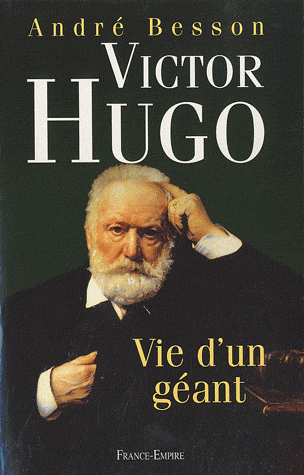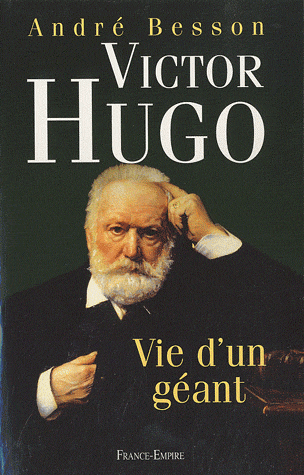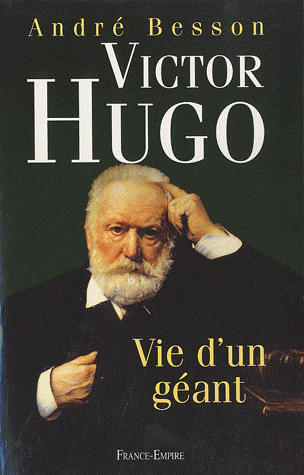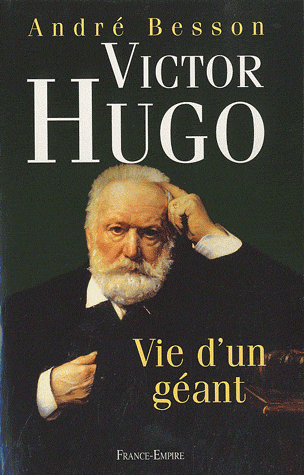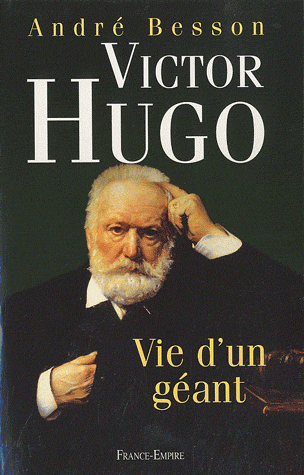afrique alphabet ange automne avatars chat animé banniere bannières barre belle belle image bleu blinkie
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· BELLE IMAGE CREATION DIVERS BIS (6781)
· CADRE (2357)
· VISAGE DE FEMME (1531)
· Femme (1324)
· Stars (1120)
· Tube cookie (1037)
· FOND D ECRAN DRAGON (575)
· Gif scintillant (556)
· FOND D ECRAN ANGE (418)
· Gif animaux animés (1052)
- · victor hugo poeme a.m.froment-meurice
- · une terre au flanc maigre victor hugo analyse
- · une terre au flanc maigre analyse
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
· tube parchemin
· oiseau gif anime
· belle image
· oiseau gif anime
· generateur de texte defilant
· gif chien
· fond d ecran
· fond d ecran
· BELLE IMAGE
· LES PREMIERS ORDINATEURS
· gif chat
· Coloriage blanche neige
· FOND D'ECRAN CHOPPER ET HARLEY
· cadeau de http://mamiebabou.centerblog.net/ merci
· FOND D ECRAN CHATS
Statistiques
Date de création : 09.08.2009
Dernière mise à jour :
31.01.2016
113496 articles
POEME VICTOR HUGO
epitaphe
Il vivait, il jouait, riante créature.
Que te sert d’avoir pris cet enfant, ô nature ?
N’as-tu pas les oiseaux peints de mille couleurs,
Les astres, les grands bois, le ciel bleu, l’onde amère ?
Que te sert d’avoir pris cet enfant à sa mère,
Et de l’avoir caché sous des touffes de fleurs ?
Pour cet enfant de plus tu n’es pas plus peuplée,
Tu n’es pas plus joyeuse, ô nature étoilée !
Et le cœur de la mère en proie à tant de soins,
Ce cœur où toute joie engendre une torture,
Cet abîme aussi grand que toi-même, ô nature,
Est vide et désolé pour cet enfant de moins !
il fait froid
L’hiver blanchit le dur chemin.
Tes jours aux méchants sont en proie.
La bise mord ta douce main;
La haine souffle sur ta joie.
La neige emplit le noir sillon.
La lumière est diminuée… –
Ferme ta porte à l’aquilon!
Ferme ta vitre à la nuée!
Et puis laisse ton coeur ouvert!
Le coeur, c’est la sainte fenêtre.
Le soleil de brume est couvert;
Mais Dieu va rayonner peut-être!
Doute du bonheur, fruit mortel;
Doute de l’homme plein d’envie;
Doute du prêtre et de l’autel;
Mais crois à l’amour, ô ma vie!
Crois à l’amour, toujours entier,
Toujours brillant sous tous les voiles!
A l’amour, tison du foyer!
A l’amour rayon des étoiles!
Aime et ne désespère pas,
Dans ton âme où parfois je passe,
Où mes vers chuchotent tout bas,
Laisse chaque chose à sa place.
La fidélité sans ennui,
La paix des vertus élevées,
Et l’indulgence pour autrui,
Éponge des fautes lavées.
Dans ta pensée où tout est beau,
Que rien ne tombe ou ne recule.
Fais de ton amour ton flambeau.
On s’éclaire de ce qui brûle.
A ces démons d’inimitié,
Oppose ta douceur sereine,
Et reverse-leur en pitié
Tout ce qu’ils t’ont vomi de haine.
La haine, c’est l’hiver du coeur.
Plains-les! mais garde ton courage.
Garde ton sourire vainqueur;
Bel arc-en-ciel, sors de l’orage!
Garde ton amour éternel.
L’hiver, l’astre éteint-il sa flamme?
Dieu ne retire rien du ciel,
Ne retire rien de ton âme!
a mademoiselle louise b
L’année en s’enfuyant par l’année est suivie.
Encore une qui meurt ! encore un pas du temps ;
Encore une limite atteinte dans la vie !
Encore un sombre hiver jeté sur nos printemps !
Le temps ! les ans ! les jours ! mots que la foule ignore !
Mots profonds qu’elle croit à d’autres mots pareils !
Quand l’heure tout-à-coup lève sa voix sonore,
Combien peu de mortels écoutent ses conseils !
L’homme les use, hélas ! ces fugitives heures,
En folle passion, en folle volupté,
Et croit que Dieu n’a pas fait de choses meilleures
Que les chants, les banquets, le rire et la beauté !
Son temps dans les plaisirs s’en va sans qu’il y pense.
Imprudent ! est-il sûr de demain ? d’aujourd’hui ?
En dépensant ses jours, sait-il ce qu’il dépense ?
Le nombre en est compté par un autre que lui.
A peine lui vient-il une grave pensée
Quand, au sein d’un festin qui satisfait ses vœux,
Ivre, il voit tout-à-coup de sa tête affaissée
Tomber en même temps les fleurs et les cheveux ;
Quand ses projets hâtifs l’un sur l’autre s’écroulent ;
Quand ses illusions meurent à son côté ;
Quand il sent le niveau de ses jours qui s’écoulent,
Baisser rapidement comme un torrent d’été.
Alors en chancelant il s’écrie, il réclame,
Il dit : Ai-je donc bu toute cette liqueur ?
Plus de vin pour ma soif ! plus d’amour pour mon âme !
Qui donc vide à la fois et ma coupe et mon cœur ?
Mais rien ne lui répond. — Et triste, et le front blême,
De ses débiles mains, de son souffle glacé,
Vainement il remue, en s’y cherchant lui-même,
Ce tas de cendre éteint qu’on nomme le passé !
II
Ainsi nous allons tous. — Mais vous dont l’âme est forte,
Vous dont le cœur est grand, vous dites : — Que m’importe
Si le temps fuit toujours,
Et si toujours un souffle emporte quand il passe,
Pêle-mêle à travers la durée et l’espace,
Les hommes et les jours ! —
Car vous avez le goût de ce qui seul peut vivre ;
Sur Dante et sur Mozart, sur la note et le livre,
Votre front est courbé.
Car vous avez l’amour des choses immortelles ;
Rien de ce que le temps emporte sur ses ailes
Des vôtres n’est tombé !
Quelquefois, quand l’esprit vous presse et vous réclame,
Une musique en feu s’échappe de votre âme,
Musique aux chants vainqueurs,
Au souffle pur, plus doux que l’aile des zéphires,
Qui palpite et qui fait vibrer comme des lyres
Les fibres de nos cœurs !
Dans ce siècle où l’éclair reluit sur chaque tête,
Où le monde, jeté de tempête en tempête,
S’écrie avec frayeur,
Vous avez su vous faire, en la nuit qui redouble,
Une sérénité qui traverse sans trouble
L’orage extérieur !
Soyez toujours ainsi ! l’amour d’une famille ;
Le centre autour duquel tout gravite et tout brille ;
La sœur qui nous défend ;
Prodigue d’indulgence et de blâme économe ;
Femme au cœur grave et doux ; sérieuse avec l’homme,
Folâtre avec l’enfant !
Car pour garder toujours la beauté de son âme,
Pour se remplir le cœur, riche ou pauvre, homme ou femme,
De pensers bienveillants,
Vous avez ce qu’on peut, après Dieu, sur la terre,
Contempler de plus saint et de plus salutaire,
Un père en cheveux blancs !
sonnez sonnez toujours clairons de la penssee
Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée.
Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée,
Suivi des siens, marchait, et, prophète irrité,
Sonnait de la trompette autour de la cité,
Au premier tour qu’il fit, le roi se mit à rire ;
Au second tour, riant toujours, il lui fit dire :
« Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ? »
A la troisième fois l’arche allait en avant,
Puis les trompettes, puis toute l’armée en marche,
Et les petits enfants venaient cracher sur l’arche,
Et, soufflant dans leur trompe, imitaient le clairon ;
Au quatrième tour, bravant les fils d’Aaron,
Entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille,
Les femmes s’asseyaient en filant leur quenouille,
Et se moquaient, jetant des pierres aux hébreux ;
A la cinquième fois, sur ces murs ténébreux,
Aveugles et boiteux vinrent, et leurs huées
Raillaient le noir clairon sonnant sous les nuées
A la sixième fois, sur sa tour de granit
Si haute qu’au sommet l’aigle faisait son nid,
Si dure que l’éclair l’eût en vain foudroyée,
Le roi revint, riant à gorge déployée,
Et cria : « Ces hébreux sont bons musiciens ! »
Autour du roi joyeux riaient tous les anciens
Qui le soir sont assis au temple, et délibèrent.
A la septième fois, les murailles tombèrent.
a celle qui est restee en france
Mets-toi sur ton séant, lève tes yeux, dérange
Ce drap glacé qui fait des plis sur ton front d’ange,
Ouvre tes mains, et prends ce livre : il est à toi.
Ce livre où vit mon âme, espoir, deuil, rêve, effroi,
Ce livre qui contient le spectre de ma vie,
Mes angoisses, mon aube, hélas ! de pleurs suivie,
L’ombre et son ouragan, la rose et son pistil,
Ce livre azuré, triste, orageux, d’où sort-il ?
D’où sort le blême éclair qui déchire la brume ?
Depuis quatre ans, j’habite un tourbillon d’écume ;
Ce livre en a jailli. Dieu dictait, j’écrivais ;
Car je suis paille au vent. Va ! dit l’esprit. Je vais.
Et, quand j’eus terminé ces pages, quand ce livre
Se mit à palpiter, à respirer, à vivre,
Une église des champs, que le lierre verdit,
Dont la tour sonne l’heure à mon néant, m’a dit :
Ton cantique est fini ; donne-le-moi, poëte.
? Je le réclame, a dit la forêt inquiète ;
Et le doux pré fleuri m’a dit : ? Donne-le-moi.
La mer, en le voyant frémir, m’a dit : ? Pourquoi
Ne pas me le jeter, puisque c’est une voile !
? C’est à moi qu’appartient cet hymne, a dit l’étoile.
? Donne-le-nous, songeur, ont crié les grands vents.
Et les oiseaux m’ont dit : ? Vas-tu pas aux vivants
Offrir ce livre, éclos si loin de leurs querelles ?
Laisse-nous l’emporter dans nos nids sur nos ailes ! —
Mais le vent n’aura point mon livre, ô cieux profonds !
Ni la sauvage mer, livrée aux noirs typhons,
Ouvrant et refermant ses flots, âpres embûches ;
Ni la verte forêt qu’emplit un bruit de ruches ;
Ni l’église où le temps fait tourner son compas ;
Le pré ne l’aura pas, l’astre ne l’aura pas,
L’oiseau ne l’aura pas, qu’il soit aigle ou colombe,
Les nids ne l’auront pas ; je le donne à la tombe.
II
Autrefois, quand septembre en larmes revenait,
Je partais, je quittais tout ce qui me connaît,
Je m’évadais ; Paris s’effaçait ; rien, personne !
J’allais, je n’étais plus qu’une ombre qui frissonne,
Je fuyais, seul, sans voir, sans penser, sans parler,
Sachant bien que j’irais où je devais aller ;
Hélas ! je n’aurais pu même dire : Je souffre !
Et, comme subissant l’attraction d’un gouffre,
Que le chemin fût beau, pluvieux, froid, mauvais,
J’ignorais, je marchais devant moi, j’arrivais.
Ô souvenirs ! ô forme horrible des collines !
Et, pendant que la mère et la sœur, orphelines,
Pleuraient dans la maison, je cherchais le lieu noir
Avec l’avidité morne du désespoir ;
Puis j’allais au champ triste à côté de l’église ;
Tête nue, à pas lents, les cheveux dans la bise,
L’œil aux cieux, j’approchais ; l’accablement soutient ;
Les arbres murmuraient : C’est le père qui vient !
Les ronces écartaient leurs branches desséchées ;
Je marchais à travers les humbles croix penchées,
Disant je ne sais quels doux et funèbres mots ;
Et je m’agenouillais au milieu des rameaux
Sur la pierre qu’on voit blanche dans la verdure.
Pourquoi donc dormais-tu d’une façon si dure
Que tu n’entendais pas lorsque je t’appelais ?
Et les pêcheurs passaient en traînant leurs filets,
Et disaient : Qu’est-ce donc que cet homme qui songe ?
Et le jour, et le soir, et l’ombre qui s’allonge,
Et Vénus, qui pour moi jadis étincela,
Tout avait disparu que j’étais encor là.
J’étais là, suppliant celui qui nous exauce ;
J’adorais, je laissais tomber sur cette fosse,
Hélas ! où j’avais vu s’évanouir mes cieux,
Tout mon cœur goutte à goutte en pleurs silencieux ;
J’effeuillais de la sauge et de la clématite ;
Je me la rappelais quand elle était petite,
Quand elle m’apportait des lys et des jasmins,
Ou quand elle prenait ma plume dans ses mains,
Gaie, et riant d’avoir de l’encre à ses doigts roses ;
Je respirais les fleurs sur cette cendre écloses,
Je fixais mon regard sur ces froids gazons verts,
Et par moments, ô Dieu, je voyais, à travers
La pierre du tombeau, comme une lueur d’âme !
Oui, jadis, quand cette heure en deuil qui me réclame
Tintait dans le ciel triste et dans mon cœur saignant,
Rien ne me retenait, et j’allais ; maintenant,
Hélas !… ? Ô fleuve ! ô bois ! vallons dont je fus l’hôte,
Elle sait, n’est-ce pas ? que ce n’est pas ma faute
Si, depuis ces quatre ans, pauvre cœur sans flambeau,
Je ne suis pas allé prier sur son tombeau !
III
Ainsi, ce noir chemin que je faisais, ce marbre
Que je contemplais, pâle, adossé contre un arbre,
Ce tombeau sur lequel mes pieds pouvaient marcher,
La nuit, que je voyais lentement approcher,
Ces ifs, ce crépuscule avec ce cimetière,
Ces sanglots, qui du moins tombaient sur cette pierre,
Ô mon Dieu, tout cela, c’était donc du bonheur !
Dis, qu’as-tu fait pendant tout ce temps-là ? ? Seigneur,
Qu’a-t-elle fait ? — Vois-tu la vie en vos demeures ?
À quelle horloge d’ombre as-tu compté les heures ?
As-tu sans bruit parfois poussé l’autre endormi ?
Et t’es-tu, m’attendant, réveillée à demi ?
T’es-tu, pâle, accoudée à l’obscure fenêtre
De l’infini, cherchant dans l’ombre à reconnaître
Un passant, à travers le noir cercueil mal joint,
Attentive, écoutant si tu n’entendais point
Quelqu’un marcher vers toi dans l’éternité sombre ?
Et t’es-tu recouchée ainsi qu’un mât qui sombre,
En disant : Qu’est-ce donc ? mon père ne vient pas !
Avez-vous tous les deux parlé de moi tout bas ?
Que de fois j’ai choisi, tout mouillés de rosée,
Des lys dans mon jardin, des lys dans ma pensée !
Que de fois j’ai cueilli de l’aubépine en fleur !
Que de fois j’ai, là-bas, cherché la tour d’Harfleur,
Murmurant : C’est demain que je pars ! et, stupide,
Je calculais le vent et la voile rapide,
Puis ma main s’ouvrait triste, et je disais : Tout fuit !
Et le bouquet tombait, sinistre, dans la nuit !
Oh ! que de fois, sentant qu’elle devait m’attendre,
J’ai pris ce que j’avais dans le cœur de plus tendre
Pour en charger quelqu’un qui passerait par là !
Lazare ouvrit les yeux quand Jésus l’appela ;
Quand je lui parle, hélas ! pourquoi les ferme-t-elle ?
Où serait donc le mal quand de l’ombre mortelle
L’amour violerait deux fois le noir secret,
Et quand, ce qu’un dieu fit, un père le ferait ?
IV
Que ce livre, du moins, obscur message, arrive,
Murmure, à ce silence, et, flot, à cette rive !
Qu’il y tombe, sanglot, soupir, larme d’amour !
Qu’il entre en ce sépulcre où sont entrés un jour
Le baiser, la jeunesse, et l’aube, et la rosée,
Et le rire adoré de la fraîche épousée,
Et la joie, et mon cœur, qui n’est pas ressorti !
Qu’il soit le cri d’espoir qui n’a jamais menti,
Le chant du deuil, la voix du pâle adieu qui pleure,
Le rêve dont on sent l’aile qui nous effleure !
Qu’elle dise : Quelqu’un est là ; j’entends du bruit !
Qu’il soit comme le pas de mon âme en sa nuit !
Ce livre, légion tournoyante et sans nombre
D’oiseaux blancs dans l’aurore et d’oiseaux noirs dans l’ombre,
Ce vol de souvenirs fuyant à l’horizon,
Cet essaim que je lâche au seuil de ma prison,
Je vous le confie, air, souffles, nuée, espace !
Que ce fauve océan qui me parle à voix basse,
Lui soit clément, l’épargne et le laisse passer !
Et que le vent ait soin de n’en rien disperser,
Et jusqu’au froid caveau fidèlement apporte
Ce don mystérieux de l’absent à la morte !
Ô Dieu ! puisqu’en effet, dans ces sombres feuillets,
Dans ces strophes qu’au fond de vos cieux je cueillais,
Dans ces chants murmurés comme un épithalame
Pendant que vous tourniez les pages de mon âme,
Puisque j’ai, dans ce livre, enregistré mes jours,
Mes maux, mes deuils, mes cris dans les problèmes sourds,
Mes amours, mes travaux, ma vie heure par heure ;
Puisque vous ne voulez pas encor que je meure,
Et qu’il faut bien pourtant que j’aille lui parler ;
Puisque je sens le vent de l’infini souffler
Sur ce livre qu’emplit l’orage et le mystère ;
Puisque j’ai versé là toutes vos ombres, terre,
Humanité, douleur, dont je suis le passant ;
Puisque de mon esprit, de mon cœur, de mon sang,
J’ai fait l’âcre parfum de ces versets funèbres,
Va-t’en, livre, à l’azur, à travers les ténèbres !
Fuis vers la brume où tout à pas lents est conduit !
Oui, qu’il vole à la fosse, à la tombe, à la nuit,
Comme une feuille d’arbre ou comme une âme d’homme !
Qu’il roule au gouffre où va tout ce que la voix nomme !
Qu’il tombe au plus profond du sépulcre hagard,
À côté d’elle, ô mort ! et que là, le regard,
Près de l’ange qui dort, lumineux et sublime,
Le voie épanoui, sombre fleur de l’abîme !
V
Ô doux commencements d’azur qui me trompiez,
Ô bonheurs ! je vous ai durement expiés !
J’ai le droit aujourd’hui d’être, quand la nuit tombe,
Un de ceux qui se font écouter de la tombe,
Et qui font, en parlant aux morts blêmes et seuls,
Remuer lentement les plis noirs des linceuls,
Et dont la parole, âpre ou tendre, émeut les pierres,
Les grains dans les sillons, les ombres dans les bières,
La vague et la nuée, et devient une voix
De la nature, ainsi que la rumeur des bois.
Car voilà, n’est-ce pas, tombeaux ? bien des années,
Que je marche au milieu des croix infortunées,
Échevelé parmi les ifs et les cyprès,
L’âme au bord de la nuit, et m’approchant tout près,
Et que je vais, courbé sur le cercueil austère,
Questionnant le plomb, les clous, le ver de terre
Qui pour moi sort des yeux de la tête de mort,
Le squelette qui rit, le squelette qui mord,
Les mains aux doigts noueux, les crânes, les poussières,
Et les os des genoux qui savent des prières !
Hélas ! j’ai fouillé tout. J’ai voulu voir le fond.
Pourquoi le mal en nous avec le bien se fond,
J’ai voulu le savoir. J’ai dit : Que faut-il croire ?
J’ai creusé la lumière, et l’aurore, et la gloire,
L’enfant joyeux, la vierge et sa chaste frayeur,
Et l’amour, et la vie, et l’âme, — fossoyeur.
Qu’ai-je appris ? J’ai, pensif, tout saisi sans rien prendre ;
J’ai vu beaucoup de nuit et fait beaucoup de cendre.
Qui sommes-nous ? que veut dire ce mot : Toujours ?
J’ai tout enseveli, songes, espoirs, amours,
Dans la fosse que j’ai creusée en ma poitrine.
Qui donc a la science ? où donc est la doctrine ?
Oh ! que ne suis-je encor le rêveur d’autrefois,
Qui s’égarait dans l’herbe, et les prés, et les bois,
Qui marchait souriant, le soir, quand le ciel brille,
Tenant la main petite et blanche de sa fille,
Et qui, joyeux, laissant luire le firmament,
Laissant l’enfant parler, se sentait lentement
Emplir de cet azur et de cette innocence !
Entre Dieu qui flamboie et l’ange qui l’encense,
J’ai vécu, j’ai lutté, sans crainte, sans remord.
Puis ma porte soudain s’ouvrit devant la mort,
Cette visite brusque et terrible de l’ombre.
Tu passes en laissant le vide et le décombre,
Ô spectre ! tu saisis mon ange et tu frappas.
Un tombeau fut dès lors le but de tous mes pas.
VI
Je ne puis plus reprendre aujourd’hui dans la plaine
Mon sentier d’autrefois qui descend vers la Seine ;
Je ne puis plus aller où j’allais ; je ne puis,
Pareil à la laveuse assise au bord du puits,
Que m’accouder au mur de l’éternel abîme ;
Paris m’est éclipsé par l’énorme Solime ;
La haute Notre-Dame à présent, qui me luit,
C’est l’ombre ayant deux tours, le silence et la nuit,
Et laissant des clartés trouer ses fatals voiles ;
Et je vois sur mon front un panthéon d’étoiles ;
Si j’appelle Rouen, Villequier, Caudebec,
Toute l’ombre me crie : Horeb, Cédron, Balbeck !
Et, si je pars, m’arrête à la première lieue,
Et me dit : Tourne-toi vers l’immensité bleue !
Et me dit : Les chemins où tu marchais sont clos.
Penche-toi sur les nuits, sur les vents, sur les flots !
À quoi penses-tu donc ? que fais-tu, solitaire ?
Crois-tu donc sous tes pieds avoir encor la terre ?
Où vas-tu de la sorte et machinalement ?
Ô songeur ! penche-toi sur l’être et l’élément !
Écoute la rumeur des âmes dans les ondes !
Contemple, s’il te faut de la cendre, les mondes ;
Cherche au moins la poussière immense, si tu veux
Mêler de la poussière à tes sombres cheveux,
Et regarde, en dehors de ton propre martyre,
Le grand néant, si c’est le néant qui t’attire !
Sois tout à ces soleils où tu remonteras !
Laisse là ton vil coin de terre. Tends les bras,
Ô proscrit de l’azur, vers les astres patries !
Revois-y refleurir tes aurores flétries ;
Deviens le grand œil fixe ouvert sur le grand tout.
Penche-toi sur l’énigme où l’être se dissout,
Sur tout ce qui naît, vit, marche, s’éteint, succombe,
Sur tout le genre humain et sur toute la tombe !
Mais mon cœur toujours saigne et du même côté.
C’est en vain que les cieux, les nuits, l’éternité,
Veulent distraire une âme et calmer un atome.
Tout l’éblouissement des lumières du dôme
M’ôte-t-il une larme ? Ah ! l’étendue a beau
Me parler, me montrer l’universel tombeau,
Les soirs sereins, les bois rêveurs, la lune amie ;
J’écoute, et je reviens à la douce endormie.
VII
Des fleurs ! oh ! si j’avais des fleurs ! si Je pouvais
Aller semer des lys sur ces deux froids chevets !
Si je pouvais couvrir de fleurs mon ange pâle !
Les fleurs sont l’or, l’azur, l’émeraude, l’opale !
Le cercueil au milieu des fleurs veut se coucher ;
Les fleurs aiment la mort, et Dieu les fait toucher
Par leur racine aux os, par leur parfum aux âmes !
Puisque je ne le puis, aux lieux que nous aimâmes,
Puisque Dieu ne veut pas nous laisser revenir,
Puisqu’il nous fait lâcher ce qu’on croyait tenir,
Puisque le froid destin, dans ma geôle profonde,
Sur la première porte en scelle une seconde,
Et, sur le père triste et sur l’enfant qui dort,
Ferme l’exil après avoir fermé la mort,
Puisqu’il est impossible à présent que je jette
Même un brin de bruyère à sa fosse muette,
C’est bien le moins qu’elle ait mon âme, n’est-ce pas ?
Ô vent noir dont j’entends sur mon plafond le pas !
Tempête, hiver, qui bats ma vitre de ta grêle !
Mers, nuits ! et je l’ai mise en ce livre pour elle !
Prends ce livre ; et dis-toi : Ceci vient du vivant
Que nous avons laissé derrière nous, rêvant.
Prends. Et, quoique de loin, reconnais ma voix, âme !
Oh ! ta cendre est le lit de mon reste de flamme ;
Ta tombe est mon espoir, ma charité, ma foi ;
Ton linceul toujours flotte entre la vie et moi.
Prends ce livre, et fais-en sortir un divin psaume !
Qu’entre tes vagues mains il devienne fantôme !
Qu’il blanchisse, pareil à l’aube qui pâlit,
À mesure que l’œil de mon ange le lit,
Et qu’il s’évanouisse, et flotte, et disparaisse,
Ainsi qu’un âtre obscur qu’un souffle errant caresse,
Ainsi qu’une lueur qu’on voit passer le soir,
Ainsi qu’un tourbillon de feu de l’encensoir,
Et que, sous ton regard éblouissant et sombre,
Chaque page s’en aille en étoiles dans l’ombre !
VIII
Oh ! quoi que nous fassions et quoi que nous disions,
Soit que notre âme plane au vent des visions,
Soit qu’elle se cramponne à l’argile natale,
Toujours nous arrivons à ta grotte fatale,
Gethsémani ! qu’éclaire une vague lueur !
Ô rocher de l’étrange et funèbre sueur !
Cave où l’esprit combat le destin ! ouverture
Sur les profonds effrois de la sombre nature !
Antre d’où le lion sort rêveur, en voyant
Quelqu’un de plus sinistre et de plus effrayant,
La douleur, entrer, pâle, amère, échevelée !
Ô chute ! asile ! ô seuil de la trouble vallée
D’où nous apercevons nos ans fuyants et courts,
Nos propres pas marqués dans la fange des jours,
L’échelle où le mal pèse et monte, spectre louche,
L’âpre frémissement de la palme farouche,
Les degrés noirs tirant en bas les blancs degrés,
Et les frissons aux fronts des anges effarés !
Toujours nous arrivons à cette solitude,
Et, là, nous nous taisons, sentant la plénitude !
Paix à l’ombre ! Dormez ! dormez ! dormez ! dormez !
Êtres, groupes confus lentement transformés !
Dormez, les champs ! dormez, les fleurs ! dormez, les tombes !
Toits, murs, seuils des maisons, pierres des catacombes,
Feuilles au fond des bois, plumes au fond des nids,
Dormez ! dormez, brins d’herbe, et dormez, infinis !
Calmez-vous, forêt, chêne, érable, frêne, yeuse !
Silence sur la grande horreur religieuse,
Sur l’océan qui lutte et qui ronge son mors,
Et sur l’apaisement insondable des morts !
Paix à l’obscurité muette et redoutée,
Paix au doute effrayant, à l’immense ombre athée,
À toi, nature, cercle et centre, âme et milieu,
Fourmillement de tout, solitude de Dieu !
Ô générations aux brumeuses haleines,
Reposez-vous ! pas noirs qui marchez dans les plaines !
Dormez, vous qui saignez ; dormez, vous qui pleurez !
Douleurs, douleurs, douleurs, fermez vos yeux sacrés !
Tout est religion et rien n’est imposture.
Que sur toute existence et toute créature,
Vivant du souffle humain ou du souffle animal,
Debout au seuil du bien, croulante au bord du mal,
Tendre ou farouche, immonde ou splendide, humble ou grande,
La vaste paix des cieux de toutes parts descende !
Que les enfers dormants rêvent les paradis !
Assoupissez-vous, flots, mers, vents, âmes, tandis
Qu’assis sur la montagne en présence de l’Être,
Précipice où l’on voit pêle-mêle apparaître
Les créations, l’astre et l’homme, les essieux
De ces chars de soleil que nous nommons les cieux,
Les globes, fruits vermeils des divines ramées,
Les comètes d’argent dans un champ noir semées,
Larmes blanches du drap mortuaire des nuits,
Les chaos, les hivers, ces lugubres ennuis,
Pâle, ivre d’ignorance, ébloui de ténèbres,
Voyant dans l’infini s’écrire des algèbres,
Le contemplateur, triste et meurtri, mais serein,
Mesure le problème aux murailles d’airain,
Cherche à distinguer l’aube à travers les prodiges,
Se penche, frémissant, au puits des grands vertiges,
Suit de l’œil des blancheurs qui passent, alcyons,
Et regarde, pensif, s’étoiler de rayons,
De clartés, de lueurs, vaguement enflammées,
Le gouffre monstrueux plein d’énormes fumées.
o
en frappant a une porte
J’ai perdu mon père et ma mère,
Mon premier né, bien jeune, hélas !
Et pour moi la nature entière
Sonne le glas.
Je dormais entre mes deux frères ;
Enfants, nous étions trois oiseaux ;
Hélas ! le sort change en deux bières
Leurs deux berceaux.
Je t’ai perdue, ô fille chère,
Toi qui remplis, ô mon orgueil,
Tout mon destin de la lumière
De ton cercueil !
J’ai su monter, j’ai su descendre.
J’ai vu l’aube et l’ombre en mes cieux.
J’ai connu la pourpre, et la cendre
Qui me va mieux.
J’ai connu les ardeurs profondes,
J’ai connu les sombres amours ;
J’ai vu fuir les ailes, les ondes,
Les vents, les jours.
J’ai sur ma tête des orfraies ;
J’ai sur tous mes travaux l’affront,
Aux pieds la poudre, au cœur des plaies,
L’épine au front.
J’ai des pleurs à mon oeil qui pense,
Des trous à ma robe en lambeau ;
Je n’ai rien à la conscience ;
Ouvre, tombeau.
a aug v
Et, toi, son frère, sois le frère de mes fils.
Cœur fier, qui du destin relèves les défis,
Suis à côté de moi la voie inexorable.
Que ta mère au front gris soit ma sœur vénérable !
Ton frère dort couché dans le sépulcre noir ;
Nous, dans la nuit du sort, dans l’ombre du devoir,
Marchons à la clarté qui sort de cette pierre.
Qu’il dorme, voyant l’aube à travers sa paupière !
Un jour, quand on lira nos temps mystérieux,
Les songeurs attendris promèneront leurs yeux
De toi, le dévouement, à lui, le sacrifice.
Nous habitons du sphinx le lugubre édifice ;
Nous sommes, cœurs liés au morne piédestal,
Tous la fatale énigme et tous le mot fatal.
Ah ! famille ! ah ! douleur ! ô sœur ! ô mère ! ô veuve !
O sombres lieux, qu’emplit le murmure du fleuve !
Chaste tombe jumelle au pied du coteau vert !
Poëte, quand mon sort s’est brusquement ouvert,
Tu n’as pas reculé devant les noires portes,
Et, sans pâlir, avec le flambeau que tu portes,
Tes chants, ton avenir que l’absence interrompt,
Et le frémissement lumineux de ton front,
Trouvant la chute belle et le malheur propice,
Calme, tu t’es jeté dans le grand précipice !
Hélas ! c’est par les deuils que nous nous enchaînons.
O frères, que vos noms soient mêlés à nos noms !
Dieu vous fait des rayons de toutes nos ténèbres,
Car vous êtes entrés sous nos voûtes funèbres ;
Car vous avez été tous deux vaillants et doux ;
Car vous avez tous deux, vous rapprochant de nous
À l’heure où vers nos fronts roulait le gouffre d’ombre,
Accepté notre sort dans ce qu’il a de sombre,
Et suivi, dédaignant l’abîme et le péril,
Lui, la fille au tombeau, toi, le père à l’exil !
sentier ou l herbe se balance
Sentiers où l’herbe se balance,
Vallons, coteaux, bois chevelus,
Pourquoi ce deuil et ce silence ?
- Celui qui venait ne vient plus.
- Pourquoi personne à ta fenêtre,
Et pourquoi ton jardin sans fleurs,.
Ô maison ? où donc est ton maître ?
- Je ne sais pas, il est ailleurs.
- Chien, veille au logis. – Pourquoi faire ?
La maison est vide à présent.
-Enfant, qui pleures-tu ?- Mon père.
-Femme, qui pleures-tu ? – L’absent.
- Où s’en est-il allé ? – Dans l’ombre.
- Flots qui gémissez sur l’écueil,
D’où venez-vous ? – Du bagne sombre.
- Et qu’apportez-vous ? Un cercueil.
croire mais pas en nous
Parce qu’on a porté du pain, du linge blanc,
À quelque humble logis sous les combles tremblant
Comme le nid parmi les feuilles inquiètes ;
Parce qu’on a jeté ses restes et ses miettes
Au petit enfant maigre, au vieillard pâlissant,
Au pauvre qui contient l’éternel tout-puissant ;
Parce qu’on a laissé Dieu manger sous sa table,
On se croit vertueux, on se croit charitable !
On dit : —Je suis parfait ! louez-moi ; me voilà ! -
Et, tout en blâmant Dieu de ceci, de cela,
De ce qu’il pleut, du mal dont on le dit la cause,
Du chaud, du froid, on fait sa propre apothéose.
Le riche qui, gorgé, repu, fier, paresseux,
Laisse un peu d’or rouler de son palais sur ceux
Que le noir janvier glace et que la faim harcèle,
Ce riche-là, qui brille et donne une parcelle
De ce qu’il a de trop, et qui n’a pas assez,
Et qui, pour quelques sous du pauvre ramassés,
S’admire et ferme l’œil sur sa propre misère,
S’il a le superflu, n’a pas le nécessaire :
La justice ; et le loup rit dans l’ombre en marchant
De voir qu’il se croit bon pour n’être pas méchant.
Nous bons ! nous fraternels ! ô fange et pourriture !
Mais tournez donc vos yeux vers la mère nature !
Que sommes-nous, cœurs froids où l’égoïsme bout,
Auprès de la bonté suprême éparse en tout ?
Toutes nos actions ne valent pas la rose.
Dès que nous avons fait par hasard quelque chose,
Nous nous vantons, hélas ! vains souffles qui fuyons !
Dieu donne l’aube au ciel sans compter les rayons,
Et la rosée aux fleurs sans mesurer les gouttes ;
Nous sommes le néant ; nos vertus tiendraient toutes
Dans le creux de la pierre où vient boire l’oiseau.
L’homme est l’orgueil du cèdre emplissant le roseau.
Le meilleur n’est pas bon, vraiment, tant l’homme est frêle ;
Et tant notre fumée à nos vertus se mêle !
Le bienfait par nos mains pompeusement jeté
S’évapore aussitôt dans notre vanité ;
Même en le prodiguant aux pauvres d’un air tendre,
Nous avons tant d’orgueil que notre or devient cendre ;
Le bien que nous faisons est spectre comme nous.
L’Incréé, seul vivant, seul terrible et seul doux,
Qui juge, aime, pardonne, engendre, construit, fonde,
Voit nos hauteurs avec une pitié profonde.
Ah ! rapides passants ! ne comptons pas sur nous,
Comptons sur lui. Pensons et vivons à genoux ;
Tâchons d’être sagesse, humilité, lumière ;
Ne faisons point un pas qui n’aille à la prière ;
Car nos perfections rayonneront bien peu
Après la mort, devant l’étoile et le ciel bleu.
Dieu seul peut nous sauver. C’est un rêve de croire
Que nos lueurs d’en bas sont là-haut de la gloire ;
Si lumineux qu’il ait paru dans notre horreur,
Si doux qu’il ait été pour nos cœurs pleins d’erreur,
Quoi qu’il ait fait, celui que sur la terre on nomme
Juste, excellent, pur, sage et grand, là-haut est l’homme,
C’est-à-dire la nuit en présence du jour ;
Son amour semble haine auprès du grand amour ;
Et toutes ses splendeurs, poussant des cris funèbres,
Disent en voyant Dieu : Nous sommes les ténèbres !
Dieu, c’est le seul azur dont le monde ait besoin.
L’abîme en en parlant prend l’atome à témoin.
Dieu seul est grand ! c’est là le psaume du brin d’herbe ;
Dieu seul est vrai ! c’est là l’hymne du flot superbe ;
Dieu seul est bon ! c’est là le murmure des vents ;
Ah ! ne vous faites pas d’illusions, vivants !
Et d’où sortez-vous donc, pour croire que vous êtes
Meilleurs que Dieu, qui met les astres sur vos têtes,
Et qui vous éblouit, à l’heure du réveil,
De ce prodigieux sourire, le soleil !
a andré chenier
Oui, mon vers croit pouvoir, sans se mésallier,
Prendre à la prose un peu de son air familier.
André, c’est vrai, je ris quelquefois sur la lyre.
Voici pourquoi. Tout jeune encor, tâchant de lire
Dans le livre effrayant des forêts et des eaux,
J’habitais un parc sombre où jasaient des oiseaux,
Où des pleurs souriaient dans l’œil bleu des pervenches ;
Un jour que je songeais seul au milieu des branches,
Un bouvreuil qui faisait le feuilleton du bois
M’a dit : — Il faut marcher à terre quelquefois.
La nature est un peu moqueuse autour des hommes ;
Ô poëte, tes chants, ou ce qu’ainsi tu nommes,
Lui ressembleraient mieux si tu les dégonflais.
Les bois ont des soupirs, mais ils ont des sifflets.
L’azur luit, quand parfois la gaîté le déchire ;
L’Olympe reste grand en éclatant de rire ;
Ne crois pas que l’esprit du poëte descend
Lorsque entre deux grands vers un mot passe en dansant.
Ce n’est pas un pleureur que le vent en démence ;
Le flot profond n’est pas un chanteur de romance ;
Et la nature, au fond des siècles et des nuits,
Accouplant Rabelais à Dante plein d’ennuis,
Et l’Ugolin sinistre au Grandgousier difforme,
Près de l’immense deuil montre le rire énorme.