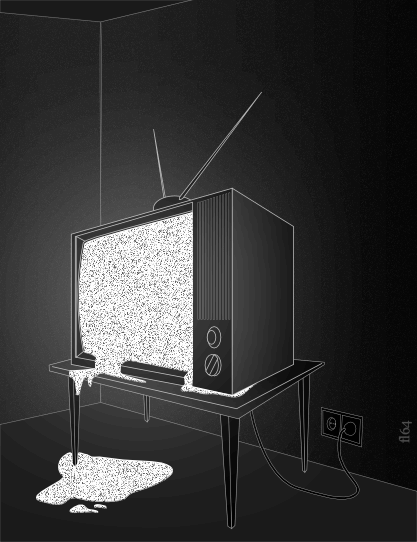Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Monde : France (3307)
· Musique (371)
· Calendrier : Événements (333)
· Monde : Etats Unis (1156)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
Thèmes
art article internet image sur france afrique chez jeux histoire création divers cadre automne sport tube center cadre
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Télévision
La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles, appelées programme télévisé (émissions, films et séquences publicitaires). Le contenu de ces programmes peut être décrit selon des procédés analogiques ou numériques tandis que leur transmission peut se faire par ondes radioélectriques ou par réseau câblé.
L'appareil permettant d'afficher des images d'un programme est dénommé téléviseur, ou, par métonymie, télévision, ou par apocope télé, ou par siglaison TV.
La télévision est tributaire d'un réseau économique, politique et culturel (langues nationales ou régionales, genres et formats, réglementation et autorisation de diffusion)
Le substantif féminin télévision est réputé emprunté à l'anglais television, un substantif composé de tele- (« télé- ») et vision (« vision »), et attesté en 1907
Histoire
1877-1878 : à la suite de la découverte des propriétés photosensibles du sélénium et de la conception par Carl Wilhelm Siemens et William Siemens d'un « œil électrique artificiel », divers « inventeurs » (Adriano de Paiva au Portugal, Constantin Senlecq en France, George R.Carey aux États-Unis, Julian Ochorowicz en Pologne) formulent des propositions d'appareils de transmission des images à distance basé sur l'usage du sélénium.
1882 : l'électricien britannique L.B. Atkinson imagine le premier système de balayage par tambour de miroirs, qui sera théorisé en 1889 par l'Alsacien Lazare Weiller et utilisé par différents systèmes de télévision mécanique dans les années 1920.
1884 : l'inventeur allemand Paul Nipkow fait breveter un dispositif d'analyse d'images par lignes, le disque de Nipkow, qui est un des deux systèmes de balayage de la télévision mécanique.
1897 : invention du tube cathodique par Karl Ferdinand Braun.
1900 : lors du Congrès international d'électricité qui a lieu à Paris dans le cadre de l'Exposition universelle, l'ingénieur russe Constantin Perskyi présente une communication « Télévision au moyen de l'électricité » qui est la première apparition du terme en français.
1921 : Édouard Belin transmet une image fixe par radio et non plus par téléphone avec son bélinographe inventé en 1907 et effectue des essais de télévision en 1926.
1926, le 27 janvier : L'Écossais John Logie Baird effectue, à Londres, la première retransmission publique de télévision en direct : télévision à système mécanique (sans tube cathodique).
1927, le 28 décembre : le gouvernement Poincaré crée le service de radiodiffusion, rattaché aux PTT.
1928 : Hovannes Adamian montre une télévision en couleur à Londres.
1931, le 14 avril : première transmission française, par René Barthélemy, devant 800 invités, d'une image de trente lignes (court-métrage et prises de vues en direct) entre le laboratoire de la Compagnie des Compteurs de Montrouge et l'école supérieure d'électricité de Malakoff située à 2 kilomètres, présentée par Suzanne Bridoux. C'est la première transmission par émetteur, d’autres ayant été réalisées précédemment mais par fil.
1931, le 6 décembre : Henri de France fonde la Compagnie générale de télévision (CGT).
1932, en décembre : invention d'une caméra de télévision et réalisation par René Barthélemy d'un programme expérimental en noir et blanc d'une heure par semaine : « Paris Télévision ». Une centaine de postes reçoivent ce programme, la plupart dans les services publics.
1935, le 26 avril : inauguration par le ministre des PTT Georges Mandel de la première émission officielle publique de télévision française, en 60 lignes, sur la chaine Radio PTT Vision présentée par la comédienne Béatrice Bretty au 97 rue de Grenelle.
1935, le 17 novembre : Barthelemy améliore la définition de la télévision qui passe en 180 lignes et un émetteur d'ondes courtes est installé au sommet de la tour Eiffel.
1937, le 4 janvier : premières émissions quotidiennes françaises de 20 h à 20 h 30. Il y a une centaine de postes chez des particuliers.
1937, le 12 mai : premier reportage en direct par la BBC, lors du couronnement du roi George VI, puis français, lors de l'inauguration de l'Exposition universelle de 1937.
1939, le 3 septembre : arrêt des émissions en France pour cause de guerre avec l'Allemagne.
1941, dans des studios de la rue Cognacq-Jay émissions allemandes à usage interne de la Wehrmacht à Paris.
1944 : René Barthélémy met au point la définition de la télévision à 819 lignes.
1945, le 29 mars : réémission de la télévision française depuis les studios de Cognacq-Jay abandonnés par les Allemands.
1947, le 5 juin : premier direct en dehors des studios, depuis le théâtre des Champs-Élysées à Paris.
1948, le 20 novembre : le standard d'émission en France est désormais en 819 lignes. Une décision prise par François Mitterrand lorsqu'il est Secrétaire d’État à l'Information. La France est le seul pays à l'adopter avec la Belgique pour ses émissions francophones, les autres pays choisissant les 625 lignes.
1951 : Premières émissions publiques en couleurs aux États-Unis.
1952 : Premières transmissions télévisées en Belgique (819 lignes).
1953 : Le couronnement d'Élisabeth II est suivi en direct par 20 millions de personnes rien que dans le Royaume-Uni.
1962, le 11 juillet : premières images de télévision transmises en direct par satellite entre Andover (Maine) (États-Unis) et Pleumeur-Bodou (Bretagne, France).
1964 : création du premier écran à plasma, inventé dans une université de l’Illinois aux États-Unis par Donald L. Bitzer et H. Gene Slottow.
1964 : Début du réseau Eurovision centralisé autour d'une régie installée à Bruxelles.
1967 : le Secam, norme de codage de la vidéo en couleurs sur 625 lignes inventée par Henri de France, est adopté pour la télédiffusion française. L'URSS et les pays satellites d'Europe de l'Est s'y rallieront tout comme la plupart des pays francophones d'Afrique et du Moyen-Orient
Télévision
La télévision est un moyen de diffuser par un courant électrique (ligne), par une onde (voie hertzienne) ou par internet, de façon séquentielle, les éléments d'une image analysée point par point, ligne après ligne. À l'origine, un mécanisme permet l'exploration d'un ensemble de cellules photoélectriques (mosaïque). Plus tard, le balayage de la mosaïque s'effectue par un mince faisceau d'électrons (analyse cathodique) et la première mosaïque composée d'éléments de sélénium est décrite, en 1877, par George R. Carey (Boston, États-Unis).
Inspiré par le Pantélégraphe de Caselli (1856), le principe du balayage apparaît en 1879, dans un projet de « télectroscope » de Constantin Senlecq, notaire dans le Pas-de-Calais : un mécanisme de pantographe explore la face arrière d'un verre dépoli sur lequel est projetée l'image d'un objet.

En 1884, l'ingénieur allemand Paul Nipkow dépose un brevet de « télescope électrique » (elektrisches Teleskop). Un disque, percé à sa périphérie de trous disposés selon une spirale centripète, analyse en tournant les brillances d'une ligne de l'image transmise par un objectif. Le décalage des trous permet de passer d'une ligne à l'autre. Dans ces divers cas, le caractère réversible de chacun des procédés doit assurer la reproduction de l'image.
En 1891, Raphael Eduard Liesegang publie l'ouvrage Beiträge zum Problem des electrischen Fernsehens (Contribution sur la question de la télévision électrique). L'ouvrage de R.W. Burns, Television, an International History of the Formative Years. The Institution of Electric Engineers, ne mentionne pas Liesegang, mais il dit que Rosing (cité ci-dessous) reconnaît sa dette envers lui.
En 1907, le russe Boris Rosing dépose un brevet qui propose d'utiliser un tube cathodique, perfectionné en 1898 par Ferdinand Braun, pour reproduire une image analysée par des moyens électromagnétiques. L'année suivante, un Anglais, Campbell-Swinton, propose l'utilisation du tube cathodique aussi bien à l'analyse qu'à la reproduction de l'image. Aucun de ces projets ne mentionne la reproduction du mouvement.
Ces projets conduisent Vladimir Zworykin, un Russe émigré aux États-Unis, à déposer en 1923 un brevet de télévision « tout électronique » (all electronic), alors qu'en Grande-Bretagne Logie Baird obtient une licence expérimentale en 1926 pour son « Televisor ». Les années 1930 allaient alors être marquées par des tentatives diverses d'émissions en Europe, principalement par la BBC de Grande-Bretagne, ainsi qu'aux États-Unis, mais la bataille entre les différentes licences et techniques utilisées d'une part, et la Seconde Guerre mondiale d'autre part, allaient retarder l'avènement de la télévision comme média populaire.
Au sortir de la guerre, les États-Unis sont les premiers à imposer une normalisation technique qui facilite la progression rapide des stations d'émission et un accroissement fulgurant du parc des récepteurs (30 000 en 1947, 157 000 en 1948, 876 000 en 1949, 3,9 millions en 1952). « L'année 1949 est [alors] celle de l'explosion. La grille des programmes de l'automne abonde en émissions en tout genre, annonciatrices de ce que nous pouvons voir à l'écran aujourd'hui : fictions comiques et dramatiques, théâtre, films, sport et, bien sûr, variétés et jeux de connaissances générales richement dotés. ».
Le 14 février 1957, le pape Pie XII fait de Claire d'Assise la sainte patronne de la télévision