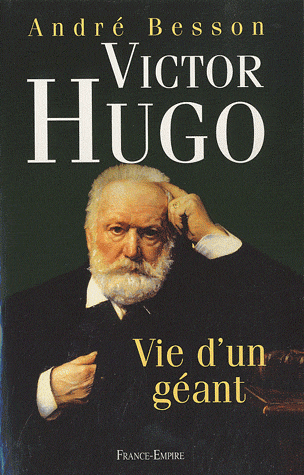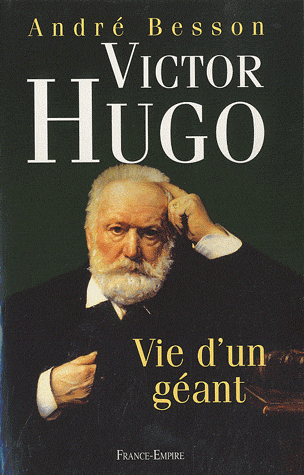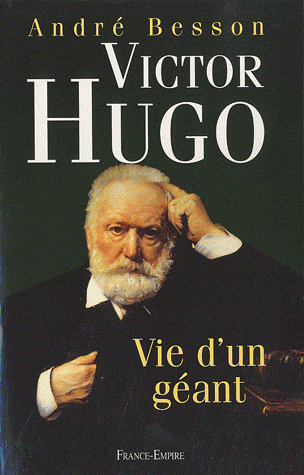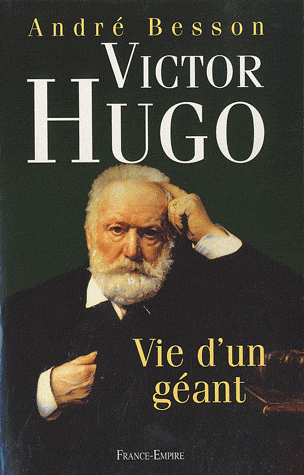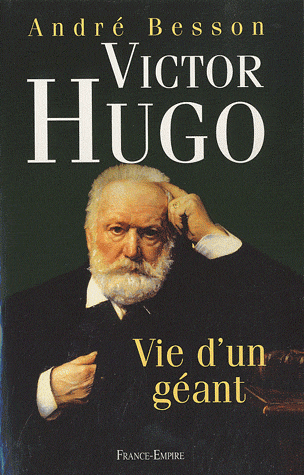afrique alphabet ange automne avatars chat animé banniere bannières barre belle belle image bleu blinkie
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· BELLE IMAGE CREATION DIVERS BIS (6781)
· CADRE (2357)
· VISAGE DE FEMME (1531)
· Femme (1324)
· Stars (1120)
· Tube cookie (1037)
· FOND D ECRAN DRAGON (575)
· Gif scintillant (556)
· FOND D ECRAN ANGE (418)
· Gif animaux animés (1052)
- · victor hugo poeme a.m.froment-meurice
- · une terre au flanc maigre victor hugo analyse
- · une terre au flanc maigre analyse
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
, 07.59.36.30.63 /watsap telegram numéro
livre ur spécialiser dans la cocaine calipuff , weed et shit qualite
Par Anonyme, le 20.02.2026
· tube parchemin
· oiseau gif anime
· belle image
· oiseau gif anime
· generateur de texte defilant
· gif chien
· fond d ecran
· fond d ecran
· BELLE IMAGE
· LES PREMIERS ORDINATEURS
· gif chat
· Coloriage blanche neige
· FOND D'ECRAN CHOPPER ET HARLEY
· cadeau de http://mamiebabou.centerblog.net/ merci
· FOND D ECRAN CHATS
Statistiques
Date de création : 09.08.2009
Dernière mise à jour :
31.01.2016
113496 articles
POEME VICTOR HUGO
a quoi songeaint les deux cavaliers dans la foret
La nuit était fort noire et la forêt très-sombre.
Hermann à mes côtés me paraissait une ombre.
Nos chevaux galopaient. A la garde de Dieu !
Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres.
Les étoiles volaient dans les branches des arbres
Comme un essaim d’oiseaux de feu.
Je suis plein de regrets. Brisé par la souffrance,
L’esprit profond d’Hermann est vide d’espérance.
Je suis plein de regrets. O mes amours, dormez !
Or, tout en traversant ces solitudes vertes,
Hermann me dit : — Je songe aux tombes entr’ouvertes ; -
Et je lui dis : — Je pense aux tombeaux refermés.-
Lui regarde en avant : je regarde en arrière,
Nos chevaux galopaient à travers la clairière ;
Le vent nous apportait de lointains angelus ;
dit : — Je songe à ceux que l’existence afflige,
A ceux qui sont, à ceux qui vivent. — Moi, — lui dis-je,
Je pense à ceux qui ne sont plus !
Les fontaines chantaient. Que disaient les fontaines ?
Les chênes murmuraient. Que murmuraient les chênes ?
Les buissons chuchotaient comme d’anciens amis.
Hermann me dit : — Jamais les vivants ne sommeillent.
En ce moment, des yeux pleurent, d’autres yeux veillent.
Et je lui dis : — Hélas ! d’autres sont endormis !
Hermann reprit alors : — Le malheur, c’est la vie.
Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux ! j’envie
Leur fosse où l’herbe pousse, où s’effeuillent les bois.
Car la nuit les caresse avec ses douces flammes ;
Car le ciel rayonnant calme toutes les âmes
Dans tous les tombeaux à la fois !
Et je lui dis : — Tais-toi ! respect au noir mystère !
Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre.
Les morts, ce sont les cœurs qui t’aimaient autrefois
C’est ton ange expiré ! c’est ton père et ta mère !
Ne les attristons point par l’ironie amère.
Comme à travers un rêve ils entendent nos voix.
eclaircie
L’Océan resplendit sous sa vaste nuée.
L’onde, de son combat sans fin exténuée,
S’assoupit, et, laissant l’écueil se reposer,
Fait de toute la rive un immense baiser.
On dirait qu’en tous lieux, en même temps, la vie
Dissout le mal, le deuil, l’hiver, la nuit, l’envie,
Et que le mort couché dit au vivant debout :
Aime ! et qu’une âme obscure, épanouie en tout,
Avance doucement sa bouche vers nos lèvres.
L’être, éteignant dans l’ombre et l’extase ses fièvres,
Ouvrant ses flancs, ses seins, ses yeux, ses cœurs épars,
Dans ses pores profonds reçoit de toutes parts
La pénétration de la sève sacrée.
La grande paix d’en haut vient comme une marée.
Le brin d’herbe palpite aux fentes du pavé ;
Et l’âme a chaud. On sent que le nid est couvé.
L’infini semble plein d’un frisson de feuillée.
On croit être à cette heure où la terre éveillée
Entend le bruit que fait l’ouverture du jour,
Le premier pas du vent, du travail, de l’amour,
De l’homme, et le verrou de la porte sonore,
Et le hennissement du blanc cheval aurore.
Le moineau d’un coup d’aile, ainsi qu’un fol esprit,
Vient taquiner le flot monstrueux qui sourit ;
L’air joue avec la mouche et l’écume avec l’aigle ;
Le grave laboureur fait ses sillons et règle
La page où s’écrira le poëme des blés ;
Des pêcheurs sont là-bas sous un pampre attablés ;
L’horizon semble un rêve éblouissant où nage
L’écaille de la mer, la plume du nuage,
Car l’Océan est hydre et le nuage oiseau.
Une lueur, rayon vague, part du berceau
Qu’une femme balance au seuil d’une chaumière,
Dore les champs, les fleurs, l’onde et devient lumière
En touchant un tombeau qui dort près du clocher.
Le jour plonge au plus noir du gouffre, et va chercher
L’ombre, et la baise au front sous l’eau sombre et hagarde.
doloros
Mère, voilà douze ans que notre fille est morte ;
Et depuis, moi le père et vous la femme forte,
Nous n’avons pas été, Dieu le sait, un seul jour
Sans parfumer son nom de prière et d’amour.
Nous avons pris la sombre et charmante habitude
De voir son ombre vivre en notre solitude,
De la sentir passer et de l’entendre errer,
Et nous sommes restés à genoux à pleurer.
Nous avons persisté dans cette douleur douce,
Et nous vivons penchés sur ce cher nid de mousse
Emporté dans l’orage avec les deux oiseaux.
Mère, nous n’avons pas plié, quoique roseaux,
Ni perdu la bonté vis-à-vis l’un de l’autre,
Ni demandé la fin de mon deuil et du vôtre
À cette lâcheté qu’on appelle l’oubli.
Oui, depuis ce jour triste où pour nous ont pâli
Les cieux, les champs, les fleurs, l’étoile, l’aube pure,
Et toutes les splendeurs de la sombre nature,
Avec les trois enfants qui nous restent, trésor
De courage et d’amour que Dieu nous laisse encor,
Nous avons essuyé des fortunes diverses,
Ce qu’on nomme malheur, adversité, traverses,
Sans trembler, sans fléchir, sans haïr les écueils,
Donnant aux deuils du cœur, à l’absence, aux cercueils,
Aux souffrances dont saigne ou l’âme ou la famille,
Aux êtres chers enfuis ou morts, à notre fille,
Aux vieux parents repris par un monde meilleur,
Nos pleurs, et le sourire à toute autre douleur.
dolor
Création ! figure en deuil ! Isis austère !
Peut-être l’homme est-il son trouble et son mystère ?
Peut-être qu’elle nous craint tous,
Et qu’à l’heure où, ployés sous notre loi mortelle,
Hagards et stupéfaits, nous tremblons devant elle,
Elle frissonne devant nous !
Ne riez point. Souffrez gravement. Soyons dignes,
Corbeaux, hiboux, vautours, de redevenir cygnes !
Courbons-nous sous l’obscure loi.
Ne jetons pas le doute aux flots comme une sonde.
Marchons sans savoir où, parlons sans qu’on réponde,
Et pleurons sans savoir pourquoi.
Homme, n’exige pas qu’on rompe le silence ;
Dis-toi : Je suis puni. Baisse la tête et pense.
C’est assez de ce que tu vois.
Une parole peut sortir du puits farouche ;
Ne la demande pas. Si l’abîme est la bouche,
Ô Dieu, qu’est-ce donc que la voix ?
Ne nous irritons pas. Il n’est pas bon de faire,
Vers la clarté qui luit au centre de la sphère,
A travers les cieux transparents,
Voler l’affront, les cris, le rire et la satire,
Et que le chandelier à sept branches attire
Tous ces noirs phalènes errants.
Nais, grandis, rêve, souffre, aime, vis, vieillis, tombe.
L’explication sainte et calme est dans la tombe.
Ô vivants, ne blasphémons point.
Qu’importe à l’Incréé, qui, soulevant ses voiles,
Nous offre le grand ciel, les mondes, les étoiles,
Qu’une ombre lui montre le poing ?
Nous figurons-nous donc qu’à l’heure où tout le prie,
Pendant qu’il crée et vit, pendant qu’il approprie
A chaque astre une humanité,
Nous pouvons de nos cris troubler sa plénitude,
Cracher notre néant jusqu’en sa solitude,
Et lui gâter l’éternité ?
Être ! quand dans l’éther tu dessinas les formes,
Partout où tu traças les orbites énormes
Des univers qui n’étaient pas,
Des soleils ont jailli, fleurs de flamme, et sans nombre,
Des trous qu’au firmament, en s’y posant dans l’ombre,
Fit la pointe de ton compas !
Qui sommes-nous ? La nuit, la mort, l’oubli, personne.
Il est. Cette splendeur suffit pour qu’on frissonne.
C’est lui l’amour, c’est lui le feu.
Quand les fleurs en avril éclatent pêle-mêle,
C’est lui. C’est lui qui gonfle, ainsi qu’une mamelle,
La rondeur de l’océan bleu.
Le penseur cherche l’homme et trouve de la cendre.
Il trouve l’orgueil froid, le mal, l’amour à vendre,
L’erreur, le sac d’or effronté,
La haine et son couteau, l’envie et son suaire,
En mettant au hasard la main dans l’ossuaire
Que nous nommons humanité.
Parce que nous souffrons, noirs et sans rien connaître,
Stupide, l’homme dit : — Je ne veux pas de l’Être !
Je souffre ; donc, l’Être n’est pas ! —
Tu n’admires que toi, vil passant, dans ce monde !
Tu prends pour de l’argent, ô ver, ta bave immonde
Marquant la place où tu rampas !
Notre nuit veut rayer ce jour qui nous éclaire ;
Nous crispons sur ce nom nos doigts pleins de colère ;
Rage d’enfant qui coûte cher !
Et nous nous figurons, race imbécile et dure,
Que nous avons un peu de Dieu dans notre ordure
Entre notre ongle et notre chair !
Nier l’Être ! à quoi bon ? L’ironie âpre et noire
Peut-elle se pencher sur le gouffre et le boire,
Comme elle boit son propre fiel ?
Quand notre orgueil le tait, notre douleur le nomme.
Le sarcasme peut-il, en crevant l’œil à l’homme,
Crever les étoiles au ciel ?
Ah ! quand nous le frappons, c’est pour nous qu’est la plaie.
Pensons, croyons. Voit-on l’océan qui bégaie,
Mordre avec rage son bâillon ?
Adorons-le dans l’astre, et la fleur, et la femme.
Ô vivants, la pensée est la pourpre de l’âme ;
Le blasphème en est le haillon.
Ne raillons pas. Nos cœurs sont les pavés du temple.
Il nous regarde, lui que l’infini contemple.
Insensé qui nie et qui mord !
Dans un rire imprudent, ne faisons pas, fils d’Ève,
Apparaître nos dents devant son œil qui rêve,
Comme elle seront dans la mort.
La femme nue ayant les hanches découvertes,
Chair qui tente l’esprit, rit sous les feuilles vertes ;
N’allons pas rire à son côté.
Ne chantons pas : — Jouir est tout. Le ciel est vide. —
La nuit a peur, vous dis-je ! elle devient livide
En contemplant l’immensité.
Ô douleur ! clef des cieux, l’ironie est fumée.
L’expiation rouvre une porte fermée ;
Les souffrances sont des faveurs.
Regardons, au-dessus des multitudes folles,
Monter vers les gibets et vers les auréoles
Les grands sacrifiés rêveurs.
Monter, c’est s’immoler. Toute cime est sévère.
L’Olympe lentement se transforme en Calvaire ;
Partout le martyre est écrit ;
Une immense croix gît dans notre nuit profonde ;
Et nous voyons saigner aux quatre coins du monde
Les quatre clous de Jésus-Christ.
Ah ! vivants, vous doutez ! ah ! vous riez, squelettes !
Lorsque l’aube apparaît, ceinte de bandelettes
D’or, d’émeraude et de carmin,
Vous huez, vous prenez, larves que le jour dore,
Pour la jeter au front céleste de l’aurore,
De la cendre dans votre main.
Vous criez : — Tout est mal. L’aigle vaut le reptile ;
Tout ce que nous voyons n’est qu’une ombre inutile.
La vie au néant nous vomit.
Rien avant, rien après. Le sage doute et raille. —
Et, pendant ce temps-là, le brin d’herbe tressaille,
L’aube pleure, et le vent gémit.
Chaque fois qu’ici-bas l’homme, en proie aux désastres,
Rit, blasphème, et secoue, en regardant les astres,
Le sarcasme, ce vil lambeau,
Les morts se dressent froids au fond du caveau sombre,
Et de leur doigt de spectre écrivent — DIEU — dans l’ombre,
Sous la pierre de leur tombeau.
a qui donc sommes nous
À qui donc sommes-nous ? Qui nous a ? qui nous mène ?
Vautour fatalité, tiens-tu la race humaine ?
Oh ! parlez, cieux vermeils,
L’âme sans fond tient-elle aux étoiles sans nombre ?
Chaque rayon d’en haut est-il un fil de l’ombre
Liant l’homme aux soleils ?
Est-ce qu’en nos esprits, que l’ombre a pour repaires,
Nous allons voir rentrer les songes de nos pères ?
Destin, lugubre assaut !
Ô vivants, serions-nous l’objet d’une dispute ?
L’un veut-il notre gloire, et l’autre notre chute ?
Combien sont-ils là-haut ?
Jadis, au fond du ciel, aux yeux du mage sombre,
Deux joueurs effrayants apparaissaient dans l’ombre.
Qui craindre ? qui prier ?
Les Manès frissonnants, les pâles Zoroastres
Voyaient deux grandes mains qui déplaçaient les astres
Sur le noir échiquier.
Songe horrible ! le bien, le mal, de cette voûte
Pendent-ils sur nos fronts ? Dieu, tire-moi du doute !
Ô sphinx, dis-moi le mot !
Cet affreux rêve pèse à nos yeux qui sommeillent,
Noirs vivants ! heureux ceux qui tout à coup s’éveillent
Et meurent en sursaut !
demain des l aube
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et, quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
POEME VICTOR HUGO
Ces femmes, qu’on envoie aux lointaines bastilles,
Peuple, ce sont tes soeurs, tes mères et tes filles !
Ô peuple, leur forfait, c’est de t’avoir aimé !
Paris sanglant, courbé, sinistre, inanimé,
Voit ces horreurs et garde un silence farouche.
Celle-ci, qu’on amène un bâillon dans la bouche,
Cria – c’est là son crime – : à bas la trahison !
Ces femmes sont la foi, la vertu, la raison,
L’équité, la pudeur, la fierté, la justice.
Saint-Lazare – il faudra broyer cette bâtisse !
Il n’en restera pas pierre sur pierre un jour ! -
Les reçoit, les dévore, et, quand revient leur tour,
S’ouvre, et les revomit par son horrible porte,
Et les jette au fourgon hideux qui les emporte.
Où vont-elles ? L’oubli le sait, et le tombeau
Le raconte au cyprès et le dit au corbeau.
Une d’elles était une mère sacrée.
Le jour qu’on l’entraîna vers l’Afrique abhorrée,
Ses enfants étaient là qui voulaient l’embrasser ;
On les chassa. La mère en deuil les vit chasser
Et dit : partons ! Le peuple en larmes criait grâce.
La porte du fourgon étant étroite et basse,
Un argousin joyeux, raillant son embonpoint,
La fit entrer de force en la poussant du poing.
Elles s’en vont ainsi, malades, verrouillées,
Dans le noir chariot aux cellules souillées
Où le captif, sans air, sans jour, sans pleurs dans l’oeil,
N’est plus qu’un mort vivant assis dans son cercueil.
Dans la route on entend leurs voix désespérées.
Le peuple hébété voit passer ces torturées.
A Toulon, le fourgon les quitte, le ponton
Les prend ; sans vêtements, sans pain, sous le bâton,
Elles passent la mer, veuves, seules au monde,
Mangeant avec les doigts dans la gamelle immonde.
POEME VICTOR HUGO
Ô France, quoique tu sommeilles,
Nous t’appelons, nous les proscrits !
Les ténèbres ont des oreilles,
Et les profondeurs ont des cris.
Le despotisme âpre et sans gloire
Sur les peuples découragés
Ferme la grille épaisse et noire
Des erreurs et des préjugés ;
Il tient sous clef l’essaim fidèle
Des fermes penseurs, des héros,
Mais l’Idée avec un coup d’aile
Ecartera les durs barreaux,
Et, comme en l’an quatrevingt-onze,
Reprendra son vol souverain ;
Car briser la cage de bronze,
C’est facile à l’oiseau d’airain.
L’obscurité couvre le monde,
Mais l’Idée illumine et luit ;
De sa clarté blanche elle inonde
Les sombres azurs de la nuit.
Elle est le fanal solitaire,
Le rayon providentiel.
Elle est la lampe de la terre
Qui ne peut s’allumer qu’au ciel.
Elle apaise l’âme qui souffre,
Guide la vie, endort la mort ;
Elle montre aux méchants le gouffre,
Elle montre aux justes le port.
En voyant dans la brume obscure
L’Idée, amour des tristes yeux,
Monter calme, sereine et pure,
Sur l’horizon mystérieux,
Les fanatismes et les haines
Rugissent devant chaque seuil,
Comme hurlent les chiens obscènes
Quand apparaît la lune en deuil.
Oh ! contemplez l’Idée altière,
Nations ! son front surhumain
A, dès à présent, la lumière
Qui vous éclairera demain !
POEME VICTOR HUGO
Trois chevaux, qu’on avait attachés au même arbre,
Causaient.
L’un, coureur leste à la croupe de marbre,
Valait cent mille francs, était vainqueur d’Epsom,
Et, tout harnaché d’or, s’écriait : sum qui sum !
Cela parle latin, les bêtes. Des mains blanches
Cent fois de ce pur-sang avaient flatté les hanches,
Et souvent il avait, dans le turf ébloui,
Senti courir les coeurs des femmes après lui.
De là bien des succès à son propriétaire.
Le second quadrupède était un militaire,
Un dada formidable, une brute d’acier,
Un cheval que Racine eût appelé coursier.
Il se dressait, bridé, superbe, ivre de joie,
D’autant plus triomphant qu’il avait l’oeil d’une oie.
Sur sa housse on lisait : Essling, Ulm, Iéna.
Il avait la fierté massive que l’on a
Lorsqu’on est orgueilleux de tout ce qu’on ignore ;
Son caparaçon fauve était riche et sonore
Il piaffait, il semblait écouter le tambour.
Et le troisième était un cheval de labour.
Un bât de corde au cou, c’était là sa toilette.
Triste bête ! on croyait voir marcher un squelette,
Ayant assez de peau sous la bise et le vent
Pour faire un peu l’effet d’un être encor vivant.
Le beau cheval de luxe, espèce de jocrisse,
Disait :
« Ici le pape, et là le baron Brisse ;
Pour l’estomac Brébant, pour l’âme Loyola ;
Etre béni, bien boire et bien manger, voilà
Ce que prêche mon maître ; et moi, roi de la joute,
J’estime que mon maître a raison, et j’ajoute
Que les cocottes font l’ornement du derby.
Il faut au peuple un dieu par les prêtres fourbi,
A nous une écurie en acajou, la bible
Pour l’homme, et des journaux, morbleu, le moins possible.
Le Jockey-Club veut mieux que l’esprit Légion.
Pas de société sans la religion.
Si je n’étais cheval, je voudrais être moine.
- Moi, je voudrais manger parfois un peu d’avoine
Et de foin, soupira le cheval paysan.
Je travaille beaucoup, et je suis, jugez-en
Par ma côte saignante et mon échine maigre,
Presque aussi mal traité que l’homme appelé nègre.
Compter les coups de fouet que je reçois serait
Compter combien d’oiseaux chantent dans la forêt ;
J’ai faim, j’ai soif, j’ai froid ; je ne suis pas féroce,
Mais je suis malheureux. »
Ainsi parla la rosse.
poeme victor hugo
Ainsi ce gouvernant dont l’ongle est une griffe,
Ce masque impérial, Bonaparte apocryphe,
A coup sûr Beauharnais, peut-être Verhueil,
Qui, pour la mettre en croix, livra, sbire cruel,
Rome républicaine à Rome catholique,
Cet homme, l’assassin de la chose publique,
Ce parvenu, choisi par le destin sans yeux,
Ainsi, lui, ce glouton singeant l’ambitieux,
Cette altesse quelconque habile aux catastrophes,
Ce loup sur qui je lâche une meute de strophes,
Ainsi ce boucanier, ainsi ce chourineur
A fait d’un jour d’orgueil un jour de déshonneur,
Mis sur la gloire un crime et souillé la victoire
Il a volé, l’infâme, Austerlitz à l’histoire ;
Brigand, dans ce trophée il a pris un poignard ;
Il a broyé bourgeois, ouvrier, campagnard ;
Il a fait de corps morts une horrible étagère
Derrière les barreaux de la cité Bergère ;
Il s’est, le sabre en main, rué sur son serment ;
Il a tué les lois et le gouvernement,
La justice, l’honneur, tout, jusqu’à l’espérance
Il a rougi de sang, de ton sang pur, ô France,
Tous nos fleuves, depuis la Seine jusqu’au Var ;
Il a conquis le Louvre en méritant Clamar ;
Et maintenant il règne, appuyant, ô patrie,
Son vil talon fangeux sur ta bouche meurtrie
Voilà ce qu’il a fait ; je n’exagère rien ;
Et quand, nous indignant de ce galérien,
Et de tous les escrocs de cette dictature,
Croyant rêver devant cette affreuse aventure,
Nous disons, de dégoût et d’horreur soulevés :
- Citoyens, marchons ! Peuple, aux armes, aux pavés !
A bas ce sabre abject qui n’est pas même un glaive !
Que le jour reparaisse et que le droit se lève ! -
C’est nous, proscrits frappés par ces coquins hardis,
Nous, les assassinés, qui sommes les bandits !
Nous qui voulons le meurtre et les guerres civiles !
Nous qui mettons la torche aux quatre coins des villes !
Donc, trôner par la mort, fouler aux pieds le droit
Etre fourbe, impudent, cynique, atroce, adroit ;
Dire : je suis César, et n’être qu’un maroufle
Etouffer la pensée et la vie et le souffle ;
Forcer quatre-vingt-neuf qui marche à reculer ;
Supprimer lois, tribune et presse ; museler
La grande nation comme une bête fauve ;
Régner par la caserne et du fond d’une alcôve ;
Restaurer les abus au profit des félons
Livrer ce pauvre peuple aux voraces Troplongs,
Sous prétexte qu’il fut, loin des temps où nous sommes,
Dévoré par les rois et par les gentilshommes
Faire manger aux chiens ce reste des lions ;
Prendre gaîment pour soi palais et millions ;
S’afficher tout crûment satrape, et, sans sourdines,
Mener joyeuse vie avec des gourgandines
Torturer des héros dans le bagne exécré ;
Bannir quiconque est ferme et fier ; vivre entouré
De grecs, comme à Byzance autrefois le despote
Etre le bras qui tue et la main qui tripote
Ceci, c’est la justice, ô peuple, et la vertu !
Et confesser le droit par le meurtre abattu
Dans l’exil, à travers l’encens et les fumées,
Dire en face aux tyrans, dire en face aux armées
- Violence, injustice et force sont vos noms
Vous êtes les soldats, vous êtes les canons ;
La terre est sous vos pieds comme votre royaume
Vous êtes le colosse et nous sommes l’atome ;
Eh bien ! guerre ! et luttons, c’est notre volonté,
Vous, pour l’oppression, nous, pour la liberté ! -
Montrer les noirs pontons, montrer les catacombes,
Et s’écrier, debout sur la pierre des tombes .
- Français ! craignez d’avoir un jour pour repentirs
Les pleurs des innocents et les os des martyrs !
Brise l’homme sépulcre, ô France ! ressuscite !
Arrache de ton flanc ce Néron parasite !
Sors de terre sanglante et belle, et dresse-toi,
Dans une main le glaive et dans l’autre la loi ! -
Jeter ce cri du fond de son âme proscrite,
Attaquer le forban, démasquer l’hypocrite
Parce que l’honneur parle et parce qu’il le faut,
C’est le crime, cela ! – Tu l’entends, toi, là-haut !
Oui, voilà ce qu’on dit, mon Dieu, devant ta face !
Témoin toujours présent qu’aucune ombre n’efface,
Voilà ce qu’on étale à tes yeux éternels !
Quoi ! le sang fume aux mains de tous ces criminels !
Quoi ! les morts, vierge, enfant, vieillards et femmes grosses
Ont à peine eu le temps de pourrir dans leurs fosses !
Quoi ! Paris saigne encor ! quoi ! devant tous les yeux,
Son faux serment est là qui plane dans les cieux !
Et voilà comme parle un tas d’êtres immondes
Ô noir bouillonnement des colères profondes !
Et maint vivant, gavé, triomphant et vermeil,
Reprend : « Ce bruit qu’on fait dérange mon sommeil.
Tout va bien. Les marchands triplent leurs clientèles,
Et nos femmes ne sont que fleurs et que dentelles !
- De quoi donc se plaint-on ? crie un autre quidam ;
En flânant sur l’asphalte et sur le macadam,
Je gagne tous les jours trois cents francs à la Bourse.
L’argent coule aujourd’hui comme l’eau d’une source ;
Les ouvriers maçons ont trois livres dix sous,
C’est superbe ; Paris est sens dessus dessous.
Il paraît qu’on a mis dehors les démagogues.
Tant mieux. Moi j’applaudis les bals et les églogues
Du prince qu’autrefois à tort je reniais.
Que m’importe qu’on ait chassé quelques niais ?
Quant aux morts, ils sont morts. Paix à ces imbéciles !
Vivent les gens d’esprit ! vivent ces temps faciles
Où l’on peut à son choix prendre pour nourricier
Le crédit mobilier ou le crédit foncier !
La république rouge aboie en ses cavernes,
C’est affreux ! Liberté, droit, progrès, balivernes
Hier encor j’empochais une prime d’un franc ;
Et moi, je sens fort peu, j’en conviens, je suis franc,
Les déclamations m’étant indifférentes,
La baisse de l’honneur dans la hausse des rentes. »
Ô langage hideux ! on le tient, on l’entend !
Eh bien, sachez-le donc ; repus au coeur content,
Que nous vous le disions bien une fois pour toutes,
Oui, nous, les vagabonds dispersés sur les routes,
Errant sans passeport, sans nom et sans foyer,
Nous autres, les proscrits qu’on ne fait pas ployer,
Nous qui n’acceptons point qu’un peuple s’abrutisse,
Qui d’ailleurs ne voulons, tout en voulant justice,
D’aucune représaille et d’aucun échafaud, ‘
Nous, dis-je, les vaincus sur qui Mandrin prévaut,
Pour que la liberté revive, et que la honte
Meure, et qu’à tous les fronts l’honneur serein remonte,
Pour affranchir romains, lombards, germains, hongrois,
Pour faire rayonner, soleil de tous les droits,
La république mère au centre de l’Europe,
Pour réconcilier le palais et l’échoppe,
Pour faire refleurir la fleur Fraternité,
Pour fonder du travail le droit incontesté,
Pour tirer les martyrs de ces bagnes infâmes,
Pour rendre aux fils le père et les maris aux femmes,
Pour qu’enfin ce grand siècle et cette nation
Sortent du Bonaparte et de l’abjection,
Pour atteindre à ce but où notre âme s’élance,
Nous nous ceignons les reins dans l’ombre et le silence
Nous nous déclarons prêts, prêts, entendez-vous bien ?
- Le sacrifice est tout, la souffrance n’est rien, -
Prêts, quand Dieu fera signe, à donner notre vie
Car, à voir ce qui vit, la mort nous fait envie,
Car nous sommes tous mal sous ce drôle effronté,
Vivant, nous sans patrie, et vous sans liberté !
Oui, sachez-le, vous tous que l’air libre importune
Et qui dans ce fumier plantez votre fortune,
Nous ne laisserons pas le peuple s’assoupir ;
Oui, nous appellerons, jusqu’au dernier soupir,
Au secours de la France aux fers et presque éteinte,
Comme nos grands -aïeux, l’insurrection sainte
Nous convierons Dieu même à foudroyer ceci
Et c’est notre pensée et nous sommes ainsi,
Aimant mieux, dût le sort nous broyer sous sa roue,
Voir couler notre sang que croupir votre boue