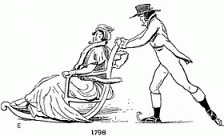Thèmes
paris paris autrefois mode et vetement directoire dinosaures
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Paris autrefois - mode et vetement- Directoire -
Publié à 14:57 par acoeuretacris
(D'après Les Modes de Paris 1797-1897, par Octave Uzanne, paru en 1898)
(partie 3)
Toutes les classes de la société étaient alors galvanisées par la dansomanie ;
on rigaudone jusque dans les greniers misérables des faubourgs et l'on vit plusieurs bals champêtres s'établir dans des caves de restaurateurs, sinon dans les sous-sols de boutiquiers.
Jamais la nation française n'offrit aux yeux de l'observateur un spectacle plus curieux, plus incohérent, plus varié, plus inconcevable qu'au début du Directoire. La Révolution avait tout submergé : traditions, mœurs, langage, trône, autels, modes et manières ; mais la légèreté spéciale à ce peuple surnageait au-dessus de tant de ruines ; l'esprit d'insouciance, de forfanterie, d'apropos, cet immortel esprit frondeur et rieur, fonds précieux du caractère national, reparaissait au lendemain de la tourmente, plus alerte, plus vivace, plus indomptable encore qu'autrefois.
La Fontaine de la rue du Regard, An VII (1799)
Comme il ne restait rien du passé et qu'on ne pouvait improviser en un jour une société avec des convenances, des usages, des vêtements entièrement inédits, on emprunta le tout à l'histoire ancienne et aux nations disparues : chacun s'affubla, se grima, « jargonna » à sa guise ; ce fut un travestissement général, un carnaval sans limites, une orgie sans fin et sans raison.
On ne peut regarder aujourd'hui cette époque dans son ensemble et dans les menus détails de son libertinage sans croire à une immense mystification, à une colossale caricature composée par quelque humoriste de l'école de Hogarth ou de Rowlandson. – Cependant, en dépit des folies parisiennes, nos armées de Sambre-et-Meuse, du Rhin et de la Moselle, ainsi que nos glorieux bataillons d'Italie, portaient au loin le renom de nos armes et des germes de liberté ; le monde entier retentissait des échos de nos victoires ; les prodiges de Bonaparte inquiétaient la vieille Europe, tant de gloire aurait pu enorgueillir et assagir à la fois les pantins qui avait fait de Paris un Guignol étourdissant et impossible à décrire !
Le Théâtre des Variétés, An VII (1799)
On aura peine à imaginer qu'au milieu des victoires de Ney, de Championnet et du général Bonaparte, on n'observait dans la capitale, sur nos boulevards et places publiques, aucun enthousiasme, aucun mouvement d'allégresse. S'il faut ajouter créance aux journaux contemporains, on passait froidement, avec indifférence, à côté des crieurs annonçant les grands succès de nos généraux ; on désirait la paix, la tranquillité, l'abondance ; l'agiotage avait gagné toutes les classes, la griserie de la mascarade anéantissait toutes idées nobles.
Les Ecrouelleux, les Inconcevables, les Merveilleux, le menton caché dans leurs cravates démesurées, maudissaient le gouvernement des Directeurs, méconnaissaient les mérites de nos soldats, disant d'un air affadi : Pa'ole victimée, cela ne peut pas du'er ! – Les fêtes même données par le Directoire, pour rendre honneur à la vaillance de nos braves, manquaient à la fois de dignité et de véritable grandeur ; le mauvais goût s'y montrait flagrant et le comédisme de ces cérémonies n'en excluait pas le ridicule.
Lorsque Junot vint apporter au gouvernement les drapeaux conquis à la bataille de la Favorite, il y fut reçu, de même que Murat, en grand apparat ; mais l'aide de camp Lavallette, dans une lettre à un ami intime, relate avec quelle pompe on procédait d'ordinaire aux petites réceptions moins extérieures.
« J'ai vu, écrivait-il, dans les appartements du petit Luxembourg, nos cinq rois, vêtus du manteau de François Ier, chamarrés de dentelles et coiffés du chapeau à la Henri IV. La figure de La Revellière-Lépeaux semblait un bouchon fixé sur deux épingles. M. de Talleyrand, en pantalon de soie lie de vin, était assis sur un pliant aux pieds de Barras et présentait gravement à ses souverains un ambassadeur du Grand-Duc de Toscane, tandis que le général Bonaparte mangeait le dîner de son maître. A droite, sur une estrade, cinquante musiciens et chanteurs de l'Opéra, Lainé, Lays et les actrices, criant une cantate patriotique sur la musique de Méhul ; à gauche, sur une autre estrade, cieux cents femmes, belles de jeunesse, de fraîcheur et de nudité, s'extasiant sur le bonheur et la majesté de la République ; toutes portaient une tunique de mousseline et un pantalon de soie collant, à la façon des danseuses d'opéra ; la plupart avaient des bagues aux orteils. Le lendemain de cette belle fête, des milliers de familles étaient proscrites dans leurs chefs, quarante-huit départements étaient veufs de leurs représentants et trente journalistes allaient mourir à Sinnanary ou sur les bords de l'Ohio. »
En dehors des fêtes dédiées à la Victoire, le gouvernement des Directeurs avait,
selon l'usage antique, institué des fêtes publiques à dates fixes, en l'honneur de la République et de sa fondation ; d'autres étaient consacrées à la Patrie, à la Vertu, à la Jeunesse ; il y eut même la Fête des Epoux, singulier à-propos en ce temps où le divorce faisait rage et où l'on se serait gardé d'élever le plus petit édicule à la Fidélité et surtout à la Constance. Le Luxembourg, dont les cinq Directeurs avaient pris possession, était devenu, ainsi que le remarque un poète du temps, une véritable cour ; et, comme cette cour était très accessible aux femmes, grâce au voluptueux Barras, elles y avaient apporté les manières les plus douces. La galanterie avait fait disparaître peu à peu les austérités républicaines et les femmes reprenaient largement l'empire dont elles avaient été dépossédées pendant le
Les citoyennes de Staël, Hamelin, de Château-Regnault, Bonaparte et Tallien étaient les reines de Paris, et il n'était point de fêtes sans elles. La fille du comte de Cabarrus, l'ex-épouse de M. de Fontenay, la future femme du comte de Caraman-Chimay, la belle en Tallien, semblait surtout la souveraine incontestée du Directoire ; on avait pu attacher au bas de son costume romain cet écriteau satirique :
Respect aux propriétés nationales.