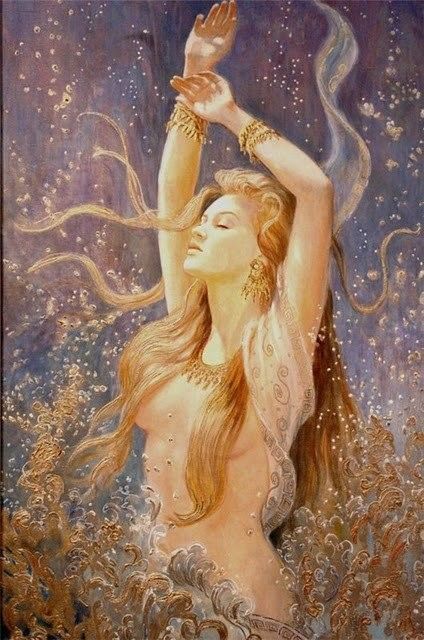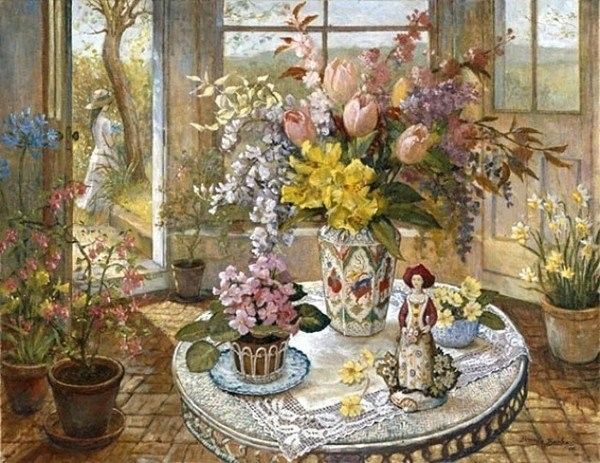Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Monde : France (3307)
· Musique (371)
· Calendrier : Événements (333)
· Monde : Etats Unis (1156)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
- · dessinsagogo55.quint e
- · photos elizabeth montgomery. tenue hot
- · special fashions photography
- · laetitia milot aubade
- · playmate x 2021
- · crista nicole
- · bb 22200 et compositions corails
- · films francais
- · delores wells
- · hendricks hot sexy
Thèmes
air amour annonce art article background base belle blogs brenda burke cadre center
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
VCR ou Video Cassette Recording
Le VCR (ou Video Cassette Recording) est un standard pour l'enregistrement de vidéo sur bande magnétique de 1/2 pouce qui a été mis au point par Philips en 1972. Une version VCR LP (VCR-Long Play) a vu le jour en 1976.
Le système VCR proposait un appareil contenant des caractéristiques aujourd'hui considérées comme classiques : un tuner, pour capter et enregistrer les programmes de télévision tout en regardant la télévision, un modulateur, pour le raccordement à un téléviseur, et une horloge pour l'enregistrement programmé.
Cela conduisit ce système à être diffusé auprès du grand public dès 1974.
La cassette avait l'originalité d'une disposition concentrique des deux bobines, leur donnant une forme carrée très caractéristique. La bande elle-même faisait 1/2" de largeur.
Trois variantes ont existé.
VCR (1972) : version originale, permettant un enregistrement de 60 minutes.
VCR LP ou VCR-Long Play (1976) : version permettant d'atteindre une durée d'enregistrement de 120 à 180 minutes grâce à une vitesse de défilement inférieure et des bandes plus fines, incompatible avec le format VCR.
SV (1980) : le Super Video était une version de Grundig permettant d'atteindre une durée d'enregistrement 5 heures grâce à une vitesse de défilement encore inférieure, incompatible avec les formats VCR et VCR-LP.
Successeur
Philips tenta d'imposer un successeur au format VCR, le V2000.
L'originalité de la cassette du V2000 était d'en faire une cassette retournable, sur le modèle de la cassette audio. La VHS, déjà bien implantée à l'époque, fit de ce format un échec commercial.
Retour à : Musique : Sommaire
Retour à : Musique : Postes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique :
Spagna
Spagna, née Ivana Spagna le 16 décembre 1956 à Valeggio sul Mincio dans la province de Vérone en Italie, est une auteur-compositeur-interprète, productrice et écrivain italienne. Avec plus de dix millions de disques vendus partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon, au Canada et en Australie, celle qui a fait carrière sous de multiples identité demeure une valeur sûre de la musique italienne, récompensée en 2006 pour l'ensemble de sa carrière par un disque d'or. La proximité avec le public de cette artiste tour à tour italo disco, pop-rock et de variété, ne s'est jamais démentie.
Dès son plus jeune âge, Spagna suit des cours de piano avec son frère, Giorgio Theo Spagna. Elle participe également à de nombreux concours de chant. C'est dans l'un de ces concours qu'elle est remarquée par un producteur qui, séduit par sa voix, lui propose d'enregistrer un premier disque à l'âge de quinze ans. Ce sera la reprise en italien de Mamy Blue, chanson créée au début des années soixante en France par Nicoletta. Le 45 tours connaît un petit succès d'estime l'année de sa sortie en 1971 et sera suivi par un deuxième 45 tours Ari Ari en 1972. La même année, la chanson sera présentée au Festivalbar ce qui donnera lieu à un nouveau pressage comprenant en face A, l'enregistrement de la prestation en public au festival et, en face B, une reprise en anglais de Rocket man, chanson créée par Elton John. Mais le succès même limité effraye l'artiste qui s'estime trop jeune et inexpérimentée pour donner suite à ce début de carrière. Néanmoins, accompagnée de son frère et de Larry Pignagnoli, elle créera le groupe Opera Madre au milieu des années soixante dix qui, jusqu'au début des années quatre-vingt, se forgera une petite notoriété dans les discothèques et dans les bals italiens.
En 1982, l'italo disco pointe le bout de son nez dans toute l'Europe. Des artistes tels que Den Harrow, Valerie Dore, Stargo ou encore Baltimora vont connaître un succès aussi fulgurant qu'éphémère, souvent juste le temps d'un ou deux 45 tours. De cette période, seuls deux artistes majeurs émergeront et connaîtront par la suite une longue et belle carrière : Raf (ou Raff) et Ivana Spagna.
En 1983, Ivana Spagna collabore à l'écriture du titre Take me to the top de Betty Miranda. C'est un succès en Europe, sa réputation de créatrice de tubes est lancée. Jusqu'en 1986, elle collaborera avec Baby's Gang, Hot cold, Silver Pozzoli et même Boney M, pour le titre Happy song. Ivana Spagna est également créditée pour les titres Voice of the dark de Mike Cannon et Hallucination de Theo S. Ces deux interprètes ne font en réalité qu'un seul, il s'agit des pseudonymes derrière lesquels se cache Giorgio Theo Spagna, le frère d'Ivana. Celui-ci ne poursuivra guère sa carrière d'interprète.
Souvent, Ivana Spagna ne se contente pas d'être l'auteure ou la compositrice de chansons à succès, elle participe également à leur enregistrement en tant que choriste. On la retrouve par exemple aux côtés de Brando sur le titre Rainy day et sur les disques de son frère. Elle aurait été en outre choriste de Paul Young. Cette expérience de choriste l'incite à devenir l'interprète principale des chansons qu'elle contribue à créer. Ainsi, à cette période, Ivana Spagna va connaître plusieurs identités artistiques.
Elle sera d'abord connue sous le pseudonyme de Carol Kane (à ne pas confondre avec l'actrice du même nom), le temps d'un 45 tours intitulé I don't believe, sorti en 1983, pas vraiment resté dans les mémoires. Puis Ivana Spagna deviendra Mirage, le temps de Woman, un autre 45 tours présenté la même année.
Ivana Spagna connaîtra en revanche en 1984 un vrai succès sous le nom d'Yvonne Kay : les deux 45 tours Rise up (for my love) et I've got the music in me seront tous les deux disque d'or en Italie (50 000 exemplaires vendus). Mais la notoriété naîtra surtout du duo Fun Fun, qui connaîtra deux succès européen en 1984, Color my love et Happy station. Le duo est composé de deux jeunes femmes italiennes... qui ne chantent pas : les voix sont celles d'Angela Parisi, d'Antonella Pepe et d'Ivana Spagna. La pratique qui consiste à différencier les artistes présentés au public de leur voix est courante dans le monde de l'ItaloDance :
Baltimora : voix de Mauricio Bassi, plastique de Jimmy McShane ;
Den Harrow : on connaît la plastique « blond aux yeux bleus et pectoraux bien dessinés » de Manuel Stefano Carry Zandri, mais moins celles des quatre voix qui se sont succédé (Thomas Hooker Beecher, Enrico Ruggeri, Chuck Rolando et Silvio Pozzoli).
Cette pratique a d'ailleurs perduré jusqu'à la grande époque de l'eurodance italienne : ainsi la voix de Corona (The rhythm of the night) n'était pas celle de la jolie brésilienne Olga de Zouza Faria mais celles de Giovanna Bersola et de Sandra Chambers. De même, il n'est pas certain que la voix féminine de Cappella (U got to let the music, Move on baby, U & me) fut celle de Kelly Overett, c'est du moins ce qu'a laissé entendre son producteur. Sur l'album de Fun Fun, Spagna place cinq titres qu'elle écrit et / ou compose. Durant cette période, elle compose également des jingles pour la télévision anglaise.
| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivana_Spagna | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Shakira : l'avant , l'après
Serge Gainsbourg
Fils d'immigrants russes juifs, il veut d'abord être artiste-peintre. Il devient célèbre en tant qu'auteur-compositeur-interprète qui aborde de nombreux styles musicaux, ainsi que le cinéma et la littérature. Ses débuts sur scène sont difficiles, en raison de son physique. Toute sa vie, Serge Gainsbourg souffre de ce sentiment de rejet et de l'image que lui renvoie son miroir : celle d'un homme que l'on qualifie de laid. Il réalise plusieurs films et vidéo-clips et compose plus de quarante musiques de films.
Il se crée avec les années, une image d'un poète maudit et provocateur, mais pas pour autant en marge du système (« J'ai retourné ma veste quand je me suis aperçu qu'elle était doublée de vison », déclare-t-il). Les textes de ses chansons jouent souvent sur le double sens et illustrent son goût pour la provocation, en particulier polémique (Lemon Incest) ou érotique (Love on the Beat). Serge Gainsbourg aime également jouer avec les références littéraires comme Alphonse Allais (l'Ami Caouette) ou Verlaine (Je suis venu te dire que je m'en vais). Cependant il considère la chanson, et en particulier les paroles de chanson, comme un "art mineur" du fait que, contrairement à la peinture, par exemple, il ne nécessite aucune initiation pour être apprécié5. Malgré cela il travaille parfois beaucoup la forme poétique de ses textes.
Gainsbourg séduit de très jolies femmes, de Brigitte Bardot à Jane Birkin, avec qui il a son troisième enfant Charlotte Gainsbourg, puis, après leur séparation, il rencontre « Bambou », Caroline Paulus de son vrai nom, qui lui donne son quatrième et dernier enfant, Lucien Gainsbourg, dit « Lulu ».
Gainsbourg a une influence considérable sur des artistes français comme Taxi Girl, Renaud ou encore Étienne Daho mais également sur des artistes internationaux tels que Beck, Portishead et le compositeur David Holmes.
Dans son enfance, le petit Lucien vit dans les quartiers populaires de Paris, le 20e puis le 9e arrondissement. Son père tente de lui apprendre le piano classique et le pousse vers le monde de la peinture.
Les années de la Seconde Guerre mondiale sont difficiles : il est obligé de porter l'étoile jaune (« Une étoile de shérif », dira-t-il plus tard par dérision, ou « Je suis né sous une bonne étoile ... jaune »). Les métiers artistiques sont interdits aux Juifs et plus personne ne veut engager son père comme pianiste. Ce dernier doit par conséquent passer en zone libre en 1942 pour retrouver du travail et échapper à la misère. Les contrôles de police sont de plus en plus nombreux dans la capitale et toute la famille finit par le rejoindre en janvier 1944 dans la région de Limoges avec de faux papiers. Ils se réfugient au Petit Vedeix en Haute-Vienne sous le nom de Guimbard. Les filles sont cachées dans une institution religieuse et Lucien, dans un collège jésuite, à Saint-Léonard-de-Noblat. Il y est pensionnaire sous sa fausse identité. Un soir, la Gestapo fait une descente dans l'établissement pour vérifier qu'aucun enfant juif ne s'y trouve. Les responsables du pensionnat l'envoient se cacher seul dans la forêt, où il passe la nuit entière avec la peur d'être pris et tué. Il vivra par la suite avec le sentiment d'être un rescapé.
Durant ces années de guerre, la famille Ginsburg se voit retirer entièrement la nationalité française par une commission spéciale mise en place par le régime de Vichy, parce qu'ils sont « israélites sans intérêt national ». Sur l'un des rapports de la commission, retrouvé en 2010, on peut lire, à propos de Joseph, le père de Serge : « Exerçant la profession de pianiste, le nommé Ginsburg qui se déplace fréquemment réside actuellement à Lyon. [...] Son fils Lucien est inscrit au collège Du Guesclin. [...] Il ressort néanmoins que l'intéressé a quitté la capitale en 1941 pour la zone libre pour s'éviter des ennuis en raison de sa confession. » La commission tranche : « retrait général ». Serge Gainsbourg n'a jamais rien su de cette dénaturalisation.
De retour à Paris après la libération, la famille s'installe dans le XVIe arrondissement de Paris. Lucien est en échec scolaire et abandonne, peu avant le bac au lycée Condorcet. Il s'inscrit alors aux Beaux-Arts, mais il est rebuté par les études mathématiques et abandonne. Il y rencontre en 1947, Élisabeth Levitsky, fille d'aristocrates russes qui a des accointances avec les surréalistes et qui devient sa compagne. Il l'épousera le 3 novembre 1951.
L'année 1948 est une année importante pour Lucien. Il fait son service militaire à Courbevoie, où il sera envoyé régulièrement au trou pour insoumission. Il y commence sa « période » éthylique ; privé de permission, il s'enivre au vin avec ses camarades de régiment. C'est également durant cette période qu'il apprend à jouer de la guitare.
Il a une révélation en voyant Boris Vian au Milord l'Arsouille, qui écrit et interprète des textes provocateurs, drôles, cyniques, loin des vedettes du moment, comme Dario Moreno ou Annie Cordy. Bientôt, engagé comme pianiste d'ambiance par Francis Claude, directeur artistique du cabaret, Serge Gainsbourg accompagnera à la guitare la chanteuse Michèle Arnaud. En 1957, c'est par hasard que Michèle et Francis découvrent avec stupéfaction les compositions de Gainsbourg en allant chez lui voir ses toiles. Le lendemain, Francis Claude pousse Serge sur scène. Mort de trac, il interprétera son propre répertoire (dont Le poinçonneur des lilas). Puis Claude le présente dans son émission sur les ondes de Paris-Inter le 5 janvier 1958. Michèle Arnaud (et plus tard, en 1966, son fils Dominique Walter) sera d'ailleurs la première interprète de Serge. Il commence à déposer ses titres à la SACEM. Elle enregistrera, dès 1958, les titres La Recette de l'amour fou, Douze Belles dans la peau, Jeunes Femmes et vieux messieurs et La Femme des uns sous le corps des autres. C'est là qu'il fait ses premières armes, compose de nombreuses chansons et même une revue musicale. Il se lance aussi dans une course effrénée après les femmes, qu'il séduit en grand nombre, ce qui l'éloigne de son épouse, Élisabeth Levitzky. Ils divorcent en octobre 1957, six ans après leur mariage.
En studio, il commence sa fructueuse collaboration avec Alain Goraguer, déjà arrangeur de Boris Vian13. Son premier album, Du chant à la une d'où est extrait Le Poinçonneur des Lilas, premier succès en 1958, détonne, mais est un échec commercial. Il sera remarqué par Marcel Aymé, qui dit que ses chansons « ont la dureté d'un constat ». Son maître Boris Vian, avant de mourir en 1959, le compare à Cole Porter.
Lorsque l'époque des yéyés arrive, il a 32 ans et n'est pas très à l'aise : il passe en première partie de Brel ou de Gréco, mais le public le rejette et les critiques, cruelles, se moquent de ses grandes oreilles et de son nez proéminent. Débute, avec Gréco, une collaboration qui durera durant toute cette période « Rive Gauche », dont le point d'orgue sera La Javanaise à l'automne 1962.
Il fera en 1964 quelques duos avec l'artiste Philippe Clay auquel il ressemble de façon troublante.
Il rencontre alors Elek Bacsik et Michel Gaudry et leur demande de faire un disque avec lui. Ce sera Gainsbourg Confidentiel empreint d'un jazz archimoderne qui plait tant à Gainsbourg, mais qui, il le sait, ne lui permettra jamais d'accéder au succès. Ce disque ne se vend qu'à 1 500 exemplaires. Sa décision était prise dès la sortie du studio : « Je vais me lancer dans l'alimentaire et m'acheter une Rolls ». Malgré tout, son album suivant, Gainsbourg Percussions, inspiré (parfois directement - et sans droit d'auteur ) des rythmes et des mélodies deMiriam Makeba et Babatunde Olatunji, reste encore à l'écart de la vague yéyé qui apparaît et fera la fortune de Gainsbourg.
Il échappe en tant qu'interprète au ghetto de la « chanson française de variétés » (par opposition à la pop) avec Qui est in ? Qui est out ?, qui passera largement à l'émission Salut les copains, lui donnant son entrée à part entière chez les « yéyés ».
Les paroles de cette chanson étonneront beaucoup de monde lors de cette diffusion et le magazine Tribune juive, écrira dans son article : «...Et pourtant, Gainsbourg n'était pas attaché à Israël. D'ailleurs, il n'y a jamais mis les pieds. Et lorsqu'il parlait de ses racines, il préférait évoquer la Russie de ses parents. Peut-être avoue-t-il dans cette chanson ce qu'il n'a jamais osé dire ?"» ... «Personne ne se doutait que Gainsbourg même s'il ne s'est jamais caché d'être juif, aurait écrit une chanson si engagée pour le jeune État d'Israël à l'issue de la guerre des 6 jours et de la libération de Jérusalem. Si Gainsbourg n'a jamais caché ses origines ("Je suis né sous une bonne étoile... jaune", disait-il), le monde était loin de s'imaginer que l'artiste composerait une chanson aussi engagée pour le jeune État d'Israël.»....
Le label Kol Record est chargé, trente ans plus tard, par Jean-Gabriel Le Nouvel d'assurer la production et l'enregistrement de l'adaptation musicalement inédite en hébreu Al Holot Israel. Elle est interprétée par la Leakat Tsvait (La Chorale) de Tsahal : La Leakat Magav.
Sur le tournage du film Slogan, en 1968, il rencontre Jane Birkin pour laquelle il sera à nouveau auteur-compositeur. Je t'aime... moi non plus et 69 Année érotique sont d'immenses succès qui dépassent les frontières. Ils deviendront pendant dix ans un couple très médiatique, faisant régulièrement la une de l'actualité couverte par les médias, chacun enchaînant disque et tournage, concerts et apparitions photographiques.
Pour la petite histoire, les deux protagonistes Serge et Jane se retrouvent, sans se voir, lors de la mort d'Édith Piaf, sur un lieu commun, le 10 octobre 1963 alors que tout le monde s'agglutinait pour regarder la dépouille de la chanteuse : Jane, encore adolescente, vivait dans une famille française qui habitait le même immeuble que la célèbre môme Piaf.
En 1975, il sort l'album Rock Around the Bunker. Avec Rock around the bunker il pousse la provocation à son comble : il tourne en dérision, au second degré, l'esthétique nazie. L'album, enregistré à Londres, est radicalement rejeté par les programmateurs de radio qui ne voient dans cette farce à la Boris Vian qu'une provocation scandaleuse avec des titres comme Nazi rock, SS si bon ou Tata teutonne. Pourtant, à la fin de la décennie 1980, cet album sera couvert de disques d'or. Il compose également des tubes commeL'Ami Caouette. En 1979, il rejoint le groupe rock Bijou sur scène et verse une larme : le jeune public rock lui fait une ovation.
En mai 1973, Serge Gainsbourg est victime d'une crise cardiaque, et la transforme en élément promotionnel en annonçant à la presse, depuis son lit d'hôpital, qu'il va réagir « en augmentant sa consommation d'alcool et de cigarettes ». Il continue à boire et à fumer, fidèle au personnage qu'il est en train de devenir.
En 1979, son nouvel album enregistré à Kingston devient disque de platine en quelques mois. La Marseillaise (reggae) choque1 le journaliste du Figaro Michel Droit qui écrit un article virulent selon lequel, en antisémitisme, « il y a aussi des rabatteurs ». Serge Gainsbourg lui répondra par voie de presse dans un article intitulé On n'a pas le con d'être aussi Droit. Un double CD réunissant nouveaux mixages, enregistrements inédits, versions dub et d'artistes jamaïcains est paru en 2003.
Pour répondre aux campagnes de presse dont il devient peu à peu l'objet et qui le touchent profondément dans son estime, le 13 décembre 1981, Gainsbourg riposte en achetant le manuscrit original de la Marseillaise (135 000 F, soit 20 580 euros), vendu aux enchères à Versailles. Peu de temps après, de nouveau en concert, cet évènement médiatisé par les journaux télévisés permettra cette fois à Serge Gainsbourg d'avoir les parachutistes de son côté, faisant ainsi définitivement taire les rumeurs malveillantes1 au sujet de son patriotisme.
La salle de concert de Strasbourg où il doit se produire est investie par des membres d'une association d'anciens parachutistes militaires qui désapprouvent sa version de La Marseillaise, mais Gainsbourg garde tout son sang-froid et prend les paras au dépourvu en chantant a cappella, et le poing tendu, la version originale de l'hymne français : les paras sont donc de ce fait obligés de se mettre au garde à vous après un moment de flottement, comme en témoignent les bandes d'actualités de l'événement. « J'ai mis les paras au pas ! », s'amusera-t-il dans l'émission « Droit de réponse » de Michel Polac ; et de fait, les paras, estimant avoir eu réparation, se retirent. Gainsbourg poursuit une tournée triomphale, accompagné de Sly and Robbie et des choristes de Bob Marley : les I Threes. Un double CD, Gainsbourg et cætera réunissant de nouveaux mixages de l'intégrale d'un concert au théâtre Le Palace de Paris restitue ce qui reste son meilleur enregistrement en public.
Les boîtes de nuit, les beuveries, le noctambulisme, la décrépitude physique... De plus en plus, « Gainsbarre » succédera à Gainsbourg avec quelques apparitions télévisées plus ou moins alcoolisées. Il fortifie ainsi sa légende de poète maudit mal rasé et ivre qui lui vaut tantôt l'admiration, tantôt le dégoût. En septembre 1980, après plus de dix ans de vie commune, Jane Birkin n'en peut plus et le quitte. Elle admet lors d'une émission télévisée réalisée après sa mort : « J'avais beaucoup aimé Gainsbourg, mais j'avais peur de Gainsbarre ». Renauds'inspirera plus de vingt années plus tard de ces évenements pour écrire sa chanson Dr Renaud, Mister renard qui traduit une descente auxenfers présentant bien des similitudes. À partir de cette période, il devient un phénoméne de télévision de par son comportement provocateur et décadent qui déclenchera plusieurs scandales.
Le 11 mars 1984, il brûle les trois quarts d'un billet de 500 francs devant les caméras de télévision pour dénoncer le "racket fiscal" qui le taxe à 74%, argent dépensé non pas pour les pauvres mais pour le "nucléaire et toutes les ..." Il apparaît le plus souvent ivre et mal rasé. En avril 1986, dans une émission de Michel Drucker du Samedi soir, où la chanteuse américaine Whitney Houston est présente, Gainsbourg lui dit en anglais, "I want to fuck her" (je veux la baiser).
Serge rencontre une nouvelle égérie, Bambou, pour laquelle, il ne peut, une fois de plus, s'empêcher de composer. Il lui fera chanter quelques titres qui ne rencontrent pas les faveurs du public (Made in China, 1989). Il continuera cependant d'écrire pour Jane Birkin.
Gainsbourg enregistre son nouvel album reggae à Nassau aux Bahamas avec la même équipe que le précédent. On peut y entendre les paroles de Ecce Homo :
On me trouve au hasard
Des night-clubs et des bars
Américains c'est bonnard
(...) Il est reggae hilare
Le cœur percé de part en part.
Son œuvre quasi-intégrale sort en coffret CD. Il contient de nombreux titres introuvables que les collectionneurs s'arrachent à prix d'or ; toutefois, les chansons écrites pour ses interprètes ne sont pas incluses, ni un certain nombre d'inédits, ni les concerts. Il part ensuite pour New York où il enregistre ses deux derniers albums, Love on the Beat et You're Under Arrest. Après le reggae, il se frotte au hip-hop et au funk. Il se produit de longues semaines en concert au Casino de Paris.
Lors de son enterrement, le 7 mars 1991, vinrent notamment parmi la foule, outre sa famille, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Françoise Hardy, Patrice Chéreau, Eddy Mitchell, Renaud, Johnny Hallyday, les ministres Jack Lang et Catherine Tasca, et les brigades de cuisiniers et serveurs du restaurant « L'Espérance » où il avait passé ses derniers jours. Catherine Deneuve lut devant la tombe le texte de la chanson Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve .
Salut les copains (magazine)
Salut les copains est un magazine pour les jeunes, lancé à l'été 1962 par Frank Ténot et Daniel Filipacchi comme prolongement écrit de l'émission radiophonique éponyme, diffusée chaque jour sur Europe 1, depuis 1959. Il était centré sur les artistes de musique pop.
La revue a connu d'emblée un succès extraordinaire qui lui a permis à son apogée de dépasser le million d'exemplaires vendus et de donner son unité à la génération yé-yé en mettant régulièrement en avant des artistes fétiches comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Chantal Goya, Françoise Hardy, Sheila, Michèle Torr, Claude François, puis Jacques Dutronc et Michel Polnareff.
Le magazine aimait à publier des reportages détaillés sur les faits et gestes, parfois les concerts, des jeunes chanteurs français, plus rarement sur les chanteurs américains et anglais, à l'exception notable des Beatles et des Rolling Stones. Les principaux rédacteurs étaient Éric Vincent, Raymond Mouly, Guy Abitan, Régis Pagniez, Michel Taittinger... Les photographies étaient le plus souvent confiées à Jean-Marie Périer et à Tony Frank.
La plus ambitieuse tenta de regrouper sur une photo en double page, dite Photo du siècle, toutes les idoles de l'époque, véritable exploit en termes d'organisation.
Deux initiatives à relever : la publication chaque mois d'un poster de l'artiste en couverture et celle des paroles des chansons du moment (en français).
Salut les copains s'est inspiré au départ de Disco Revue, lancé en septembre 1961, sans cependant adopter son exigence "puriste" vis-à-vis du rock 'n' roll des pionniers. Il a préféré d'emblée afficher son intérêt pour les chanteurs les plus commerciaux, talentueux ou pas.
Son succès commercial a suscité le lancement de nouveaux concurrents : Age Tendre, Bonjour les amis, Best, Formidable (RTL), Extra et Nous les garçons et les filles... Le titre est revendu à la société Edi-Presse. Il existe alors sous le titre Salut, avec une formule différente.
Le titre arrête définitivement sa parution en avril 2006.
Retour à : Musique : Sommaire
Retour à : Musique : Postes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique :
Salut les copains (émission)
Salut les copains était une émission de variétés (pop music), lancée le 19 octobre 1959 sur Europe 1 par Frank Ténot et Daniel Filipacchi (inventée par Jean Frydman), qui était diffusée du lundi au vendredi entre 17 h et 19 h. Un sondage indique que 40% des 12-15 ans écoutaient cette émission.
L'émission gagna un vaste public, en partie par sa conception très structurée qui lui assura une audience plus fidèle que si elle n'avait été qu'une simple succession de chansons dans le désordre.
La pub était assurée par Vonny qui, par la suite, a été chargée de courts billets dans l'émission.
On a pris conscience de l'importance de ce public lors de la Nuit Salut les Copains, place de la Nation à Paris (22 juin 1963), premier spectacle gratuit avec la participation de tous les artistes de l'émission.
Lucien Morisse, le chanteur Carlos, Hubert Wayaffe dit HUBERT ont présenté cette émission.
Une partie du succès de l'émission, et de sa perception comme telle, venait du fait qu'on ne se contentait pas d'y passer simplement des disques à la suite comme sur les autres stations. Elle possédait une structure, un rituel qui finissait par devenir presque addictif chez les fans :
Diffusé en début et en fin d'émission, ainsi qu'à la reprise après la grande pause pub de milieu d'émission, il était assuré de 15 passages aux heures de plus grande écoute la semaine où il était choisi. Le passage en chouchou n'était toutefois pas une garantie de montée du disque au hit-parade. Ainsi, après l'énorme succès de Yeh yeh par Georgie Fame, sa chanson suivante Getaway fut programmée en chouchou, mais sans pour autant devenir un "tube" comparable.
Coup de projecteur sur un groupe ou un artiste dont on passait trois chansons successivement. Cette rubrique aida rapidement le public à se familiariser avec le "son" d'artistes moins connus, et ainsi à les apprécier.
Il arrivait dans certains cas (par exemple les Nashville Teens) que les artistes en question fussent présents sur le plateau et interviewés par Daniel.
Une même chanson exécutée dans trois versions, et parfois dans deux langues, différentes. Les reprises de "standards" du rock ainsi que les nombreuses traductions françaises de succès anglo-américains permettaient de fournir régulièrement cette rubrique. Exemple typique : trois versions de "Mercy" (la version blues originale, et deux contemporaines dont celle des Rolling Stones).
Le premier générique (le terme alors en vigueur étant "indicatif") de SLC a été "Rat Race", de Count Basie. Daniel Filipacchi était déjà le co-animateur d'une autre émission culte d'Europe no 1, "Pour ceux qui aiment le jazz". D'où le choix de ce morceau.
Le générique qui a marqué le plus les auditeurs de l'émission a été sans doute "Last night", instrumental des Mar-Keys. Les Mar-Keys étaient le premier groupe à développer le "Memphis Sound", le son des studios Stax de Memphis (Tennessee).
Une version plus "française" du riff des Mar-Keys est devenue l'indicatif de SLC en 1962 : "SLC twist" d'Eddie Vartan. Les breaks du début étaient conçus pour accueillir les voix de Petula Clark, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.
Les modes se succédant en France, l'indicatif suivait alors : après "SLC Twist", Les Gamblers (groupe de Claude François) a créé " SLC Surf"...
A suivi une période floue pendant laquelle l'indicatif a été joué par Bill Doggett ("Hold It"), Lonnie Mack ("Memphis"), avant 1966, date de l'arrivée à l'antenne des jingles packages historiques de SLC, composés par Michel Colombier. À partir de cette période, l'indicatif de SLC reprend le thème "SLC Salut Les Copains" développé en version longue.
Jingles
"Daniel, boîte postale 150, Paris 8e" (chanté)
"C'est chouchouuuu !" (parlé)
Discographie
Coffret Salut les copains, 50e anniversaire, Les cent tubes de Salut les copains, 4 CD, Europe 1/Universal Music/éd. Montparnasse,sortie prévue le 3 novembre 2009.
Box collector Salut les copains, 50e anniversaire, répliques en CD de vingt 45 tours mythiques, livret, poster de la photo emblématique réalisée par Jean-Marie Périer, Europe 1/Universal Music/éd. Montparnasse, sortie prévue le 30 novembre 2009.
Vidéographie
Coffret Salut les copains, 50e anniversaire, 3 DVDs, Europe 1/INA/éd. Montparnasse, sortie prévue le 3 novembre 2009.
Jingles de l'émission, 120 chansons des idoles des années 60, interviews et actualités d'époque.
Retour à : Musique : Sommaire
Retour à : Musique : Postes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique :