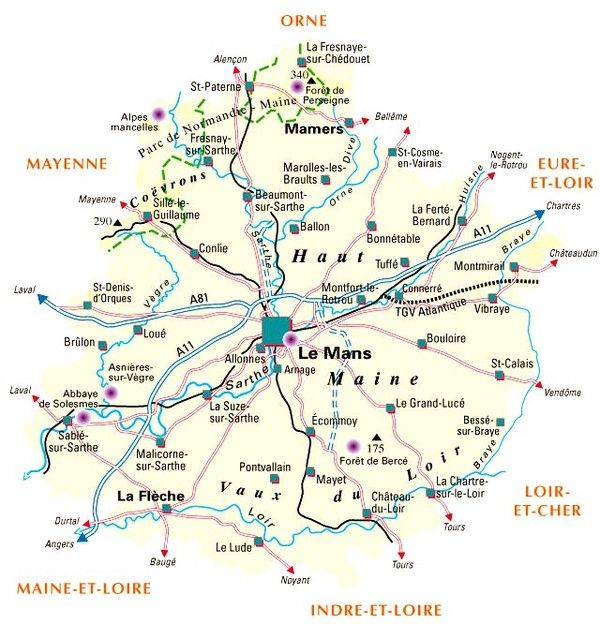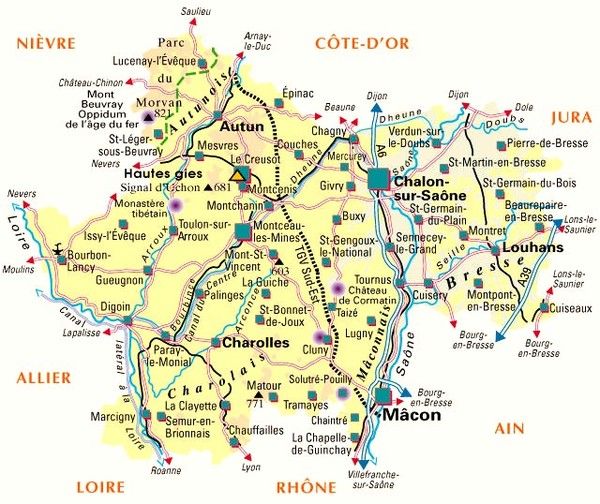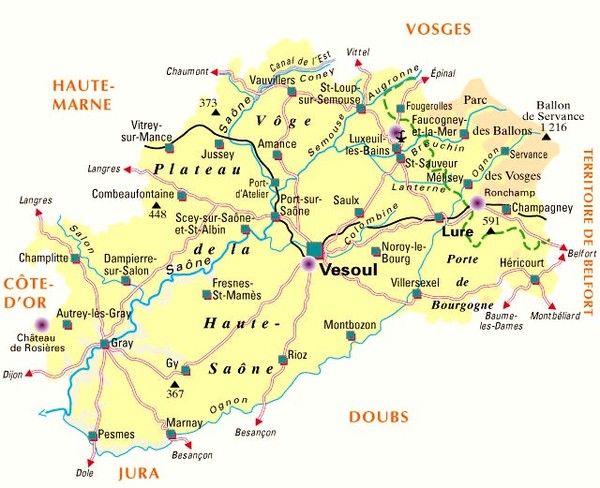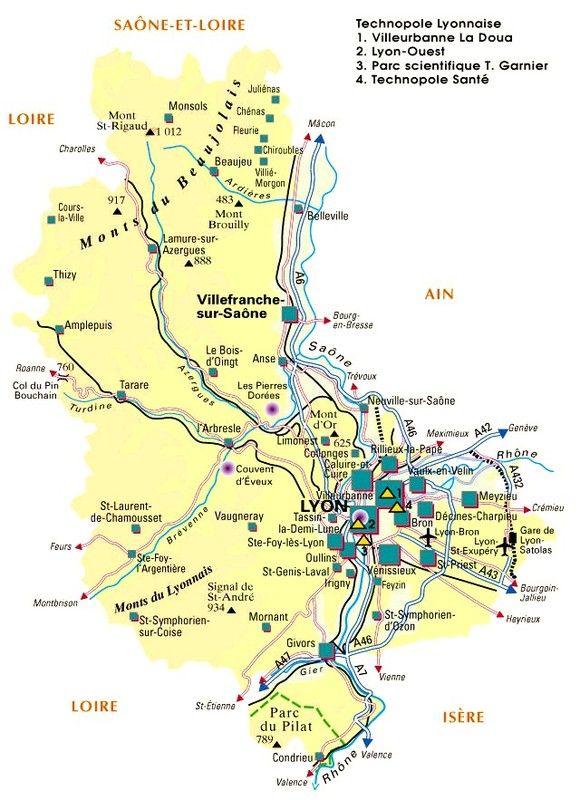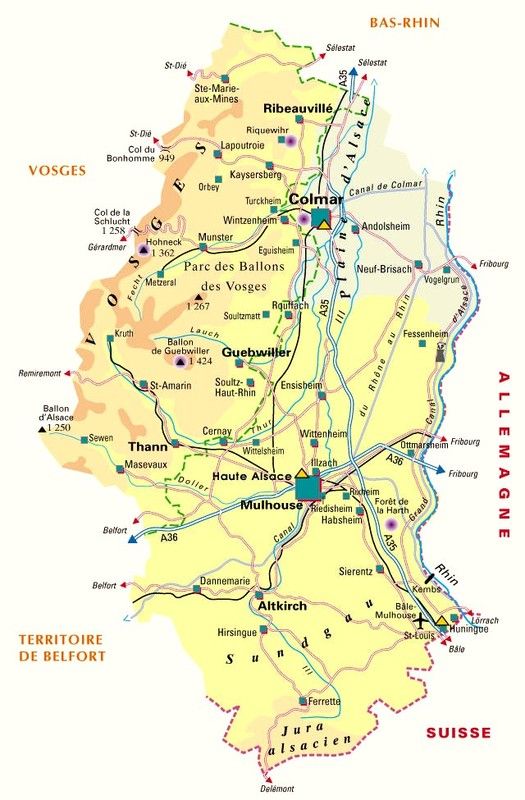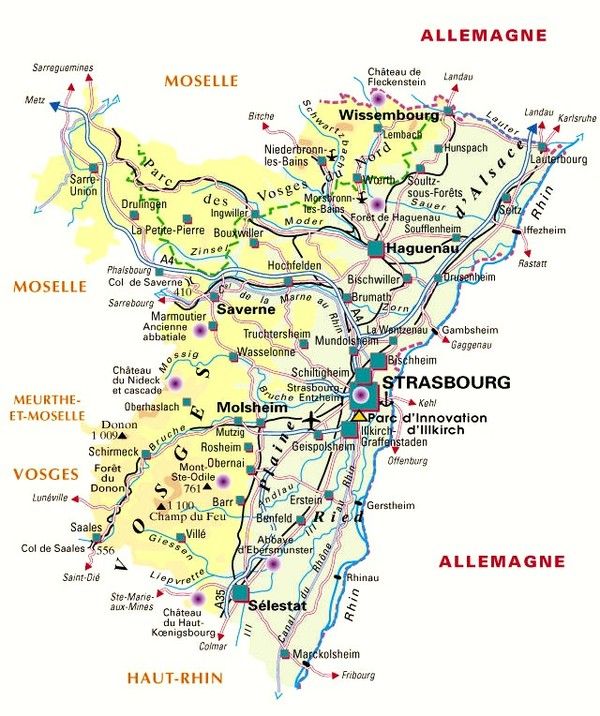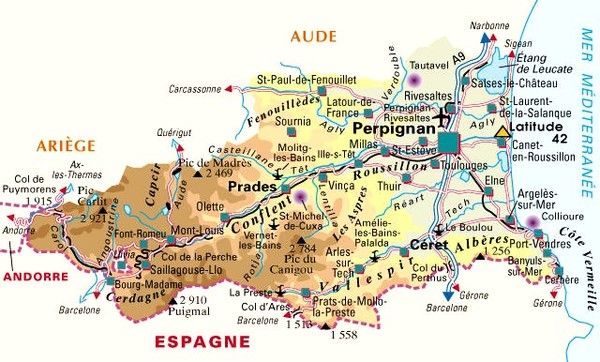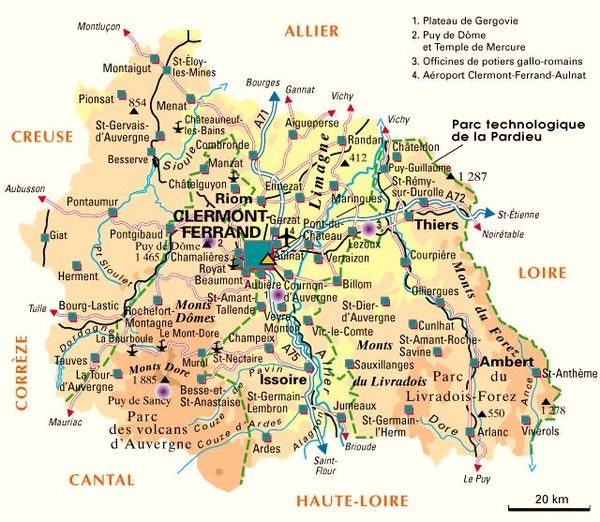Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Les départements-(histoire)-
Les départements et leur histoire - Savoie - 73 -
Partie 1
L'union territoriale de la France, la force de cohésion qui relie entre elles toutes ses parties et qui fait l'admiration ou l'envie des autres nations, ce fait à peu près unique en Europe et dont l'histoire n'est pas un accident dû au hasard, c'est, au milieu des événements humains, le dégagement d'un grand principe, la consécration d'une loi providentielle. Ce fait, comme toute œuvre destinée à durer, est œuvre patiente du temps, et il lui a fallu de longs siècles pour s'accomplir.
La Savoie, dont nous allons résumer les annales, nous prouvera une fois de plus que les peuples, pas plus que les individus, ne peuvent échapper à leur destinée et que l'harmonie, ici-bas, consiste tout entière dans l'accomplissement des lois que nous impose la divine Providence.
Quoique la réunion de la Savoie à la France ne date que d'hier, nos lecteurs verront depuis combien de temps cette fusion était préparée dans les esprits, dans les mœurs, dans les besoins, dans les vœux de tous, et par conséquent à combien de titres elle était légitime ; ils savent que les années sont à peine des jours dans la vie des peuples, et ils se rappelleront que celles de nos provinces les plus profondément, les plus énergiquement françaises, étaient encore séparées de la grande, de la bien-aimée famille, au commencement du siècle dernier.
Alors encore, pour rattacher ces membres au tronc, il fallut de violents efforts, des guerres sanglantes ; le temps a marché depuis ; la Révolution française est enfin venue. Par elle, un nouveau droit public a surgi ; les peuples ont repris possession d'eux-mêmes, et, cette fois, c'est à un suffrage libre que la France doit l'agrandissement de sa famille et l'extension de ses frontières. Ces annexions, conquêtes pacifiques, les seules que devrait désormais accepter l'esprit moderne, sont déterminées par une communauté d'origine, des liens de traditions historiques et une solidarité d'intérêts dont l'évidence ressortira, nous l'espérons, des faits que nous avons à retracer.
Avant l'invasion romaine, époque pleine d'obscurité et d'incertitude, on sait seulement que la Savoie était habitée par des tribus allobroges, sorties, comme les tribus gauloises, de la race celtique. L'organisation politique était la même, les moeurs étaient semblables. Aussi, quand Brennuset Bellovèse descendirent en Italie, leurs hordes, en passant les Alpes, se grossirent-elles de nombreux contingents de l'Allobrogie. Polybe donne le nom d'un roi des Allobroges, Bancas, qui aurait servi de guide à Annibal ; mais aucun monument ne constate d'une manière positive le passage du général carthaginois. MM. Champollion-Figeac et Barentin de Montchal prétendent que le gouvernement des Allobroges était républicain, nous ne mentionnons donc le fait que pour constater les controverses auxquelles il a donné lieu.
Le premier événement dont l'authenticité soit incontestable remonte à l'an 118 avant l'ère chrétienne. Les Allobroges avaient donné asile au roi des Liguriens, ennemi de Marseille que Rome protégeait, Domitius Ahenobarbus saisit avec empressement ce prétexte ; la guerre fut déclarée ; les Savoisiens, unis aux Dauphinois septentrionaux, s'avancèrent au-devant de l'ennemi ; les armées se rencontrèrent près d'Avignon, dans les plaines d'un village nommé Vindalie ; les Romains furent vainqueurs, et l'Allobrogie fut ajoutée aux provinces déjà conquises.
Jusqu'à l'arrivée de César, les montagnards semblent avoir supporté le joug assez difficilement ; ils protestaient contre la lourdeur des impôts, et leur mécontentement était si notoire, que Catilina comptait sur eux dans ses projets contre le sénat. Il fut trahi à Rome par leurs députés, qui entrèrent d'abord dans la conjuration ; mais la nation ne s'en associa pas moins par un soulèvement à sa tentative : il fallut que le préteur de la Gaule Narbonnaise marchât contre les révoltés. Un de leurs chefs, Induciomar, de la tribu des Voconces, se mit à leur tête.
Toute l'Allobrogie s'arma ; deux batailles rangées furent gagnées par les montagnards sur les légions romaines ; mais ce triomphe fut de peu de durée. C'est à César qu'il appartenait d'achever de les vaincre. L'indocilité des Allobroges et les nombreuses interventions qu'elle nécessitait valurent au pays la création de deux voies romaines, constatées dans les itinéraires d'Antonin et dont de nombreux vestiges existent encore : l'une de Milan à Vienne en Dauphiné, séparant la Tarentaise et la Savoie proprement dite du petit Saint-Bernard et de Saint-Genix-d'Aoste ; l'autre de la Tarentaise à Genève ; la première longue de 100 kilomètres environ, et la seconde de 110.
Depuis César jusqu'à l'invasion des Burgondes en 427, la tradition ne nous a transmis le souvenir d'aucun événement important. On peut supposer que, le caractère des Savoisiens ayant été mieux apprécié par les Romains, de meilleurs rapports s'établirent entre les vainqueurs et les vaincus, que les impôts furent diminués et qu'une période de paix et de bonheur relatif fit oublier les tempêtes et les calamités passées. N'est-ce pas l'occasion d'appliquer le mot célèbre : Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire ?
C'est par analogie encore que nous sommes réduits a juger les temps qui suivirent. Le contact de la civilisation romaine dut opérer en Allobrogie une transformation semblable à celle que nous avons pu signaler dans la plus grande partie de la Gaule par certains changements caractéristiques et avec des documents précis qui manquent ici. Il fallait que le caractère national eût perdu beaucoup de son ancienne fierté et de son énergie pour accepter sans protestation une invasion des Burgondes vaincus que le patrice romain Aétius parquait dans les vallées de la Savoie (Sapaudia ou Sabaudia) en l'an 427. Il fallait que les éléments de sa nationalité primitive fussent bien altérés pour se laisser aussi facilement absorber par la barbarie des nouveaux hôtes.
A quelle époque paraît le mot Sabaudia pour désigner cette région, et d'où vient-il ? On l'ignore complètement. C'est un écrivain du IVe siècle. après Jésus-Christ, Ammien-Marcellin, qui l'emploie pour la première fois, et depuis il a été conservé. Des différentes étymologies qu'on lui a données, la seule vraisemblable est la suivante : Sap-Wald, deux mots teutons ou germaniques dont la réunion signifie Forêt, ou Pays des Pins.
Pendant près de six siècles, la Sapaudia disparaît dans les royaumes de Bourgogne, plus complètement encore que l'Allobrogie n'avait été effacée sous les successeurs de César ; malheureusement, cette époque, moins éloignée de nous et mieux connue que la précédente, ne nous permet pas d'aussi rassurantes suppositions.
La pauvre Savoie eut sa part de tribulations, de misères, d'épreuves de tout genre, dans les crises que traversèrent ces éphémères monarchies burgondes. Nos lecteurs trouveront un aperçu de cette lamentable histoire dans la notice de la Côte-d'Or, où il était mieux à sa place ; nous n'y emprunterons que quelques détails se rattachant plus directement au passé du département qui nous occupe.
Nous rappellerons seulement le nom de quatre rois de la première dynastie : Gondicaire fonde le royaume. Chilpéric est le père de la célèbre Clotilde, épouse de Clovis. Gondebaud promulgue la loi Gombette, ce code de la féodalité qui survécut si longtemps à l'invasion des barbares et dont l'empreinte est encore si puissante dans plusieurs constitutions contemporaines ; enfin le dernier et le meilleur, dit-on, Sigismond, fait étrangler son fils sur un simple soupçon de révolte ; mais il fait de nombreux dons au clergé et de pieuses fondations : il est canonisé.
C'est à cette période de son histoire qu'on fait remonter, pour la Savoie, la première organisation de son territoire en papi, espèce de districts désignés sous la dénomination générique de Pagi Burgonden, organisation que remania de sa main puissante Charlemagne en 763, lorsque, passant d'Allemagne en Italie, il s'arrêta a Genève et à Saint-Jean-de-Maurienne.
Dans ce même temps, les plus célèbres apôtres du christianisme en Savoie furent saint Romain, saint Colomban et saint Lupicin. Notons encore, comme preuve de la permanente solidarité qui devait unir la Savoie aux provinces voisines de la Gaule, que le royaume de Bourgogne comprenait, avec la Savoie elle-même et le nord-est de la Suisse, la Bourgogne proprement dite, la Bresse, la Franche-Comté, le Dauphiné, le Lyonnais et toute la Provence. La capitale était tantôt Lyon ou Vienne, tantôt Chalon-sur-Saône. Les annales de la Savoie sont plus dépourvues encore de tout intérêt spécial et plus vides d'événements importants sous la seconde monarchie bourguignonne.
Lorsque Louis le Débonnaire, en 842, partagea entre ses fils l'héritage de Charlemagne, la Savoie échut à Lothaire avec l'Italie, la Provence et le titre d'empereur. Après Louis, fils de Boson, le royaume de Bourgogne transjurane se scinde, et la Savoie passe sous le sceptre de Rodolphe Ier, premier roi du second royaume de Bourgogne.
Ce roi, comme son prédécesseur Boson, n'était d'abord qu'un simple gouverneur de province ; il profita des troubles du royaume, en fomenta de nouveaux et se fit proclamer roi à Saint-Maurice-en-Valais, par les grands feudataires qu'il avait séduits. Rodolphe II, qui lui succéda, mourut à Payerne, près de Lausanne, en 938 ; il ajouta à ses États les principautés d'Arles et de Provence.
A la mort de ce prince, surnommé le Fainéant, le royaume tomba dans l'anarchie et passa .pièces par pièces aux comtes, aux barons qui s'emparèrent de l'autorité souveraine dans leurs districts. Conréard, qui lui succéda, eut lui-même pour successeur Rodolphe III, plus fainéant encore que Rodolphe II. Ce dernier compléta l'oeuvre de dissolution en étendant aux titulaires ecclésiastiques les concessions d'autorité temporelle que l'autre avait faites aux seigneurs laïques.
Nos lecteurs ont déjà remarqué sans doute l'identité qui existe même dans ce surnom de fainéant entre ces tristes chroniques de Bourgogne et l'histoire de France qui lui correspond ; nous avons à signaler une similitude plus déplorable encore, le fléau des invasions.
Citons un historien national, Claude Genoux, une des gloires populaires de la Savoie : « Ce fut en 891, dit-iI dans son excellente Histoire de Savoie, que les Sarrasins, fanatiques sectaires de Mahomet, abordèrent à Nice ; ils désolèrent d'abord le Piémont et passèrent ensuite en Savoie. Les marquis (commandants des marches), les comtes, les évêques de Maurienne, de Tarentaise et de Genève, convoquèrent le ban et l'arrière-ban de leurs guerriers ; ce fut en vain : des flots de sang coulèrent, et, malgré la bravoure de ses défenseurs, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne fut ruinée de fond en comble ; le Faucigny, la Tarentaise et le Valais eurent à peu près le même sort.
« C'était toujours chargés de butin que les Sarrasins, après leurs expéditions, se réfugiaient dans la haute vallée des Beauges, ou bien encore, dit la tradition, dans le quartier général à La Roche-Cevin. A Conflans, où ils ne laissèrent pas pierre sur pierre, ils bâtirent eux-mêmes une tour carrée, afin de perpétuer la mémoire de leurs méfaits. Cette tour se voit encore aujourd'hui à l'angle droit de l'esplanade de la ville ; une autre version, il est vrai, prétend que les barons saxons bâtirent cette tour ainsi que beaucoup d'autres et qu'ils y employèrent comme manœuvres les prisonniers qu'ils firent aux Sarrasins. Toujours est-il que, de toute notre Savoie, le château d'Ugines seul leur résista. C'était vers 940, sous le règne de Conréard, troisième roi du second royaume de Bourgogne. Cette invasion avait duré cinquante ans. »
La fin de Rodolphe III nous conduit à l'an 1033. La Savoie appartient alors à Conrad le Salique, fils de Rodolphe II. Adopté comme héritier par Charles Constantin, il est, à la mort de celui-ci, couronné empereur d'Allemagne. Une nouvelle période commence pour l'histoire de notre province.
Ici, toutefois, se présente pour nous une difficulté nouvelle. Pour les époques précédentes, les documents sont rares et confus ; ceux que nous allons rencontrer maintenant ont besoin d'être transformés et dégagés d'éléments qui ne leur sont pas propres. Il n'existe point, pour ainsi dire, d'histoire de Savoie, tant cette histoire se fond et s'absorbe dans celle de la maison qui régnait sur ce pays.
Ce peuple, tout de dévouement et d'abnégation, semble avoir renoncé à toute existence nationale pour vivre de la vie de ses souverains. Ses prospérités comme ses infortunes, sa gloire comme ses revers sont ceux de ses comtes, de ses ducs, de ses rois ; et les historiens du pays se sont tellement associés à cette espèce d'abdication, que leur grand souci est de rechercher s'il faut faire remonter l'origine d'Humbert aux Blanches mains, le premier comte de Savoie, à Boson, le fondateur du second royaume de Bourgogne, ou à Bérold le Saxon, descendant du fameux Witikind, comme le désiraient les princes de Savoie, dans le but de se donner un titre germanique à l'empire d'Allemagne, auquel aspirèrent plusieurs d'entre eux.
Notre observation n'a rien d'hostile pour l'antique et illustre maison de Savoie ; nous sommes tout disposés à reconnaître qu'elle a souvent donné des preuves de clémence, de mansuétude et de bonté, bien rares dans ces siècles d'injustice et de violence ; nous sommes prêts à proclamer que beaucoup de ses membres ont été aussi sages, aussi habiles, aussi prudents que courageux et magnanimes ; nous faisons trop la part du temps, des moeurs, des institutions, pour lui reprocher sa persévérante ambition ; mais il nous sera permis de regretter que tout cet éclat ait laissé dans une ombre trop profonde les mérites oubliés de ceux qui ont tant contribué à cette fortune.
En tirant une excuse pour l'insuffisance de cette notice, nous espérons aussi y trouver un argument à l'appui des opinions que nous avons émises en commençant. Telle est, en effet, la puissance des liens qui rattachent la Savoie à la France, que, malgré son dévouement docile, malgré l'héroïque fidélité avec laquelle elle suit et sert ses princes dans leurs brillantes aventures, rien ne peut détourner ni ses regards, ni ses pensées, toujours tournés vers l'occident ; aujourd'hui même que sa croix blanche flotte victorieuse des confins du Tyrol aux rivages de la Sicile, aucun regret ne se mêle au bonheur qu'elle éprouve d'arborer enfin le drapeau de la France.
Tâchons de répondre à ces précieuses sympathies de nos nouveaux compatriotes, et qu'ils ne s'en prennent qu'à l'humilité et a la modestie de leurs ancêtres, s'il est si difficile de glorifier convenablement leur passé.
Voici quelles étaient, en Savoie, vers le milieu du XIe siècle, les grandes familles de hauts barons déjà existantes : les vicomtes de Maurienne, de Briançon et de Chambéry, les barons de Seyssel, de Menthon, de La Rochette, de Blonay, de Montbel, de Chevron-Villette, de Beaufort, de Montmayeur, de Miolans et d'Allinges.
Au-dessous de ces puissantes maisons existait une noblesse inférieure, ne possédant que de petites baronnies et qui formait l'ordre équestre. Après lui venait, dans l'ordre hiérarchique, une noblesse militaire, composée de capitaines, qui forma, plus tard, l'ordre des chevaliers.
Après cette dernière classe de la noblesse venait celle des vavasseurs ou hommes libres, que l'on nommait aussi hommes d'honneur et compagnons de guerre ; puis les propriétaires libres ou de franc-alleu, et ensuite les vilains ou villageois ; ils étaient affranchis et propriétaires, mais attachés à la glèbe.
Enfin, les serfs venaient en dernier lieu ; ils terminaient cette longue liste de privilèges, de servitude et de misère. Cette classe, beaucoup plus nombreuse que toutes les autres ensemble, dit Costa de Beauregard, était composée d'ilotes voués exclusivement aux travaux des champs, à qui l'usage des armes était interdit, qui ne devaient jamais quitter le sol natal, qui ne connaissaient point les douceurs de la propriété, et auxquels il n'était permis ni de se marier ni de tester, sans le consentement de leurs seigneurs, lesquels étaient les maîtres de lever sur eux des contributions arbitraires ; et comme, suivant la coutume des Francs et des Bourguignons, la longueur de la chevelure indiquait le degré de la noblesse, les serfs, en signe de leur condition, devaient tenir sans cesse leurs cheveux coupés au ras de la tête.
De l'an 1033 à 1391, dix-sept comtes de la dynastie de Savoie possèdent successivement tout ou partie du pays. Voici la liste de ces princes, avec la date approximative de leur règne, sans y comprendre le trop problématique Bérold de Saxe : 1033. Humbert Ier, dit aux Blanches mains. - 1048. Amédée Ier, ou, par abréviation, Amé, surnommé la Queue. - 1069. Oddon ou Othon. - 1078. Amédée Il, surnommé Adélao. - 1094. Humbert II, dit le Renforcé. - 1103, Amédée III. - 1150. Humbert III, surnommé le Saint. - 1188. Thomas Ier. - 1230. Amédée IV. - 1253. Boniface, dit le Roland. - 1263. Pierre, dit le petit Charlemagne. - 1268. Philippe. - 1285. Amédée V, dit le Grand. - 1323. Édouard, surnommé le Libéral. - 1329. Aimon, dit le Pacifique. - 1344. Amédée VI, dit le comte Vert. - 1383. Amédée VII, surnommé le Rouge, le Noir ou le Roux.
Après la réunion des deux Bourgognes sous le sceptre de l'empereur Conrad le Salique, Humbert Ier obtint de ce prince le titre de comte souverain de Maurienne. Cette concession, toutefois, ne s'étendait qu'à une partie de la Maurienne et à quelques-unes de ses petites vallées. Le comte habita, ainsi que ses successeurs, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, le château fort de Charbonnière, résidence ordinaire dés marquis, feudataires des rois de Bourgogne et chargés, par eux, de défendre la vallée de Maurienne et la ville d'Aiguebelle. Tels furent l'humble berceau et les premiers domaines de la puissante monarchie de Savoie.
Sous Amédée Ier, les progrès étaient déjà sensibles, à en juger d'après la chronique à laquelle ce prince dut son peu poétique surnom. L'empereur d'Allemagne, Henri III, allait se faire couronner à Rome ; il était accompagné d'Amédée Ier, que suivaient de nombreux gentilshommes ; quarante, dit-on.
« Advint un jour, raconte Paradin, que le comte se vint présenter à l'huis de la chambre où se tenoit le conseil, et ayant heurté, lui fut incontinent la porte présentée, pour sa personne seulement, le priant l'huissier du conseil de vouloir faire retirer cette grande troupe qui estoit à sa queue ; à quoi ne voulant acquiescer, ne voulut l'huissier permettre l'entrée : dont il persista encore si haultement que l'empereur oyant le bruit demanda que c'estoit, l'huissier répond que c'estoit le comte de Maurienne qui menoit après soi un grand nombre de gentils-hommes. Lors, dit l'empereur, qu'on le laisse entrer et qu'il laisse sa queue dehors : ce qu'ayant entendu, le comte répondit avec mécontentement : si ma queue n'y entre avec moi, je n'y entrerai jà et vous en quitte. Alors l'empereur ordonna que la porte fût ouverte au comte et à sa queue. » N'est-ce point un curieux tableau des moeurs du temps et un intéressant indice des rapports qui existaient alors entre les divers degrés de la hiérarchie féodale ?
Le marquisat de Suse, ce premier regard sur l'Italie, échoit à Oddon par son mariage avec Adélaïde, fille de Mainfroy. Sous le règne de son fils, Amédée II, cette Adélaïde sert de médiatrice entre le pape Grégoire VII et l'empereur Henri IV ; et il est déjà question de l'importance politique que prend la maison de Savoie, dans une relation adressée par l'ambassadeur Foscarini au sénat de Venise.
Cependant le titre de comte de Savoie ne semble avoir été pris pour la première fois que par Humbert II. La Savoie eut, comme la France, les folles terreurs de l'an 1000 qui multiplièrent les fondations religieuses. Le siècle suivant fut celui des croisades ; ce fut principalement à la troisième que prit part la Savoie. Amédée III accompagna le roi de France Louis VII ; il mourut à Nicosie, dans l'île de Chypre, deux ans après son départ de Charbonnière.
Voici le nom des principaux seigneurs dont il fut suivi le baron de Faucigny et son fils, les barons de Seyssel et de La Chambre, ceux de Miolans et de Montbel, les seigneurs de Thoire, de Montmayeur, de Vienne-de-Viry, de La Palude, de Blonay, de Chevron-Villette, de Chignin et de Châtillon.
Les premières monnaies qui portent l'empreinte de la croix de Savoie datent de Humbert III, le premier de sa race qui ait été enterré à l'abbaye de Hautecombe. L'espace si restreint dont nous disposons nous oblige à passer sous silence bien des faits importants. Nous ne pouvons rien dire des guerres si fréquentes auxquelles les comtes devaient presque toujours un accroissement de leur influence et une extension de leurs frontières ; n'oublions pas cependant que l'acquisition de Chambéry est due au comte Thomas, qui l'acheta du comte Berlion, le 15 mars 1232, moyennant 32 000 sous forts de Suse, somme équivalente a 100 000 francs de notre monnaie ; le château n'étant pas compris dans ce marché.
C'est à cette époque que remontent les premières franchises municipales conquises, obtenues ou achetées par les communes. Inscrivons ces dates glorieuses : elles valent bien celles des batailles ou de l'avènement des princes. Yenne s'affranchit la première en 1215, Montmélian en 1221, Plumet en 1228, Chambéry en 1233, Beaugé en 1250, Évian en 1265, Seyssel en 1285, Bonneville en 1289, Rumilly en 1292, Chaumont et Cluses en 1310, Thonon en 1323, La Roche en 1325, Annecy en 1367. Genève, si fière aujourd'hui de sa liberté, n'en fit la première conquête qu'en 1387.
Le règne d'Amédée IV fut marqué par une épouvantable catastrophe, l'écroulement de la montagne du Grenier ; les blocs de rochers, dit la légende, ne s'arrêtèrent que devant le sanctuaire de Notre-Dame de Myans ; l'image de la Vierge qu'on y vénérait passait pour avoir été peinte par saint Luc ; aussi la dévotion envers cette madone devint-elle une des pratiques les plus répandues et les plus populaires de la Savoie.
Les départements et leur histoire - Sarthe - 72 -
Les Aulerces Cénomans (Aulerci Cenomani) occupaient, avant la domination romaine, le territoire du département de la Sarthe. Ils sont comptés par Tite-Live au nombre des peuplades gauloises qui, sous la conduite de Bellovèse, envahirent l'Italie et s'établirent dans le nord de la péninsule. Ils furent soumis par Crassus, l'un des lieutenants de César, à l'époque de la conquête des Gaules. Plus tard, ils prirent une part énergique à l'insurrection gauloise, dont Vercingétorix fut le chef et le martyr.
Le pays, soumis à la domination romaine sous les Césars, s'en affranchit, et vécut d'une existence indépendante avec tout le reste des nations occidentales de la Gaule, jusqu'au milieu du Ve siècle, où il subit la domination d'un chef franc, Régnomer. Le christianisme, prêché dans le pays par saint Julien, y avait depuis longtemps fait de nombreux prosélytes, et, pendant les premiers siècles de notre histoire, la plus grande autorité du pays fut celle des évêques du Mans, dont plusieurs se signalèrent par leur charité, leurs lumières et leurs fondations pieuses.
Leur influence bienfaisante répara un peu les malheurs que l'anarchie sanglante de cette époque fit peser sur le Maine, comme sur le reste de notre pays. Après avoir joui d'un moment de calme sous Charlemagne, qui traversa la contrée en se rendant en Espagne, le Maine, dont la capitale était devenue une ville importante, excita la convoitise des divers successeurs de Charlemagne, et fut enfin envahi par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. « Quelques années avant sa descente en Angleterre, dit Augustin Thierry, Guillaume fut reconnu pour suzerain du Maine par Herbert, comte de ce pays, grand ennemi de la puissance angevine, et à qui ses excursions nocturnes dans les bourgs de l'Anjou avaient fait donner le nom bizarre et énergique d'Éveille-Chien.
« Comme vassaux du duc de Normandie, les Manceaux lui fournirent de bonne grâce leur contingent de chevaliers et d'archers ; mais, quand ils le virent occupé des soins et des embarras de la conquête, ils songèrent à s'affranchir de la domination normande. Nobles, gens de guerre, bourgeois, toutes les classes de la population concoururent à cette œuvre patriotique : les châteaux gardés par les soldats normands furent attaqués et pris l'un après l'autre ; Turgis de Tracy et Guillaume de La Ferté, qui commandaient la citadelle du Mans, rendirent cette place, et sortirent du pays avec tous ceux de leurs compatriotes qui avaient échappé aux représailles et aux vengeances populaires. Le mouvement imprimé aux esprits par cette insurrection ne s'arrêta pas lorsque le Maine eut été rendu à ses seigneurs nationaux, et l'on vit éclater dans la principale ville une révolution d'un autre genre. »
Cette révolution, dont nous parlerons plus en détail en nous occupant de la ville même qui en fut le théâtre, eut pour premier résultat la fondation d'une commune au Mans ; mais la querelle se prolongeant, Guillaume en profita pour envahir le pays. Ses soldats dévastèrent toute la contrée, et telle fut la terreur répandue partout par leurs excès, que les places fortes se hâtèrent de se soumettre, et les principaux citoyens du Mans apportèrent les clefs de leur ville au duc, qui campait sur les bords de la Sarthe. Ils lui prêtèrent serment, et Guillaume leur assura la conservation de leurs anciennes franchises ; mais il ne paraît pas qu'il ait maintenu l'établissement de la commune.
Les Manceaux, dont l'humeur libre et fière est constatée par les plus vieux historiens, se révoltèrent plusieurs fois sous les successeurs de Guillaume. Le comté du Maine fut réuni aux domaines du comte d'Anjou, appartint aux Plantagenets, qui, en arrivant au trône d'Angleterre, firent passer leurs comtés sous la domination anglaise.
Le Maine fut, sous Philippe-Auguste, réuni à la couronne de France, après l'assassinat commis par Jean sans Terre sur son neveu Arthur et la confiscation prononcée contre le meurtrier. A partir de ce moment, le Maine est plusieurs fois donné comme apanage à des princes du sang royal, et d'abord possédé par Charles d'Anjou, frère de saint Louis et roi de Naples. Il ne fait définitivement retour à la couronne que sous Louis XI, en 1481.
Pendant la guerre de Cent ans, le pays fut le théâtre d'une guerre acharnée. Le duc de Lancastre s'y était établi sous Charles V : celui-ci rappelle d'Espagne Bertrand Du Guesclin, qui taille en pièces les Anglais a quelques lieues du Mans, à Pontvallain, en 1370. Aidé d'Olivier de Clisson, il les défait encore en plusieurs rencontres.
En 1424, après la funeste bataille de Verneuil, le comte de Salisbury vient mettre le siège devant Le Mans, foudroie la ville avec son artillerie, usage nouveau alors de ces canons qui avaient un siècle auparavant contribué à notre défaite à Crécy : la ville se rend après vingt jours de résistance. La guerre continue cependant à ravager le pays ; Le Mans est repris par les Français, puis par Talbot, qui met à mort ceux des habitants qui se sont soulevés contre l'étranger.
Enfin, en 1443, les Anglais sortent du Maine pour n'y plus rentrer. Pendant cette longue lutte, un gentilhomme manceau, Ambroise de Loré, à qui il ne manqua qu'une scène plus éclatante pour obtenir plus de gloire, se rendit fameux dans le pays par sa bravoure et sa lutte opiniâtre contre les conquérants.
Le faible Henri VI, en épousant Marguerite d'Anjou, fille du roi René, avait restitué les comtés d'Anjou et du Maine à son beau-père, « dont les titres pompeux ne répondaient guère à la maigreur de la bourse, » dit Shakespeare. Il faut voir dans le Henri VI du grand poète, avec quelle amertume les seigneurs anglais reprochèrent cette concession à leur roi. « Par la mort de celui qui est mort pour tous, dit Salisbury, ces comtés étaient la clef de la Normandie. Pourquoi pleures-tu, Warwick, mon valeureux fils ? - Warwick. Je pleure de douleur en voyant ces pays perdus pour nous sans retour ; car, s'il restait quelque espoir de les recouvrer, mon épée verserait du sang, mes yeux ne verseraient point de larmes. L'Anjou, le Maine ! C'est moi qui ai conquis ces deux provinces, c'est ce bras qui les a domptées. Eh quoi ! ces villes dont la prise m'a coûté des blessures, faut-il que je les voie rendre avec des paroles de paix, mordieu ! - York. Périsse le duc de Suffolk, qui ternit l'honneur de cette île belliqueuse ! La France m'aurait arraché le cœur avant de me faire souscrire à un pareil traité." Henri VI tenta de ne pas exécuter ce traité fatal à sa puissance et a son honneur ; mais le roi de France ne tarda pas à lui reprendre ces deux provinces.
Le Maine fit retour à la couronne de France après la mort de son dernier comte, Charles, neveu de René d'Anjou, qui avait institué pour son héritier le roi Louis XI. Cette province, si éprouvée par la guerre étrangère, fut encore dévastée par la guerre civile que les passions religieuses y allumèrent au XVIe siècle.
Les premiers prédicateurs du calvinisme, dans le Maine, furent Henri Salvert, qui y vint de Tours en 1559, et Merlin, de La Rochelle, un des disciples de Théodore de Bèze. Les progrès de la nouvelle doctrine furent rapides : un an après, un consistoire était établi au Mans, et seize ministres étaient institués. Mamers devint bientôt l'un des plus ardents foyers du protestantisme dans cette contrée ; mais, la guerre ayant éclaté, les calvinistes s'emparèrent du Mans, qu'ils occupèrent pendant trois mois : les catholiques reprirent bientôt la ville, et y exercèrent d'atroces vengeances.
Ces cruautés rendirent plus tard inutile au Mans le massacre de la Saint-Barthélemy. L'édit de Nantes rétablit le calme dans ce pays, et un peu de tolérance à l'égard des réformés. Ils établirent au Mans un temple qui subsista jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes : le lieu où il était bâti porte encore le nom de Chemin du Prêche.
Le pays resta tranquille jusqu'a la Révolution ; à cette époque, la population s'y prononça en général pour la cause des réformes. Elle envoya à la Convention les députés Sieyès, Levasseur, Letourneur, Phelippeaux.
Mais la contrée fut cruellement éprouvée par la guerre civile dont l'Ouest fut le théâtre. Les Vendéens entrèrent dans le Maine en décembre 1793 ; ils étaient commandés par La Rochejacquelein. Le Mans, dégarni de troupes, tenta de leur résister ; les gardes nationales défendirent bravement les approches de la ville ; mais il fallut céder au nombre, et les Vendéens s'emparèrent de la ville. Deux jours après, ils en étaient chassés après un combat sanglant par les généraux républicains Marceau et Westermann.
La pacification du département fut due aux efforts intelligents du général Hoche, et le pays commençait à respirer, quand la chouannerie y éclata. Les chouans, sous la conduite de M. de Bourmont, surprirent Le Mans pendant la nuit du 13 octobre 1799, et le gardèrent pendant trois jours. Du reste, cette guerre peu sérieuse fut bientôt terminée, grâce à l'activité du général Brune.
Le département qui avait envoyé au conseil des Cinq-Cents Carnot, Daunou, Chénier, Legendre, envoya, sous la Restauration, siéger à la chambre des députés le général La Fayette et Benjamin Constant.
Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département de la Sarthe fut occupé par les armées ennemies poursuivant la 2e armée de la Loire en retraite vers l'Ouest. Dans la notice historique que nous avons consacrée au département de Loir-et-Cher, nous avons raconté les débuts de cette retraite, après les combats de Marchenoir et de Fréteval, et la bataille de Vendôme. Nous reprendrons ici notre rapide récit.
Le 1er janvier 1871, le prince Frédéric-Charles reprenait l'offensive contre la 2e armée de la Loire ; le 6 janvier, quatre corps marchaient concentriquement vers l'Huisne ; le 7, les corps se concentraient : le grand-duc de Mecklembourg enlevait Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) et le centre garnissait la rive gauche de la Braye, de Sargé à Savigny (Loir-et-Cher). Le 8, le centre allemand arrivait à Saint-Calais où s'établissait le prince Frédéric-Charles, et sa gauche gagnait le Loir à La Chartre, pendant que le grand-duc, faisant un nouveau pas en avant dans la vallée de l'Huisne, dépassait La Ferté-Bernard.
Le cercle se resserrait autour du Mans, où le général Chanzy s'était arrêté et où il se reconstituait en toute hâte. Le 9, Frédéric-Charles s'établit à Bouloire ; le Xe corps allemand, forcé de combattre à Chahaignes, ne peut dépasser le village de Brives, tandis que le corps français du général Jouffroy arrête l'ennemi a Vancé et que le général Jaurès ne cède que pied à pied au XIIIe corps, qui peut pourtant gagner Connerré-Thorigné.
Le 10, l'ennemi rencontre à Saint-Mars, à Champagné, à Changé-Parigné, une résistance vigoureuse et s'arrête à 4 kilomètres du Mans. « Le plateau d'Aujour, dit un historien, fut même repris par un héroïque retour offensif des zouaves pontificaux du 17e corps conduit par le général Goujard, et la XVIIIe division allemande fut repoussée à Montfort dans une tentative pour franchir l'Huisne a Pont-de-Gennes. »
Mais le 11, les mobilisés de Bretagne, mal armés, mal approvisionnés, abandonnèrent le poste, si important de La Tuilerie, ce qui décida la retraite. Le 12, le XIIIe corps allemand fut encore arrêté à La Croix par le général Jaurès ; toutefois le Xe corps occupa Le Mans. Le brouillard du matin avait favorisé la retraite de notre malheureuse armée ; mais elle laissait aux mains de l'ennemi, après sept jours de combats, 18 000 prisonniers et 20 canons. La poursuite continua jusqu'a Laval. Les Français s'établirent solidement derrière la Mayenne, et, quand l'armistice arriva, le général Chanzy avait réussi à réorganiser en partie cette 2e armée de la Loire qui restait debout après six semaines de combats incessants résolue à continuer la lutte.
Pour terminer, nous allons donner le nom des localités de la Sarthe successivement occupées par les troupes du prince Frédéric-Charles venant de Vendôme et par celles du grand-duc. Ce sont : Saint-Calais, Bouloire, Arthenay, Champagné, Le Mans, Neuville-sur-Sarthe, Conlie, Sillé-le-Guillaume, Saint-Georges, Le Grand-Lucé, Parigné l'Évêque, Changé, Pontlieue, Chassillé, Saint-Denisd'Orgnes, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Écommoy, La Flèche, Sablé, et par les corps venant de Chartres La Ferté-Bernard, Sceaux, Connerré et Montfort.
Les pertes éprouvées par le département de la Sarthe durant cette lugubre invasion sont considérables ; elles se montent à 17 026 660 francs 72 centimes.
Les départements et leur histoire - Saone et Loire - 71
Les Éduens, puissante tribu de la Gaule centrale, occupaient, avant l'invasion romaine, la plus grande partie du territoire dont a été formé le département de Saône-et-Loire. C'est comme allié des Éduens, et appelé par eux, pour les aider dans une guerre qu'ils soutenaient contre les Séquanais, que César franchit les Alpes.
L'occupation romaine ne rencontra donc d'abord dans la contrée aucune résistance et n'y souleva aucune opposition. Bibracte (dont on crut jusqu'en 1851 qu'il s'agissait d'Autun), la vieille capitale du pays, fut adoptée par les soldats de César comme une seconde patrie ; mais cette union, qui reposait sur un malentendu, ne fut pas de longue durée ; lorsque les Éduens virent se changer en conquête définitive une occupation qu'ils n'avaient acceptée que comme un secours momentané, leur esprit national se réveilla et les sympathies anciennes firent bientôt place à une hostilité mal déguisée.
De leur côté, les conquérants, pour entraver l'organisation de la révolte, changèrent à diverses reprises les divisions administratives de la province. Une levée de boucliers répondit à ces mesures vexatoires ; les esclaves gladiateurs destinés aux cirques de Rome se réunirent sous un chef acclamé par eux, le vaillant Sacrovir ; la population presque entière se joignit à eux, et les Éduens tentèrent, mais trop tard, de réparer la faute qu'ils avaient commise en appelant l'étranger dans leur patrie. Cette tentative échoua comme celle de Vercingétorix dans l'Arvernie ; les dernières forces de la race celtique s'y épuisèrent, et la volonté des Éduens n'eut même plus à intervenir dans le choix des maîtres qui se disputèrent leur territoire.
Quand le colosse romain commença à vaciller sur ses bases, quand les possessions de l'empire énervé purent être attaquées impunément, la Saône fut franchie tour à tour par les hordes barbares qui, des rives du Rhin ou du sommet des Alpes, se ruaient dans les plaines de l'ouest et du midi.
Attila, avec ses Huns, passa comme une avalanche. Les lourds Bourguignons s'arrêtèrent au bord du fleuve, et jusqu'à la venue des Francs le pays fut possédé par deux maîtres à la fois, les Bourguignons et les Romains. Les nouvelles divisions territoriales qu'entraîna la conquête de Clovis, les partages de son héritage, plus tard la constitution des grands fiefs donnèrent naissance à un royaume, puis à un duché de Bourgogne, dont fit presque toujours partie le département de Saône-et-Loire, mais dont l'histoire trouvera sa place plus spéciale dans notre notice sur Dijon et la Côte-d'Or.
L'importance des villes détermina d'abord la division administrative du pays en pagi ou cantons, qui devinrent autant de comtés plus ou moins indépendants quand prévalut, sous la seconde race, l'organisation féodale dans la France entière, et ne furent réunis à la couronne que successivement et beaucoup plus tard. L'Autunois, le Mâconnais, le Châlonnais et le Charolais eurent donc chacun pendant longtemps une existence particulière, dont se compose l'ensemble des annales du département.
L'Autunois tira son nom de la ville d'Autun, autrefois Bibracte, l'ancienne capitale des Éduens. Cette tribu, par haine des Allobroges et des Arvernes, s'allia étroitement avec les Romains ; aussi eut-elle des citoyens admis dans le sénat avant toutes les autres peuplades gauloises.
La foi chrétienne fut apportée clans cette contrée dès le IIe siècle par saint Andoche, prêtre, et saint Thirse, diacre, qui, malgré la protection d'un riche habitant de Saulieu nommé Faustus, souffrirent le martyre à leur retour à Autun ; en même temps qu'un marchand du nom de Félix qui leur avait donné asile. Tetricus, général romain, s'étant fait reconnaître empereur, entraîna les Éduens dans son parti. Claude vint le combattre, ravagea les campagnes, incendia et pilla les villes.
Constance et Constantin réparèrent ces désastres ; le pays fut tranquille et prospère jusqu'à l'invasion des barbares. Les rapides progrès du christianisme dans l'Autunois et l'influence de l'évêque dans la capitale donnèrent de bonne heure une prépondérance marquée au pouvoir clérical. Sur quatre bailliages dont la province était composée, un seul, celui de Bourbon-Lancy devint une baronnie de quelque importance.
Le Mâconnais (pagus Matisconensis) des Éduens eut sous les Romains les mêmes destinées que l'Autunois. Sa position sur les bords de la Saône en faisait un centre d'approvisionnement ; on y fabriquait aussi des instruments de guerre. Sous la seconde race, le Mâconnais est possédé par des comtes qui rendent leurs domaines héréditaires, et arrivent par leurs alliances jusqu'a la couronne ducale de Bourgogne. C'était un comte du Mâconnais, cet Othon-Guillaume auquel le roi Robert fut obligé de disputer devant un concile et par les armes les deux Bourgognes et le comté de Nevers.
Sa descendance resta en possession du comté jusqu'en 1245, époque a laquelle il fut cédé à saint Louis par la comtesse Alix. A l'exception d'une courte période pendant laquelle Charles VII l'aliéna à Philippe le Bon, le Mâconnais est demeuré depuis annexé au domaine royal ; depuis saint Louis, il relevait du parlement de Paris, et les privilèges municipaux accordés par ce prince aux habitants des villes furent maintenus jusqu'à la Révolution de 1789.
Le pouvoir épiscopal profita moins encore de l'extinction des comtes du Mâconnais que de l'importance acquise par la puissante abbaye de Cluny. Le convent fournit un grand nombre de prélats au siège de Mâcon ; aussi fut-il occupé, le plus souvent, par des personnages d'un grand nom et d'une haute position dont l'influence fut souveraine sur les destinées de la province.
Le Châlonnais était aussi compris dans le pays des Éduens ; il en est question, ainsi que de sa capitale Cabillonum, Châlon ; dans César, Strabon et Ptolémée. C'était un poste important des légions romaines ; une large chaussée fut construite pour relier Autun à la Saône. La tradition populaire donne les environs de Châlon pour théâtre à l'apparition de la croix miraculeuse autour de laquelle Constantin put lire : « Tu vaincras par ce signe : » In hoc signo vinces.
Après avoir été traversé et ravagé par Attila, le Châlonnais devint le centre de la première monarchie burgonde. Châlon était la capitale du roi Gontran, et Clovis II y convoqua une assemblée nationale. La position du pays, qui le désigna dès les premières invasions comme le passage le plus favorable de l'est au centre de la France et du nord au midi, ne lui permit d'échapper à aucun des envahissements que nos pères eurent a subir. Après les Romains, les Germains, les Helvètes, les Huns et les Bourguignons, vinrent les Sarrasins, et après eux les Normands.
Jamais terre ne fut foulée par tant d'ennemis différents ; et comme si ce n'eût point encore été assez, après tant d'assauts, de devenir le théâtre des luttes entre les maisons de France et de Bourgogne, il fallut encore que le Châlonnais payât tribut aux guerres de religion et à toutes nos discordes civiles. Le premier comte héréditaire du Châlonnais fut Théodoric Ier ; c'est seulement en 1247 que, par suite d'échange, le comté échut à la maison de Bourgogne ; il y est resté jusqu la réunion du duché à la France.
Le premier apôtre du Châlonnais fut saint Marcel, prêtre attaché a saint Potin et venu de Lyon avec lui ; il souffrit le martyre en 161, sous le règne de Vérus. Pendant la période féodale, le pouvoir de l'évêque sur le Châlonnais fut plus nominal que réel ; les comtes se laissaient investir par eux de leur titre, mais sans renoncer a agir ensuite au gré de leur caprice ou selon leur intérêt ; les ducs de Bourgogne et les rois de France, trop haut placés pour recevoir l'investiture du comté des mains de l'évêque de Châlon, leur laissèrent en réalité un cercle d'action plus libre et moins restreint. Il est juste d'ajouter que le pays ne s'en trouva pas plus mal.
Les Ambarri et les Brannovii occupaient le Charolais et vivaient dans une étroite alliance avec les Éduens ; sous les Romains et les Bourguignons, leurs destinées furent communes. L'administration franque constitua le Charolais en comté, qui sous la première race dépendit du comté d'Autun, et de celui de Châlon sous la seconde.
Au XIIIe siècle, Hugues IV, duc de Bourgogne, ayant acquis le comté de Châlon et ses dépendances, le donna en apanage à son second fils Jean, qui épousa l'héritière de Bourbon. Une seule fille naquit de cette union : on la maria à Robert, comte de Clermont, fils de saint Louis ; ce prince et trois générations de ses descendants possédèrent donc le Charolais, mais comme fief relevant du duché de Bourgogne.
En 1390, Philippe le Hardi le racheta moyennant 60 000 francs d'or. Il demeura plus d'un siècle dans la maison ducale, et l'estime qu'elle faisait de cette possession est attestée par le titre de comte du Charolais que portaient ordinairement les fils aînés des ducs de Bourgogne. A la mort de Charles le Téméraire, en 1477, le Charolais fut compris dans les dépouilles de l'ennemi vaincu que Louis XI réunit a la France.
Ses successeurs, Charles VIII et Louis XII, restituèrent ce comté aux héritiers de Marie de Bourgogne ; il fut donc rendu, en 1493, à Philippe d'Autriche, père de Charles-Quint, et resta dans la maison d'Espagne jusqu'en 1684, mais cette fois comme fief de la couronne de France, à la charge de foi et hommage, et soumis à la juridiction française. Le prétexte dont on usa pour mettre fin à cet état de choses mérite d'être rapporté.
En dehors des grands événements qui décidèrent de ses destinées, les régions qui composent le département de Saône-et-Loire eurent leur part dans toutes les épreuves que traversa la France : sans avoir été marqué par des luttes aussi violentes que dans d'autres localités, l'établissement des communes l'agita au XIIIe siècle.
Au XIVe le pays fut décimé par la peste noire ; treize familles seulement survécurent à Verdun-en-Châlonnais. Ce fut ensuite l'invasion des Anglais sous la conduite du Prince Noir, et, quelques années plus tard, les brigandages des Écorcheurs. Du Guesclin, en 1366, les avait décidés à le suivre en Espagne dans l'espoir d'un riche butin ; mais ils revinrent quelques années après et ravagèrent tout le Mâconnais.
Nous les retrouvons, en 1438, en compagnie de la peste et de la famine, dévastant le Charolais et les environs de Paray-le-Monial, sous la conduite du fameux Antoine de Chabannes ; il fallut, pour en délivrer la contrée, que le comte de Fribourg, gouverneur de la Bourgogne, convoquât la noblesse à une sorte de croisade ; les prisonniers mêmes ne furent point épargnés.
La guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, les luttes qui précédèrent la réunion du duché a la France eurent presque continuellement pour théâtre ces contrées douées d'une telle vitalité que quelques années de paix leur rendaient une prospérité relative.
Les discussions religieuses agitaient sourdement la France depuis plusieurs années, lorsque le massacre de Vassy fit éclater la guerre civile. La noblesse de Bourgogne était peu favorable aux protestants, mais ils avaient de nombreux adhérents dans les villes. En 1562, un fameux capitaine calviniste nommé Ponsenac parcourut la Bresse et le Mâconnais à la tête d'une troupe de six à sept mille hommes, saccageant, pillant, brûlant les couvents et les églises. Le capitaine d'Entraigues et deux de ses lieutenants, Jean-Jacques et Misery étaient maîtres d'une partie de la province, quand leur marche fut arrêtée par le maréchal de Tavannes. Quelques années plus tard, en 1567, 1570 et 1576, c'est contre les Suisses et les reîtres des Deux-Ponts qu'il faut se défendre ; ces derniers avaient traversé la Loire a Marcigny, au nombre de 25 000 environ.
L'anarchie régna en Bourgogne pendant tout le temps de la Ligue, et même après l'abjuration de Henri IV et la bataille de Fontaine-Française ; en 1593, un article du traité de Folembray accordait au duc de Mayenne la ville de Chalons comme place de sûreté.
Sous Louis XIII, la révolte de Gaston d'Orléans, frère du roi, appela les Impériaux en Bourgogne ; la courageuse et patriotique résistance des habitants fit obstacle aux funestes progrès de l'invasion, qui échoua définitivement devant l'héroïsme de Saint-Jean-de-Losne. Le pays se ressentit peu des agitations de la Fronde ; quelques communes seulement eurent à subir les exactions de soldats indisciplinés et d'une bande de rebelles qui ne compta jamais plus de 500 hommes et que commandait un aventurier du nom de Poussin de Longepierre.
Les règnes suivants ne furent signalés que par d'utiles travaux et de magnifiques améliorations (1789). Le grand Condé, ayant fait sa paix avec la cour de Saint-Germain, réclama du roi d'Espagne des sommes considérables, prix de ses services pendant la guerre contre la France ; pour rentrer dans cette créance, il saisit le Charolais : une procédure s'ensuivit comme s'il se fût agi de la dette d'un marchand, ou tout au moins d'une seigneurie ordinaire ; on plaida, et un arrêt intervint qui adjugea le comté à la maison de Condé. C'est seulement en 1761 qu'il fut racheté par Louis XIV et réuni au domaine royal.
En 1814, à la chute du premier Empire, le département fut traversé par les troupes autrichiennes. Châlon, qui n'avait qu'une garnison de 200 hommes, n'en résista pas moins au général Bubna, et l'ennemi ne s'en rendit maître qu'après un vif combat soutenu, le 4 février, parles habitants. Sa vengeance s'exerça sur Autun qui fut durement traitée, et sur le château de Martigny-sous-Saint-Symphorien qui fut incendié.
En 1870, la situation pouvait paraître plus périlleuse. Autun couvrant l'important établissement du Creusot, dont le matériel et les puissantes ressources devaient être un objectif pour les envahisseurs victorieux ; ils firent, en effet, dans les premiers jours de décembre, quelques démonstrations hostiles ; mais Garibaldi y avait alors son quartier général, où des forces imposantes avaient été réunies, pour appuyer les opérations de l'armée de l'Est, commandée par le général Bourbaki ; l'ennemi s'en tint donc à quelques reconnaissances autour de la ville, et prit sa direction vers le département de l'Yonne et la Loire. Les pertes éprouvées par le département montèrent seulement à 30 292 francs 27 centimes.
La Révolution de 1789, qui donna à la France unité et liberté, avait été accueillie par le département de Saône-et-Loire avec le plus grand enthousiasme. Les habitants sont restés fidèles au culte de leurs principes. En 1792, comme en 1814 et en 1870, la patrie menacée ne trouva dans aucune province de plus dévoués défenseurs. Le sentiment de la nationalité est aussi fortement empreint chez le citoyen des villes que dans la population des campagnes. Les développements de l'industrie et du commerce, le soin des intérêts privés n'ont altéré ni comprimé dans ce département les élans généreux, les aspirations enthousiastes qui caractérisent les fortes races et les grands peuples.
les département et leur histoire - Haute-Saone - 70 -
Ainsi que les deux départements du Jura et du Doubs, celui de la Haute-Saône fut formé, en 1790,d'une partie de l'ancienne province de Franche-Comté. Le territoire qu'il occupe formait sa partie septentrionale, et cette circonscription reçut, à cause de cela, le nom de grand bailliage d'Amont. Gray en était la capitale.
Cette contrée, avant l'arrivée des Romains, était habitée par les Séquanais. On sait que les luttes de ce peuple avec les Éduens amena l'intervention romaine. Les ruines qu'on rencontre encore à Luxeuil et sur l'emplacement de l'ancienne Amagetobria attestent le séjour et la longue domination du peuple-roi. La Séquanie, dans laquelle était compris le département actuel de la Haute-Saône, fut incorporée, sous Auguste, dans la Germanie supérieure.
Quand les Burgondes franchirent le Rhin et descendirent les pentes des Alpes et du Jura, la Séquanie constitua une importante fraction du premier royaume de Bourgogne. Nous rentrons ici dans l'histoire de cet État, que nos lecteurs trouveront plus détaillée et moins incomplète dans notre notice sur la Côte-d'Or. Après avoir été conquise par Clovis et possédée quelque temps par les rois francs ses successeurs, la Séquanie échut à Lothaire, lors du démembrement de l'empire de Charlemagne.
On sait que cette époque fut le signal des usurpations féodales. Nulle part le pouvoir des comtes et des abbés ne fut plus indépendant que dans le comté de Bourgogne ; pendant plusieurs siècles l'autorité centrale est presque entièrement annulée ; la plupart des fiefs relevaient bien de l'empire d'Allemagne, mais cette dépendance n'était que nominale. C'est donc dans les annales des villes, dans les chroniques des puissants monastères qu'il faut chercher la vie historique de cette époque ; c'est a peine si son unité peut se rattacher à celle du duché de Bourgogne dans la grande phase des quatre derniers ducs.
Les populations des trois bailliages se prononcèrent bien plus énergiquement encore que celles de Bourgogne en faveur de l'héritière de Charles le Téméraire, contre les prétentions de Louis XI ; ce prince fit une rude guerre aux obstinés Comtois qui ne voulaient pas devenir Français. Nous suivrons dans les épisodes locaux, dans le siège des villes, la dévastation des campagnes, les traces de cette première lutte, qui se termina par l'incorporation de la Comté aux États d'Autriche.
Presque toutes les cités du bailliage d'Amont eurent leur part dans les calamités de cette période. Voici comment cette transformation est caractérisée par Eugène Rougebief, historien franc-comtois, dans son patriotique et savant ouvrage : « La Franche-Comté se trouvait pour la troisième fois séparée du duché de Bourgogne. Rendue à la maison d'Autriche par le traité de Senlis, on va la voir changer de maître et continuer son existence isolée. C'est en elle dorénavant que se personnifiera le génie de la vieille nationalité bourguignonne ; c'est elle qui s'en montrera la dernière expression ; et, lorsque viendra le jour où la logique de l'histoire aura marqué sa place dans le grand cycle de la France, elle gardera longtemps encore sa physionomie originale, son vieil esprit traditionnel. Nous venons de la laisser à la fin d'une lutte courageuse, et qui ne devait pas être la dernière.
« Aussi dévouée à ses princes que jalouse de ses libertés, la Franche-Comté, plus grande en sa réputation qu'en son étendue, comme a dit un historien, ne reculera devant aucun sacrifice pour rester digue de son antique renom et de l'estime de ses souverains ; elle va se soutenir pendant deux siècles avant de trouver son maître : encore faudra-t-il, pour la dompter, que la forte épée de la France vienne a trois reprises s'abattre sur elle, et les hommes qui la tiendront, cette épée, s'appelleront Henri IV, Richelieu, Louis XIV. »
Il n'avait point été difficile à Maximilien de rattacher à l'Autriche une province qui ne connaissait la domination française que par les rigueurs de Louis XI ou l'incapacité administrative de Charles VIII ; son fils, Philippe le Beau, devenu possesseur de la Franche-Comté par l'avènement de son père à l'Empire, resserra encore les liens d'affection qui attachaient les Comtois à sa maison. Il visita deux fois leur province, présida les états et confirma les privilèges de la bourgeoisie. Il avait épousé Jeanne, infante d'Espagne, et c'est de cette alliance que découlèrent plus tard lés droits de Charles-Quint sur la Comté.
L'intervalle qui sépara le règne de Philippe de l'avènement du grand empereur fut rempli par la régence de marguerite, deux fois veuve avant d'avoir été mariée, et qui laissa dans le pays un souvenir durable de ses qualités aussi aimables que solides. C'est à cette époque aussi que se rattache le grand mouvement suscité par les prédications de Luther et de Munzer. Leurs paroles trouvèrent de l'écho dans cette province, si hostile à toutes les oppressions ; mais les effets de la réforme religieuse furent amortis par la tolérance même qu'elle rencontra chez ses adversaires, et la révolte des paysans eut dans la Comté un caractère particulier qui la fait ressembler aux guerres des hussites plutôt qu'à la Jacquerie de France.
Le sol était raffermi quand Charles-Quint prit en main l'administration du pays que la comtesse sa tante avait si habilement gouverné. Il se conforma scrupuleusement aux instructions qu'elle lui avait tracées dans son testament ; il hérita surtout des sympathies profondes que Marguerite avait conservées jusqu'à sa mort pour la Franche-Comté.
Rien ne put jamais distraire le puissant monarque de la bienveillante sollicitude avec laquelle il veillait sur les destinées de cette province de prédilection. Chaque ville reçut quelque témoignage particulier de sa libéralité et de son affection ; c'est à des Comtois qu'il confia les postes les plus importants de son gouvernement ; à sa cour, dans son intimité, il aimait à se sentir entouré de ces fidèles Bourguignons, et l'histoire en cite un nombre considérable qui, par l'éclat de leurs services ou l'importance de leur position, ont participé à la gloire de son règne.
La mort de Charles-Quint mit un terme à cette ère de splendeur et de prospérité ; le fanatique Philippe II compromit au dedans et au dehors les destinées de la Franche-Comté. L'inquisition, établie par lui, fit couler des flots de sang, jeta la perturbation dans ces populations tolérantes et paisibles, excita les passions religieuses et entraîna le pays dans les luttes désastreuses du XVIe siècle.
En février 1595, le bailliage d'Amont fut envahi par six mille soldats lorrains, commandés par deux anciens capitaines ligueurs, d'Aussonville et Beauvau-Tremblecourt, qui promenèrent dans toute la contrée le pillage, le meurtre et l'incendie. Cette expédition livrait les clefs de la province à Henri IV, qui, quelques mois plus tard, y remportait la célèbre victoire de Fontaine-Française et se vengeait sur les habitants inoffensifs des justes griefs qu'il avait contre le roi d'Espagne. Ce n'était là encore que le commencement des épreuves auxquelles était réservé ce malheureux pays ; le traité de Vervins remit les choses dans .l'état où elles étaient avant la guerre, c'est a dire dans un provisoire plein de périls.
Richelieu reprit l'oeuvre de Henri IV, et le prince de Condé pénétra en Franche-Comté. Les haines séculaires de la France et de l'Espagne semblaient avoir adopté cette province pour champ clos ; c'est là, en effet, que se vidaient toutes les querelles ; mais plus la constitution de l'unité française rendait indispensable l'incorporation de ce pays, plus les habitants luttaient avec énergie et désespoir contre ce qu'ils appelaient la domination de l'étranger et la perte de leur indépendance.
La résistance aux efforts de Richelieu, guerre de dix ans, amena successivement dans le pays les plus illustres capitaines du temps ; après Condé, ce furent Turenne, Villeroy, Longueville et ce prince de sanglante mémoire, Bernard de Saxe-Weimar, le fléau du bailliage d'Amont, pillant, rançonnant, dévastant tout sur son passage ; il ne s'attaquait qu'aux petites places ; il prit Jonvelle, Jussey, Champlitte, Pierrecourt, et, comme les habitants de ce village avaient tué quelques hommes de son avant-garde, il livra les habitations aux flammes et passa la population au fil de l'épée.
Aux attaques incessantes qui s'acharnaient contre elle, la Franche-Comté opposa victorieusement l'indomptable énergie de quatre villes, Hâle, Gray, Salins et Besançon, qui repoussèrent tous les assauts comme elles rejetaient toutes les offres de capitulation ; le génie patriotique de deux capitaines comtois, le baron d'Amans et Lacuzon, qui se maintenaient dans les montagnes et qu'aucun échec ne pouvait ni abattre ni décourager ; enfin, l'héroïque et mâle courage d'une femme, de la jeune et belle comtesse de Saint-Amour, dont l'exemple entraînait sur les remparts des villes assiégées les mères, les femmes et les filles des combattants.
Louis XIV n'aurait sans doute pas été plus heureux que Henri IV et Richelieu, si, comme eux, il n'avait eu recours qu'a la force de ses armes ; mais, profitant de la position qu'avait maintenue la paix de Munster, en 1648, laissé en possession de plusieurs places au cœur du pays, il fit de la le siège des consciences, et toutes ne furent pas imprenables comme les glorieuses cités comtoises.
Éblouis par les pompes de Versailles, gagnés peut-être aussi par d'autres séductions, l'abbé de Watteville pratiqua la noblesse, d'Aubépin fit circonvenir la bourgeoisie des parlements ; le peuple, trahi par ses anciens chefs, abandonné par l'Espagne épuisée, n'eut mémo plus à défendre ses forteresses, que les gouverneurs livraient a prix d'argent. Le 4 juillet 1674, dernier effort de la nationalité comtoise, la ville de Faucogney succombait après trois jours d'assaut, les habitants étaient passés par les armes, la conquête était accomplie, et Louis XIV pouvait se faire représenter sur un arc de triomphe en conquérant et en dominateur de la Franche-Comté.
Nous avons ailleurs caractérisé son règne et celui de ses successeurs ; c'est un sujet sur lequel il serait plus pénible encore qu'inutile de revenir. Si le bailliage d'Amont ne fut français réellement et de coeur que depuis 1789, il a pris dès lors une bonne et glorieuse place dans la nouvelle famille ; le bataillon de la Haute-Saône en 1792, les patriotes comtois en 1814 et 1815 ont scellé de leur sang le pacte d'alliance qui les unit pour toujours à la France. L'année 1870-1871 réservait à ce département une nouvelle et douloureuse occasion de montrer son patriotisme.
A la fin de la notice historique que nous avons consacrée au département du Doubs, nous avons raconté les événements de la guerre franco-allemande qui ont eu pour théâtre le territoire de ce département, c'est-à-dire de la lamentable retraite de la première armée de la Loire vers la frontière, suisse, après les combats d'Héricourt et de Montbéliard. Nous nous proposons de reprendre notre récit un peu plus haut et de faire connaître les faits militaires concernant la même armée, qui se sont accomplis à cette époque dans le département de la Haute-Saône, notamment les batailles de Villersexel et d'Héricourt.
Dès le 3 janvier 1871, la première armée de la Loire devenue l'armée de l'Est, placée sous les ordres du général Bourbaki, se mettait en mouvement. Le général en chef prenait ses dispositions pour se porter sur Belfort et débloquer cette place, assiégée par le général allemand de Werder, commandant le XIVe corps ou corps d'opérations d'Alsace.
A cette date, Vesoul était occupé par les troupes du mye corps, une brigade badoise était à Gray, la division Schmeling à Villersexel, à l'embranchement des routes de Dijon, Gray et Vesoul sur Montbéliard et Belfort. Héricourt était gardé par divers détachements ennemis. Le 4 janvier, la division Cremer reçoit l'ordre de marcher sur Vesoul ; mais les avant-postes français rétrogradent sur Gray, et notre armée se dirige directement sur Belfort. Le général de Werder manoeuvre de façon à couper la route de l'armée française, qui était, hélas ! très mal équipée et mal nourrie.
Le 8 janvier, celle-ci était signalée à Montbozon, et les deux armées, suivant deux routes convergentes, se trouvaient à 20 kilomètres environ de Villersexel où ces routes se croisaient. Le 9, la division Schmeling enlevait Villersexel ; mais l'armée française arrivait successivement et se présentait devant la petite ville fortement retranchée par les troupes allemandes A dix heures du matin, le combat s'engage et se prolonge jusqu'à dix heures du soir.
La ville, clef de la position et qui a donné son nom a la bataille, est prise et reprise et finit par nous rester. Le général Bourbaki déploya dans cette journée sou audace habituelle, menant lui-même au feu ses colonnes d'attaque. Nous restons maîtres des positions ; l'ennemi, abandonnant le champ de bataille, se retire sur Lure, au nord, et de là rejoint le corps de blocus devant Belfort, amenant au général de Werden un renfort urgent. La présence du général Cremer sur la route de Vesoul à Lare eût amené un désastre pour l'ennemi ; malheureusement, un froid de 18° au-dessous de zéro avait retardé le jeune et vigoureux général, qui le 8 seulement quittait Dijon, et l'empêchait d'arriver a temps pour la bataille du lendemain. Les Allemands perdirent plus de 1 000 hommes à la bataille de Villersexel.
Le 10 janvier, le général français laisse reposer ses troupes exténuées ; le 11, il reprend sa marche vers les positions ennemies de la Lisaine, mais avec une grande lenteur, tant le froid est intense. Le 13, l'armée française repoussait à d'Arcey, à 20 kilomètres de Villersexel et à 15 de Montbéliard, les avant-postes allemands ; sa gauche était devant Lure et forçait le colonel Willisen de se replier, le 14, sur Ronchamp.
Pendant la nuit du 14 au 15, le thermomètre descend à 17° au-dessous de zéro. Dès le matin pourtant, Bourbaki recommence ses attaques contre les lignes de la Lisaine, et essaye d'enlever d'abord Chagey, à la droite des Allemands. Repoussé, il tente inutilement jusqu'au soir de percer la ligne à Lure et à Héricourt.
« La canonnade ne discontinue pas, écrit l'auteur de l'ouvrage intitulé : la Guerre au jour le jour (1870-1871). Vers midi, une vigoureuse attaque est dirigée sur le centre de la position de Werder, a Busserel et a Béthancourt. Les chemins sont détestables et glissants. La division Cremer, retardée par la marche sur la gauche du XVIIIe corps, ne peut entrer en ligne qu'à trois heures. En résumé, pendant celle journée, nous tentons vainement d'enfoncer le centre et nous couchons sur nos positions. »
Le 16, la bataille recommence au point du jour, du côté d'Héricourt et de Busserel, puis près de Montbéliard. Le 17, après avoir combattu de huit heures du matin à quatre heures du soir, après une lutte héroïque de trois jours, le général en chef reconnaît l'impossibilité de forcer le passage et ordonne la retraite. L'ennemi, dont les troupes sont aussi fatiguées que les nôtres, n'ose nous poursuivre. Le général Bourbaki apprend alors que le XVIIe corps allemand menace ses lignes de retraite ; il donne ses ordres pour hâter la marche de l'armée sur Besançon, ne se dissimulant pas l'épouvantable position dans laquelle il va se trouver.
On sait le reste. Notre armée, décimée et en désordre, ne put se réorganiser et dut se résigner à passer désarmée la frontière de la Suisse hospitalière. Les pertes occasionnées au département de la Haute-Saône par l'invasion se sont élevées au chiffre considérable de 13 825 505 fr. 86.
Les départements et leur histoire - Rhone - 69 -
1ère partie
Le territoire qui forme le département du Rhône avait été habité primitivement par les Ségusiens, peuple gaulois de la clientèle des Éduens. Inférieurs, pour l'importance politique, aux Éduens, aux Arvernes et aux Séquanais, les Ségusiens n'ont pas eu une histoire particulière ; ils se sont attachés à la destinée du peuple qui étendait sur eux son vaste patronage et ont eu le même sort.
Le voisinage des colonies phéniciennes et phocéennes de la Méditerranée et de la province romaine exerça quelque influence sur leurs moeurs et leur caractère ; ils se montrèrent mieux disposés que le reste des populations gauloises à subir la domination de Rome. On sait que, 124 ans avant Jésus-Christ, le consul Domitius Ahenobarbus était intervenu, par l'intermédiaire de Marseille, dans un démêlé survenu entre la confédération des Éduens et celle des Arvernes unie aux Allobroges. Biteuth, roi des Arvernes, fut vaincu dans une grande bataille.
C'est dans cette occasion qu'il fut donné aux Ségusiens de voir pour la première fois les légions romaines ; ils n'avaient encore qu'un seul établissement de quelque importance, Forum Segusianorum (Feurs). César compta ce peuple au nombre de ses alliés lorsqu'il soumit les Gaules ; une seule fois ils se soulevèrent ; ce fut en l'an 52, dans cette dernière grande campagne où toutes les confédérations galliques, si longtemps divisées, se réunirent autour de l'Arverne Vercingétorix.
Mais le héros de l'indépendance gauloise succomba, et les anciens alliés de Rome se firent aisément a la domination nouvelle. Ils n'eurent d'ailleurs pas a se plaindre d'avoir subi ce joug ; peuplade secondaire de la Gaule, au temps de leur indépendance, ils acquirent tout d'un coup, par la fondation d'une ville, la plus haute importance ; Rome leur donna Lyon. Les Ségusiens furent compris par Auguste dans la province Lyonnaise, puis dans la première Lyonnaise, par Dioclétien, lors de la nouvelle division de l'empire (292).
A la dissolution de l'empire romain, ce pays fut l'un des premiers qui vit les invasions barbares ; les Burgondes s'établirent au milieu d'eux de 413 à 419. Le contact des barbares fut pénible à ce peuple presque façonné à la politesse romaine, si l'on en croit le portrait que le poète de Lyon, au Ve siècle, Sidoine Apollinaire, trace des nouveaux venus : « ... Que faire au milieu de ces géants de sept pieds ? Est-il permis d'écrire rien d'élégant au milieu de soldats dont la longue chevelure est imprégnée de beurre aigre, et qui parlent une langue que nous ne comprenons pas ? Peut-on chanter quand on a l'âme et le visage tristes ? Vos yeux sont bien heureux de ne pas voir des gens semblables, et vos oreilles de ne pas les entendre ! Heureux surtout votre odorat de ne pas sentir ces hommes puants qui mangent par jour dix bottes d'oignons ! Quelle muse se ferait comprendre au milieu d'ivrognes criant toujours pour égayer leurs débauches ! De tels dominateurs, comme vous le pensez, mettent de terribles obstacles au désir qu'on aurait d'être joyeux. Mais je m'arrête de peur qu'on ne prenne ceci pour une satire et qu'on ne me dénonce aux Bourguignons. »
Les anciens Ségusiens n'étaient cependant pas les plus mal partagés des peuples de la Gaule, et leurs maîtres étaient réputés les plus doux entre les barbares ; Paul Orose prétend qu'ils traitaient les Gaulois parmi lesquels ils vivaient moins en . sujets qu'en frères, et tout en faisant la part de l'exagération de ce témoignage, nous avons la certitude qu'ils se montrèrent moins durs envers les populations conquises que les Wisigoths, et surtout que les Francs.
Les Ségusiens purent comparer les dominations Burgonde et franque quand, en 534, à la suite des démêlés des fils de Clovis et de Gondemar, fils et successeur de Gondebaud, ils eurent pour maître Childebert, roi de Paris. A la mort de ce roi (558), ils furent réunis au reste de la monarchie franque par Clotaire et, après ce dernier, ils passèrent à son fils Gontran (561).
Les maux de toute nature fondirent à cette époque sur le pays ; ce furent d'abord les fleuves qui débordèrent, puis une disette générale suivie de la peste ; enfin une nouvelle invasion aussi terrible que les précédentes, celle des Sarrasins, qui s'emparèrent de la capitale du pays et n'en furent chassés que par Charles Martel (732). Au temps de Charlemagne, le Lyonnais respira sous la bienfaisante administration du sage et savant. Leydrade, ami du roi germain, qui lui-même, dit-on, eut un instant l'intention de venir habiter, près de Lyon, le célèbre monastère de l'île Barbe.
Le Lyonnais échut a Lothaire, par suite du traité de Verdun (843). Cet empereur le laissa à son fils Charles, qui le transmit a son second fils Lothaire II le Jeune ; puis, un an après la mort de ce prince, la province lyonnaise et le Beaujolais qui se trouve plus au nord, et qui jusque-là avait suivi les mêmes vicissitudes, entrèrent, par le traité de Mersen (870), dans le partage de Charles le Chauve.
Cette même année, ces deux provinces, réunies au Forez, furent données au comte Guillaume Ier, dont le fils, Guillaume Il , rendit la dignité de comte de Lyon héréditaire dans sa famille. Guillaume II eut deux fils, Artaud et Bernard ; l'aîné, comte de Forez, réunit a cette province le comté de Lyon ; Bernard eut pour sa part le Beaujolais, qui, à partir de ce moment, eut une existence distincte et une histoire particulière (920).
A la faveur des troubles que les incursions normandes, la déposition de l'empereur Charles le Gros et l'établissement de la féodalité amenèrent sur tout le sol gaulois, un seigneur, Rodolphe, fils de Conrad, comte d'Auxerre, s'était fait proclamer roi de la Bourgogne transjurane (888).
Son fils Rodolphe II avait réuni la Provence à ses États. Le Lyonnais, situé dans une position intermédiaire entre la France et ce royaume de Provence, devint d'autant mieux un fief indépendant que les derniers Carlovingiens et les nouveaux rois d'Arles s'en disputaient la mouvance. Lothaire, fils de Louis d'Outre-mer, mariant sa sœur Mathilde au roi d'Arles Conrad le Pacifique (955), lui donna en dot ses droits de suzeraineté sur le comté de Lyon.
Le comte était alors Artaud, qui gouverna de 920 a 960. Giraud Ier (960-990), puis Artaud II, l'un des bienfaiteurs de l'abbaye de Cluny (990-1007), lui succédèrent. Ce dernier laissait deux fils en bas âge ; l'aîné, Artaud III, succéda à son père dans le Lyonnais. Le gouvernement d'Artaud III fut plein de vicissitudes. Lyon avait pour archevêque un membre de la famille suzeraine des rois d'Arles, Burchard, fils de Conrad le Pacifique et frère de Rodolphe III, dernier prince qui régna. Ce Burchard regarda le comté de Lyon comme son apanage et en fit hommage a l'empereur allemand Conrad le Salique, le même qui, à la mort de Rodolphe III, hérita de la Bourgogne transjurane et du royaume d'Arles.
Chassé du Lyonnais, son héritage, Artaud III y rentra les armes à la main avec l'appui de son frère et peut-être aussi à la sollicitation secrète des Capétiens de France, qui pouvaient ne pas voir avec plaisir la suzeraineté du Lyonnais passer à l'empire. Burchard fut a son tour chassé, puis il revint par la toute-puissante protection de sa famille, et un accord fut conclu entre le comte et l'archevêque.
Le comte abandonna grand nombre de ses droits seigneuriaux sur sa riche capitale, Lyon, et reçut, en échange, des terres que l'archevêque possédait dans le Forez. Artaud survécut peu à cet arrangement ; à sa mort, son frère Giraud joignit le titre de comte du Lyonnais a ceux de comtes de Roannais et de Forez qu'il possédait déjà ; mais ce titre fut plus nominal que réel.
L'archevêque Burchard mourut en 1031 et eut pour successeur son neveu Burchard, qui considérait le titre de son oncle comme un droit héréditaire. Giraud prit les armes, expulsa le nouvel archevêque et voulut le remplacer par un de ses fils ; mais Burchard recourut a l'empereur allemand Conrad, auquel il avait renouvelé l'hommage et le serment déjà prêté par son oncle. Conrad envoya une armée , chassa Giraud et son fils, rétablit Burchard et lui donna toute autorité. C'est ainsi que la ville de Lyon échangea la domination immédiate de ses comtes contre celle de ses archevêques ; Giraud ne reparut plus dans la ville, et son fils, Artaud IV, tout en prenant le titre de comte du Lyonnais (1058-1076), fit du Forez, qu'il possédait également, le lieu habituel de son séjour.
Rien n'égale la barbarie et la brutalité de cette époque ; la misère était générale parmi les populations du Lyonnais ; les dissensions des seigneurs, loin de profiter a leur repos, redoublaient la tyrannie et les exactions que chacun se croyait en droit d'exercer. La plus haute classe de cette société féodale n'échappait pas a la sauvage férocité des moeurs germaines que la religion était insuffisante à contenir, et que ne tempérait pas encore la politesse de la chevalerie et de ses institutions.
Entre autres enfants, Giraud II, père d'Artaud IV, avait eu deux filles ; l'une d'elles, Rotulfe, épousa Guignes de L'Arieu, l'un des principaux seigneurs du Forez. L'autre, Prève, bien que d'une éclatante beauté et recherchée par de fiers barons, fut touchée de la grâce et ne voulut avoir que le Seigneur pour époux, dit la légende.
Ses jours s'écoulaient dans un monastère au milieu des prières et d'un pieux recueillement, quand un des chevaliers qui avaient brigué sa main s'en vint la trouver et s'efforça de l'arracher a sa retraite ; vainement Prève lui rappela qu'elle avait consacré à Dieu sa virginité et que tenter de la détourner de ses devoirs était une entreprise sacrilège ; ni larmes ni touchantes raisons ne purent convaincre celui qui l'obsédait. Alors, la fille du comte lyonnais s'enferma dans une noble fierté et chassa de sa présence un homme qui ne craignait pas d'outrager Dieu et l'une de ses servantes jusque dans son sanctuaire.
Le chevalier, plein de courroux, partit méditant une terrible vengeance ; il vint à la cour de Giraud et alla trouver ses trois fils Artaud, Geoffroy-Guillaume et Conrad. « Savez-vous, leur dit-il, pourquoi votre soeur Prève a rejeté avec mépris les plus braves de vos amis et tous les seigneurs des deux comtés ? C'était pour se retirer, sous prétexte de religion, dans un lieu reculé et y vivre en débauche avec serfs et vilains. »
Les jeunes gens le crurent ; ils prirent leurs armes, montèrent vite leurs chevaux et coururent au monastère. Prève était en prière ; mais, sans vouloir rien voir et rien entendre : « La voila donc ! s'écrièrent-ils, celle qui déshonore le comte et les fils du comte ! » Et ils lui plongèrent une épée dans les reins, puis ils coupèrent sa tète et jetèrent le cadavre dans un puits ; ensuite ils revinrent contents d'avoir vengé leur honneur.
Mais voilà que la stérilité frappa toute la contrée et que des signes de feu annonçaient dans le ciel le courroux céleste ; si on cherchait de l'eau dans le puits où avait été jeté le corps de l'innocente, on n'en tirait que du sang, et, à l'endroit où avait roulé sa tête, sur une dalle de pierre, avait fleuri un lis d'une éclatante blancheur ; en même temps, une voix du ciel ne cessait de répéter aux fils de Giraud : « Votre soeur n'était pas coupable. » Convaincus par ces manifestations de la volonté divine, ils s'en retournèrent au couvent, donnèrent la sépulture au corps de la jeune fille, lui consacrèrent une fondation pieuse, et depuis ce temps Prève compte, dans le martyrologe, au nombre des vierges saintes.
A Burchard succéda, dans l'évêché de Lyon, Humbert, et c'est par suite de l'arrangement convenu entre lui et Artaud IV que ce dernier quitta Lyon. Les successeurs d'Artaud IV ne furent guère comtes du Lyonnais que nominalement ; Wedelin, 1076 ; Artaud V, 1078 ; Guillaume III, 1085 ; Ide Raimonde et son époux Guignes ou Guy de Viennois, 1097 ; Guignes II, 1109 , ne résidèrent pas dans le pays.
Mais Guignes III, qui remplaça dans le titre de comte son père Guigues II en 1137, et qui, après avoir atteint, sous la tutelle du roi de France, Louis VII le Jeune, l'âge de majorité, fit une guerre heureuse à Guillaume II, comte de Nevers, prétendit revenir sur les anciennes conventions passées entre son aïeul Artaud IV et l'archevêque Humbert. C'était, dit un historien de la vie de saint Bernard , une grande injustice envers l'Église ; dans la guerre que Guignes avait soutenue contre le comte de Nevers, bien inférieur en force à son adversaire, il aurait été infailliblement battu sans les prières du saint et la protection manifeste que Dieu accorda à son intercession.
Quoi qu'il en soit, Guignes ne se montra pas reconnaissant. Héraclius de Montboissier, archevêque de Lyon, avait obtenu, en 1157, de l'empereur Frédéric Ier, par une bulle d'or, datée d'Arbois le 19 novembre, l'exarchat du royaume de Bourgogne, avec tous les droits régaliens sur la ville de Lyon. Guignes, qui voulait conserver au moins sa prépondérance, sinon gouverner seul, dans cette capitale de l'un de ses comtés et ne reconnaître d'autre suzeraineté que celle de Louis VII, s'offensa de cette concession et entra dans Lyon a main armée ; les partisans du prélat furent maltraités ; les clercs surtout furent malmenés grandement ; on pilla leurs maisons, et l'archevêque fut obligé de sortir de la ville où il ne rentra que l'année suivante, exerçant un pouvoir précaire jusqu'a sa mort (1163), sans cesser un instant d'être molesté par son terrible adversaire.
L'empereur Frédéric, qui n'avait aucunement abandonné ses droits de suzeraineté sur sa capitale du Lyonnais, malgré la prétention de Guignes à se reconnaître vassal de Louis VII, voulut l'année suivante élever une forteresse sur le territoire de Lyon. Le comte chassa les ouvriers et les menaça, s'ils revenaient, de les faire tous pendre. En même temps, il entretenait les dissensions qui, a la mort d'Héraclius, s'étaient élevées dans le chapitre, pour le choix de son successeur, et s'installa dans la ville ; mais il en fut chassé par Drogon, l'un des deux candidats a l'archevêché, qui, après l'avoir emporté sur son rival Guichard, recourut au comte de Mâcon, arma ses partisans et chassa le comte.
Guignes recourut alors à son protecteur naturel, Louis VII, qui faisait en Auvergne la guerre au comte Guillaume. « Seigneur, lui écrivit-il, je m'étonne qu'étant votre homme a tant de titres, qu'ayant été fait chevalier par Votre Majesté, laissé par mon père sous votre garde, et d'ailleurs votre vassal, je n'aie rien appris de votre arrivée en Auvergne ; cependant je serais dans votre armée sans le comte de Mâcon , Girard, et les schismatiques de Lyon qui sont entrés à main armée sur ma terre ; ils sont venus non seulement pour me dépouiller s'ils le pouvaient, mais encore pour transporter mon comté, qui relève de votre couronne, à l'empire teutonique. S'ils y réussissaient, ce serait un outrage sanglant qu'ils vous feraient en face et au mépris des armes que vous avez entre les mains. Que Votre Majesté prenne donc les mesures convenables pour mettre son honneur à couvert et mes domaines en sûreté. »
Louis écouta favorablement son baron ; il alla le trouver dans la capitale du Forez, et, en retour de la bonne réception que lui fit le comte, il lui accorda, sur sa demande, l'investiture de l'abbaye de Savigny. Mais ce fut dans le pays une source de querelles ; Humbert II, sire de Beaujeu, protecteur et patron, en vertu de ses droits héréditaires, de l'abbaye de Savigny, s'opposa à cette concession et força Guignes d'y renoncer solennellement en présence même de Louis et de sa cour. Le roi, pour dédommager son serviteur, lui donna la garde des grands chemins, dans l'étendue des deux comtés du Forez et du Lyonnais.
Cette concession est d'une haute importance dans l'histoire générale de la France ; elle nous apprend, en effet, qu'à une époque qui précède le règne de Philippe-Auguste, et où la féodalité était encore toute puissante, le roi conservait la garde des grands chemins dans toute l'étendue du royaume, et que les seigneurs particuliers ne la tenaient dans leurs domaines qu'en fief et de la munificence royale. C'est que ce droit était l'un des plus importants et de ceux que la royauté n'a perdus que localement et qu'elle s'est efforcée le plus tôt de reconquérir ; il donnait la connaissance et justice des crimes commis sur les grands chemins.
L'archevêque Drogon fut chassé par Guichard ; mais la contestation pour la prééminence dans Lyon continua entre Guignes et le nouveau prélat. Il y eut un- premier accord en 1167, à la suite duquel la querelle s'envenima de nouveau et ne s'apaisa qu'en 1173 par la cession absolue que le comte fit de ses droits en échange d'une somme d'argent et de terres dans le Forez.
Cet accord fut approuvé par les papes Alexandre III et Lucius III et ratifié par Philippe-Auguste, en 1183 , qui reçut de Jean aux belles mains, alors archevêque, hommage pour la partie de la ville située sur la rive droite de la Saône, tandis que l'empereur Frédéric se faisait prêter serment pour le territoire de la rive gauche. C'est ainsi que fut consacrée cette distinction qui, de nos jours, s'est maintenue par la tradition et subsiste encore parmi les bateliers du fleuve dans leurs dénominations de France et Empire appliquées en opposition à l'une et l'autre rive.
Les habitants de Lyon ne se prêtèrent pas à cet arrangement et, se soulevant à de fréquentes reprises contre leurs archevêques, ils essayèrent de faire prévaloir une sorte d'administration républicaine. Au milieu de cette guerre dont Lyon fut le théâtre entre les habitants et les archevêques, les rois de France commencèrent à intervenir et à jeter les fondements de leur domination prochaine.
Lyon était alors tout le Lyonnais ; Guignes, qui abdiqua la dignité en 1199, et ses successeurs se bornèrent à la possession du Forez ; ils retenaient bien quelques restes de leur ancienne suprématie sur le comté de Lyon, mais ces droits se bornaient à peu de chose et s'amoindrissaient chaque jour. C'est ainsi que Guignes V reconnut par une charte, en 1224, que plusieurs lieux, Saint-Rambert, Bonson, Chambles, Saint-Cyprien et Saint-Just, où ses successeurs et lui avaient le droit de taille à volonté, étaient francs-alleux de l'abbaye de l'île Barbe. Il s'en désista et accorda aux habitants le pouvoir de donner, vendre, obliger, aliéner leurs fonds sans retenir pour lui autre chose que ses droits saufs et sa pleine seigneurie sur les biens que ces mêmes habitants auraient dans d'autres paroisses.
Quant à la capitale, elle continua d'être agitée par les discordes des habitants et de leur prélat. Une constitution du pape Grégoire X, en 1273, ne mit pas un terme aux animosités ; les Lyonnais, à l'occasion d'une rivalité qui s'était glissée dans l'église entre l'archevêque et les chanoines, au sujet de l'exercice de la justice, recoururent au roi de France et lui demandèrent protection.
Philippe le Bel, qui régnait alors, saisit avec joie ce prétexte d'intervention ; il établit, en 1292, un gardiateur de la ville, magistrat chargé de recevoir et de juger au nom du roi les appels des bourgeois. Six ans plus tard, le roi de France agrandit ses prétentions ; il exigea de l'archevêque qui venait d'être nommé l'hommage illimité et le serment de fidélité tel que le prêtaient les autres prélats du royaume. Henri de Villers, archevêque, réclama auprès de l'ennemi de Philippe le Bel, Boniface VIII, contre cette autorité et ces prétentions qui lui semblaient exagérées.
Boniface avait fait droit aux réclamations de l'archevêque ; il y eut conflit entre ses officiers et ceux du roi. Philippe, qui ne souffrait ni atteinte à ses volontés ni contestation de ses droits réels, s'arrogea, par deux édits datés de Pontoise (1307), l'exercice de la double jurisprudence archiépiscopale et royale. Il y était dit que le roi, dans toute la ville et cité de Lyon, et dans toute la baronnie de l'église de Lyon, en deçà de la Saône, connaîtrait des appellations et des sentences définitives données par le juge lay (laïque), et que ces appellations seraient jugées au parlement par plusieurs conseillers royaux, suivant le droit écrit, et que l'archevêque ferait au roi serment de fidélité, sans toutefois que les biens de son église fussent censés être du fief du roi.
Henri de Villers se soumit ; mais son successeur, Pierre de Savoie, qui monta sur le siège archiépiscopal en 1308, débuta par réclamer contre les deux édits et s'apprêta a soutenir ses réclamations par les armes. Louis le Hutin, fils aîné de Philippe, fut envoyé contre lui en 1310, et fit le siège de cette ville. Pierre, pressé par les ennemis, fut obligé de se rendre ; conduit a Paris, il demanda pardon au roi, qui lui fit grâce, et termina le différend en 1313 par la cession absolue de tous les droits de l'église sur la ville, en échange de quelques terres ; le château de Pierre-Scise demeura seul sous la juridiction ecclésiastique.
les départements et leur Histoire - Haut Rhin - 68
L'histoire de ce département peut se diviser en quatre parties : la première comprenant les temps antérieurs à la conquête romaine et la domination romaine elle-même ; la seconde : l'invasion et l'établissement de la monarchie franque jusqu'aux successeurs de Charlemagne ; la troisième correspondant à la période allemande, depuis Othon jusqu'au traité de Westphalie ; la dernière enfin, commençant par l'incorporation de l'Alsace à la France, sous Louis XIV.
Ce qu'on a pu recueillir de positif sur l'histoire du pays avant l'arrivée des Romains, c'est qu'il était habité par la race celtique ; que les principales peuplades maîtresses de la haute Alsace étaient les Rauraques et les Séquanais, et qu'on y conservait un vif et douloureux souvenir de l'invasion d'Arioviste. Les bourgades existant à cette époque et dont le nom est parvenu jusqu'à nous sont : Gramatum (Offemont), Larga (Largitzen), Arialbin (Binningen), Brisac (Vieux-Brisach), Olin (Edenbourg), Argentonaria (Hornbourg).
On croit avoir reconnu sur le sommet des Vosges quelques vestiges d'anciens autels druidiques ; ce qui paraît plus positif, c'est que, sous le nom de Krutzman, une espèce d'Hercule sauvage était adoré par les populations, et que le Rhin fut lui-même une des divinités du pays.
Les traces du passage des Romains sont beaucoup moins incertaines ; cinquante forts furent élevés sur les bords du Rhin, pour protéger le pays contre les menaces d'invasion ; huit légions furent employées à leur garde, et, parmi leurs généraux, l'histoire a gardé les noms de Drusus, de Germanicus et de Silius. Des routes percées, souvent à travers les forêts défrichées, relièrent entre elles les anciennes villes agrandies, ou de nouvelles cités qui se formaient. Deux siècles de prospérité et de paix récompensèrent les intelligents efforts du génie colonisateur des Romains.
Mais les deux siècles suivants, troublés par les révolutions impériales, dont le contrecoup se faisait sentir depuis Rome jusqu'aux provinces les plus reculées, par les ferments de discorde que l'incertitude du pouvoir développait, furent agités surtout par les menaces incessantes et plus redoutables d'année en année des hordes du nord , qu'une invincible fatalité poussait vers les rives du Rhin, seule barrière qui les séparât de ces contrées occidentales, objet de leur ardente convoitise, proie dévouée à leurs envahissements.
Malgré l'apaisement d'une première révolte, suscitée en l'an 70 par Civilis, malgré les glorieux exploits de Crispus sous Constantin, les victoires de Julien qui put envoyer prisonnier à Rome le roi barbare Chrodomar, en 357 ; malgré l'importante journée d'Argentonaria, en 378, et la pacification momentanée de la province par Gratien, il fallut bientôt renoncer a la lutte. Stilicon, lieutenant d'Honorius, ayant retiré ses troupes, les barbares se ruèrent sur le pays sans défense et en firent un désert. Aux Alains et aux Vandales succédèrent les Alamans, qui tentèrent de fonder quelques établissements, en 407.
Tout fut dispersé ou anéanti lors du passage d'Attila, en 451 ; puis enfin, en 496, la victoire de Tolbiac, près de Cologne, vint asseoir sur toute la contrée le pouvoir de Clovis et la domination des Francs. C'est à l'époque romaine et au règne de Constantin que se rattachent les premières prédications du christianisme en Alsace, et saint Materne fut le premier révélateur de la foi nouvelle, qui déjà, vers la fin du IVe siècle, possédait un évêque à Strasbourg ; là comme dans les autres provinces de France, les progrès religieux furent rapides sous la monarchie franque.
La haute Alsace, ou Sundgau, comprise d'abord dans le duché d'Alemanie, forma ensuite avec la basse Alsace un duché particulier du royaume d'Austrasie, jusqu'à la mort de Childebert II, époque à laquelle, en vertu du traité de Verdun, elle fut incorporée dans le nouveau royaume de Lorraine. La division du territoire, à cette époque, en cantons (gaue) administrés au nom du roi par des comtes, et en terres franches ou mundats (immunitates), qui appartenaient à l'Église ou relevaient d'administrations particulières, l'éloignement du pouvoir central, expliquent le développement simultané de deux puissances : celle des évêques, qui surent se soustraire plus tard, eux et leurs domaines, à toute domination ; et celle des seigneurs, qui devinrent la souche des plus puissantes dynasties.
Parmi les cinq ducs qui représentèrent d'abord en Alsace l'autorité royale, Athic ou Adalric, plus connu encore sous le nom d'Ethico, qui succéda à Boniface et à Gundon, est le personnage le plus illustre que l'Alsace puisse revendiquer ; sans parler de sa descendance immédiate, de son fils Adalbert et de son petit-fils Luitfrid, qui tous deux héritèrent de sa dignité, et aux mains desquels elle s'éteignit, les ducs d'Alsace ayant été remplacés alors par des commissaires royaux, sous le titre d'envoyés de la chambre, nuntii camerae, la lignée masculine du duc Eticho embrasse : les comtes d'Eguisheim, les ducs de Lorraine, la maison de Habsbourg, les comtes de Flandre, de Paris, de Roussillon, de Brisgau, d'Altenbourg, de Zaehringen, de Bade et de Lentybourg ; et par les femmes cette illustre famille tient aux empereurs d'Allemagne, à ceux de la maison Hohenstauffen et à Hugues Capet par Robert le Fort.
Le gouvernement des ducs d'Alsace ne fut signalé par aucun événement politique important. Sa fin nous conduit au règne de Charlemagne qui, respecté au dehors, obéi au dedans, continua pour cette province l'ère de paix et d'organisation qu'elle devait à l'administration précédente.
La troisième période commence en 870, au milieu des déchirements qui suivirent la mort du grand empereur, et dont le partage de ses vastes États fut la cause. L'Alsace incorporée à l'empire germanique eut, en 916, une nouvelle série de ducs qui prirent alors le titre de ducs de Souabe et d'Alsace. On en compte vingt-six, dont les quinze premiers, de différentes familles allemandes, et les onze autres appartenant tous à la maison impériale de Hohenstauffen. Le dernier fut Conradin, envoyé en Italie à l'âge de seize ans, à la tête d'une armée, pour disputer à Charles d'Anjou le royaume de Pouille et de Sicile ; il fut vaincu, pris et décapité à Naples, le 26 octobre 1268.
L'autorité des ducs n'était pas souveraine, elle s'exerçait au nom de l'empereur, mais le haut rang des princes qui en étaient revêtus, presque tous fils ou proches parents du souverain, rehaussa l'éclat de cette dignité, devenue en quelque sorte héréditaire, en même temps qu'elle procurait à l'Alsace presque tous les avantages d'une véritable immédiateté.
Les landgraves succédèrent aux ducs ; non pas cependant que l'établissement du landgraviat coïncide avec l'extinction des duchés ; depuis 1186, les landgraves, dans la personne d'Adalbert IIl, dit le Riche, avaient remplacé les comtes du Sundgau ou de la haute Alsace, qui, sous les ducs, administraient la province, et étaient spécialement chargés de rendre la justice.
Ils n'avaient point de résidence fixe et tenaient leurs assises à Meyenheim, à Ensisheim, à Rouffach et souvent en pleine campagne ; les premiers comtes, depuis 673 jusqu'à 1111, avaient été pris dans diverses familles, principalement cependant dans celle du duc Eticho ; de 1111 à 1308, ils furent tous de la maison de Habsbourg, et depuis cette époque jusqu'à la réunion à la France, en 1648, les landgraves, successeurs des comtes, appartinrent sans exception à la maison habsbourgo-autrichienne.
C'est à la longue possession du landgraviat par la même famille, à l'accumulation des richesses, à l'étendue des domaines et. à l'influence qui en furent les conséquences naturelles, que Rodolphe Ier de Habsbourg dut son élévation au trône impérial, en 1273. II n'est sorte de faveurs, distinctions et privilèges qui n'aient été constamment attachés à cette dignité de landgrave, devenue comme l'apanage héréditaire des fils puînés de la famille impériale dont plusieurs, à l'exemple de Rodolphe, n'ont quitté le gouvernement de l'Alsace que pour aller s'asseoir sur le trône des Césars.
Nous avons dû insister sur cette aride généalogie des princes d'Alsace, parce qu'elle nous semble résumer la partie la plus intime de l'histoire de la province ; les événements qui se déroulèrent pendant leur longue domination, ou appartiennent à un cadre plus général et plus vaste que le nôtre, et il nous suffira de les signaler, ou rentrent dans les annales spéciales des bourgs du Territoire que nous essayerons bientôt de faire connaître.
Jusqu'au XVe siècle, outre les invasions normandes et anglaises , les revendications armées des rois de France et les démêlés avec la maison de Bourgogne, le pays fut presque continuellement déchiré par des discordes intestines. Tous les pouvoirs avaient grandi à la fois ; nous avons signalé l'origine de celui des évêques ; la féodalité avait acquis en Alsace les mêmes développements que dans le reste de la France ; nous avons montré quelle était la grandeur et l'illustration des ducs et des landgraves : à côté, au-dessous d'eux, trop haut placés pour descendre aux détails de l'administration, s'étaient élevés les landvogt, qui, laissant aux princes impériaux les dehors de la toute-puissance, s'attachaient à en conquérir les réalités ; la bourgeoisie des villes enfin opposait alternativement aux prétentions du clergé les immunités et privilèges de l'empire, aux réclamations de l'empire ses vieilles franchises épiscopales.
De ce conflit perpétuel, de celte incertitude sur l'étendue et la légitimité de tous les pouvoirs, naquit une situation confuse dont les désordres devinrent souvent de véritables brigandages. Et cependant, au milieu de ces luttes sanglantes que soutenait la bourgeoisie pour augmenter ou défendre ses libertés, l'art grandissait comme pour prouver une fois de plus son alliance indissoluble avec la liberté ; l'Alsace avait ses peintres, ses sculpteurs, ses musiciens, ses savants, ses poètes, et Gutenberg inventait l'art typographique.
C'est dans ces circonstances qu'apparut Luther, dont la doctrine se répandit rapidement dans tout le pays. Entre ses premières prédications et la fondation par Calvin d'une Église réformée à Strasbourg, en 1548, se place le douloureux épisode de la guerre des rustauds, lutte des paysans contre la noblesse, et le massacre des anabaptistes, apôtres de l'égalité absolue.
Hâtons-nous de franchir cette période sanglante qui n'offre que des récits de persécutions, que des tableaux de meurtre et de désolation ; mentionnons la guerre de Trente ans qui en fut comme le couronnement ; Colmar, Belfort, Altkirch, nous diraient les exploits de Gustave-Adolphe et du général Horn ; arrivons enfin à la victorieuse intervention de la France, au traité de Westphalie et à la réunion au sol français de cette belle province qui depuis lui resta si fidèle.
Cependant, si Louis XIV apportait le repos à ce pays longtemps troublé, le despotisme de son gouvernement devait froisser vivement des populations auxquelles la liberté était si chère ;. le traité d'annexion avait garanti aux anciennes villes impériales le maintien de leurs franchises et privilèges ; la violation de. cet article essentiel du contrat suscita des séditions et des révoltes qui ne cédèrent qu'aux victoires de Turenne, de Condé et de Créqui.
Ce fut donc alors pour l'Alsace plutôt une soumission à la force qu'une incorporation à la patrie commune ; le règne de Louis XV ne lui donna encore que les abus de l'ancien régime français avec la paix, en compensation des gloires si chèrement payées du règne précédent, mais sans aucune restitution de ses libertés ravies.
Enfin arriva le jour qui devait cimentera jamais l'union de l'Alsace et de la France ; la proclamation des principes de 1789 répondait trop aux sentiments, aux souvenirs et aux espérances toujours vivaces des habitants pour ne pus y être accueillie avec la plus grande satisfaction. L'égalité des cultes était surtout une précieuse conquête pour une contrée où les dissidents formaient une minorité notable de la population.
Aussi, quand la France républicaine fut menacée, l'Alsace se leva comme un seul homme, et courut aux frontières. Exposée la première à toutes les attaques, à tous les assauts des puissances coalisées, jamais cette province, devenue le premier boulevard de la liberté, ne faillit .aux devoirs que ses destinées nouvelles lui imposaient ; pas une plainte ne. s'éleva du sein de cette brave contrée, sentinelle avancée de la France, toujours sur pied, toujours en armes ; pas un murmure n'échappa à cet héroïque pays qui s'était fait, tout à coup, et volontairement, le soldat de sa nouvelle patrie, et soldat aussi dévoué, aussi soumis, aussi discipliné, qu'il avait été sujet intraitable et rebelle pour les anciens maîtres dont il contestait le pouvoir.
Hélas ! cette union, qui durait depuis 223 ans, devait être rompue violemment Le 15 juillet I870, le gouvernement français se décidait témérairement, sans motif plausible et malgré l'opposition des patriotes clairvoyants, au nombre desquels M. Thiers était au premier rang, à déclarer la guerre à la Prusse, et, dès le 19 du même mois, le gouvernement prussien recevait notification officielle de cette folle déclaration. Le résultat fut désastreux : la France fut amenée au bord de l'abîme, amputée de deux riches provinces : l'Alsace et la plus grande partie de la Lorraine.
Nous allons passer rapidement en revue les principaux événements qui amenèrent et précédèrent, l'envahissement du Haut-Rhin et le siège de Belfort. Dès le début, on avait dû renoncer au plan d'attaque conçu par Napoléon III ; la rapidité de la mobilisation des troupes allemandes et le désarroi dans lequel se trouvèrent immédiatement les troupes françaises ne permettaient d'autre objectif que la défensive.
Le 2 août, le général de Failly attaque la petite place de Sarrebruck, qu'il abandonnait presque immédiatement. Le 4, le général Abel Douai est battu et tué à Wissembourg. Les défaites succèdent- aux défaites : le 5 et le 6, le maréchal de Mac-Mahon était vaincu à Froeschwiller, en même temps que le général Frossard l'était à Forbach. Le 10, le général allemand de Werder sommait Strasbourg de se rendre.
Cette reddition ne devait avoir lieu que le 28 septembre, après la vigoureuse défense du général Uhrich. Le 13 août, la première armée allemande entourait Metz. Le 14, le 15 et le 18, se livrèrent les batailles meurtrières de Borny, de Gravelotte et de Saint-Privat, à la suite desquelles - l'armée du Rhin, sous les ordres de Bazaine, rentrait dans Metz. Dès le 19, l'armée du prince Frédéric-Charles commençait le blocus de cette place, qui jusqu'à ce jour s'était enorgueillie de son surnom de la Pucelle.
Le 23 août, le bombardement de Strasbourg commençait. Il était impossible d'y répondre efficacement : nos pièces avaient une portée insuffisante ; il était impossible aussi de garantir des projectiles la garnison et les habitants : les refuges casematés faisaient défaut. Le 30 août, la défaite du maréchal de Mac-Mahon à Beaumont préludait à la catastrophe de Sedan. Le 1er septembre, Napoléon III rendait son épée au roi Guillaume de Prusse. Wimpfen signait la capitulation dont on trouvera le texte au département des Ardennes.
Le 23 septembre, Phalsbourg se rendait ; Strasbourg le 28. Le 1er octobre, le général de Schmeling franchissait le Rhin et pénétrait dans le Haut-Rhin. Les villes les plus importantes de ce département furent successivement occupées par des troupes allemandes : Colmar, Altkirch, Mulhouse, Neuf-Brisach, Dannemarie, etc. Belfort ne fut rendu que le 17 février 1871.
Vers la fin de septembre, un petit corps allemand s'installa à Chalampé, sur la rive française du Rhin, un peu au nord de Mulhouse, en face de la petite ville badoise de Neuenbourg, qu'un simple bac reliait à l'autre rive ; au commencement d'octobre, l'ennemi, laissé définitivement tranquille possesseur de Chalampé, y établit un pont par lequel entrèrent dans le Haut-Rhin quelques milliers d'hommes qui commencèrent à rançonner le pays d'alentour, et notamment Mulhouse.
Malheureusement, les populations étaient prises d'une panique indicible ; dès qu'un uhlan apparaissait, les armes qui avaient été distribuées dans le but d'obtenir une résistance locale, étaient renvoyées à Belfort, où elles arrivaient par charretées ; heureux encore quand elles n'étaient pas livrées par centaines à quelques cavaliers. Cette défaillance inconcevable enhardit tellement l'ennemi qu'il osa alors venir à Altkirch, presque à mi-chemin de Mulhouse et de Belfort. Le général Thorneton, qui occupait avec de la cavalerie et de l'infanterie les abords de Belfort jusqu'à Dannemarie, fit retraite de ses positions le 6 octobre, et peu s'en fallut que le grand viaduc du chemin de fer à Dannemarie ne fût prématurément détruit.
Mais les événements avaient pris une tournure de plus en plus grave ; l'ennemi avait grossi en nombre dans le Haut-Rhin, réquisitionnant partout sans trouver la moindre résistance, même à Mulhouse, où le conseil municipal avait redouté de laisser armer la nombreuse population ouvrière qui, sans cela, se fût défendue avec plus ou moins de succès, mais eût 'au moins arrêté quelque temps l'envahisseur.
Enfin, devenu assez fort, l'ennemi entreprit le siège de Neuf-Brisach, puis celui de Schlestadt, qui, tous les deux, capitulèrent après de courtes et incomplètes résistances. A la suite de divers engagements, glorieux pour nos armes, dans la haute Alsace et à l'entrée de Saint-Amarin avec les francs-tireurs de Keller, député du-Haut-Rhin, mais dont les résultats furent insuffisants pour l'arrêter, l'ennemi attaqua, le 14 octobre,. la petite ville de Soultz, énergiquement défendue par les francs-tireurs, avec le concours de la population. L'ennemi avait du canon et l'affaire fut chaude. Vers le soir, renonçant à entrer dans Soultz avec les troupes dont il disposait, il appela à lui des renforts ; l'arrivée d'un détachement français de 300 hommes dépendant de Dannemarie, avec une centaine de gardes nationaux de Mulhouse, le décida à une retraite immédiate. Cette affaire, où la victoire nous resta, fut le plus sérieux de tous les engagements de ce côté.
Vers la même époque (19 octobre), le général Crouzat fut appelé sous les ordres du général Cambriels, et le commandement de Belfort fut. donné au lieutenant-colonel du génie Denfert-Rochereau, qui fut en même temps nommé colonel. A l'article que nous consacrons plus loin à Belfort, nous racontons en détail les péripéties de ce siège, qui suffirait à lui seul pour sauver l'honneur du pays, et qui eut pour résultat de conserver à la France mutilée cette position précieuse, cette gardienne de la Trouée des Vosges.
Les départements et leur histoire - Bas Rhin - 67
Le territoire du département du Bas-Rhin prit, au Moyen Age les noms de Nordgau et de basse Alsace, et fut habité primitivement par une peuplade de la nation celtique. Au temps où César visita cette limite de la Gaule, une partie de la confédération des Médiomatrices, dont la capitale Divodurum (Metz) était située de l'autre côté des Vosges, y avaient formé quelques établissements dont les principaux étaient Argentoratum (Strasbourg), Brocomagus (Brumat), Helvetum (Elle ou Schlestadt), Altitona (Hohenbourg).
Ce n'étaient encore que des bourgades composées d'habitations chétives et dispersées au hasard, mais qui servaient de retraite à des guerriers de haute stature, robustes et infatigables, à ces Belges que César eut tant de peine à vaincre. Les Médiomatrices bravèrent deux fois les armes du conquérant, en 56 et 52 ; mais après la destruction d'Alise et la ruine des efforts de Vercingétorix pour rendre les Gaulois à la liberté, leur soumission fut complète.
Quelques années plus tard, pendant la guerre de César contre Pompée, les passages du Rhin et des Vosges n'étant plus suffisamment défendus, les Germains en profitèrent pour revenir en deçà du fleuve. Les Nemètes et les Triboques, deux des peuples que César avait chassés de la Séquanaise, réussirent alors à s'établir vers Spire et vers Strasbourg dans la basse Alsace qui, séparée jusque-là de la Gaule médiomatricienne par les montagnes des Vosges, le fut bien plus encore, depuis cette époque, par les moeurs et le langage de ses habitants.
Malgré cet établissement des Germains, les Romains restèrent maîtres de l'Alsace ; mais pour se prémunir contre une nouvelle invasion, ils élevèrent sur les bords du Rhin et aux défilés des Vosges des retranchements coupés par des tours élevées et par des camps environnés d'énormes murailles de pierre ; il reste des vestiges de ces travaux gigantesques, et ce n'est pas sans admiration qu'on peut examiner encore le retranchement bâti sur les hauteurs de Hohenbourg et dont la vaste enceinte bien reconnaissable se développe sur un contour de près de quatre lieues.
Aussi, pendant deux siècles, l'Alsace, qui dans la nouvelle division forma la Première Germanie, jouit-elle d'une tranquillité qui ne fut troublée que par la révolte de Civilis (l'an 70 de J. C.). Cette période vit s'élever des villes nouvelles ; les anciennes cités s'agrandirent et devinrent vraiment dignes de ce nom, les institutions romaines apportées en germe avec la conquête se développèrent et donnèrent à une contrée jusque-là barbare les premiers éléments de la civilisation.
La basse Alsace fut comprise par Auguste dans la Germanie supérieure, puis, par Constantin, dans la première Germanie, et ce fut vers le règne de cet empereur que le christianisme fut apporté en Alsace par saint Materne. A cette époque les fortifications établies sur les rives du Rhin pour arrêter l'irruption des barbares devinrent insuffisantes ; aucune force humaine ne fut plus capable de contenir les peuplades envahissantes. Julien retarda par ses victoires la grande invasion ; il défit en 357 les Lètes aux environs de Strasbourg ; mais après sa mort, les Alains, les Suèves, les Vandales, les Huns, les Francs se jetèrent sur la Gaule.
En 407, lors de la grande invasion de la Gaule par les Suèves, les Vandales, les Alains et les Bourguignons, la plupart des villes de l'Alsace les premières exposées aux hordes envahissantes furent détruites. Argentoratum fut de ce nombre, et la province entière fut enlevée sans retour aux Romains. A partir de ce moment commence pour les deux Alsaces une série de misères qui se continue presque sans interruption dans l'espace de plusieurs siècles. Les ravages, les famines, les épidémies se succèdent et dépeuplent la contrée.
En 451, Attila détruit tout sur son passage. Les Francs ne tardent pas à s'emparer de la première Germanie ; Clovis en mourant laisse à son fils Théodoric cette partie de ses États sous le nom de royaume de Metz ; Clotaire réunit en 558 toute la monarchie franque et lègue à son tour Metz ou l'Austrasie à Sigebert. Les intrigues de la reine Brunehaut agitèrent l'Alsace de 600 à 613.
Clotaire et Dagobert s'efforcèrent d'adoucir par leur présence et leur administration les malheurs de cet infortuné pays. Dagobert laissa en mourant l'Austrasie à Sigebert II ; vers la fin du règne de ce faible roi, l'Alsace fut érigée en duché en faveur d'Athic ou d'Adalric dont la fille Odile, célèbre pour sa piété, fonda près de Hohenbourg le monastère qui porte son nom.
Les victoires de la famille d'Héristal sur les Saxons préservèrent la basse Alsace d'une nouvelle invasion. Louis le Débonnaire comprit le territoire de l'Alsace dans la part de l'empire qu'il assigna à son fils Lothaire au traité de 817. Le partage de Verdun (843) qui fut le résultat de la bataille de Fontenay confirma le fils aîné de Louis le Débonnaire dans cette possession. Sous Lothaire II l'Alsace fut comprise dans la Lotharingie (855).
Ce prince constitua de nouveau cette province en duché et la donna à un de ses bâtards du nom de Hugues ; mais à sa mort, Charles le Chauve et Louis le Germanique se partagèrent ses États par le traité de Mersen (870), et ce fut Louis qui devint maître de l'Alsace. Cependant Hugues le Bâtard s'efforçait de maintenir parles armes son titre de duc ; Charles le Gros s'empara par trahison de sa personne, lui fit crever les yeux et le jeta dans un monastère.
Cet empereur, un instant maître de tous les États de Charlemagne, fut déposé à la diète de Tribur (888), et Arnoul, proclamé roi d'Allemagne, s'empara de l'Alsace, et la donna avec la Lorraine à son fils naturel Zwentibold, auquel les grands et les évêques substituèrent à la mort d'Arnoul, arrivée en 899, le fils légitime de ce roi le jeune Louis, âgé seulement de six ans. Louis l'Enfant fut incapable de lutter contre l'agrandissement du pouvoir féodal, qui prit en Alsace, sous son règne, une extension encore plus grande que dans le reste de l'empire carlovingien.
Charles le Simple disputa aux empereurs allemands la possession de cette province ; elle finit par rester à ces derniers, et aux misères sans nombre qu'avaient occasionnées les guerres dont elle fut à cette époque le théâtre se joignirent les ravages des Hongrois ; à deux reprises, en 917 et 926, ces barbares dévastèrent l'Alsace. L'année même de leur deuxième invasion, l'empereur Henri Ier l'Oiseleur réunit cette contrée à la Souabe et la donna, avec le titre de duché, à Hermann.
L'un des derniers Carlovingiens, Louis d'Outre-mer, essaya encore, mais en vain, de reprendre l'Alsace, cette province demeura définitivement dans la possession des empereurs allemands. A la mort d'Othon III (1002), quatre prétendants se disputèrent l'empire ; parmi eux étaient Hermann, duc de Souabe et d'Alsace ; l'un de ses adversaires trouva un appui dans les populations même de l'Alsace et dans la ville de Strasbourg ; Hermann, pour se venger de ses sujets infidèles, brûla la capitale de son duché et ravagea tout le territoire.
Quelque temps après la querelle des investitures partagea l'Allemagne entre le pape Grégoire VII et l'empereur Henri IV ; Grégoire déposa son adversaire en vertu de la toute-puissance qu'il prétendait s'arroger sur les rois, et Rodolphe, duc de Souabe et d'Alsace, fut élu par les grands de l'empire ; le nouvel empereur reçut de Grégoire une couronne d'or sur laquelle était gravé ce vers : Petra dedit Petro, Petrus diadema Rodolphe.
Mais la bataille de Mersbourg fut fatale à Rodolphe : ce prince y perdit la vie. Henri disposa alors de la Souabe et de l'Alsace en faveur de Frédéric de Hohenstauffen, Lorsque Grégoire avait fait proclamer un nouvel empereur, Henri, par représailles, avait créé un antipape ; ce schisme et les vicissitudes de la guerre détruisirent tellement la religion en Alsace qu'il fallut un missionnaire pour la rétablir.
La peste ravageait alors toute cette partie de l'empire ; les esprits se montrèrent disposés, sous l'influence de ce fléau, à accueillir les exhortations du prêtre Manégold envoyé par le pape Urbain II, les désordres cessèrent et un grand nombre de fondations pieuses datent de cette époque. Frédéric le Borgne remplaça Frédéric de Hohenstauffen comme duc d'Alsace ; son administration fut ferme et prudente. Conrad III, frère de Frédéric, fut appelé en 1130 au trône impérial, et cette élévation des Hohenstauffen donna un nouvel éclat à l'Alsace. Haguenau, construit par Frédéric le Borgne, devint l'une des principales résidences impériales.
Frédéric Barberousse, successeur de Conrad (1152), y fit de fréquents séjours et se plut souvent à chasser dans la forêt voisine qu'on appelait Forêt Sainte ; il donna à l'Alsace pour duc immédiat un de ses fils qui portait, comme la plupart de ses prédécesseurs, le nom de Frédéric.
A cette époque les deux Alsaces avaient pour gouverneurs chacune un comte ou landgrave (land pays, graff, comte), chargés de l'administration de la justice. Ces landgraves ne jouissaient des droits réguliers que sur leurs propres terres, et on appelait de leurs décisions au tribunal de l'empereur. Le règne de l'empereur Frédéric II, fils de Henri VI (1197 -1250), fut pour l'Alsace une époque de calme et de prospérité ; après ce prince, les empereurs conservèrent le titre de ducs de Souabe et d'Alsace ; mais les troubles qui suivirent sa mort portèrent le désordre dans ce territoire.
L'héritier de l'empereur Conradin, fait prisonnier par Charles d'Anjou, fut décapité en 1268. Pendant cette confusion la plupart des grands se rendirent indépendants et les principales villes du Rhin, Strasbourg, Schlestadt, Haguenau, Wissembourg formèrent entre elles une confédération pour les intérêts de leur commerce ; le nom de villes impériales fut donné à la plupart d'entre elles, et bientôt quelques-unes, telles que Strasbourg et Haguenau, acquirent une presque complète indépendance.
Rodolphe de Hapsbourg, qui termina le grand interrègne (1273), visita l'Alsace et lui donna pour landgrave son fils, nommé comme lui Rodolphe ; les troubles que lui-même y avait allumés avant d'être empereur n'en continuèrent pas moins. L'Alsace se souleva plus tard contre Adolphe de Nassau, parvint à le renverser et lui substitua ce fameux Albert Ier sous lequel les cantons suisses conquirent leur indépendance.
L'Alsace favorisa l'insurrection de ces montagnards et une vaste ligue se forma de Porentrui à Seltz. Strasbourg secoua entièrement le joug de l'aristocratie et établit dans ses murs une sorte de constitution républicaine sous la protection de l'empire. Les discordes civiles n'en continuèrent pas moins dans la contrée sous cette nouvelle forme de gouvernement, et il ne fallut rien moins, pour les faire cesser, que l'irruption des bandes anglaises en Alsace après la bataille de Poitiers.
En 1375 un seigneur français, Enguerrand de Coucy, petit-fils d'Albert ler, prétendit faire valoir ses droits à la possession du duché d'Alsace ; il se mit à la tête des bandes d'aventuriers qui ravageaient le pays, et mit les deux landgraviats à feu et à sang. Survinrent ensuite de nouvelles querelles entre l'aristocratie et les habitants des villes ; les campagnes furent dévastées, et cent cinquante villages furent de nouveau détruits.
La paix ne se fit guère qu'en 1429, et fut suivie de la ligue de dix villes, parmi lesquelles Haguenau, Strasbourg, Schlestadt, Wissembourg, Obernheim se trouvent dans cette partie de l'Alsace dont nous nous occupons. Ces cités prirent une part active à la guerre des Suisses contre Charles le Téméraire ; leurs milices assistèrent à la défaite de Saint-Jacques (1444), et aux glorieuses journées de Granson et de Morat (1476).
Les guerres occasionnées par la réforme s'annoncèrent par plusieurs soulèvements populaires en Alsace. Ce fut d'abord la ligue du Soulier formée par des paysans qui avaient pris pour devise contre les grands et le clergé : Rien que la justice de Dieu, puis le soulèvement des Rustauds en 1525. Les anabaptistes vinrent ensuite et proclamèrent l'égalité de tous les hommes. On les persécuta, et six cents d'entre eux subirent le dernier supplice.
Le protestantisme fit des progrès au milieu des entraves que l'Église romaine s'efforçait d'apporter à son développement ; Calvin, chassé de Genève, vint en 1 538 à Strasbourg fonder l'Église française réformée. Les troubles religieux furent le premier prétexte de cette guerre de Trente ans, qui devint européenne.
L'Alsace eut sa part de désordres et de misères pendant cette période ; les détails qui la concernent trouveront leur place à l'histoire du Haut-Rhin. Cependant, il faut dire qu'en 1637, le duc de Saxe-Weimar battit près de Strasbourg l'armée impériale. Les deux landgraviats furent conquis et cédés à la France par la paix de Westphalie ; ils se soulevèrent à plusieurs reprises, et leur possession eut besoin d'être confirmée par les victoires de Condé et de Turenne.
Strasbourg seul avait conservé sa liberté ; elle la perdit après le traité de Nimègue, en 1679. Malgré sa réunion à la France, l'Alsace resta allemande jusqu'en 1789. La révolution, qui assurait à tous les cultes une égale protection, fut généralement accueillie avec faveur dans les deux landgraviats ; quelques soulèvements furent rapidement comprimés, et les départements du Haut et du Bas-Rhin défendirent généreusement leurs frontières contre l'armée prussienne.
Le Bas-Rhin vit passer Moreau, et Kehl et Huningue furent le premier théâtre des opérations de ce général lorsqu'il lit la célèbre campagne d'Allemagne. L'Alsace se distingua en 4814 par sa fidélité à l'empereur ; en 1815, Rapp, presque sans soldats, fit soutenir aux habitants de Strasbourg un blocus de trois mois. L'industrie s'y développa cependant, et à la fin du XIXe siècle, le département du Bas-Rhin est l'un des premiers parmi les départements manufacturiers de France.
Les départements et leur histoire -Pyrénées Orientales-66
(Région Languedoc-Roussillon)
Le département des Pyrénées-Orientales a été formé du Roussillon et de l'ancienne Cerdagne. Ce qu'on sait de plus positif ou de plus probable sur l'origine des premiers habitants de ces contrées, c'est que les Gaulois, dans leur émigration du nord au sud, y substituèrent leur domination à celle de colons sardes ou tyriens qui y avaient fondé d'importants établissements.
Les vainqueurs empruntèrent des vaincus ou leur imposèrent le nom de Sardones, qui devint celui d'une puissante tribu de la confédération des Consorani et des Tectosages. On sait que ces peuples tentèrent de lointaines expéditions en Orient et jusqu'en Asie. Les Romains, qui avaient appris à les connaître, leur envoyèrent des ambassadeurs pour solliciter leur alliance contre Annibal, qui, d'Espagne, marchait sur l'Italie. Les Sardones refusèrent de prendre aucun engagement, et quand à son tour se présenta le général carthaginois comme hôte, disait-il, et non comme ennemi, le passage dans les campagnes lui fut laissé libre, mais pas un des soldats de son armée ne put pénétrer dans les villes. Tite-Live, qui rapporte cet épisode dans ses annales, rend hommage à la fière indépendance de ces premiers Roussillonnais.
Si le pays n'échappa point alors pour longtemps aux armes romaines, sa défaite a quelque chose d'honorablement exceptionnel par l'éclat des grands noms qui s'y trouvent mêlés. Après Annibal, c'est Marius qui apparaît, venant punir les Cimbres d'une double invasion ; c'est ensuite le grand Pompée, dressant sur la cime des Pyrénées la colonne commémorative de sa victoire sur Sertorius. César, enfin, vient après eux, et plus habile dans son orgueil, c'est aux dieux qu'il élève un autel pour marquer son passage.
La conquête du pays des Sardones, compris plus tard dans la Gaule Narbonnaise, remonte à l'an de Rome 633 et est attribuée à Q. Marcius, le fondateur de la colonie de Narbonne. Cette période dura jusqu'à l'année 409 de l'ère chrétienne. La position géographique du Roussillon sur la route d'Es pagne, la richesse de ses villes, dont l'une, Elne, comptait dès lors parmi les sept sièges épiscopaux de la Septimanie, le désignaient fatalement comme une proie à l'avidité des Barbares.
Vandales, Suèves et Alains s'y étaient installés, quand les Wisigoths les en chassèrent. La domination de ces derniers dura trois siècles environ et laissa une profonde empreinte dans les moeurs et dans la législation du pays. Entre Euric et Roderic, le premier et le dernier roi de la monarchie wisigothe, l'événement qui affecta le plus spécialement la province dont nous nous occupons est la révolte de Paul, un des lieutenants du prince Wamba.
Envoyé par son maître, qui résidait alors à Tolède, en Septimanie, pour y comprimer une sédition populaire, ce général se mit à la tête des rebelles et se . fit proclamer roi d'Orient en 673. Wamba fut obligé de venir en personne combattre l'usurpateur ; il traversa deux fois le Roussillon ; la seconde, après la défaite et la prise de son rival, il s'y arrêta pour réglementer l'administration ; il donna des délimitations nouvelles aux diocèses, réforma sur différents points la discipline ecclésiastique, rendit entre autres une ordonnance qui obligeait. les prêtres à prendre les armes pour la défense du sol et, après une étude sérieuse des besoins du pays, laissa à ses agents de sages instructions qui ne furent pas sans une heureuse influence sur la province.
Deux siècles après la bataille de Vouglé, le Roussillon était encore au pouvoir des Wisigoths ; rien n'indique .que cette possession fût même menacée par les princes francs ou les ducs d'Aquitaine, lorsque les Sarrasins, maîtres de l'Espagne, apparurent sur la crête des Pyrénées, invasion méridionale venant se heurter contre les hordes victorieuses du Nord.
Le Roussillon fut le premier champ de bataille et la première conquête des Sarrasins. La grande épopée de Charles Martel, la journée de Poitiers, les exploits décisifs de Pépin n'appartiennent point à cette notice ; nous nous bornerons donc aux faits dont notre province fut le théâtre. C'est en 719 que le Roussillon fut envahi par Zama, gouverneur de l'Espagne pour les califes de Damas.
Cette province et la ville de Narbonne étaient les points où l'autorité musulmane s'était le plus solidement établie. Un des lieutenants d'Abd-er-Rahman, nommé Manuza, se laissa séduire par les charmes de Lampégie, fille d'Eudes, duc d'Aquitaine, l'épousa, et conclut une trêve de trois ans avec son beau-père. Cette inaction de Manuza au moment d'une lutte suprême souleva la colère d'Abd-er-Rahman ; il envoya contre le traître un autre chef nommé Gedhi ; c'est dans le Roussillon que les deux généraux se rejoignirent pour combattre : Manuza, vaincu, alla mourir dans les murs de la petite forteresse de Livia, dont on voit encore quelques ruines.
Sa femme, captive, fut conduite à Damas, au sérail du calife. A cette époque, en 731, les Maures étaient encore maîtres du Roussillon, et Charles Martel avait échoué dans ses tentatives sur Narbonne ; c'est seulement vingt ans environ après, alors que Pépin prenait enfin la ville vainement assiégée par son père, que les Roussillonnais chassent eux-mêmes les soldats du prophète et se donnent au fondateur de la seconde dynastie franque.
Il fallait que les circonstances fissent de ce rapprochement une nécessité bien impérieuse, car de longs siècles devaient s'écouler avant qu'aucune fusion fût possible entre les conquérants des Gaules et les habitants des Pyrénées. Lorsque Charlemagne traversa le pays en 778, rendant l'offensive aux armes des Francs, il apprécia, dans son génie, le rôle que pouvait jouer, dans son nouvel empire, la race roussillonnaise ; conciliant avec l'intérêt de la patrie commune l'indépendance ombrageuse et la belliqueuse fierté de ces populations, il fit de cette province un de ces comtés qui, sous le nom de marches d'Espagne, devaient, comme des sentinelles avancées, veiller sur les frontières naguère menacées.
Mais le grand monarque n'avait point prévu le rapide affaissement de son oeuvre et les déchirements auxquels la faiblesse de ses successeurs livrerait son immense empire. Les comtes du Roussillon furent des premiers à secouer le joug royal. Les chefs de cette maison féodale étaient les comtes de Barcelone, qui apanagèrent deux branches cadettes de leur famille, l'une de la Cerdagne et l'autre du Roussillon.
Cette période est la plus confuse et la plus désastreuse de l'histoire de la province ; le nom même des seigneurs possesseurs du pays disparaît dans ce chaos qui dure plus de trois siècles. Gaucelme ou Gancion échappe à cet oubli des chroniques par la part qu'il prend à la lutte de Pépin d'Aquitaine contre Louis le Débonnaire et par sa mort tragique. Étant tombé aux mains de Lothaire, il eut la tête tranchée, et sa soeur, prisonnière comme lui, fut enfermée dans un tonneau et jetée dans la Saône.
Aux attaques incessantes des Maures, aux courses dévastatrices des Normands, se joignaient les horreurs d'une guerre civile presque permanente, les rivalités locales mettant sans cesse les armes aux mains des petits chefs féodaux. Ces désordres devinrent tels, qu'une intervention des seigneurs tant laïques qu'ecclésiastiques dut s'efforcer d'y apporter remède : des constitutions de paix et trêve, désignées sous le nom de treuga Dei (trêve de Dieu), furent décrétées dans deux conciles tenus dans la petite ville de Toulouges, près de Perpignan, en 1041.
Les clauses principales de ces traités prouvent à quel degré le mal était arrivé. Il était défendu de se saisir des bestiaux utiles à l'agriculture au-dessous de six mois, tant on redoutait l'anéantissement des espèces. Chacun avait le droit de tuer quiconque était reconnu coupable d'avoir violé la trêve de Dieu ; on alla plus loin encore, et, pour stimuler l'ardeur des vengeurs de la justice, on déclara que ceux qui auraient puni un homme condamné pour ce fait recevraient le titre de zélateurs de la cause divine.
Quelques fondations pieuses, les exploits d'un Guinard au siège d'Antioche, la lutte impie d'un autre Guinard contre son père Gausfred III et, à la suite de ces déchirements, la désolation de la province réduite à recourir à l'aumône de la Septimanie chrétienne, tels sont les faits principaux dans lesquels se résume l'histoire du Roussillon pendant cette déplorable époque.
Enfin ce Guinard, auquel son père avait pardonné et qui avait hérité de ses domaines, ne s'étant pas marié, légua son comté au roi d'Aragon, Alphonse II, en 1172. Il avait été précédé dans cette détermination par Bernard-Guillaume, comte de Cerdagne, dont le testament, en 1117, avait institué, pour hériter de ses petits États, Raymond V, comte de Barcelone, qui devint roi d'Aragon en 1134, par son mariage avec Pétronille, fille de Ramire II. Un dernier lien, malgré ces donations, rattachait le Roussillon à la France : les princes d'Aragon reconnurent pour ces contrées la souveraineté de nos rois jusqu'à la renonciation qu'en fit saint Louis en faveur de Jacques Ier, et en échange des prétentions de ce dernier sur une partie du Languedoc, prétentions qu'il abandonna par le traité de Corbeil, en 1258.
Quoiqu'il en puisse coûter à notre amour-propre national, il faut reconnaître que la domination aragonaise inaugura pour le Roussillon une ère de réparation et de prospérité. Alphonse, vaillant, habile, doué de qualités aussi solides que brillantes, mit tous ses soins à faire accepter par les sympathies et les intérêts des provinces cédées leur incorporation à son royaume d'Aragon.
Perpignan devint une de ses résidences de prédilection et l'objet de ses faveurs les plus signalées. Sa cour était le rendez-vous des poètes et des savants de l'époque ; aux bruits de guerre avaient succédé les chants d'amour, et les vers des troubadours, les poétiques légendes remplaçaient le sinistre récit des. batailles. Guillaume de Cabestaing, le trouvère roussillonnais, était un ami particulier d'Alphonse ; sa fin tragique, qui rappelle la sanglante histoire de Gabrielle de Levergies, fut vengée par le roi.
Ce nom n'est pas le seul qui ait illustré le règne d'Alphonse ; il faut lui joindre ceux de Bérenger de Palazol, de Raymond Bistor, de Pons d'Odessa et Tormit de Perpignan, gracieux talents de la môme époque dont le Roussillon garde encore aujourd'hui le glorieux souvenir. Alphonse avait créé de nouveaux comtes de Roussillon ; mais, pour prévenir toute division, tout déchirement, c'est dans sa famille, au profit de son frère don Sanche, qu'il avait constitué cet apanage.
Les traditions d'Alphonse furent suivies un siècle environ après sa mort, arrivée le 25 avril 1196. C'est dans cet intervalle que le roi don Jayme Ier, surnommé le Conquérant parce qu'il avait agrandi ses États des îles Baléares et du royaume de Valence, obtint de Louis IX sa renonciation à la souveraineté de la Cerdagne et du Roussillon.
Ce prince, regardant comme solidement établie la domination de sa maison sur les diverses parties de son royaume, le partagea à sa mort entre ses deux fils, don Pèdre III et don Jayme. Le premier, qui était l'aîné, eut l'Aragon, Valence et la Catalogne ; Majorque et les possessions françaises échurent à l'autre. Ce malheureux partage replongea nos provinces dans toutes les calamités de la guerre. Les prétentions de suzeraineté soulevées par don Pèdre jetèrent son frère dans les bras du roi de France.
L'excommunication fulminée par le pape contre le roi d'Aragon fournit un prétexte à Philippe le Hardi, qui vint se faire battre au pied des Pyrénées et mourir à Perpignan le 5 octobre 1285. La couronne de Majorque perdit beaucoup de son prestige à cette défaite, et le Roussillon en particulier, théâtre de la lutte, en éprouva des dommages considérables.
Les successeurs immédiats de don Jayme cherchèrent à faire oublier les torts et les revers de leur aïeul par leur attitude humble et soumise ; mais les éléments de rivalité n'en subsistaient pas moins ; la lutte recommença entre Pierre IV et Jayme II. Cette fois, elle fut décisive. Malgré l'obstination désespérée de Jayme, toujours vaincu et toujours menaçant, malgré l'infatigable dévouement des Roussillonnais, la dernière heure était venue pour le royaume de Majorque ; en 1374, il était définitivement réuni à l'Aragon, et le Roussillon retombait pour trois siècles sous la domination espagnole.
Il y eut un retour momentané à la France ; mais ce court épisode se rattache au XVe siècle et au règne de Louis XI, dont le nom se représente partout où sont tentés les premiers efforts pour constituer l'unité française, et près de deux cents ans nous en séparent encore. Pierre IV était un prince d'une haute capacité ; l'énergie qu'avaient déployée les Roussillonnais pour la défense du royaume de Majorque lui inspira plus d'estime pour leur caractère que de rancune pour la résistance qu'ils lui avaient opposée ; recommençant la politique d'Alphonse II, c'est par une administration bienveillante qu'il voulut s'attacher ses nouveaux sujets.
Il les associa à la législation catalane, les admit aux états généraux ou Cortès, encouragea l'industrie et la navigation par des traités avec les nations voisines, protégea l'agriculture et fit replanter d'arbres les contrées ravagées dans les dernières guerres. Jean Ier, fils et successeur de Pèdre IV, ne suivit pas l'exemple de son père ; il abandonna le Roussillon à l'administration d'un gouverneur général et d'officiers royaux, plus soucieux de leur enrichissement et de leur élévation que des intérêts du pays ; le seul acte qui signale ce règne est une ordonnance à la date du 13 décembre 1388, qui ouvre le Roussillon aux criminels expulsés des autres provinces de l'Aragon.
Martin, qui succéda à Jean Ier, était sympathique aux Roussillonnais, il répara une partie des maux causés par l'incurie de son prédécesseur. Ce prince étant mort sans héritier, les états du royaume décernèrent sa couronne à Ferdinand infant de Castille, dont le règne fut déchiré par le schisme de Benoît III. Alphonse V, qui lui succéda, passa presque toute sa vie à guerroyer en Italie ; le Roussillon n'eut qu'à se louer de la régence de la reine Marie, sa femme, dont l'administration laissa dans le pays des traces de grande sagesse et des souvenirs de bonté.
C'est en 1458 que Jean II monta sur le trône, et c'est presque aussitôt qu'éclatèrent ses démêlés avec le roi de France. La Catalogne s'était soulevée, le Roussillon s'était associé à la révolte ; Jean, impuissant à faire rentrer ses sujets dans le devoir, s'adressa à Louis XI et sollicita de lui un secours de sept cents lances.
Le rusé monarque y consentit, mais à la condition que les frais de l'expédition, évalués à deux cent mille écus, seraient à la charge du roi d'Aragon, et que, si cette somme n'était pas exactement payée dans un délai donné, le Roussillon et la Cerdagne deviendraient les gages de la créance. Jean ne tarda pas à s'apercevoir du piège caché sous les conditions de son allié ; il mit alors toutes ses espérances dans le succès de cette sédition qu'il était naguère si désireux de comprimer. Les soldats français furent reçus et traités en ennemis.
Louis XI n'en fut sans doute que médiocrement affecté ; il envoya à leur secours une armée de trente mille hommes. La résistance fut encouragée et organisée alors par le roi d'Aragon ; c'était la guerre ; elle fut vaillamment soutenue de part et d'autre, mais Louis XI n'était pas homme à se dessaisir facilement de ce qu'il avait une fois tenu.
Les négociations achevèrent l'oeuvre que les armes avaient commencée, et en 1475 le Roussillon et la Cerdagne appartenaient à la France. Mais le génie n'est point héréditaire ; Charles VIII n'était capable ni de comprendre ni de poursuivre les grandes traditions politiques de son père ; il avait, d'ailleurs, pour antagoniste ce Ferdinand qui, par son mariage avec Isabelle, venait de réunir sous le même sceptre Aragon et Castille, et dont la couronne allait s'enrichir de tous les trésors de l'Amérique.
Une intrigue ourdie par deux moines à la solde de l'étranger jeta le trouble dans la conscience du jeune roi, qui, malgré l'avis de son conseil, malgré la résistance des gouverneurs provinciaux, s'obstina à restituer Ies conquêtes paternelles ; Ferdinand et Isabelle firent leur entrée solennelle à Perpignan en septembre 1493. Toutefois, cette faute était si énorme qu'elle excita de fréquents regrets chez Charles VIII et Louis XII, qui tentèrent d'inutiles efforts pour revenir sur cette déplorable cession.
L'occasion perdue ne devait pas sitôt renaître ; Louis XII, aussi peu heureux à la guerre que dans les négociations, renouvela authentiquement la restitution du Roussillon en échange du royaume de Naples, qu'il ne devait pas mieux conserver ; déçu des deux côtés, il recommença la lutte, triste héritage pour son successeur François Ier. En Roussillon, comme à Pavie, tout fut perdu fors l'honneur sous le règne du chevaleresque monarque, et pendant soixante-dix ans la domination espagnole ne fut plus même contestée.
La seule consolation que nous puissions nous donner est le tableau de l'ignorance et de la misère où le pays resta plongé pendant cette période de la domination étrangère. Pestes, famines, envahissement des esprits par les superstitions les plus absurdes, persécutions des prétendus sorciers, plus absurdes encore, rien ne manque à la honte et au malheur des populations.
Enfin la tâche de Louis XI put être reprise. Richelieu gouvernait la France, lorsque les animosités soulevées par Olivarès, premier ministre de Philippe IV, firent explosion en Catalogne ; le Roussillon fit, comme toujours, cause commune avec la province révoltée ; Olivares, en recourant aux moyens de répression pratiqués ailleurs par le duc d'Albe, poussa les esprits au désespoir.
Vers le même temps, une attaque des Espagnols sur la ville de Trèves, sans déclaration de guerre préalable, fournissait à Richelieu un prétexte d'intervention. Condé entra dans le Roussillon ; les habitants songeaient alors à fonder une république fédérative ; on leur fit comprendre qu'on attendait un autre prix du secours qu'on leur apportait. En haine de la domination espagnole, ils se donnèrent à la France.
Louis XIII vint en personne faire le siège des places fortes. En 1642, tout le Roussillon était occupé par l'armée française ; en 1659, le traité de la Bidassoa consacrait les droits de la France sur tout le versant septentrional des Pyrénées, et le Roussillon prenait place parmi nos provinces. Une conspiration de quelques nobles, découverte en 1674 par suite d'une indiscrétion amoureuse, fut la seule protestation contre le nouveau régime. La crise de la Révolution, les désastres de l'Empire ont trouvé les populations inébranlablement dévouées à la France.
Au XIXe siècle, si quelques usages, quelques détails de costume, quelques traits de la physionomie trahissent encore chez les Roussillonnais leurs longues et intimes relations avec l'Espagne, sous tant d'autres rapports l'assimilation est si complète, qu'il faut relire l'histoire pour ne pas oublier que cette, contrée n'est française que depuis un peu plus de trois siècles.
Les départements et leur histoire-Pyrénées Atlantiques-64-
Le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques appartenait, au moment de la conquête romaine, aux peuples désignés sous le nom générique d'Aquitains ; ils étaient formés du mélange des Ibères, les plus anciens possesseurs du sol et des Celtes qui autrefois les avaient conquis et refoulés dans leurs montagnes.
Rome, avant César, avait déjà tenté de les soumettre ; deux fois ses armées avaient été repoussées. Le jeune Crassus, lieutenant de César, fut plus heureux. Malgré l'énergique résistance des belliqueux habitants de ces contrées, il réussit à les dompter, et si quelques peuplades durent à leur éloignement ou à leur situation dans les montagnes d'échapper d'abord à la conquête romaine, elles ne tardèrent pas à se soumettre à César lui-même, qui, cinq ans après Crassus, vint en Aquitaine. Le pays se révolta sous Auguste, et fut de nouveau subjugué par le proconsul Messala ; ces succès méritèrent au vainqueur l'honneur d'un triomphe rappelé par Tibulle, son ami : Genlis Aquitanae celeber Messala triomphis.
Sous Adrien, le pays fit partie de la Novempopulanie. Il est fait mention, sous l'empire, de deux villes importantes, dont l'une, Iluro, est devenue Oloron ; l'autre, Beneharnum, d'où vient le nom de Béarn, a donné lieu à de grandes discussions ; on croit que la ville de Lescar est bâtie sur l'emplacement de cette antique cité.
Ravagée par les barbares : Vandales, Alains, Wisigoths, qui prenaient ce chemin pour envahir l'Espagne, la contrée fut, au VIIe siècle, occupée par les Vascons, chassés de Pampelune et de Calahorra par les Wisigoths : ces peuples intrépides luttèrent contre Dagobert et les autres rois francs de la première race, qu'ils inquiétèrent perpétuellement par leur humeur turbulente et guerrière.
Plus tard, ce furent les Vascons, qui, à Roncevaux, firent subir à l'arrière-garde de Charlemagne, revenant d'Espagne, la fameuse défaite où périt Roland. Louis le Débonnaire, successeur de Charlemagne, vengea cette défaite au lieu même où son père avait été surpris par les Vascons et où ceux-ci lui avaient à lui-même tendu une nouvelle embuscade. Après de nouvelles guerres contre ces peuplades insoumises, l'empereur franc fait bannir le duc de Vasconie, Loup Centulle, et un peu plus tard donne le pays de Béarn à un frère du dernier duc. Ce n'est pourtant qu'en 905 que nous voyons commencer la maison des vicomtes de Béarn, vassaux du comte de Gascogne ; le premier d'entre eux fut Centulle Ier.
L'histoire des premiers vicomtes de Béarn, qui, tous, portent le nom de Centulle, présente peu d'intérêt : leur turbulence guerroyante à l'égard de leurs voisins, leur dévotion et leur libéralité envers les monastères, voilà tout ce qu'on peut signaler dans cette période. L'un d'eux cependant, Centulle III, se montra moins généreux que les autres envers les moines. « Aussi, dit la chronique de Lescar, fut-il blessé et mourut-il de ses blessures, Dieu merci ! »
Un cartulaire du temps constate un jugement rendu sous lui, et qui peint l'époque : les moines de Saint-Pée réclament l'héritage de Guillaume Fel, qui, selon eux, leur en avait fait donation. Les enfants de Fel le contestent et redemandent leur patrimoine. Tout se termine par un duel judiciaire ; le champion du couvent est vainqueur, et, en conséquence, les enfants de Fel sont dépouillés de l'héritage paternel. Nous voyons encore un fait assez curieux dans le testament de Raymond, second fils de Centulle III : il lègue au même monastère un paysan, qui ne devait cesser de leur appartenir que si le vicomte de Béarn jugeait à propos de le racheter ; le prix du rachat est déterminé : trois cents sols.
Centulle III avait commencé l'émancipation de sa vicomté et agrandi ses domaines. Aussi, après avoir enlevé au vicomte d'Acqs deux hameaux, ce baron gascon se qualifie-t-il pompeusement dans une charte de grand dominateur de la terre, magnus dominator terrae. Sous son petit-fils, Centulle IV, le duc d'Aquitaine, pour récompenser quelques services qu'il en avait reçus, fit remise au vicomte de Béarn de tous devoirs de vassalité. Centulle IV bâtit ou embellit quelques villes.
Gaston IV (1088) se signala par son courage chevaleresque à la croisade en Orient et contre les Maures ; mais la postérité lui doit plus de reconnaissance pour le libéralisme qui respire dans ses institutions. Avant Louis le Gros, il donna un exemple d'affranchissement communal : Morlaàs fut par lui déclarée ville libre. Par ses autres institutions, il établit l'ordre dans ses États, et protégea le faible contre le fort. Il fonda des hôpitaux, et s'occupa surtout d'arrêter les progrès de la lèpre, maladie affreuse que les croisés avaient rapportée d'Orient.
On sépara les lépreux de la société ; ils eurent en Béarn, dans chaque commune, des maisons isolées ; il leur était défendu d'en sortir, et ils y vivaient seuls. On leur permettait cependant d'assister aux exercices religieux dans les églises ; mais ils y entraient par une porte réservée pour eux seuls ; ils avaient en particulier un bénitier, une place, et jusqu'à un cimetière, afin que, même après leur mort, ils n'eussent rien de commun avec leurs concitoyens. On ne les admettait point dans les armées, et on ne leur permettait point d'exercer aucun autre métier que ceux auxquels on travaille en plein air. La lèpre était regardée comme une punition infligée directement par la main de Dieu ; c'est ce qu'on appelait un mal sacré. Les ecclésiastiques, déjà chargés du soin des pauvres, devinrent aussi les tuteurs des lépreux.
Gaston IV, que son ardeur belliqueuse avait entraîné en Espagne dans une croisade contre les Maures, y fut tué dans une embuscade. Son corps, porté à Saragosse, y fut inhumé dans l'église de Notre-Dame del Pilar ; on y montre encore aujourd'hui son cor et ses éperons, et les historiens espagnols s'accordent à célébrer sa bravoure et les services qu'il a rendus à leur pays. Il avait reçu de ses alliés le titre de vicomte et de pair d'Aragon.
Les successeurs de Gaston IV n'ont point marqué dans l'histoire, et sa famille ne tarda pas à s'éteindre. Marie, seule héritière de cette maison, fait hommage, pour sa principauté, à Alphonse d'Aragon, sous la tutelle duquel elle vivait encore, et se laisse imposer par lui une union avec Guillaume de Moncade, né d'une des premières familles de Catalogne (1170). Le Béarn se trouvait ainsi lié à l'Espagne et détaché de la France ; mais l'hommage que le nouveau seigneur fit au roi d'Aragon alarma l'humeur fière et indépendante des Béarnais ; ils le déposèrent, et déclarèrent le trône vacant. Ils élurent pour souverain un chevalier du Bigorre ; mais celui-ci, n'ayant point respecté leurs privilèges, fut tué par eux au bout d'un an.
Même sort était réservé à son successeur, venu d'Auvergne, et qui offensa par son orgueil la fierté des Béarnais. La cour de Béarn le fit tuer d'un coup de pique par un écuyer sur le pont de Saranh. Alors, dit une ancienne pièce dont la copie (du XIVe et du XVe siècle) est conservée aux archives de Pau, alors les Béarnais entendirent parler avec éloge d'un chevalier de Catalogne, lequel avait deux fils jumeaux. Les gens du Béarn tinrent conseil, et envoyèrent deux prud'hommes lui demander pour seigneur un de ces enfants. Arrivés en Catalogne, ils allèrent les voir, et les trouvèrent endormis : l'un tenait les mains ouvertes, l'autre les tenait fermées.
Ils choisirent le premier, parce que ses mains ouvertes annonçaient qu'il serait libéral. Ce prince de trois ans, si singulièrement choisi, régna sur eux sous le nom de Gaston VI. Sa famille prit le nom de Moncade. Avec lui commença la seconde dynastie des seigneurs du Béarn.
Malgré sa libéralité envers les églises, Gaston VI fut excommunié comme albigeois. Sa soumission, ses protestations pacifiques ne purent lui faire obtenir grâce de Simon de Montfort, l'ambitieux et terrible capitaine chargé d'exécuter les sentences fulminées par le pape Innocent III. Gaston, obligé de se défendre, réunit ses troupes à celles de ses voisins excommuniés comme lui. Vaincu à Muret par Simon de Montfort, il rentra pourtant dans le sein de l'Église, et fut relevé de son excommunication par l'évêque d'Oloron, qui lui accorda sa grâce en échange des seigneuries de Sainte-Marie et de Catron. A la mort de Gaston, en 1215, les Béarnais lui donnèrent pour successeur son frère, Guillaume-Raymond.
Ce prince, dont la jeunesse avait été violente et orageuse, se montra un habile législateur. Sous lui fut établie une cour de justice composée de douze jurats : cette charge était héréditaire, et devint très importante. A ceux qui la remplissaient fut réservé bientôt le titre de baron à l'exclusion des autres gentilshommes.
Sous ses successeurs, dont l'histoire est insignifiante, le Béarn s'agrandit sans bruit par des héritages et des mariages avec des familles royales. C'était l'époque de la lutte entre l'Angleterre et la France ; ils prirent parti contre les Anglais, qui jamais ne franchirent la frontière de leurs États. Le dernier prince de la famille de Moncade, Gaston VII, se voyant mourir sans 'enfants mâles, choisit pour successeur son gendre, le comte de Foix ; mais les Béarnais exigèrent que leur pays restât distinct du comté de Foix, et Roger-Bernard, leur nouveau souverain, vint fixer sa cour à Orthez, la capitale des derniers princes de la maison de Moncade. C'est ici que commence la période la plus éclatante de l'histoire du Béarn.
Le plus illustre de ses princes fut Gaston Phoebus (1343), renommé en son temps parmi tous les chevaliers de la chrétienté pour sa beauté, sa bravoure et sa courtoisie envers les dames, « grand clerc d'ailleurs en fait de lettres, aimant les dons de ménétriers et s'y connoissant, et faisant lui-même des vers. » A quinze ans, Gaston fit ses premières armes contre les Maures d'Espagne. Il épousa Agnès de Navarre, soeur de Charles le Mauvais ; mais, loin de tremper dans les intrigues de son beau-frère, il défendit ses États contre les Anglais, refusant d'ailleurs de rendre hommage au roi de France pour le Béarn, et déclarant qu'il ne devait hommage qu'à Dieu.
Il fut le premier des souverains du Béarn à qui les états accordèrent des subsides ; ce qui en fit un riche seigneur. Il se lança dans les aventures et parcourut les pays étrangers. Il revenait, dit Froissart, en compagnie du captal de Buch, d'une croisade contre les païens de la Prusse, et était arrivé à Châlons en Champagne, lorsqu'il y apprit la pestilence et l'horribleté qui couroit alors sur les gentilshommes. C'était l'insurrection de la Jacquerie ; et les paysans, exaspérés par de longs siècles de misères et de cruautés, s'abandonnaient à d'affreuses représailles.
Un grand nombre de dames s'étaient réfugiées à Meaux, déjà menacé par les Jacques. Gaston Phoebus et le captal de Buch y courent ; la ville est déjà envahie. Ils pouvaient être quarante lances et non plus ; ils n'entreprirent pas moins de déconfire et de détruire ces vilains. Ce qui diminue un peu la valeur de leur résolution, c'est que, comme ajoute Froissart, les vilains estoient noirs et petits, et très mal armés, tandis que les chevaliers, couverts de fer, eux et leurs chevaux, des pieds à la tête, étaient à peu près invulnérables.
Ils se ruèrent sur les paysans et n'eurent qu'à tuer. « Ils les abattoient à grands monceaux, dit le chroniqueur, et les tuoient ainsi que bestes, et en tuèrent tant qu'ils en estoient tous lassés et tannés, et les faisoient saillir en la rivière de Marne. Finalement ils mirent à fin en ce jour plus de sept mille, et boutèrent le feu en la désordonnée ville de Meaux, et l'ardirent toute, et tous les vilains du bourg qu'ils purent dedans enclore. »
Animés par cette facile boucherie, les chevaliers poursuivirent les vilains, brillant et égorgeant sans merci, et dévastant le pays mieux que ne l'eussent pu faire les Anglais ; ce qui ne leur en attira pas moins beaucoup de gloire et un grand renom par toute la chrétienté.
Gaston, de retour dans ses États, eut à soutenir contre des seigneurs révoltés ou des voisins belliqueux des guerres plus difficiles. Il vainquit et fit prisonniers le sire d'Albret et le comte d'Armagnac ; il se réconcilia avec ce dernier, dont la fille fut fiancée au fils de Gaston. Gaston devint bientôt un très redouté seigneur, riche et fastueux, aimant les fêtes et les tournois ; la chasse, son plaisir favori, prenait une partie de son temps, et il entretenait une meute qui, dit-on, ne comprenait pas moins de seize cents chiens. Froissart, bien accueilli et choyé à la cour d'Orthez, ne tarit pas d'éloges sur ce prince, qui, en bien comme en mal, doit être cité comme un des types les plus caractérisés des temps féodaux.
Malgré sa courtoisie, des crimes, abominables même pour l'époque, souillèrent la mémoire de ce prince : il tua son frère naturel, Pierre Arnaud, attiré dans un guet-apens. Son jeune fils, touché du délaissement où Gaston tenait sa mère, reçut, un jour de Charles le Mauvais, son oncle, le conseil de jeter dans les aliments de sou père une certaine poudre qu'on lui donna, et qui devait rendre à sa mère tout l'amour de son mari. Le crédule enfant tente l'expérience ; la poudre était du poison. Son père demande vengeance aux états, qui essayent vainement de protéger contre le vicomte de. Béarn ce fils qu'ils regardent comme innocent.
Voici comment Froissart raconte la mort de l'enfant. Après avoir dit que le fils de Gaston, dans sa douleur, refusait de manger, et que les serviteurs du comte vinrent l'en prévenir, le chroniqueur ajoute : « Le comte, sans mot dire, se partit de sa chambre, et s'en vint vers la prison où son fils estoit ; et tenoit à la malheure un petit long couteau, dont il appareilloit ses ongles et nettoyoit. Il fit ouvrir l'huis de la prison, et vint à son fils ; et tenoit la lame de son couteau par la pointe, et si près de la pointe, qu'il n'y en avoit pas hors de ses doigts la longueur de l'épaisseur d'un gros tournois. Par maltalent, en boutant ce tant de pointe en la gorge de son fils, il l'assena ne sait en quelle veine, et lui dit : Ha ! traiteur, pourquoi ne manges-tu point ? Et tantôt s'en partit le comte sans plus rien dire ni faire, et rentra en sa chambre. L'enfant fut sang mué et effrayé de la venue de son père, avec cela qu'il estoit foible de jeûner, et qu'il vit ou sentit la pointe du couteau qui le toucha à la gorge comme petit fust, mais ce fust en une veine ; il se tourna d'autre part, et là mourut... Son père l'occit voirement, mais le roi de Navarre lui donna le coup de la mort. » Gaston n'avait pas d'autre enfant légitime ; il ne lui restait que deux bâtards.
D'ailleurs, il administrait ses États avec vigilance et habileté, et fut prud'homme en l'art de régner. Quand Froissart le vit à Orthez, « le comte Gaston de Foix avoit environ cinquante-neuf ans d'âge. Et vous dis que j'ai en mon temps vu moult chevaliers, rois, princes et autres ; mais je n'en vis oncques nul qui fut de si beaux membres, de si belles formes, ni de si belle taille, et visage bel, sanguin et riant, les yeux vairs et amoureux, là où il lui plaisoit son regard asseoir. De toutes choses il estoit si très parfait qu'on ne le pourroit trop louer. Il aimoit ce qu'il devoit aimer, et haïssoit ce qu'il devoit haïr. Sage chevalier estoit, et de haute emprise et plein de bon conseil. Il disoit en son retrait planté d'oraisons, tous les jours une nocturne du psaultier, heures de Notre-Dame, du Saint-Esprit, de la Croix et vigiles des morts, et tous les jours faisoit donner cinq francs en petite monnoie pour l'amour de Dieu, et l'aumône à sa porte à toutes gens.
« Il fut large et courtois en dons, et trop bien savoit prendre où il appartenoit, et remettre où il afféroit ; les chiens sur toutes bètes il aimoit, et aux champs, été ou hiver, aux chasses volontiers estoit. D'armes et d'amour volontiers se déduisoit.... Briefvement, tout considéré, ajoute Froissart, avant que je vinsse en cette cour, j'avois été en moult cours de rois, de ducs, de princes, de comtes et de hautes clames ; mais je ne fus oncques en nulle qui mieux me plut. » Évidemment, l'enthousiasme du bon Froissart se ressentait un peu de la générosité de Gaston Phoebus envers les étrangers ménétriers.
Le comte de Foix mourut subitement d'apoplexie au retour d'une chasse à l'ours (1390). Nous lui devons le livre intitulé : Phébus, des déduiz de la chasse des bestes sauvaiges et des oiseaux de proye, au début duquel il prend Dieu, la Vierge Marie et la sainte Trinité à témoin que pendant toute sa vie « il s'est délité par espécial en trois choses, l'une est en armes, l'autre est en amours, et l'autre si est en chasse. » Ce livre est encore de nos jours un des traités les plus complets de vénerie.
Son cousin, Matthieu de Castelbon, lui succéda, et mourut sans enfants ; en lui s'éteignit la ligne masculine de la maison de Foix. Sa soeur, Isabelle, qui lui succéda, épousa Archambault de Grailli, captal de Buch, qui prit le nom de Foix. Ses descendants n'ont joué aucun rôle important jusqu'au jeune et vaillant Gaston de Foix, duc de Nemours, le compagnon d'armes de Bayard, qui fut tué à l'âge de vingt-trois ans, en 1512, à la bataille de Ravenne, en poursuivant les ennemis qu'il venait de vaincre.
Le mariage d'un de ces princes avec l'héritière du royaume de Navarre avait augmenté la puissance de cette maison ; mais le duc d'Albe, au nom de Ferdinand le Catholique, enleva aux comtes de Béarn la plus grande partie de ce royaume, et les réduisit à la basse Navarre. A la maison de Foix avait succédé celle d'Albret (1500), dont un des membres, Jean II, avait épousé Catherine de Foix. Henri d'Albret, son fils, combattit vaillamment à Pavie aux cotés de François Ier ; fait prisonnier avec lui, il reçut après sa délivrance le prix de son dévouement en épousant la sœur du roi, la brillante Marguerite, si connue par l'élégance de son esprit, et qui nous a laissé dans ses contes une fidèle peinture des mœurs licencieuses de cette époque.
Jeanne d'Albret (1555), fille de Henri, épousa Antoine de Bourbon. Ce prince, après avoir embrassé le calvinisme, l'abjura ; sa femme, au contraire, quitta le catholicisme, et demeura inébranlable dans sa nouvelle religion. Marguerite de Navarre avait déjà favorisé le calvinisme ; Jeanne, devenue seule souveraine du pays depuis la mort de son mari tué au siège de Rouen, établit en Béarn l'exercice public du culte réformé.
Protestante rigide, elle honore ses convictions par ses vertus, par l'élévation de son esprit et de son coeur ; elle le propage avec ardeur au moyen de ministres instruits. Le pape fait afficher un décret du saint office sommant Jeanne de comparaître en personne comme suspecte d'hérésie, et prononçant en cas de refus la confiscation de ses domaines ; la cour de France obtint du pape qu'il suspendît la publication de ce décret.
Mais Jeanne ayant fourni des secours au prince de Condé, chef des protestants, Charles IX fait déclarer Jeanne rebelle et prononcer la confiscation de ses terres par le parlement de Bordeaux. Le féroce Blaise de Montluc est chargé d'exécuter l'arrêt ; il marche sur le Bigorre, tandis que son lieutenant Terride répand la terreur dans le Béarn. Le sire de Terride s'empare de Pau, et convoque les états, qui protestent contre l'envahissement du pays.
Mais Jeanne a réuni une armée ; le terrible Montgomery en est le chef, il envahit le Béarn, le reconquiert en quinze jours, et exerce d'affreuses représailles. Maître des dix principaux chefs catholiques qui s'étaient enfermés avec Terride dans le fort Moncade, et qu'il amène à capituler en leur promettant la vie sauve, il les fait poignarder au mépris de la foi jurée : Terride seul échappe, on ne sait comment. Jeanne rentre dans ses États et y rétablit la foi protestante.
Elle commit, comme la plupart des chefs de la religion réformée, l'imprudence de se fier aux avances de ses ennemis ; elle se laissa entraîner à la cour de Charles IX par Catherine de Médicis, qui lui proposait le mariage de sa fille avec le prince de Béarn (depuis Henri IV). Jeanne se rend à Paris, et meurt peu de temps après, empoisonnée, dit-on. « C'estoit, dit Agrippa d'Aubigné, une femme n'ayant de femme que le sexe, l'âme en fière aux choses viriles , I'esprit puissant aux grandes affaires, le cour invincible aux grandes adversités. » Elle fut la mère de Henri IV.
Nous n'avons pas à raconter la vie de ce prince, dont l'histoire appartient moins au Béarn qu'à la France. Rappelons seulement ce qui se rapporte plus particulièrement à son pays natal. Henri rétablit en Béarn la religion catholique, dont sa mère avait proscrit l'exercice public après l'invasion de ses États par les troupes du roi Charles IX.
Les états rassemblés à Pau protestent contre l'édit du roi, et de nouveaux désordres ensanglantent le pays. Mais bientôt, après le massacre de la Saint-Barthélemy, Henri révoque l'édit, et vient visiter ses États avec sa femme Marguerite de Valois. Il donne aux Béarnais pour régente sa sœur Catherine, qui réussit à s'en faire aimer. Devenu roi de France, Henri s'occupa du Béarn, flatta ses premiers sujets au point de leur dire qu'il avait « donné la France au Béarn, et non le Béarn à la France." C'est dans ces paroles, comme en beaucoup d'autres, qu'on reconnaît la vérité du jugement de d'Aubigné sur lui : « C'estoit le plus rusé et madré prince qu'il y eut jamais. » Sa mort fut sentie en Béarn plus vivement qu'en aucun lieu de la France.
Louis XIII, malgré la résistance des états, réunit la Navarre et le Béarn à la couronne de France, ce que son père n'avait osé tenter. L'opposition fut si vive, que le roi jugea à propos d'aller lui-même à Pau, détruisit l'ancienne organisation du pays, supprima les conseils souverains de Béarn et de basse Navarre, et établit un parlement unique siégeant à Pau. Il laissa cependant au pays ses états, qui, du reste, ne se réunirent plus que pour voter l'impôt.
Depuis cette époque, le Béarn n'a plus joué un rôle distinct dans notre histoire. Seulement, au commencement de la Révolution, les Béarnais, inspirés par un étrange esprit de patriotisme local, hésitèrent à nommer des députés à l'Assemblée constituante ; ils finirent pourtant par s'y décider, mais continuèrent à montrer un esprit hostile à la Révolution. Chose non moins extraordinaire, aucune réaction violente ne vint, de la part des révolutionnaires, châtier un pays si mal disposé, et le Béarn, qui avait paru songer un moment à se reconstituer en un pays indépendant, se laissa tranquillement enclaver dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Aux annales du Béarn succède l'histoire du département dans lequel il a été incorporé, et les événements dont il a été le théâtre participent à 1a grandeur de la nouvelle patrie. Le mot historique : « Il n'y a plus de Pyrénées » n'a pas toujours été un oracle de paix depuis l'union des deux branches de la famille de Bourbon. La cour de Madrid manifesta des intentions hostiles contre la Révolution ; mais l'établissement d'un camp au pied des Pyrénées, quelques démonstrations vigoureuses, et l'influence des victoires des armées républicaines sur les autres frontières, imposèrent à l'Espagne sa neutralité à défaut de sympathie.
Les Pyrénées furent franchies par les armées de Napoléon Ier qui, pour assurer le succès de son rêve continental, voulait avoir un membre de sa famille sur le trône des héritiers de Philippe V. L'intervention de l'Angleterre venant en aide aux résistances nationales, les Pyrénées virent reculer pour la première fois nos aigles victorieuses. Une sorte de revanche fut prise sous la Restauration, lors qu'un arrière-neveu de Philippe V, le duc d'Angoulême, alla défendre le trône bourbonien menacé par la junte insurrectionnelle de Cadix, se contentant des stériles exploits du Trocadéro.
Depuis lors, les échos des Pyrénées n'ont été réveillés que par des bruits de guerre civile et des brigandages que les autorités françaises ont eu à surveiller et à réprimer, mais sans aucune participation directe. Le mariage de Napoléon III avec une comtesse espagnole ne fut, pour le département, l'occasion d'aucune faveur spéciale ; il y gagna toutefois, au cours du règne, des embellissements et des libéralités pour quelques localités visitées ou affectionnées par l'épouse du souverain.
Les départements et leur histoire - Puy-de-Dome-63-
Le département du Puy-de-Dôme occupe environ les trois cinquièmes de l'ancienne province d'Auvergne, dont le Cantal, une partie de la Haute-Loire, de la Creuse et de la Corrèze complètent la circonscription.
Ce pays était occupé lors de l'invasion romaine, par une des plus puissantes tribus de l'ancienne Gaule, les Arvernes (ar, haut ; verann, habitation), dont la domination ou l'influence s'étendait depuis le Tarn et les Cévennes jusqu'au cours supérieur de l'Allier, du Cher et de la Creuse, et depuis la Vezère et la Corrèze jusqu'à la haute Loire. Ils avaient pour clients les Vellavi (Velay), les Gabali (Gévaudan), les Rutheni (Rouergue), et pour alliés les Cadurci (Quercy), le dernier peuple de la Gaule qui subit la domination romaine. Le roi des Arvernes pouvait lever deux cent mille combattants et tenir en échec les puissantes tribus des Éduens, des Séquanes et des Bituriges.
La capitale de l'Arvernie était Gergovia (près de Romagnat, à 6 kilomètres au sud de Clermont), dont le nom disparaît de l'histoire après l'héroïque défense de Vercingétorix. Après sa destruction, il n'est plus question que de Nemetum ou Nemossus (aujourd'hui Clermont), qui s'élevait dans le voisinage de Gergovie.
Nous ne savons rien des événements dont ce pays a été le théâtre pendant la domination gauloise. Des guerres de peuplade à peuplade, des incursions sur des territoires peu ou point limités, des alliances conclues ou rompues, le tout sans résultats politiques importants, sans noms historiques, sans chronologie ; voilà ce que nous connaissons des Arvernes, comme de leurs voisins, avant l'arrivée des légions romaines.
Leur nom figure parmi ceux des tribus gauloises qui, dès l'an 150 de Rome, vinrent, sous la conduite de Bellovèse et de Sigovèse, s'établir dans le nord de l'Italie, appelé, de cette invasion, Gaule cisalpine. Luer, Luern ou Luérius est le premier roi dont il est fait mention ; il régnait vers l'an 130 avant notre ère ; il s'est rendu célèbre par sa magnificence et ses libéralités. Son fils Bituit s'est fait un nom illustre parmi les chefs de la Gaule ; avec lui commence l'histoire de l'Arvernie, c'est-à-dire l'histoire de la décadence et de l'asservissement de sa nation.
Les Romains avaient pénétré jusque chez les Allobroges (Savoie et Dauphiné) ; la conquête de ce territoire devenait pour les Arvernes une menace imminente d'invasion. Bituit offrit sa médiation ; il envoya au consul Domitius Abenobarbus une ambassade qui lui permit d'étaler aux yeux des austères conquérants toute la pompe d'un roi barbare, mais qui n'eut aucun résultat. Il se hâta d'appeler aux armes sa nation et ses clients, et leva une armée qu'on n'évaluait pas à moins de deux cent mille hommes. Mais il n'arriva que pour assister à la défaite de ses alliés ; tout ce qu'il put faire, ce fut d'empêcher les vainqueurs de poursuivre momentanément leurs succès.
Il ne les arrêta pas longtemps. Le consul Fabius Maximus vint amener à son collègue un renfort de vingt mille hommes. Bituit se porta au-devant de l'ennemi, franchit le Rhône et offrit la bataille (121 avant J.-C.). Plein de confiance dans le nombre de ses soldats, il regardait avec mépris cette poignée d'envahisseurs qui se proposait de dicter des lois à une grande nation. « Il n'y a pas là de quoi nourrir mes chiens, » disait-il dans son orgueilleux dédain.
Cependant la tactique parut un instant céder au nombre. Fabius fit alors charger les éléphants. C'était la première fois que les Arvernes se trouvaient en présence de pareils ennemis. La panique se mit dans les rangs ; ce fut un sauve-qui-peut général ; on compte qu'il périt, tant sous le fer de l'ennemi que dans les eaux du Rhône, plus de cent vingt mille hommes. Ce chiffre, quelque énorme qu'il soit, ne paraîtra pas exagéré, du moins quant à la proportion des morts sur le nombre des combattants, si l'on songe qu'à cette époque les batailles se terminaient presque par l'extermination de l'armée vaincue, témoin la défaite des Cimbres et des Teutons par Marius.
Bituit, assez heureux pour échapper au massacre, s'enfuit dans les montagnes, laissant au vainqueur son char et ses trésors. A quelque temps de là, Domitius l'attira dans une entrevue, sous prétexte de propositions de paix, et le fit traîtreusement prisonnier. L'infortuné Bituit fut envoyé à Rome pour figurer dans la solennité des honneurs du triomphe décernés à ses vainqueurs. Il mourut à Albe. Son fils Congentiat, amené également à Rome, où le sénat avait promis de le faire instruire, disparut, sans que l'on sût jamais ce qu'il était devenu. Malgré la grandeur d'un tel échec, les Arvernes ne furent point traités en peuple conquis. Les Romains n'étaient pas encore en mesure de se maintenir dans le pays.
Bituit n'eut point de successeur. La nation resta constituée en une sorte de république, sans chef prépondérant, et Celtill, pour avoir aspiré à la royauté, fut mis à mort par ses concitoyens.
Ce fut vers l'an 58 avant J.-C. que César pénétra dans les Gaules. Il venait au secours des Éduens, menacés de dépossession par les Helvètes et les Germains d'Arioviste. En quelques mois, le général romain refoula les envahisseurs dans leurs montagnes et au delà du Rhin, avec des pertes considérables. Mais, au lieu d'un allié, les Éduens avaient amené un maître.
La prodigieuse activité par laquelle César soumit, en quelques années, toute la Gaule et la Grande-Bretagne fera l'éternel étonnement de l'histoire. Cependant, si l'on considère que, dans leurs guerres de tribus à tribus et de nation à nation, il s'agissait, entre barbares, non d'une question de prédominance, mais de la possession même du sol, on sera moins surpris de la facilité avec laquelle les Gaulois subirent la domination romaine, qui leur laissait leurs champs, leurs villes, une partie de leurs institutions, et ne leur imposait qu'un tribut et une garnison.
C'était la civilisation instruisant la barbarie. Aussi, le héros romain est-il populaire chez ceux mômes qu'il vient de soumettre. Toutefois, ce travail d'éducation est avant tout l'oeuvre du temps, et avant qu'il ait porté ses fruits, les puissances déchues n'ont pas renoncé à ressaisir leur influence. Si la masse, qui n'a fait que changer de maîtres, accepte une autorité qui s'annonce d'abord par des bienfaits, les chefs, les bardes, les prêtres, les grands feront appel à tous les sentiments de religion, de patrie, d'indépendance, afin d'entraîner les peuples à la révolte et de ressaisir leur suprématie.
Le retour de César en Italie et son séjour prolongé à Rome parurent aux Gaulois une occasion favorable de prendre l'offensive. Les Arvernes, qui avaient subi sans trop de résistance la conquête, se trouvent cette fois les meneurs de l'insurrection nationale. Vercingétorix, qu'ils viennent de placer à leur tête, devient le chef de tous les confédérés. Ce n'était plus une révolte que les Romains avaient à combattre, mais le soulèvement général d'un peuple, jusque-là divisé, mais uni cette fois contre l'ennemi commun, et résolu, pour l'affamer, à ne laisser derrière lui que la ruine et la mort.
A la nouvelle des événements, César quitte brusquement l'Italie, franchit les Alpes Maritimes et parait tout à coup sur le territoire des Arvernes, brûlant et saccageant tout, afin de faire un exemple et de contenir les populations par la terreur des représailles. Vercingétorix était alors chez les Bituriges avec son armée. Il revient à la hâte défendre son pays. Déjà le général romain, laissant un détachement sous les ordres de son lieutenant Brutus, est allé rejoindre ses légions cantonnées au pays des Lingons. Il reparaît à la tête de nouvelles forces en Arvernie et vient mettre le siège devant Gergovia. Mais la résistance des assiégés et le soulèvement des Eduens l'obligent à la retraite.
Encouragé par le succès, Vercingétorix poursuit l'armée romaine jusque hors de son territoire, sur les bords de la Saône ; malheureusement, il a l'imprudence d'offrir la bataille. Ce n'était pas la bravoure qui manquait aux Gaulois. Aussi la mêlée fut-elle des plus sanglantes. Cependant le nombre dut céder encore à la tactique, et le chef arverne fut trop heureux d'échapper au massacre avec quelques débris de son armée.
La défaite n'abattit pas ses espérances ; il réussit à rallier quatre-vingt mille hommes et s'enferma dans Alésia (Alise), une des forteresses les plus redoutables de la Gaule. La résistance ne fut pas moins opiniâtre qu'à Gergovie ; mais Alésia fut forcée de se rendre, et Vercingétorix, fait prisonnier, fut envoyé à Rome et lâchement assassiné dans sa prison six ans plus tard. Ce fut le dernier effort de l'indépendance. A dater de ce moment (l'an 705 de Rome), et jusqu'à l'invasion des barbares, la Gaule n'est plus qu'une province de l'empire.
Les Romains, cruels jusqu'à la lâcheté envers leurs ennemis, comme on l'a vu par l'exemple de Bituit et de Vercingétorix, ne s'occupaient plus, après la victoire, que des moyens de s'attacher les vaincus. Comprise dans la Gallia comata (Gaule chevelue), Nemetum, la nouvelle capitale de l'Arvernie, eut son capitole, son sénat, ses monuments, ses écoles.
En reconnaissance des bienfaits d'Auguste, elle voulut s'appeler Augusto-Nemetum. Elle eut bientôt des savants, des artistes, des orateurs dont la réputation ne le céda en rien à ceux de la métropole : Marcus Cornélius Fronton, professeur d'éloquence, atteignit une telle célébrité qu'il fut mandé à Rome, où il devint l'instituteur et l'ami de Marc-Aurèle ; plus tard, nous trouvons les Avitus, Sidoine Apollinaire, etc.
Le christianisme ne commença d'être prêché aux Arvernes que vers l'an 250. L'Église a consacré le souvenir des premiers apôtres de ce pays : saint Austremoine, saint Alyre, saint Népotien, saint Rustique, saint Éparque. Elle tient également en vénération la mémoire du sénateur Injuriosus, qui vécut avec sa femme dans une perpétuelle continence et dont l'histoire se trouve rapportée au long dans Grégoire de Tours.
Malgré ses montagnes et les fortifications naturelles dont elle se trouve protégée, l'Arvernie ne fut point à l'abri des incursions des barbares. Elle fut ravagée tour à tour par les Vandales, les Mains, les Suèves ; Crocus, chef d'une de ces bandes, pénétra jusqu'à Nemetum et détruisit le fameux temple de Wasso, l'une des merveilles de l'antiquité.
Les Huns y passèrent à leur tour (439). Trop faibles pour résister à l'invasion, les empereurs romains avaient cru prudent de lui faire sa part. Dès 419, Honorius avait cédé l'Aquitaine aux Wisigoths. En 475, Népos dut acheter quelques moments de trêve en leur cédant encore l'Auvergne, où ils avaient déjà fait une incursion l'année précédente. Ils la gardèrent trente-deux ans ; et, après la bataille de Vouillé, qui leur fit perdre toutes leurs possessions des Gaules, l'Auvergne passa sous la domination des rois francs, comme partie du royaume d'Austrasie (507). Thierry, fils de Clovis (511-534) fut obligé de reconquérir cette partie de ses États sur Childebert, roi de Paris, qui, pendant que son frère était occupé au delà du Rhin, s'était emparé de Clermont.
Le règne de Théodebert (534-547) et celui de Théodebald (547-553) permirent aux Auvergnats de réparer les désastres des invasions précédentes. Clotaire Ier, roi de Soissons et bientôt après de toute la monarchie franque, confia le gouvernement de l'Auvergne à son fils Chramne, dont la révolte ramena encore une fois les fléaux de la guerre sur cette province. Vaincu par ses frères Caribert et Gontran, le nouvel Absalon périt au milieu des flammes (560).
L'Auvergne, ravagée encore une fois en 573 par les Saxons, fut comprise dans le royaume d'Aquitaine, fondé en 630 par Dagobert en faveur de son frère Caribert. Pendant un siècle et demi, les annales se taisent sur les événements politiques de cette contrée. A défaut de chefs de hordes, promenant après eux le pillage et l'incendie, elles conservent les noms de quelques bienfaiteurs de la civilisation : saint Gal ; saint Avit, qui fit construire, en 580, l'église du Port ; saint Genès, d'une famille sénatoriale, qui fonda deux monastères et un hospice ; saint Bonnet, grammairien et jurisconsulte ; saint Avit II.
De 730 à 732, invasion des Sarrasins ; de 750 à 768, guerre entre Waïfre, duc d'Aquitaine, et Pépin, chef de la seconde dynastie franque. Nouveaux désastres pour le pays. Clermont est livré aux flammes (761). Au IXe et au Xe siècle, incursions des Normands.
C'est de la domination des rois d'Aquitaine que date la création du comté d'Auvergne, dont les titulaires, d'abord simples gouverneurs amovibles, finirent par se rendre héréditaires. Guillaume le Pieux, le premier comte par droit de succession, succéda à son père Bernard en 886. En 893, Eudes le nomma roi d'Aquitaine. Cependant la suzeraineté du comte de Poitiers fut presque constamment reconnue.
Les Auvergnats, qui avaient subi plutôt qu'accepté l'autorité des Carlovingiens, ne se montrèrent pas moins hostiles aux fondateurs de la troisième race. La déposition de Charles le Simple ne les empêcha point de dater leurs actes par les années de son règne ; et, après sa mort, ils adoptèrent la formule : « Christo regnante, Rege deficiente ; Christ régnant, le roi manquant. »
Au XIe siècle s'arrêtent les incursions des barbares.. Indigènes et conquérants ont fini par trouver place sur le sol. La nouvelle société est en travail d'organisation. Ce sont les beaux jours de la féodalité. En attendant que la puissance royale, confisquant à son profit toutes les suzerainetés secondaires, ne reconnaisse plus dans les provinces que des gouverneurs amovibles, chaque pays, chaque canton va avoir son seigneur.
A côté des comtes d'Auvergne surgissent ceux de Murat, de Carlat, de Thiers, de Mercoeur, de Brioude, etc. Aux seigneuries laïques viennent s'ajouter les fiefs ecclésiastiques : le chapitre de Clermont, l'abbaye de Saint-Austremoine, celles de Mauzac, de Mauriac, d'Aurillac, de La Chaise-Dieu. C'est la guerre civile en germe ; elle ne tardera pas à faire oublier les maux de l'invasion. Toutefois la première croisade, résolue au concile même de Clermont (1095), en réunissant toutes les activités vers un but commun, arrête un instant l'explosion des querelles intestines. Mais, dès 1121, Guillaume VI entre en campagne contre l'évêque, qui appelle à son secours le roi Louis le Gros. Le comte est forcé de céder. Son fils Robert III va à son tour chercher querelle aux chanoines de Brioude.
A sa mort, son fils Guillaume VII le Jeune était en Terre sainte ; son frère puîné, Guillaume VIII le Vieux, s'empara du comté. Les deux compétiteurs en appelèrent à leurs suzerains ; l'oncle s'adressa au roi de France, le neveu au duc d'Aquitaine, qui était alors Henri II, roi d'Angleterre. La querelle des vassaux venait de soulever une question de compétence, il en sortit la guerre entre les suzerains.
Les deux Guillaume s'arrangèrent par un partage, et Guillaume le Jeune devint la souche des comtes de Dauphiné. La guerre n'en continua pas moins entre les rois de France et les rois d'Angleterre. Les ceintes se déclarèrent contre le premier, et Philippe-Auguste fut obligé de reconquérir une à une toutes les places de l'Auvergne (1213). Saint Louis en rendit une partie à Guillaume X (1230).
Le XIIIe et le XIVe siècle nous montrent la bourgeoisie aux prises avec les seigneurs. C'est la lutte des communes pour leur affranchissement, lutte autrement féconde que les querelles des hobereaux et des abbés. Les cités d'Auvergne obtinrent sans trop de résistance leurs franchises, et dès le commencement du XIVe siècle, treize villes avaient leurs représentants aux états provinciaux.
A cette époque, les comtes d'Auvergne semblèrent accepter complètement la suzeraineté royale et ne se signalèrent plus que par leur zèle à servir la couronne. Nous les trouvons avec leurs vassaux et toute la noblesse aux guerres de Flandre et aux combats d'Azincourt, de Crécy, de Poitiers. Citons, en passant, la mort tragique d'un comte de la branche aînée, le templier Gui, brûlé avec Jacques Molay, en 1313.
Le traité de Brétigny vint distraire l'Auvergne de l'administration royale en la constituant en duché-pairie au bénéfice de Jean, troisième fils du roi, à qui ce même traité enlevait le comté de Poitou, cédé aux Anglais. La fin du XIVe siècle fut signalée par les ravages des Anglais, des grandes compagnies et par la révolte des paysans contre leurs seigneurs. Béraud II, dauphin, et Louis II, duc de Bourbon, firent de vains efforts pour arrêter les désordres.
Le XVe siècle vit éclore sous les auspices des ducs de Bourbon, comtes d'Auvergne, deux révoltes contre le pouvoir royal : la première, la Praguerie, comptait parmi ses chefs le dauphin, depuis Louis XI ; la seconde, la ligue du Bien public, était dirigée contre ce même prince devenu roi. Ces deux insurrections trouvèrent peu de partisans chez les Auvergnats ; aussi la couronne en eut-elle bon marché.
En 1510, réunion des trois états de la province, afin de mettre en harmonie les coutumes et le droit écrit et d'arriver à une sorte d'unité de législation. 1533, voyage de François Ier allant au-devant de Catherine de Médicis, fiancée à son second fils Henri ; il passe par l'Auvergne, où on lui offre des fêtes splendides.
Nous arrivons aux guerres de religion. Les doctrines de la Réforme avaient pénétré en Auvergne et y avaient trouvé de zélés partisans. Les supplices et les exécutions ne pouvaient manquer de suivre. En 1548, Jean Brugière, du village de Piernoël, avait été brûlé vif à Issoire ; en 1553, Antoine Magne, d'Aurillac, avait été supplicié à Paris. En 1561, massacre de tous les protestants d'Aurillac. C'était assez de violences pour légitimer la révolte. Les protestants levèrent une armée et battirent les catholiques en 1568. Les succès de chacun des deux partis furent signalés par des atrocités et des supplices. La ville d'Issoire dut à sa qualité de place forte d'être assiégée, pillée et saccagée par les huguenots et par les catholiques.
L'Auvergne ne sortit des troubles religieux que pour tomber dans ceux de la Ligue. Les rebelles avaient à leur tête, dans cette province, Louis de La Rochefoucauld, comte de Randon, gouverneur du pays, et son frère François, évêque de Clermont. La population résista tant qu'elle put à l'entraînement des partis. Mais la guerre n'en dévasta pas moins la contrée, et ce fut encore la malheureuse ville d'Issoire qui en paya les frais. Les royalistes s'en emparèrent en 1590, le jour même où Henri IV gagnait la bataille d'Ivry. Ce fut la ruine de la Ligue.
En 1606, l'Auvergne se trouve définitivement réunie à la couronne ; nous résumons ici les mutations qu'elle a subies jusqu'à cette époque. Nous avons parlé du partage qui eut lieu vers 1155 entre Guillaume VII et Guillaume VIII. Le Dauphiné d'Auvergne resta dans la famille de Guillaume VII jusqu'en 1436 ; à cette époque, il passa dans la maison de Bourbon-Montpensier, par la mort de Jeanne, femme de Louis de Bourbon, décédé sans postérité.
Le comté d'Auvergne proprement dit subit encore un démembrement. Gui II, troisième successeur de Guillaume VIII, était en guerre avec son frère, l'évêque de Clermont. Ce dernier appela à son secours le roi de France Philippe-Auguste. Le comte, vaincu, fut dépouillé de son titre, dont fut investi Gui de Dampierre. La famille du nouveau seigneur s'éteignit en la personne de son fils. Le comté, réuni à la couronne, fut de nouveau constitué en apanage, en 1225, par Louis VIII, et divisé en deux parts : la plus considérable, érigée en duché, fut donnée à Alphonse, comte de Poitou, second fils du roi ; l'autre fut rendue par saint Louis à Guillaume X, fils de Gui II, dépossédé par Philippe-Auguste.
Le duché, réuni à la couronne à la mort d'Alphonse, reconstitué au bénéfice de Jean de France, duc de Berry, fut cédé, en 1416, à la maison de Bourbon, déjà maîtresse du Dauphiné. La confiscation des biens du connétable (26 juillet 1527) fit rentrer à la couronne ces deux fiefs importants. Quant au comté rendu à Guillaume X, il resta dans la mémo famille jusqu'en 1505. A cette époque, Jeanne,. héritière de Jean III, se voyant sans postérité, légua ses biens à Catherine de Médicis, sa nièce par son mariage avec Henri II.
Le comté échut par héritage à Marguerite de Valois, soeur de Henri III et première femme de Henri IV. Elle en fit don au dauphin, depuis Louis XIII (1606), et l'annexion de toute la province à la couronne se trouva complète.
L'histoire de l'Auvergne se confond, à dater de ce moment, dans l'histoire générale. Nous devons mentionner la tenue des Grands-Jours à Clermont, en 1665. Les guerres de religion et les troubles de la Fronde causèrent de grands désordres en Auvergne et dans le centre de la France ; l'autorité royale y était méconnue, et la plupart des nobles et des seigneurs y avaient ramené les tyrannies et les exactions de la féodalité.
Le roi et le parlement s'émurent des plaintes qui leur parvenaient, et, le 31 août 1665, une déclaration royale ordonna la tenue d'une juridiction ou cour, vulgairement appelée les Grands-Jours, dans la ville de Clermont, pour l'Auvergne, le Bourbonnais, le Nivernais, le Forez, le Beaujolais, le Lyonnais, la Combrailles, la Marche et le Berry. Un président au parlement, Potier de Novion, un maître des requêtes, Caumartin, seize conseillers, un avocat général, Denys Talon, et un substitut du procureur général furent désignés pour tenir ces assises extraordinaires.
Leurs pouvoirs étaient à peu près absolus. L'arrivée des commissaires royaux, de Messieurs des Grands-Jours, comme on les appelait, produisit dans toute l'Auvergne une émotion extraordinaire. Le peuple accueillit les magistrats parisiens comme des libérateurs, et l'on a conservé un remarquable monument de sa joie, c'est le Noël des Grands-Jours. La terreur, au contraire, planait sur les châteaux ; une foule de gentilshommes quittaient la province ou se cachaient dans les montagnes ; d'autres s'efforçaient d'amadouer les paysans, et ceux que avaient été les tyrans des pauvres devenaient leurs suppliants. Fléchier, alors simple abbé, âgé de trente-trois ans, qui accompagnait M. de Caumartin en qualité de précepteur de son fils, a laissé une curieuse relation de son voyage en Auvergne et de ces assises judiciaires.
Le vicomte de La Mothe-Canillac fut condamné à mort et exécuté, ainsi que le sieur de Veyrac ; le marquis Jacques-Timoléon de Montboissier-Canillac, l'Homme aux douze Apôtres ; Gaspard, marquis d'Espinchal ; le comte d'Apchier ; les comtes du Palais, alliés à la maison de Turenne ; le baron de Sénégas, et bien d'autres, furent condamnés par contumace, leurs châteaux furent démolis et leurs biens confisqués.
Il y eut 273 contumaces condamnés au gibet, 96 au bannissement, 44 à la décapitation, 32 à la roue et 28 aux galères. De sages règlements furent édictés pour prévenir le retour des abus de la noblesse. Les Grands-Jours furent levés après trois mois d'assises, d'octobre 1665 à janvier 1666, et une médaille, frappée à cette occasion, en consacra la mémoire. L'effet moral qu'ils avaient produit fut très considérable. La dernière secousse violente imprimée au pays fut la révocation de l'édit de Nantes (1685). Des villes entières furent ruinées par cet acte impolitique que l'histoire a reproché au grand roi.