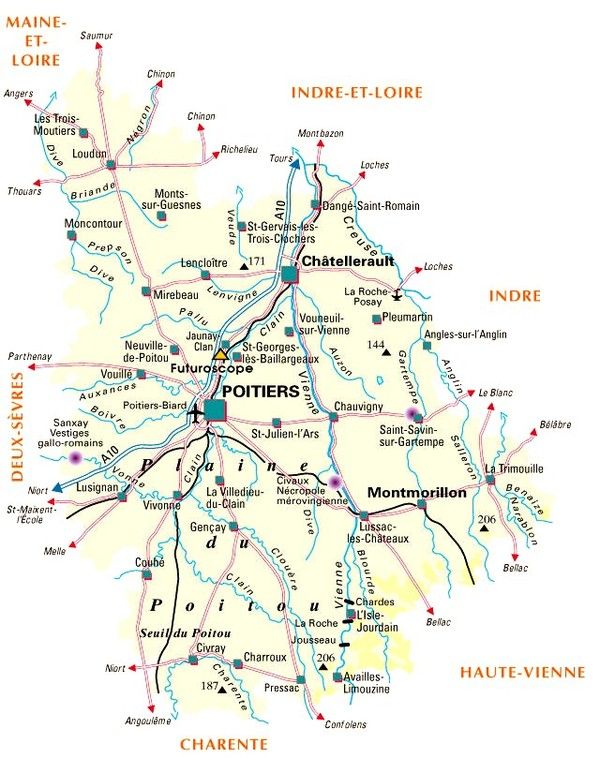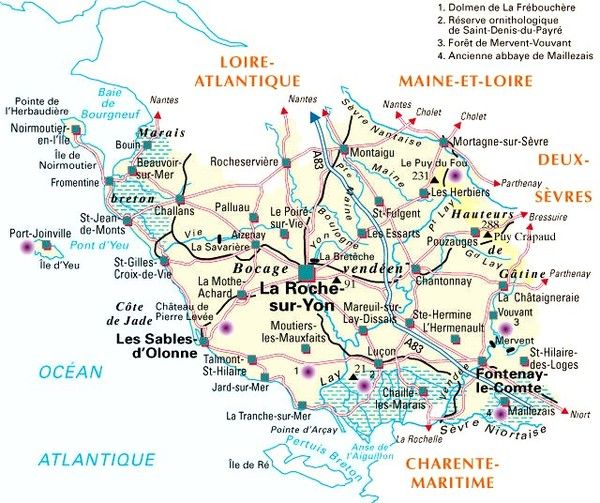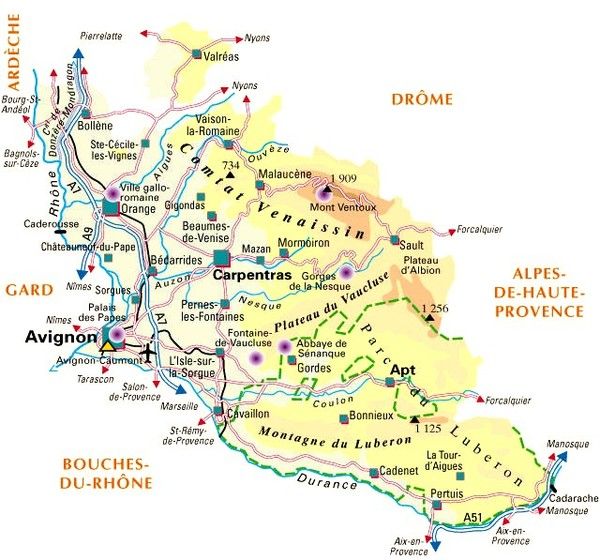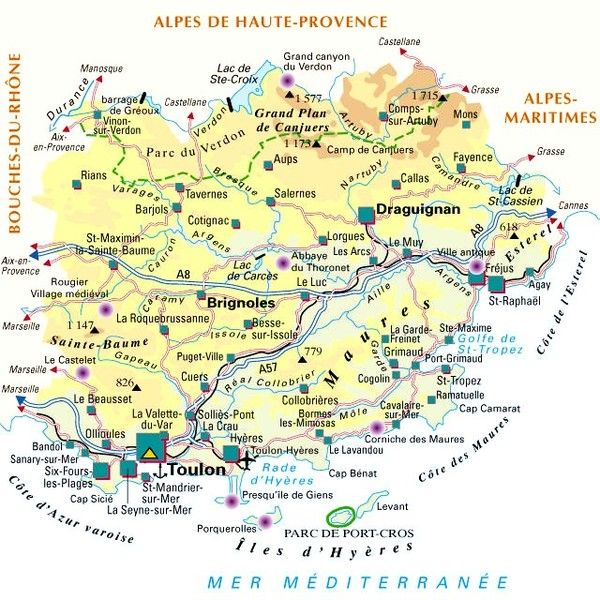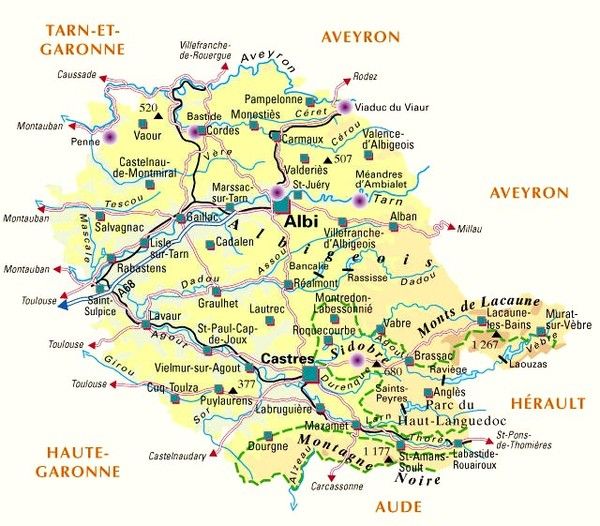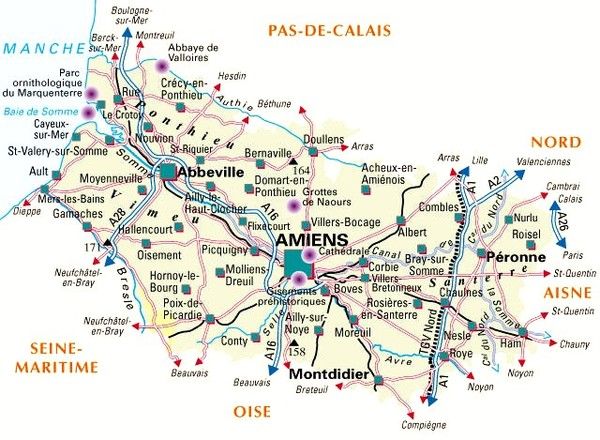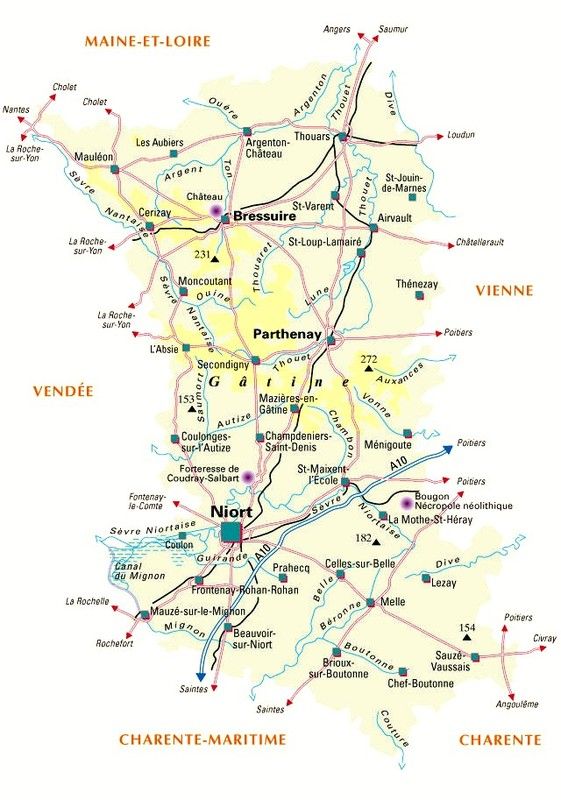Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Les départements-(histoire)-
Les départements-(histoire)- Haute Vienne - 87 -
Le département de la Haute-Vienne est formé du haut Limousin, d'une. partie de la basse Marche et de quelques communes du haut Poitou. Avant la conquête romaine, ce pays, compris dans la Celtique, était habité par les Lemovices, peuple indépendant dont la puissance paraît avoir été assez considérable.
Les Lémovices, dans la lutte contre César, ne trahirent pas la nationalité gauloise. Ils envoyèrent 10 000 hommes sous les murs d'Alésia pour forcer les Romains à lever le siège de cette ville, et leur chef, Sédulius, périt dans la déroute de Vercingétorix. Sous Auguste, lors de la division des Gaules en quatre provinces, la cité des Lémovices fut annexée à l'Aquitaine. Plus tard, Dioclétien divisa l'Aquitaine en deux parties, et le Limousin fut compris dans la première, qui avait Bourges pour métropole.
L'histoire de cette province se confond pendant toute la durée de l'empire avec celle de l'Aquitaine. En 418, le faible Honorius la céda aux Wisigoths. Leur domination fut de courte durée. Clovis, chef des Francs, s'empara du Limousin après la bataille de Vouillé (507). En 579 éclata un soulèvement général des peuples de Limoges. Chilpéric, fils de Clovis, avait établi un nouvel impôt sur les produits des terres et sur la propriété des esclaves.
La multitude, excitée par le clergé, se porta vers la demeure de Marcus, le référendaire royal ; elle saisit les registres de l'imposition et les brûla en place publique. Des poursuites rigoureuses furent dirigées contre les auteurs et les complices de cette insurrection. Plusieurs prêtres subirent la torture et la mort ; un grand nombre de laïques furent décapités. Mais ces exécutions ne firent qu'exaspérer la haine que les habitants portaient à la domination des rois francs. En 630, Dagobert donne l'Aquitaine à son frère Caribert II.
Pendant la période des rois fainéants, le Limousin, comme tout le Midi de la France, eut à souffrir des invasions des Sarrasins. Pépin le Bref rétablit l'unité de la Gaule. Après la chute de Waïfre (768), le duché d'Aquitaine perdit son indépendance, et le Limousin rentra sous l'autorité des rois francs. Charles le Chauve, en 845, céda à Pépin Il toute l'Aquitaine, moins le Poitou, la Saintonge et l'Angoumois.
L'année suivante, les Normands parurent dans le Limousin. Les seigneurs du pays, irrités contre Pépin, appelèrent Charles le Chauve et le proclamèrent roi d'Aquitaine à Limoges (848) ; mais bientôt ils l'abandonnèrent ; puis, par un nouveau revirement, ils lui livrèrent son rival (852). Charles, second fils de Charles le Chauve, fut nommé roi d'Aquitaine (855). Il mourut dix ans après (865).
Charles le Chauve établit dans le Limousin des comtes et des vicomtes héréditaires. Le roi Eudes, fils de Robert le Fort, eut à combattre Rainulfe II, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, qui prenait le titre de roi. Eudes établit le premier vicomte à Limoges en 876 ; c'était Aldebert, de la maison de Ségur. En 930, Raoul, duc de Bourgogne, proclamé roi de France par Hugues le Grand, battit les Normands dans le Limousin. Sous le règne de Hugues Capet, le pays fut désolé par la peste (994). Le clergé, profitant de la terreur que le redoutable fléau jetait dans toutes les âmes, demanda l'établissement de la trêve de Dieu. Le concile de Limoges (1031) prononça l'excommunication contre tous ceux qui ne garderaient pas la paix de la justice.
En 1152, Éléonore de Guyenne, fille de Guillaume IX, dernier duc d'Aquitaine, après avoir été répudiée par Louis le Jeune, épousa Henri Platangenet, et lui apporta en dot les domaines de son père, dont le Limousin faisait partie avec l'Auvergne, le Périgord, le Poitou, l'Angoumois, la Saintonge et la Guyenne. Lorsque, après la mort d'Étienne, Henri succéda au trône d'Angleterre (1154), il possédait un tiers de la France.
Le Limousin resta sous la domination anglaise jusqu'en 1203. Il fut alors confisqué et réuni au domaine royal, en exécution de l'arrêt rendu par les pairs de France contre Jean sans Terre. La soumission de cette province ne fut achevée que par Louis VIII, en 1224. Louis IX, par la traité d'Abbeville (1259), rendit à Henri III d'Angleterre, outre le pays au delà de la Garonne, le Limousin, le Quercy, le Périgord, les revenus de l'Agénois, Saintes et la partie de la Saintonge au sud de la Charente, à la condition de faire l'hommage lige et de renoncer à toutes les autres possessions des rois anglais en France.
Jean le Bon, par le traité de Brétigny (8 mai 1360), confirma les Anglais dans la possession de nos provinces méridionales. Charles V essaya de réparer par une politique adroite et cauteleuse les désastres de Crécy et de Poitiers. Il entretint de secrètes intelligences dans le Limousin. Louis, vicomte de Rochechouart, devint suspect au prince de Galles, qui le fit venir à Angoulême et donna l'ordre de l'arrêter. Remis en liberté, il prit ouvertement le parti du roi de France et soutint un siège dans son château contre les troupes anglaises. Charles V le nomma gouverneur du Limousin.
L'évêque de Limoges, gagné par les émissaires du roi, traita avec le duc de Berry (1368), et la cité de Limoges qu'il ne faut pas confondre avec le château ou ville proprement dite, selon l'expression du temps, se tourna française. Mais le Prince Noir punit bientôt cette trahison en faisant massacrer une partie de ceux qui défendaient la cité, en 1370.
En 1374, une armée anglaise, sous le commandement des ducs de Lancastre et de Bretagne, partit de Calais, passa sous les murs d'Arras, de Ham, de Saint-Quentin, traversa l'Oise, la Marne, la Seine, et vint dévaster la Bourgogne, l'Auvergne et le Limousin. « Plusieurs barons et chevaliers du royaume de France et consaulx des bonnes villes murmuroient l'un à l'autre, et disoient en public que c'estoit chose inconvénients et grand vitupère pour les nobles du royaume de France, où tant a de barons, chevaliers et écuyers, et de quoi la puissance est si renommée, quand ils laissoient ainsi passer les Anglais à leur aise, et point ne s'estoient combattus, et que de ce blâme ils estioent vitupérés par tout le monde. » (Froissart.)
Le roi, malgré les plaintes, ne changea point de politique. « Par ma foi, disoit-il, je n'en pense jà à issir ni à mettre ma chevalerie ni mon royaume en péril d'estre perdus pour un peu de plat pays. » Telle était aussi l'opinion de Clisson et de Du Guesclin. « Laissez-les aller ; par fumières ne peuvent-ils venir à votre héritage. Il leur ennuiera, et iront tous à néant. Quand un orage et une tempête se appert à la fois en un pays, si se départ depuis et se dégâte de soi-même ; ainsi adviendra-t-il de ces gens anglois. »
En effet, les troupes anglaises, épuisées par la fatigue, sans chevaux, sans armes, sans vivres, purent à grande peine arriver jusqu'à Bordeaux. C'était la dernière armée d'Edouard III. Charles V, en évitant les grosses affaires, avait tiré des mains de l'ennemi le Ponthieu, le Limousin, le Quercy, le Rouergue, la Saintonge, l'Angoumois et le Poitou.
Pourtant le Limousin ne fut pas dès lors complètement délivré des Anglais. Ce fut une des malheureuses provinces où la guerre se poursuivit malgré toutes les trêves officielles. Aux limites des deux dominations s'étaient établis des aventuriers qui se disaient Anglais pour avoir un prétexte de piller et de ravageur les terres de France. On pouvait leur appliquer à tous ces paroles que Froissart met dans la bouche d'un chevalier : « Ils ne sont pas Anglois de nation, mais Gascons, et font guerre d'Anglois. » Un de leurs capitaines en renom, Geofrroy Tête noire, disait à ses compagnons de brigandage : « Ma guerre a toujours été telle que je n'avois cure à qui, mais que profit y eùt. Jamais, sur l'ombre de la guerre et querelle des rois d'Angleterre, je me suis formé et opinioné plus que de nul autre ; car je me suis toujours trouvé en terre de conquest ; et là se doivent toujours traire et tenir les compagnons aventureux qui demandent les armes et se désirent a avancer. »
Froissart nous montre ces Anglais de Gascogne, établis en 1387, sous les ordres de Perrot le Béarnais, au château de Chalusset, près de Limoges. « Les compagnons à l'aventure couroient en Auvergue ; or pour ce que le pays a esté et estoit toujours en doute pour tels gens, sur les frontières du Bourbonnois se tenoit, de par le duc de Bourbon, un sien chevalier, vaillant homme aux armes .
Les temps du brigandage féodal étaient revenus. Pillés par les aventuriers, par les Anglais, par leurs propres seigneurs, les paysans, poussés à bout, cherchèrent plus d'une fois la fin de leurs maux dans des révoltes désespérées. En 1381, ceux de l'Auvergne, du Limousin et du Poitou prirent les armes, assiégèrent les châteaux, massacrèrent les nobles et cette nouvelle Jacquerie ne fut éteinte que dans les supplices.
Pendant la première période du règne de Charles VII, la misère du peuple alla toujours croissant. Quand ce n'étaient pas les Anglais qui étaient maîtres de son royaume, c'étaient ses serviteurs, ses routiers pillards et féroces. « Il faut bien que nous vivions, répondaient-ils aux plaintes des paysans : si ce fussent des Anglois, vous n'en parleriez pas tant. »
En 1442, Charles VII se décida à purger enfin de ces hôtes exécrables les provinces de l'Ouest et du Midi. Dans son expédition vers les Pyrénées, il traversa le Limousin et en chassa les écorcheurs. Louis XI acheva l'oeuvre de son père, et rétablit dans les provinces un peu d'ordre et de sécurité. Le parlement de Bordeaux, qu'il créa en 1462, comprit le Limousin dans sa juridiction.
Durant le XIVe siècle, ce pays, encore fatigué des longues souffrances de la Guerre de Cent ans, ne put échapper aux désastres des guerres de religion. La Réforme commença à se montrer en Limousin vers 1560 ; mais elle fit peu de progrès. Les habitants suivirent en général la cause du roi, et repoussèrent également les ligueurs et les huguenots.
Pendant les guerres de religion, le Limousin fut le théâtre de la guerre en 1569. C'est à Châlus que les Allemands, amenés par le duc de Deux-Ponts, opérèrent leur jonction avec les troupes de Coligny. Le duc d'Anjou perdit la bataille de La Roche-l'Abeille. L'armée catholique mourait de faim dans ce pays peu fertile et déjà ravagé par les protestants. Les reîtres du duc d'Anjou déclaraient qu'ils ne pouvaient combattre à jeûn.
Gens d'armes et fantassins s'en allaient par bandes sans congé. De leur côté, les huguenots se fatiguaient de la guerre d'escarmouches. Leur victoire de La Roche-l'Abeille ne leur avait pas procuré de grands avantages. Ils auraient mieux aimé une bataille décisive. Pour terminer la campagne, ils tentèrent la voie des négociations ; mais Charles IX déclara qu'ils n'accorderait rien avant que les rebelles eussent posé les armes.
C'était rejeter formellement toute proposition de paix. Coligny et les princes continuèrent les opérations militaires. Ils s'occupèrent à des sièges à défaut de bataille, et soumirent plusieurs places du Périgord, du haut Poitou et du Limousin. Après la mort de Henri III (1589), la Ligue mit pour gouverneurs dans le Limousin et dans les provinces voisines Louis de Pompadour et Desprez de Montpezat. Anne de Lévis de Ventadour était gouverneur pour le roi lorsque les ligueurs assiégèrent la ville de Saint-Yrieix.
En 1594, Henri IV, par ses victoires et ses négociations, acheva la conquête de la France. Mais, pendant que les grands traitaient avec le roi et que les cités de toutes parts lui ouvraient leurs portes la lassitude de la guerre civile, qui faisait déposer les armes à la bourgeoisie, les faisait prendre aux paysans du sud-ouest. Il n'est pas facile d'imaginer à quel degré d'insolence et de cruauté étaient arrivés les petits chefs militaires des provinces : toutes les horreurs des temps les plus désordonnés de la féodalité se renouvelaient au fond des donjons ligueurs et royalistes.
Mille petits tyrans, d'autant plus pressés de se gorger d'or qu'ils sentaient leur règne plus éphémère, écrasaient, torturaient, suçaient jusqu'au sang les peuples des campagnes. Les paysans se soulevèrent par milliers dans le Poitou, la Saintonge, le Limonsin, la Marche, le Périgord, l'Agénois, le Queréy, non plus pour la messe ou le prêche, pour le roi ou la Ligue, mais pour avoir le droit de vivre et d'être hommes.
Ils refusèrent le payement des tailles, des dîmes, des droits féodaux ; assaillirent les repaires de leurs oppresseurs, coururent sus aux percepteurs, aux gens de guerre, aux nobles connus, pour maltraiter leurs vassaux, à tous ceux qui croquaient le pauvre peuple. Leur cri de guerre : Aux croquants ! aux croquants ! leur valut à eux-mêmes le nom bizarre qu'ils donnaient à leurs ennemis.
Dans le Poitou, le Limousin et l'Angoumois, où le mouvement avait commencé, les gouverneurs royaux dissipèrent les bandes de paysans moitié par force, moitié par promesse d'un meilleur traitement. Dans le Limousin, les croquants avaient pour cher un nommé P. Deschamps. Il fut tué au mois de mai 1591. Les paysans pillèrent le château de Châlus et assiégèrent Saint-Yrieix.
On peut lire dans Chroniques limousines : « M. de Chambaret, gouverneur du haut et bas Limousin, fit venir quatre à cinq cents hommes de cheval et des compagnies de gens de pied. MM. Dably et de Marsillac (La Rochefoucauld) lui amenèrent autant d'hommes. Les seigneurs de La Capelle, Biron et de Peyraux s'y joignirent encore avec toute la noblesse de ces provinces. Ils vinrent à Rujaleuf où se tenait le capitaine des croquants, qu'il n'osa attaquer. Il se retira à Crouzilh (Couzeix), autrement le petit Limoges, où il remporta quelque avantage, et mit le feu au bourg. Il les dénicha, avec le canon, de Crouzilh, puis de Saint-Priest-Ligoure.
« Entre Nexon, Meilhat, Lagarde et Bost-Richard, il voulut charger 2 500 de leurs arquebusiers ; mais les croquants et Desmoulins, leur capitaine, les repoussèrent vivement d'abord. Desmoulins et leurs autres capitaines, gagnés par M. de Chambaret, les abandonnèrent ensuite. On en tua 1 500, et presque tous les autres furent blessés. C'était un ramassis de paysans des paroisses de Saint-Pardoux, Saint-Paul, Saint-Jorry, Sainte-Marie, SaintPriest, Saint-Nicolas, Meilhat, Frugier, Firbeix, Dournazac, Legeyrac, Ladignac, Champsac en Périgord et en Limosin. »
LLe Bulletin de la Société de l'histoire de France a publié une circulaire de paysans insurgés, se qualifiant du tiers état des pays de Quercy, Agénois, Périgord, Saintonge, Limousin, haute et basse Marche, en armes pour le service du roi et conservation du royaume. Cette pièce est adressée aux officiers et habitants des diverses châtellenies de la contrée, que les insurgés somment de se joindre à eux contre « les inventeurs de subsides, voleurs, leurs receveurs et commis, etc. »
Ils reconnaissent Henri IV pour roi de droit divin, naturel et humain, et déclarent vouloir maintenir l'Église, la noblesse sans reproche et la justice. L'autorité royale étouffa dans les massacres et dans les supplices cette révolte uniquement dirigée contre les brigands féodaux. Mais la même main qui écrasait les croquants ne ménagea pas davantage les seigneurs trop remuants et trop orgueilleux.
En 1605, les nobles mécontents conspiraient dans le Midi contre Henri IV. Le roi résolut de se montrer en personne dans ses provinces du sud. Il marcha en Limousin à la tête d'un petit corps d'armée (octobre 1605). Une chambre du Parlement de Paris vint tenir les Grands-Jours à Limoges, et, suivant l'expression des mémoires de Sully, « il y eut dix à douze têtes qui volèrent. »
Pendant la réunion des états généraux, l'insolence d'un député limousin amena une vive querelle entre la noblesse et le tiers état. Le 3 février 1615, le sieur de Bonneval, député de la noblesse du Limousin, chargea de coups de bâton, dans la rue, le sieur de Chavailles, député du tiers de la même province et lieutenant particulier à Uzerche. Cet outrage. souleva une furieuse tempête. Le tiers en corps se transporta sur-le-champ au Louvre, et demanda justice à Louis XIII du crime de lèse-majesté commis sur un membre des états, participant de l'inviolabilité royale.
Pendant les troubles de la Fronde, le Limousin n'eut pas trop à souffrir de la guerre civile. Condé le traversa, mais en aventurier et dans un singulier équipage. Gourville, dans ses mémoires, raconte cette expédition dont il fit partie. « M. le Prince, dit-il, ayant eu des nouvelles que M. de Beaufort, qui commandait les troupes de Monsieur, et M. de Nemours, qui commandait les siennes, quoique beaux-frères, avaient de grands démêlés ensemble, jusque-là qu'on craignait qu'ils n'en vinssent aux mains, et que, si M. le Prince pouvait se rendre à cette armée, cela pourrait obliger la cour à faire une paix qui lui serait avantageuse.
« M. le Prince prit le parti de s'y rendre avec un petit nombre de gens à sa suite ; ayant concerté l'affaire avec M. de La Rochefoucauld, qui souhaita que M. le prince de Marsillac, quoique fort jeune, en fût aussi, M. le marquis de Lévis, M. de Chavagnac, M. Guitaut, M. de Bercenay, capitaine des gardes de M. de La Rochefoucauld, moi et Rochefort, valet de chambre de Son Altesse sérénissime. Le jour qui fut choisi pour partir (d'Agen) était le, dimanche des Rameaux (1652). Ils prirent tous des habits modestes, qui paraissaient plutôt habits de cavaliers que de seigneurs...
« Nous entrâmes dans un village (au delà de Cahuzac), où il y avait un cabaret. L'on y demeura trois ou quatre heures, et n'y ayant trouvé que des œufs, M. le Prince se piqua de bien faire une omelette. L'hôtesse lui ayant dit qu'il fallait la tourner pour la mieux faire cuire, et enseigné à peu près comme il fallait faire, l'ayant voulu exécuter, il la jeta bravement du premier coup dans le feu. Je priai l'hôtesse d'en faire une a autre et de ne pas la confier à cet habile cuisinier. Nos gens ne faisant que dormir, j'étais obligé d'avoir soin des chevaux et de compter, de sorte que je ne pouvais reposer un moment.
« Le mercredi, à trois heures du matin, marchant auprès de notre guide, et voyant que nous approchions d'un lieu qui me parut assez gros, je lui demandai si nous devions passer dedans ; il me dit que non, mais que la rivière en était si proche qu'il n'y ait que la largeur du chemin entre deux, et qu'on y faisait une espèce de garde. Je me mis pour lors une écharpe blanche dont je m'étais nanti : voyant quelques hommes devant la porte, je les priai de ne laisser entrer personne de ceux qui me suivaient ; je, fus aussitôt obéi. Nous passâmes, et allâmes faire repaître nos chevaux dans un gros village, où un paysan dit à M. le Prince qu'il le connaissait bien, et en effet le nomma. L'ayant entendu, je me mis a rire, et, quelques autres s'approchant, je leur dis ce qui venait d'arriver. Tous plaisantant sur cela, le pauvre ne savait plus qu'en croire. »
Le duc de La Rochefoucauld parle aussi de cette course. aventureuse à travers le Périgord et le Limousin. « Ce qu'il y eut, dit il de plus rude dans ce voyage fut l'extraordinaire diligence avec laquelle on marcha jour et nuit, presque toujours sur les mêmes chevaux, et sans demeurer jamais deux heures en même lieu. On logea chez deux ou trois gentilshommes, amis du duc de Lévis, pour se reposer quelques heures et pour acheter des chevaux ; mais ces hôtes soupçonnaient si peu M. le Prince d'être ce qu'il était, que, dans un de ces repas, où l'on dit d'ordinaire ses sentiments avec plus de sincérité qu'ailleurs, il put apprendre des nouvelles de ses proches qu'il avait peut-être ignorées jusqu'alors. »
La Rochefoucauld fait ici allusion à ses amours avec Mme de Longueville, sœur du prince de Condé. Gourville, plus discret que son maître, ne rapporte pas ce détail assez piquant. Le voyage se termina heureusement ; Condé traversa sans encombre le Périgord, le Limousin, l'Auvergne et le Bourbonnais. « Il arriva, le samedi au soir au Bec-d'Allier, à deux lieues de La Charité, où il passa la rivière de Loire sans aucan empêchement. »
Depuis la victoire de Louis XIV et l'établissement de la monarchie absolue, l'histoire du Limousin se confond entièrement dans celle de la nation ; cette province n'a plus de vie personnelle ; pourtant, elle ne perd pas tout à fait son caractère propre et original. Dans l'unité de la France, on reconnaît encore le Limousin.
Voici le tableau de cette province à la fin du XVIIe siècle, tel que l'a tracé le comte dé Boulainvilliers, d'après les rapports de l'intendant de Limoges : « Le haut Limousin est montueux et froid, couvert de bois de châtaigniers, dont le fruit est la principale nourriture du peuple. Les. terres sont peu propres au froment ; mais on y recueille de bon seigle, et surtout quantité de blé noir avec des raves de la grosse espèce. Ces deux derniers, avec les châtaignes, sont la nourriture ordinaire des paysans, et, quelque bonne que soit d'ailleurs la récolte, ils pâtissent toujours beaucoup quand l'une de ces trois espèces vient à manquer. Il ne faut pas croire qu'ils fassent du pain de châtaignes, comme on le dit à Paris, ce fruit n'étant propre ni à être moulu ni à être pétri ; mais ils le font bouillir, le dépouillent par ce moyen de ses deux écorces, et le mangent ensuite avec délice. Cette nourriture rend les hommes durs au travail et robustes, mais elle ne leur donne aucune vivacité. »
Après avoir décrit le pays, Boulainvilliers, traçant le caractère des habitants, ajoute : « Les habitants du haut Limosin sont grossiers et pesants, mais laborieux, entendus à leurs affaires, vigilants, économes jusqu'à l'avarice, jaloux, défiants, craignant le mépris, durs sur le recouvrement des deniers du roi. Quand ils se soumettent aux impôts, c'est plutôt par crainte que par bonne volonté ; car leur passion dominante est de posséder sans inquiétude et sans partagé le fruit de leurs travaux. »
Le Limousin n'avait pas de coutumes ni d'usages particuliers : c'était un pays de droit écrit, et l'une des provinces qui, suivant Necker, étaient les moins productives. « Ce pays, dit l'abbé de Laporte dans son Voyageur français, a donné plusieurs papes à l'Église, plusieurs hommes célèbres dans la magistrature et dans les lettres, les sciences et des arts : les Dorat, les Saint-Aulaire, les d'Aguesseau, et plusieurs autres qui doivent effacer par leurs talents ou leur illustration l'espèce de ridicule que Molière a jeté sur la noblesse Limousine et sur l'esprit des habitants de cette province. Il est vrai que le peuple, pauvre et malheureux, obligé de suppléer par une vie dure, par des travaux continuels, à la stérilité du sol, n'a guère cultivé ses facultés intellectuelles et n'a point suivi les progrès de son siècle. La misère n'est point favorable à l'instruction. Le besoin a fait naître chez les Limosins l'industrie, l'activité, la sobriété. On leur reproche d'être méfiants, processifs et surtout superstitieux. La religion des Limosins ne consiste qu'en des pratiques extérieures de processions et de pèlerinages, et la vénération qu'ils ont pour les saints de leur pays, saint Martial et saint Léonard, est exclusive de tous les autres, et va même à l'abaissement du culte de Dieu. »
Une nouvelle industrie, celle de la porcelaine, a augmenté l'aisance des habitants, et cette profession, presque artistique, a éveillé des intelligences longtemps paresseuses. Au XIXe siècle, le département compte 40 fabriques de porcelaine, dont les produits rivalisent avec les plus beaux et les plus estimés de l'Angleterre, de la Saxe et des autres pays étrangers.
Depuis le temps où Turgot, intendant de la généralité de Limoges (1761), abolit la corvée et donna à ce pays, jusqu'alors impraticable, les routes les plus belles et les mieux entretenues de la France, de nouveaux progrès ont été accomplis, et la création d'un réseau de chemins de fer à travers le département y a apporté une activité industrielle, et commerciale qui n'a pas tardé à l'enrichir et à en faire un des plus importants de la France.
Mais si le frottement de la civilisation moderne a poli le caractère, limousin, il n'en a pas altéré les qualités saines et solides. Dans sa Statistique du département de la Haute-Vienne, AI. Texier Olivier, préfet de la Haute-Vienne a fait en ces termes l'éloge de ses administrés . « La douceur est le caractère distinctif des habitants du département de la Haute-Vienne. Ils sont, en général, pleins de bonhomie et de candeur ; et, quoique excessivement économes, ils se montrent charitables et hospitaliers. Durs envers eux-mêmes, ils sont honnêtes envers les étrangers ; ils savent apprécier le bien qu'on leur fait ; ils sont serviables et reconnaissants. »
Toujours au XIXe siècle, on parle généralement à Limoges le français, mais avec une prononciation vicieuse ; l'accent limousin se perd difficilement, même chez ceux qui font de longues absences. Le patois du pays est un idiome mélangé de latin, d'espagnol et de langue romane corrompue. Au Moyen Age, la langue limousine a eu ses troubadours et ses poètes ; de nos jours, les imitations des fables de La Fontaine, les contes, les chansons et les noëls patois des abbés Foucaud et Richard et de quelques autres, nous ont conservé celle langue. On y trouve des expressions originales qui, traduites en français, perdraient tout ce qu'elles ont d'énergie, de sel et de valeur.
Les départements-(histoire)- Vienne - 86 -
Le département de la Vienne a été formé, en 1790, de la contrée qu'on appelait le haut Poitou. Antérieurement à la conquête romaine, ce pays était habité par les Pictones, les Pictons, dont le nom se transforma plus tard en celui de Pictavi, tribu importante de la nation gauloise.
Publius Crassus, un des lieutenants de César, pénétra le premier chez les Pictones, dont César en personne vint plus tard incorporer le territoire dans l'Aquitaine. Le Poitou s'associa aux efforts des provinces qui protestèrent avec Vercingétorix contre le joug de l'étranger, et son contingent, sous les murs d'Alise, paya sa dette à la nationalité opprimée. Là, comme ailleurs, la politique habile des vainqueurs parvint à énerver, à endormir pendant plusieurs siècles les ressentiments des vaincus.
Les bienfaits de la civilisation romaine firent oublier les hontes de la servitude. Les camps devinrent des villes, les vieilles cités s'embellirent, des voies de communication furent tracées et ouvertes, le commerce et les arts achevèrent l'oeuvre que les victoires des légions avaient commencée. Cette transformation sociale était à peine accomplie que les Romains, à leur tour, purent regretter de ne plus avoir pour alliés ou pour sujets que des esclaves à opposer aux nouveaux ennemis qui venaient leur disputer leurs conquêtes.
Après de longues années d'une résistance qui allait toujours mollissant, il fallut capituler avec ces barbares infatigables, qu'aucun échec n'épuisait, dont le flot grossissait toujours, irrésistible, implacable comme la fatalité. L'Ouest et le Sud étaient devenus la proie des Wisigoths ; l'orgueil romain transi-en et, ne pouvant les chasser, les accepta dans l'Aquitaine. Le partage de la souveraineté, c'était l'abdication.
La domination romaine s'efface, disparaît ; l'empire wisigoth est fondé. Il avait pour limites la Loire et les Pyrénées ; le Poitou en fit partie. Toutefois, ce triomphe de la barbarie consacrait en même temps le triomphe d'une foi nouvelle, bien plus favorable aux progrès de l'avenir et aux destinées de l'humanité que tous les raffinements de la civilisation qu'elle venait remplacer. Les princes wisigoths, comme les rois francs, prirent d'abord le christianisme pour base de leur autorité ; ils travaillèrent aussi à sa propagation, mais se laissèrent bientôt entraîner dans le schisme d'Arius.
On sait avec quelle adresse et quel bonheur Clovis exploita la circonstance ; l'orthodoxie avait été le prétexte, les évêques furent les instruments ; le résultat ne fut rien moins que la constitution de la monarchie franque. C'est dans les plaines du Poitou, en 507, que se vida cette grande querelle. Nous verrons encore, dans les crises suprêmes, races et principes se heurter au milieu de cette province, théâtre prédestiné où devaient se dérouler les épisodes les plus décisifs de notre histoire nationale.
Les armées de Clovis et d'Alaric se rencontrèrent dans un lieu désigné alors sous le nom de Campus Vocaldensis, c'est-à-dire Vouillé ; Alaric y fut battu et tué. De nos jours, on a voulu contester à Vouillé l'honneur de ce champ de bataille mémorable en le plaçant sur le territoire des communes actuelles de Voulon et de Mougon ; d'autres assignent pour théâtre à cet important événement de notre histoire nationale le lieu dit : Le Camp Sichard, à 2 kilomètres à l'est de Voulon, sur la rive droite du Clain, en face de l'embouchure de la Bouleure ; on trouve, en effet, dans ce lieu de nombreuses tombelles sépulcrales et des tombes en maçonnerie ; mais cela ne prouve rien à propos du champ de bataille. Ce qui est certain, c'est que ce grand drame se joua dans les environs de Poitiers, et que cette ville, déjà importante, renfermait des catholiques ardents, dont le concours et les sympathies étaient acquis à Clovis.
Le Poitou, pendant la période mérovingienne, fut gouverné par des comtes non héréditaires, dont quelques noms sont parvenus jusqu'à nous. Willechaire en 509, Austrapius en 544, Sigulfe en 567, Eunodius en 577 et en 586, Bérulfe, dans l'intervalle, en 581, Macon en 589 et Sadragésile en 630. Puis, sous Dagobert, on voit se former, au profit des princes du sang royal, le royaume ou duché d'Aquitaine, dans lequel le Poitou se trouve absorbé.
Tout l'intérêt historique de cette époque est dans la lutte héroïque des ducs d'Aquitaine et d'es maires du palais des derniers rois chevelus, les uns s'efforçant de reconstituer, dans ses limites et dans son indépendance, l'empire des Wisigoths, les autres ne voulant pas laisser s'amoindrir le domaine de Clovis, dont leur génie les fera héritiers. Boggis, Hunold, Waïfre, héros vaincus, princes dépossédés, sont les noms dans lesquels se résument les péripéties de ces guerres, dont le Poitou partagea les calamités et subit les conséquences.
Il est un événement de la même époque dont la gloire se rattache plus spécialement aux annales du Poitou : c'est la victoire de Charles Martel sur les Sarrasins. L'invasion, cette fois, au lieu de venir du Nord, partait du Midi. L'Ibérie était conquise, les Pyrénées franchies, la partie la plus méridionale des Gaules occupée, et l'émir Abd-el-Rhaman, traînant tout un peuple après lui, se dirigeait vers la Loire.
En ce péril, le duc Eudes s'adressa aux Francs d'Austrasie, ennemis de sa race, mais chrétiens et défenseurs solidaires de l'Aquitaine contre les envahissements du croissant. Charles Martel rassembla ses forces, qui ne s'élevaient pas au-dessus de trente mille hommes, et se dirigea par la Touraine à la rencontre des Sarrasins, c'est sur la voie romaine de Poitiers à Tours, dans le lieu appelé Moussais-la-Bataille, que ce grand conflit s'engagea.
Abd-el-Rhaman, à la nouvelle de l'arrivée des Austrasiens, fit un mouvement rétrograde pour concentrer sa nombreuse armée. Il forma à la hâte un camp pour y abriter les femmes, enfants, vieillards et ceux qui n'avaient pas l'habitude de combattre. Ses soldats furent placés en arrière du point où est actuellement le bourg de Moussais, la gauche appuyée sur le Clain, le centre sur la voie romaine et la droite sur la hauteur où se trouve la ferme de la Bataille. Ainsi, comme l'a fait remarquer un habile tacticien moderne, « les Arabes présentaient une vaste courbure, embrassant les plaines du vieux Poitiers, dans lesquelles ils croyaient, suivant l'usage des formations orientales, enfermer leurs adversaires par le rapprochement de leurs ailes. »
Charles passa la Vienne et rangea son armée en bataille dans les plaines en avant de Moussais. Une sorte d'hésitation sembla précéder l'engagement décisif. La croix et le croissant demeurent en présence et comme immobiles pendant plusieurs jours. Enfin Abd-el-Rhaman donna le signal à la tête de sa cavalerie. Le premier choc fut terrible ; la race du Midi eut d'abord l'avantage, mais celle du Nord reprit le dessus ; la fougue des cavaliers orientaux venait se briser contre les armures d'acier des fantassins septentrionaux ; des efforts d'une valeur indicible furent faits de part et d'autre, mais un mouvement inattendu décida tout à coup du triomphe de la croix.
C'était Eudes, le duc des Aquitains, qui, arrivant en toute diligence avec son corps de troupes, attaqua la droite des musulmans et pénétra dans leur camp, où il fit un grand carnage, surtout parmi les non-combattants. S'apercevant du mouvement rétrograde de cette partie de son armée, Abd-el-Rhaman courut rétablir le combat ; mais il y trouva la mort, et, le désordre s'étant mis aussitôt parmi les siens, la déroute devint complète. La nuit seule, qui survint, empêcha l'entière destruction de cette horde arabe, qui se retira par essaims vers les Pyrénées.
La gloire de cette journée rejaillit sur Charles Martel et facilita à sa famille l'avènement au trône de France, aussi bien que la domination de l'Aquitaine. Charlemagne, en 778, reconstitua cette province en royaume particulier, dépendant de l'empire franc, et il en fit l'apanage de son fils aîné, Louis le Débonnaire, le jour même de sa naissance. Le Poitou partagea encore les destinées du nouvel État ; jusqu'au règne de Louis le Bègue, c'est-à-dire jusqu'à l'établissement de la grande féodalité, il fut gouverné par des comtes révocables : Abbon en 778, Ricwin en 814, Raynulfe Ier en 839 et Bernhard en 869.
A dater de cette époque, les prétentions des comtes de Poitou semblent grandir en proportion de l'affaissement du pouvoir des Carlovingiens. Raynulfe Il ajoute à son titre celui de duc d'Aquitaine, et en 880 il veut se faire nommer roi. Eudes eut recours au poison pour se délivrer de ce vassal insatiable. Mais le principe d'hérédité était désormais acquis à cette maison de Poitou, qui, par alliance ou conquête, avait ajouté à ses domaines l'Auvergne, le Berry, le Limousin, et à laquelle on ne songeait plus à contester le titre de ducs d'Aquitaine. Le premier de ces seigneurs héréditaires qui ait laissé un nom historique est le fameux Guillaume Tête d'Étoupe, surnom qu'il devait à la couleur de ses cheveux. Las de la vie guerrière et agitée qu'il avait menée, il se retira dans l'abbaye de Saint-Maixent, y prit l'habit de moine et y mourut en 964.
Son fils, Guillaume, qui lui succéda, fut surnommé Fier-à-bras, titre qu'il mérita principalement, dit Belleforêt, parce qu'il tint tête à Hugues Capet et qu'il lui écrivit dans les termes les plus forts et les plus hardis. Ce monarque vint assiéger Poitiers et contraignit enfin le duc d'Aquitaine à se soumettre. Ce fut ce même duc qui fonda l'abbaye de Maillezais et qu'on assure être mort, comme son père, religieux de ce couvent ou de celui de Saint-Maixent. On prétend aussi qu'il eut un frère puîné, qui passa en Dauphiné et fut la tige de l'illustre maison de Poitiers, qui ne s'est éteinte qu'au XVIIe siècle et de laquelle descendait la fameuse maîtresse de Henri Il.
Le fils de Fier-à-bras, nommé Guillaume, comme ses aïeux, mérita le surnom de Grand. Ce fut un prince très savant dans ce siècle d'ignorance ; il entretenait des relations avec tous les esprits distingués de son temps. Les hommes de guerre l'appelèrent Grand, parce qu'il augmenta considérablement ses États par ses conquêtes et ses alliances. Les moines le surnommèrent le Pieux, parce qu'il releva beaucoup d'églises ruinées, et les savants l'appelèrent le Grammairien, parce qu'il fonda des écoles et qu'il s'occupa du soin d'instruire ses sujets.
Sa fille Agnès, qui épousa l'empereur Henri III, était également savante. Ses trois fils lui succédèrent l'un après l'autre. Le premier se nomma Guillaume le Gros ; le second, Eudes, qui, du chef de sa mère, réunit la Gascogne à ses domaines, et le troisième, encore Guillaume. Celui-ci eut un fils, qui prit le nom de Guillaume, héréditaire, comme on le voit, dans la famille ; il était fort instruit, homme d'esprit et d'une rare vaillance, mais ses moeurs et ses principes étaient peu exemplaires. Il composait des vers, des chansons et des fabliaux, remarquables, dit-on, par la verve et la finesse, mais généralement très libres, très scandaleux et même injurieux pour le clergé.
Un auteur anglais accuse ce prince d'avoir eu l'idée de fonder une abbaye de belles dames et de jolies demoiselles, plus galantes que dévotes, et de leur donner des règlements conformes à leurs moeurs. Il voulait mettre à leur tête Maubergeonne, vicomtesse de Châtellerault, avec laquelle il vivait publiquement après avoir abandonné sa femme Hildegarde. Celle-ci en porta ses plaintes au pape, et les évêques forcèrent le comte à la reprendre et à vivre avec elle.
Ce fut sans doute pour éluder cet ordre, et cependant pour réparer ses premiers scandales, qu'il se croisa et passa en Orient. Il y acquit beaucoup de gloire par sa valeur, quoique ses troupes y eussent été maltraitées et qu'il revînt lui-même en assez piteux état. Il mourut en 1126, laissant pour successeur son fils, Guillaume IX, dernier duc d'Aquitaine de la maison des anciens comtes de Poitou.
La vie de ce Guillaume est un véritable roman. Les légendes populaires, les contes merveilleux s'y sont tellement substitués à l'histoire, qu'il est bien difficile de faire la part de ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Protecteur zélé de l'Église durant les premières années de son règne, fondateur du Montierneuf à Poitiers, bienfaiteur de Fontevrault, il eut le malheur de prendre parti pour l'antipape Anaclet contre Innocent II.
Saint Bernard, ne voulant pas laisser au schisme un appui aussi puissant, se rendit lui-même auprès de Guillaume. Un jour qu'il célébrait la messe en présence du duc, au moment de l'élévation, tenant entre ses mains l'hostie, sainte levée, dans un accès de soudaine inspiration, il adjura Guillaume de reconnaître le pape légitime, de chasser de ses domaines les évêques schismatiques et de rappeler ceux qu'il avait bannis de leurs sièges. S'abandonnant à sa foudroyante éloquence, à cet enthousiasme mystique dont nul autre ne fut possédé au même degré, il le menace de la colère céleste et le déclare frappé d'excommunication s'il n'obéit. Guillaume, interdit, effrayé, promet tout ; mais le lendemain il veut éluder ses promesses.
Alors s'accomplissent autour de lui les prodiges du plus sinistre augure : l'évêque intrus de Limoges tombe de sa mule et meurt de sa chute ; celui de Poitiers est pris d'une fièvre chaude et se coupe la gorge avec un rasoir. Le duc, saisi de terreur, n'essaye plus de résister aux avertissements du ciel. Il va consulter saint Bernard à Clairvaux, il se rend en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, appelle auprès de lui les trois officiers de sa maison auxquels il avait le plus de confiance, leur fait promettre, sous les plus grands serments, d'exécuter ses ordres avec fidélité et discrétion, puis il leur remet son testament et les charge de le porter au roi Louis le Gros. C'était son abdication au profit d'Éléonore, sa fille aînée ; il priait le roi de lui servir de tuteur et de lui faire épouser son fils, Louis le Jeune.
Les volontés de Guillaume furent exécutées de tout point. Quant à lui, après s'être fait passer pour mort et s'être fait construire un tombeau, il s'embarque pour la Terre sainte. Ici commence une série d'aventures auxquelles manque tout caractère d'authenticité, et qui, d'ailleurs, ne se rattachent aucunement à l'histoire du Poitou.
Cette province suivit les destinées de la princesse qui en était devenue souveraine ; séparée de la France, comme on le sait, par le déplorable divorce d'Éléonore, elle devint, par son second mariage avec Henri Plantagenet, apanage des princes anglais. L'accroissement de puissance des comtes de Poitou avait eu pour conséquence un développement proportionnel des grands vassaux qui, au-dessous d'eux, gouvernaient le pays.
Le sol avait été divisé en vigueries, institution empruntée à la nation gothique, pour l'administration de la justice ; au-dessus des viguiers avaient été placés les vicomtes, comme intermédiaires entre eux et les comtes. Plus la maison de Poitou étendait ses possessions, plus les vicomtes, ses lieutenants, acquéraient d'indépendance et d'importance ; ils créèrent donc à leur tour des dynasties héréditaire, avec lesquelles eurent souvent à compter les rois de France et d'Angleterre. Telle fut l'origine des maisons de Melle, d'Aunay, de Châtellerault, de Thouars, de Lusignan, de Parthenay, de Talmont, de Mauléon, de Bressuire et de beaucoup d'autres que nous pourrions citer.
Les conséquences calamiteuses qu'entraîna la possession d'une partie de la France par un prince anglais ne se firent sentir nulle part plus cruellement qu'en Poitou ; c'est là, en effet, que l'étranger établit le centre de sa domination. Richard Coeur de Lion, fils d'Éléonore et de Henri Il d'Angleterre, fut créé comte de Poitou ; il aimait cette province et y résida longtemps, partageant son temps entre le palais de Poitiers et le château à de Montreuil-Bonnin, où il faisait battre monnaie.
Lorsqu'il fut devenu roi, il donna le Poitou à son neveu, Othon de Saxe, dit de Brunswick, qui, plus tard, devint empereur d'Allemagne. L'arrêt de confiscation prononcé contre Jean Plantagenet après l'assassinat d'Arthur, duc de Bretagne, fit rentrer momentanément le Poitou sous la loi française ; saint Louis concéda, en 1241, le Poitou à son frère Alphonse, et les tentatives des Anglais pour le reprendre aboutirent à la glorieuse bataille de Taillebourg.
A la mort d'Alphonse, qui ne laissa pas d'héritier, ses domaines firent retour à la couronne, et, en 1304, Philippe le Bel investit du comté de Poitou le second de ses fils ; ce prince, lorsqu'il arriva au trône, sous le nom de Philippe le Long réunit de nouveau le Poitou au domaine royal. Cette possession, toutefois, était plus nominale que réelle ; l'Anglais n'avait point cessé d'avoir pied en France, et, malgré les divers traités intervenus, les hostilités étaient pour ainsi dire permanentes.
La rivalité des maisons de France et d'Angleterre caractérisait cette époque, comme autrefois la lutte des Francs et des Wisigoths et plus tard l'invasion des Maures d'Espagne avaient marqué deux autres grandes périodes de notre histoire. Cette fois encore le Poitou fut le théâtre où s'accomplit l'acte le plus important de cette crise. En avril 1356, le prince Noir, fils aîné du roi d'Angleterre, maître du Limousin et du Berry, menaçait la Touraine, où il semblait vouloir faire jonction avec le duc de Lancastre, qui venait d'opérer en Bretagne ; le roi Jean, occupé alors au siège de Breteuil, en Normandie, fit rassembler des troupes dans la province menacée, vint en prendre lui-même le commandement, et passa la Vienne pour se porter à la rencontre de l'ennemi. A cette nouvelle, le prince Noir, qui était parvenu à deux lieues de Poitiers, fit halte et se retrancha non loin de l'abbaye de Nouaillé, dans la lande de Maupertuis-de-Beauvoir.
C'est là que les deux armées se rencontrèrent, et, après être restées deux journées en présence, elles en vinrent aux mains le 19 septembre. Le prince anglais, habile tacticien, quoique bien inférieur en forces à son adversaire, sut disposer ses troupes de manière à écraser avec toute son armée chacun des trois corps français tenus dans l'isolément l'un de l'autre.
La supériorité numérique des soldats du roi Jean ne fit qu'ajouter au désordre de la défaite ; la France, dans cette journée néfaste, perdit 11 000 hommes, parmi lesquels le connétable, un des maréchaux, plusieurs princes et 2 000 chevaliers. Le roi, nu-tête et à pied, tenant sa hache à deux mains, se défendit avec un courage héroïque jusqu'à la fin de la bataille ; succombant enfin sous le nombre, épuisé de fatigue, affaibli par ses, blessures, il fut conduit au prince de Galles.
On sait que le malheureux monarque, traîné de Bordeaux à Londres, y figura dans l'entrée triomphale de son vainqueur. Sa liberté coûta à la France le traité de Brétigny (8 mai 1360), qui abandonnait à l'Angleterre le Poitou et une grande partie de nos provinces d'outre-Loire.
Édouard, investi du duché d'Aquitaine, conserva le Poitou jusqu'aux victoires de Du Guesclin. Le Poitou donc redevenu français fut l'apanage de Jean de Berry, du duc de Touraine et du dauphin, fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. De ce domaine, ils n'eurent le plus souvent que le titre ; le Poitou ne fut définitivement réuni à la France qu'en 1436, après les victoires décisives de Charles VII. Ce prince, néanmoins, après le massacre des Armagnacs, en mai 1418, avait trouvé un asile à Poitiers et y avait établi le parlement. Un siècle de paix succéda à ces longs orages ; mais la province, à peine remise de ces violentes secousses, avait une dernière épreuve à traverser.
Le Poitou fut une des premières provinces de France envahies par le protestantisme. Calvin y avait prêché la doctrine nouvelle dans les grottes de Saint-Benoît et de Croutelle ; l'une d'elles porte encore son nom. Les dissentiments se changeant en discordes civiles, les persécutions poussant les vaincus à la vengeance et à la guerre, c'est l'histoire de tous les pays dont s'empare le fanatisme religieux ; ce fut donc aussi durant le XVIe siècle l'histoire du Poitou, avec cette particularité, qu'au plus fort de la lutte, au moment où la crise était suprême, c'est encore sur ce sol prédestiné que les deux partis se heurtèrent.
La rencontre eut lieu la 3 octobre 1577, non sur les hauteurs de Moncontour, quoique le nom en soit resté à la fameuse journée, mais assez loin de là, dans la plaine, entre les bourgs d'Assais et de Jumeaux, le village de Plumain et la butte de Puytaillé. Le sang coula Surtout dans les vallées appelées aujourd'hui, à cause de ce grand événement, la vallée Sanguine et la vallée de la Bataille.
L'armée protestante, sous les ordres de Coligny, était forte de 12 000 fantassins et de 7 000 hommes de cavalerie. L'armée catholique, sous la conduite du duc d'Anjou, se composait de 18 000 hommes de pied et de 9 000 chevaux. Henri IV, débutant alors dan la carrière militaire, assista à la défaite des huguenots. L'importance de cette journée était telle, que Catherine de Médicis, à qui on parlait des suites qu'aurait pu entraîner alors une défaite de son parti, répondit qu'il aurait fallu se résigner à entendre la messe en français.
La bataille de Moncontour est le dernier événement politique dont soient marquées les annales du haut Poitou ; la département de la Vienne est entré avec intelligence et résolution dans la voie de progrès ouverte aux générations modernes depuis le commencement de ce siècle. Il a eu l'heureuse fortune de rester en dehors de ces guerres impies et fratricides qui ensanglantèrent les contrées voisines, alors que la patrie n'avait pas trop du sang de tous ses enfants pour se défendre contre l'étranger. Dans ces derniers temps, il a eu le bonheur d'échapper aux désastres de l'occupation étrangère (1870-1871).
Les départements-(histoire)- Vendée - 85 -
Pendant la Période gauloise, le pays qui forme aujourd'hui le département de la Vendée était habité par les Pictones, puissante confédération à laquelle appartenaient trois tribus alliées dont les noms sont parvenus jusqu'à nous : les Ambiliates, dont les possessions réunies plus tard à l'Anjou, notamment le pays de Mauge, se prolongeaient jusque vers les rives de la Sèvre Nantaise ; les Anagnutes ou Agnotes, qui occupaient la partie de la province désignée dans la suite sous le nom de pays de Rais, près du duché de Retz, et la contrée de Pareds, jusqu'aux Alpes vendéennes ; enfin, les Cambolectri Agesinates, qui tenaient les bords de la mer et s'avançaient jusqu'à une certaine distance dans l'intérieur des terres.
Ces derniers fournirent leurs marins à César pour l'aider a réduire les Vénètes, et valurent à la province entière, l'amitié des vainqueurs et l'exemption de certains impôts dont furent grevés les autres peuples ; ce qui a fait dire à Lucain Pictones immunes. La conquête compliqua ces divers éléments de population. Des Sarmates et des Teiffaliens furent envoyés en garnison dans le Poitou ; c'est une colonie de ces derniers qui a laissé dans Tiffauges un souvenir de son séjour et de son nom. La maison de Lusignan passe pour être issue de cette race.
L'invasion des barbares, l'établissement du christianisme, l'envahissement et la défaite des Wisigoths ne se signalent dans la Vendée par aucune particularité notable ; il en est de même pour toute l'époque mérovingienne. Cette contrée,. comme le reste du Poitou, reste attachée au sort du duché d'Aquitaine, et, comme elle en formait l'extrême frontière au nord-ouest, une marche fut créée, commune au Poitou et à la Bretagne, territoire neutre de 2 à 4 kilomètres de largeur sur 60 de longueur. Ce canton, exempt de tailles, gabelles et tous droits fiscaux, était arrivé à un haut degré de prospérité ; nulle autre part l'agriculture n'avait fait plus de progrès.
Une autre marche séparait le Poitou de l'Anjou et était commune à ces deux provinces. C'est la région qui, parallèle au cours de la Loire, répond dans la division populaire de la Vendée au mot de Plaine, en opposition au Bocage et an Marais. Nous aurons à revenir, dans l'appréciation des événement contemporains, sur cette division et sur l'influence que la diversité du sol a exercée sur les mœurs et le caractère des populations. Nous traversons encore toute la période carlovingienne, l'époque des Maures et des Normands, sans rencontrer un seul fait important qui ne se rattache ou à l'histoire générale de la province, ou aux annales particulières des villes ou des bourgs ; nous voyons seulement, en 1317, le pape Jean XXII diviser en trois évêchés le Poitou, qui n'avait eu jusqu'alors que celui de Poitiers, et les deux nouveaux sièges sont placés dans la Vendée, à Maillezais et à Luçon.
Les empiétements de la féodalité, les péripéties de la lutte contre l'Angleterre, la reconstitution du pouvoir central, les guerres de religion, les agitations de la Ligue et de la Fronde passèrent sur le bas Poitou sans que les calamités que ces événements y attirèrent se recommandent à l'attention de l'historien par aucun retentissement exceptionnel ; le pays, dans ces diverses phases, n'affecte pas encore de physionomie particulière ; il n'y joue qu'un rôle passif et ne figure que comme partie intégrante de la province.
D'où lui vient donc, à la fin du dernier siècle, cette notoriété subite, qui lui fait désormais une place à part dans les annales contemporaines ? Nous croyons que l'histoire de la Vendée moderne est encore à faire ; nous croyons qu'il est bien difficile à tout homme de notre temps de se dépouiller assez complètement des passions présentés, pour porter un jugement vrai sur ce drame formidable que chacun envisage encore aujourd'hui au point de vue de ses espérances ou de ses regrets. Le caractère de loyale impartialité que noirs cherchons à donner à nos notices nous interdit donc toute appréciation, et nous nous bornerons à exposer les faits en recherchant les causes les plus probables.
C'est ici l'occasion de revenir sur celle division topographique de la Vendée dont nous avons déjà dit quelques mots. En descendant la Loire, sur la rive gauche du fleuve, après l'étroite et longue plaine qui formait autrefois les marches d'Anjou et de Bretagne, on rencontre un pays accidenté, couvert de bois, adossé, à l'est, à une chaîne de montagnes, d'une médiocre élévation, mais d'un accès peu pratiqué, et s'abaissant à l'ouest jusqu'à la région appelée le Marais ; cet espace intermédiaire est le Bocage.
Plus isolé, plus impénétrable encore, le Marais est une espèce de triangle resserré entre la mer, la Loire et le Bocage ; le sol humide et bas se compose de prairies coupées par une infinité de petites rivières, par leurs affluents et par des canaux de jonction que leurs eaux se sont creusés ; chaque champ est entouré de haies formées d'arbres touffus et élevés qui donnent au pays l'aspect d'une forêt immense ; les rares chemins étroits, fangeux, profondément encaissés, serpentent sous ces voûtes épaisses où arrive à peine la clarté du jour.
Qu'on ajoute à ces obstacles naturels les barrières que l'ancienne organisation administrative et politique élevait entre les provinces du même État, entre les seigneuries de la même province ; qu'on se rappelle la longue indépendance de la Bretagne, l'isolement d'une côte saris commerce, entre les deux grands ports de Nantes. et de La Rochelle, et on comprendra dans quel oubli de tous, dans quelle ignorance des faits nouveaux et des idées qui en surgissent, devait vivre, avant la Révolution, ce pays perdu, ce bout du inonde français, ce bas Poitou, la Vendée.
En 1789, on en était encore aux vieux souvenirs des guerres contre les Anglais : les exploits du roi et des seigneurs qui avaient défendu la France, la tradition des miracles qui l'avaient sauvée alimentaient encore les récits de la veillée ; les agitations du XVIe et du XVIIe siècle y avaient à peine troublé quelques villes ; mais les ardeurs réformistes, les intrigues de la Fronde, la propagande philosophique, l'indiscipline des parlements n'avaient trouvé aucun écho dans ces naïves populations.
La difficulté des communications enchaînant le clergé et le noble près du paysan avait établi entre les trois classes des rapports d'intimité, presque de famille, inconnus dans le reste de la France, et qui plaçaient Ie vassal reconnaissant et soumis sous l'influence exclusive de son curé et de son seigneur. D'ailleurs n'avaient-elles pas aussi leur poésie, ces traditions intimes de village ! Dieu et le Roi, cette double manifestation de la puissance divine et humaine, cette protection sur la terre, cette récompense dans le ciel, ce symbole de justice et de bonté autour duquel on ne laissait planer aucune ombre, aucun soupçon, ne devait-il pas suffire à remplir ces coeurs simples, confiants et fidèles ?
Les premiers actes de la Révolution passèrent inaperçus ; la portée n'en fut pas comprise. Comment préjuger les conséquences de principes qui n'avaient pénétré dans aucune intelligence ? La captivité du roi, la persécution des nobles, le schisme dans l'Élise à l'occasion du serment constitutionnel, voilà les faits par lesquels se révéla le grand drame et pour seuls interprètes à ces faits, le prêtre qui se cache et le seigneur dépossédé !
Ce n'est pas tout : à ces motifs de mécontentement et d'aversion vient s'ajouter pour chacun une atteinte plus personnelle, qui comble la mesure et détermine l'explosion, c'était la conscription et les levées extraordinaires. Le Vendéen est brave, il devait bientôt le prouver : ce n'est pas la mort qu'il redoute, mais l'absence des siens, l'éloignement du foyer. Et dans quels rangs fallait-il aller combattre ? Parmi ceux qui avaient chassé le roi de son château et Dieu de ses églises !
Au milieu des luttes civiles et étrangères que la Révolution soutenait pour le triomphe des principes qu'elle avait proclamés, ils relevèrent le drapeau de la royauté en face de la république incomprise ; les deux forces se heurtèrent et une guerre de géants commença.
Quelques émeutes partielles et une fermentation sourde annonçaient que la levée de 1793 éprouverait de grandes difficultés ; cependant il y avait encore hésitation, lorsque, le 10 mars, un coup de canon tiré imprudemment, dans la ville de Saint-Florent-le-Vieil, sur des conscrits réfractaires, porta la rage dans tous les coeurs et hâta la crise.
Le soir même, six jeunes gens, qui rentraient dans leur famille, traversant le bourg de Pin-en-Mauge, y furent accostés par un homme qui, les bras nus, pétrissait le pain du ménage et, venant d'apprendre l'épisode de Saint-Florent, leur en demanda les détails ; c'était un colporteur marchand de laine, père de cinq enfants ; il se nommait Cathelineau et avait dans tous les environs la réputation d'un homme d'intelligence et d'énergie. Il était rempli d'une indignation qu'il sut communiquer à ses auditeurs ; ils sont vingt-sept et n'ont à la main que des bâtons ; dans trois mois, ils seront vingt mille et assiégeront Nantes sous les ordres du généralissime Cathelineau.
La petite troupe, en effet, recrute des forces de métairie en métairie ; elle arrive, le 14, à La Poitevinière. Le tocsin sonne de clocher en clocher. A ce signal, tout paysan valide fait sa prière, prend son chapelet et son fusil, ou, s'il n'a pas de fusil, sa faux retournée, embrasse sa mère ou sa femme, et court rejoindre ses frères à travers les haies.
Le château de Jallais, défendu par un détachement du 84e régiment de ligne et par la garde nationale de Chalonnes, est attaqué. Le médecin Rousseau, qui la commande, fait braquer sur les assiégeants une pièce de six ; mais les jeunes gars improvisent la tactique qui leur vaudra tant de victoires : ils se jettent tous à la fois ventre à terre, laissent passer la mitraille sur leurs têtes, se relèvent, s'élancent et enlèvent. la pièce avec ses artilleurs.
Ces premiers progrès donnent à la révolte d'énormes et rapides développements ; mais elle eut à lutter contre le plus énergique pouvoir qui ait jamais gouverné la France. Le 13 mars, la Convention rend un décret dont l'article 6 condamne à mort les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, leurs agents ou domestiques, ceux qui ont en des emplois ou exercé des fonctions publiques sous l'ancien gouvernement ou depuis la Révolution, pour le fait seul de leur présence en pays insurgé.
Cette sommation, si elle ne parvenait pas à étouffer la guerre, devait lui donner un caractère ouvertement politique. C'est ce qui arriva. Les paysans, trop enivrés de leurs premiers triomphes pour renoncer à la lutte, trop clairvoyants cependant pour ne pas sentir l'insuffisance de leurs ressources dans la direction d'une guerre sérieuse, s'adressèrent à ceux dont le décret faisait les principaux intéressés ; c'est ainsi que M. de Charette, de La Rochejaquelein, de Lescure, d'Elbée, de Bonchamp, Dommaigné, prirent les commandements.
Les ordres de rassemblement portaient : « Au saint nom de Dieu, de par le Roi, la paroisse de... se rendra tel jour à tel endroit, avec ses armes et du pain. » Là, on s'organisait par compagnie et par clocher ; chaque compagnie choisissait son capitaine par acclamation ; c'était, d'ordinaire, le plus fort et le plus brave. Tous lui juraient obéissance à la vie et à la mort. Ceux qui avaient des chevaux formaient la cavalerie.
L'aspect de ces troupes était des plus étranges c'étaient des hommes et des chevaux de toutes tailles et de toutes couleurs ; des selles entremêlées de bâts ; des chapeaux, des bonnets et des mouchoirs de tête ; des reliques attachées à des cocardes blanches ; des cordes et des ficelles pour baudriers et pour étriers ; une précaution que personne n'oubliait, c'était d'attacher à sa boutonnière, à côté du chapelet et du sacré-cœur, sa cuiller de bois ou d'étain. Les chefs n'avaient guère plus de coquetterie. Les capitaines de paroisse n'ajoutaient à leur costume villageois qu'une longue plume blanche, fixée à la Henri IV, sur le bord relevé de leur chapeau.
La masse des combattants vendéens se divisait en trois classes : la première se composait de gardes-chasse, de braconniers, de contrebandiers, excellents tireurs, la plupart armés de fusils à deux coups et de pistolets. Ils formaient le corps des éclaireurs ; ils n'avaient pas besoin des officiers pour les commander ; ils se portaient rapidement le long des haies et des ravins, sur les ailes de l'ennemi qu'ils cherchaient toujours à dépasser. Ils ne tiraient qu'à portée, et il était rare qu'ils manquassent leur coup.
La seconde classe était celle des paysans les plus déterminés et les plus exercés au maniement du fusil. C'était la troupe des braves ; ils avaient appris à se connaître dans les combats. Les plus entreprenants soutenaient les tirailleurs que l'on regardait comme les premiers soldats de l'armée ; les autres attaquaient sur la ligne de l'ennemi, mais ils ne marchaient sur lui que lorsque les ailes commençaient à plier.
La troisième classe, composée du reste des paysans, la plupart mal armés, formait une masse confuse autour des canons et des caissons, que l'on tenait toujours à une grande distance ; la cavalerie, composée des hommes les plus intelligents, servait à la découverte de l'ennemi, à l'ouverture de la bataille, à la poursuite des fuyards, et surtout à la garde du pays après la dispersion des soldats.
Quand les combattants se trouvaient réunis, pour une expédition, au lieu qui leur avait été désigné, avant d'attaquer les bleus ou d'essuyer leur charge, la troupe entière tombait à genoux, chantait un cantique et recevait l'absolution du prêtre, qui, après avoir béni les armes, se mêlait souvent dans les rangs pour assister les blessés ou ramener les fuyards en leur montrant le crucifix.
La tactique des Vendéens était presque toujours la même. Pendant que leur avant-garde attaquait l'ennemi de front, tout le corps d'armée l'enveloppait, en se dispersant à droite et à gauche au commandement : Égaillez-vous allez-vous, les gars ! Ce cercle invisible se resserrait en tiraillant à travers les haies, et si les bleus ne parvenaient point à se dégager, ils périssaient tous dans quelque carrefour ou dans quelque chemin creux. Arrivés en face des canons dirigés contre eux, les plus intrépides Vendéens s'élançaient en faisant le plongeon à chaque décharge (Ventre à terre, les gars !) et s'emparaient des pièces en exterminant les canonniers.
Au premier pas des républicains en arrière, un cri sauvage des paysans annonçait leur déroute ; ce cri trouvait à l'instant et de proche en proche mille échos effroyables, et tous, sortant comme une fourmilière des broussailles, des genêts, des coteaux et des ravins, se ruaient corps à corps à la poursuite et au carnage. Chacun démontait un bleu, l'égorgeait ou lui brûlait la cervelle, et lui prenait son cheval, son argent et ses armes.
On conçoit quel était l'avantage des indigènes dans ce labyrinthe fourré du Bocage, dont eux seuls connaissaient les détours. S'ils étaient vaincus, ils trouvaient le même avantage pour fuir ; aussi leurs chefs avaient-ils toutes les peines du monde à les rallier. Au reste, il ne fallait pas que la durée des expéditions dépassât plus d'une semaine.
Ce terme arrivé, quel que fût le dénouement, le paysan retournait faire sa moisson, embrasser sa femme et prendre une chemise blanche ; quitte à revenir avec une religieuse exactitude au premier appel de ses chefs. Le respect de ces habitudes était une des conditions du succès ; on en eut la preuve lorsque, le cercle des opérations s'élargissant, on voulut assujettir ces vainqueurs indisciplinés à des excursions plus éloignées et à une plus longue présence sous les armes.
Tout Vendéen fit d'abord la guerre à ses frais, payant ses dépenses de sa bourse et vivant de l'humble pain de son ménage. Plus tard, quand les châteaux et les chaumières furent brûlés, on émit des bons au nom du roi ; les paroisses se cotisèrent pour les fournitures de grains, de boeufs et de moutons. Les femmes apprêtaient le pain, et, à genoux sur les routes où les paysans devaient passer, elles récitaient le chapelet en attendant les soldats auxquels elles offraient l'aumône de la foi.
Les paroisses armées communiquaient entre elles au moyen de courriers établis dans toutes les communes et toujours prêts à partir. Ces courriers, connaissant les moindres détours du pays, se glissaient invisibles à travers les ligues des bleus. C'étaient souvent des enfants et des femmes qui portaient dans leurs sabots les dépêches de la plus terrible gravité.
Les Vendéens avaient organisé une correspondance télégraphique au sommet de toutes les hauteurs, de tous les moulins et de tous les grands arbres de leur pays. Ils appliquaient à ces arbres des échelles portatives, observaient des plus hautes branches la marche des bleus, et tiraient un son convenu de leurs cornes de pasteur. Ce son, répété de distance en distance, portait la bonne ou la mauvaise nouvelle à tous ceux qu'elle intéressait. La disposition des ailes de moulin avait aussi son langage. Ceux de la montagne des Alouettes, près des Herbiers, étaient consultés à toute heure par les divisions du centre. Voilà ce qu'avait fait de cette pacifique contrée la loi politique et religieuse.
Les départements-(histoire)- Vaucluse - 84 -
Le territoire qui forme aujourd'hui le département de Vaucluse était occupé, avant la conquête romaine, par trois peuplades celtiques, les Cavares, les Voconces et les Méminiens. Les Cavares, répandus sur les bords du Rhône et de la Durance, occupaient les pays d'orange (Arausio), d'Avignon (Aouenion) et de Cavaillon. Les Voconces avaient pour capitale Vaison, au nord-est, et les Méminiens étaient fixés aux alentours de Carpentras, sur le versant méridional du mont Ventoux.
Les Phéniciens pénétrèrent chez ces peuples et lièrent avec eux des relations de commerce. Plus tard, les Phocéens s'étant établis à Marseille, les Cavares devinrent les alliés de cette florissante république, dont le contact adoucit leurs moeurs et les enrichit. Cette alliance avec Marseille les entraîna dans l'alliance de Rome. Ils tentèrent, mais en vain, d'arrêter Annibal au passage du Rhône, et ils s'armèrent encore, mais inutilement, quand ils virent les vainqueurs de Carthage s'introduire au coeur de la Gaule et, dans leur pays même, porter les premiers coups à l'indépendance de la grande nation des Celtes ; car c'est tout près d'Avignon, au confluent de la Sorgues et du Rhône, que le consul Cn. Domitius Ahenobarbus, l'an 121 avant J.-C., défit complètement les Arvernes et dressa des tours chargées de trophées, contrairement, dit Florus, à l'usage des Romains, qui n'avaient point l'habitude de reprocher aux vaincus leur défaite. La protection de Rome se changea bientôt en domination. Les Cavares, les Voconces, les Méminiens furent enveloppés dans la Narbonnaise. Après la division de la Gaule en dix-sept provinces, ils furent compris dans la Viennoise.
Avec les moeurs celtiques, déjà fort modifiées, disparurent les monuments mégalithiques, et l'on aurait grande peine, avec le petit nombre de médailles gauloises trouvées jusqu'ici dans la contrée, à reconstruire l'histoire de la période celtique. Rome recouvrit tout de sa civilisation et de ses monuments, et le département de Vaucluse nous en offre encore aujourd'hui de magnifiques restes. La population elle-même fut à peu près renouvelée, et par les colonies militaires que César y établit, et par le grand nombre de Romains que l'administration, le commerce les intérêts de toute sorte y attirèrent pendant la longue durée de l'empire.
Dans le partage que les barbares du Ve siècle se firent de la Gaule, les bords du Rhône et de la Durance, ravagés par les Alains, les Suèves, les Vandales et les Goths, échurent aux Burgondes et furent compris dans leur royaume. Mais les Francs les leur disputèrent plus d'une fois ; Clovis y parut. Les rois d'Austrasie tinrent longtemps Avignon en leur puissance. Les Lombards se montrèrent ensuite, et furent repoussés par le patrice Mummol ; vinrent ensuite les Sarrasins, à qui Mauronte, maître de Marseille, ouvrit le pays. Charles Martel les chassa (737).
Après le démembrement de l'empire carlovingien et du royaume d'Arles, fondé par Boson, l'Avignonnais et le Venaissin échurent aux comtes de Provence. C'est à tort que l'on a quelquefois regardé comme une même chose le comtat d'Avignon et le comtat Venaissin. Le Venaissin, qui ne fut érigé en comté qu'au XIVe siècle par Clément V, était un pays distinct de l'Avignonnais. Il paraît tirer son nom de Vénasque, jadis ville importante, évêché et capitale du pays avant que Carpentras lui eût ravi ce titre.
Après les comtes de Provence, ce furent les comtes de Toulouse qui devinrent maîtres de ces deux pays, et ils le demeurèrent pendant plus de deux siècles. Par le traité de Meaux (1229), Raymond VII abandonna au pape tout ce qu'il possédait sur la rive gauche du Rhône. Cette cession, confirmée en 1274 par Philippe le Hardi, mit les papes en possession du comtat Venaissin.
Le comtat d'Avignon ne leur appartint qu'en 1348, après que Jeanne, reine de Naples, l'eût vendu à Clément VI. Bien qu'ils eussent cessé de résider dans le pays en 1376, ils le gardèrent néanmoins jusqu'à la Révolution française, en se faisant représenter à Avignon par un vice-légat, et dans le comtat Venaissin par un ecclésiastique d'un rang moins élevé qu'on appelait recteur.
Seulement, dans cet intervalle, les deux comtats furent trois fois saisis par les rois de France : la première fois par Louis XIV, de juillet,1663 à juillet 1664, à l'occasion de l'insulte faite par la garde corse du pape à l'ambassadeur de France, le duc de Créqui ; la seconde fois encore par Louis XIV, lors de ses démêlés avec Innocent XI, d'octobre 1689 à octobre 1689, en vertu d'un arrêt rendu en 1683 par le Parlement, et portant réunion de ces pays au royaume ; la troisième fois enfin, de 1768 à 1774, par Louis XV, qui voulait punir l'affront fait par Clément XIII au duc de Parme. Toujours restituées par les rois aux pontifes, ces enclaves, qui rompaient l'unité du royaume dans le Midi, ne furent définitivement ramenées dans le sein de la France que par la Révolution ; mais ce ne fut pas sans quelques difficultés.
Les obstacles ne vinrent pas, comme on pourrait le croire, d'une opposition d'idées. Il semble que les Avignonnais et les Venaissinois, si longtemps soumis à la tiare, eussent dû haïr les doctrines révolutionnaires ; ce fut le contraire, ils leur ouvrirent les bras. Dès 1790, Avignon substituait les armes de France à celles de Rome et chassait le vice-légat.
Quant aux Venaissinois, ils tinrent une conduite plus singulière ; ils eurent la prétention de former un petit État indépendant, qui réaliserait chez lui les réformes de la Constituante, mais sans souffrir qu'on parlât de le réunir à la France. Dès 1785, l'assemblée ordinaire du Venaissin avait songé à opérer des réformes.
Mais, en 1789, l'effervescence croissant et faisant éclater des insurrections en plusieurs lieux, elle supplia le pape Pie VI de permettre la convocation des états généraux de la province, qui n'avaient pas été réunis depuis 1596. Le pape éluda, nomma une commission de réformes ; mais les Venaissinois ne se laissèrent point payer de celle monnaie, et il fallut que le légat autorisât enfin les élections ; elles se firent en avril 1790 ; l'assemblée fut formée de cent sept députés, quatorze pour le clergé, neuf pour la noblesse, quatre-vingt-quatre pour le tiers. La division des ordres était maintenue. Le 30 mai, les états généraux ouvrirent leurs séances et prirent le titre d'Assemblée représentative.
L'égalité de l'impôt, l'abolition des immunités ecclésiastiques et des titres de noblesse furent adoptées ; Pie VI fut déclaré prince constitutionnel des Venaissinois. Comme Avignon voulait contrarier la révolution venaissinoise et la forcer de se confondre dans la Révolution française en l'associant à la fédération, l'Assemblée représentative forma un camp de douze mille hommes à la tour de Sabran, renouvela le serment de fidélité à Pie VI et accueillit le vice-légat fugitif.
Mais toujours révolutionnaire, alors même qu'elle demeurait fidèle au pape, elle vota, malgré le veto du vice-légat, l'abolition des justices seigneuriales et une nouvelle organisation judiciaire, puis divisa le pays en quatre départements : d'Aigues, de l'Auzon, de l'Ouvèze et de Vaucluse.
Cette innocente parodie de la grande Révolution française ne pouvait durer bien longtemps. Les Avignonnais envahirent le Venaissin et enlevèrent Cavaillon ; la lutte devint sanglante ; Carpentras, deux fois assiégée, opposa une héroïque résistance à Jourdan Coupe-tête, qui lui lança en vain plus de deux cent boulets rouges. Mais, malgré tout, le parti français gagnait chaque jour du terrain, même dans le pays. L'Assemblée nationale de France chargea enfin trois commissaires, Verninac Saint Maur, Lescène-des-Maisons et l'abbé Mulot, d'aller mettre fin à une lutte aussi funeste que ridicule, et, le 14 septembre 1791, un décret, rendu sur la proposition du député Camus, réunit à la France Avignon et le comtat Venaissin.
Nous avons laissé de côté jusqu'ici cette partie du pays des Cavares où est située Orange. Elle fut érigée par Charlemagne en comté et donnée à Guillaume au Cornet, qui s'était distingué par sa valeur dans la guerre contre les infidèles. Ce Guillaume fut le chef de la première maison d'Orange, éteinte dans les mâles en 1185. L'héritière, Tiburge, avait épousé Bertrand, de l'illustre famille des Baux, lequel fonda la seconde maison d'Orange. C'est son fils, Guillaume V, qui échangea le titre de comte contre celui de prince d'Orange par la grâce de Dieu, auquel il joignit celui de roi d'Arles, par autorisation de l'empereur Frédéric Il (1214).
La troisième maison d'Orange commença, à la fin du XIVe siècle, dans la personne de Jean de Châlons, époux de l'héritière, Marie de Baux. Cette maison est illustre, mais elle se montra généralement hostile aux rois de France. Louis Ier, fils de Jean, nommé gouverneur du Languedoc par lsabeau de Bavière, repoussa des murs d'Orange le dauphin Charles ; en 1430, il envahit le Dauphiné en compagnie du duc de Savoie ; mais il fut repoussé par le gouverneur Gaucourt, et se laissa même enlever un instant sa capitale.
Guillaume VIII ne fut pas plus heureux, et, après avoir accompagné Charles le Téméraire au siège de Liège, se fit faire prisonnier par Louis XI, qui l'obligea de lui prêter l'hommage féodal (1473). Son successeur prit part aux complots du duc d'Orléans pendant la minorité de Charles VIII, et fut avec lui fait prisonnier à Saint-Aubin-du-Cormier. Enfin Philibert ler, le plus considérable par ses talents, passa dans le camp de Charles-Quint pour se venger de l'affront que lui avait fait François Ier. Celui-ci confisqua sa principauté, s'empara de sa personne et le tint captif à Bourges, jusque après le traité de Madrid.
Philibert fut tué en 1530 au siège de Florence, après avoir institué son héritier son neveu, René de Nassau ; sa sœur, Claude, ayant épousé Henri, comte de Nassau. Ce René commença donc, en,1530, la quatrième maison d'Orange, Nassau Orange, la plus fameuse de toutes ; c'est de celle là que sortiront Guillaume IX, fondateur de la république des Provinces-Unies, et Guillaume-Henri, l'ennemi acharné de Louis XIV, roi d'Angleterre après la révolution de 1688.
Ce dernier étant mort sans postérité la principauté d'Orange devint l'héritage de Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, qui la céda à la France au traité d'Utrecht ; il fut alors stipulé que les héritiers du prince de Nassau auraient le droit d'imposer à une partie de la Gueldre le nom de principauté d'Orange et d'en retenir le titre et les armoiries. Depuis ce temps, l'héritier présomptif du royaume de Hollande porte le titre de prince d'Orange. Quant à la véritable principauté d'Orange, détachée un instant de la couronne en faveur du prince Armand de Bourbon-Conti, elle y fut de nouveau et définitivement réunie en 1731, et fit partie de la province de Dauphiné.
Lors de la division de la France en départements, en 1791, le comtat d'Avignon, le comtat Venaissin et la principauté d'Orange furent réunis pour former celui de Vaucluse.
Les départements-(histoire)- Var - 83 -
L'histoire du département du Var se confond tellement avec celle des deux départements limitrophes, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Hautes-Provence, que nous nous contenterons d'en faire une esquisse rapide, en renvoyant pour plus de développements à l'histoire de ces deux départements.
Des peuplades celtiques, appartenant à la confédération puissante des Ligures Saliens, en occupaient le territoire avant la conquête romaine c'étaient les Décéates, dans le village d'Antibes ; les Suétriens, les Quariates, les Adunicates, les Oxybiens, les Ligaunienset les Sueltères, dans le bassin de l'Argens, la rivière aux eaux blanches comme l'argent.
Ces peuples ont laissé peu de monuments. On montre pourtant près de Draguignan un imposant dolmen : moins embarrassée que la science pour expliquer les mystères archéologiques, l'imagination populaire, en Provence comme en Bretagne, a évoqué la toute-puissance des fées.
Le pâtre provençal a oublié les sanglants sacrifices de ses pères : il vous raconte dans sa langue harmonieuse que, en des temps bien éloignés, une fée, qui se plaisait à se déguiser en bergère et à jouer de la mandoline sous les bosquets d'orangers et de grenadiers, inspira un violent amour à un jeune seigneur, qui lui-même était un génie. Il lui demanda sa main et elle promit de l'épouser, mais à une condition : il fallait que son mariage fût célébré sur une table formée de trois pierres, dont deux dressées sur le tranchant et à neuf pas de distance, et ayant pareille hauteur, serviraient de supports à une troisième presque carrée, de onze pas de long sur deux pas d'épaisseur. A cette description, le seigneur reconnut trois pierres énormes qui, depuis dix siècles, avaient roulé du haut de la montagne de Fréjus dans la gorge que parcourt la grande route.
Le génie se mit à l'oeuvre ; il dressa les deux pierres qui devaient servir de supports, mais sa puissance n'alla pas jusqu'à remuer la troisième, tant elle était lourde. La bergère fée eut pitié de sa peine : elle se rendit la nuit auprès de l'énorme pierre et traça alentour avec sa baguette un cercle magique ; aussitôt une grande flamme sortit de terre, et la pierre fut en un instant transportée sur les deux autres. Elle attendit le lendemain son amant avec plus d'impatience, espérant jouir de sa surprise : mais, à peine eut-il vu accomplie la condition d'où semblait dépendre son bonheur, qu'il tomba mourant aux pieds de celle qu'il aimait. Avant d'expirer, il lui révéla un fatal secret : on lui avait prédit qu'il mourrait quand il serait amoureux d'une personne plus puissante que lui, et il avait cru, en adressant ses vœux à une bergère, n'avoir rien à redouter. La légende ajoute que la pauvre fée, désespérée des funestes effets de son travestissement, suivit de près l'amant dont elle avait causé la mort.
L'esprit grec est-il pour quelque chose dans ces gracieuses légendes ? Avant les Romains, les Grecs de Marseille occupèrent ces rivages. Antipolis (Antibes), Athaenopolis (dans l'anse d'Agay), Olbia l'heureuse (près d'Hyères), Fréjus, sous un autre nom, d'autres encore, étaient des colonies de la colonie phocéenne devenue métropole à son tour.
Les légions de Rome parurent en 125 avant Jésus-Christ, et, bientôt après, le pays devenait province romaine. Lors de la division de la Gaule en dix-sept provinces, le territoire actuel du déparquement fut compris dans la Seconde Narbonnaise qui s'étendait du Var au Rhône. Ce pays, qui était pour les Romains l'entrée de la Gaule, reçut nécessairement la profonde empreinte de leur civilisation.
Les monuments n'y manquent point, sans y être pourtant aussi nombreux et aussi magnifiques que dans les départements voisins, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, où se formèrent les principaux établissements. La grande voie Aurélienne traversait intérieurement le pays de l'est à l'ouest, en projetant sur la côte plusieurs embranchements. La plupart des villes et même des villages qui s'élèvent encore aujourd'hui sur cette voie sont d'origine antique : Antibes (Antipolis), Auribeau (ad Horrea). Fréjus (Forum Julii), Le Luc (Forum Voconii), Cabasse (Matavonium), Tourves (ad Turrim), la grande Pugère (Tegulatum), où l'on voit les ruines d'un pont romain.
Le tracé de la voie romaine est à peu près, comme on le voit, celui de la grande route actuelle. Sur l'embranchement maritime qui longeait la côte, à partir de Fréjus, on trouvait Heraclea Caccabaria (près de Saint-Tropez), Alconis (Aiguebonne); Pomponiana (?), Telo Martius (Toulon), Tauroentum (près de La Ciotat).
A la domination de Rome succéda celle des Burgondes, des Ostrogoths, des Francs. Quand l'empire de Charlemagne se démembra, le royaume d'Arles, érigé par Boson (879), enveloppa toute la Provence. Au siècle suivant, la Provence devint un comté. Cette période fut désastreuse pour le pays à cause des Sarrasins, qui ne cessèrent d'y exercer de cruels ravages. Leur première descente est de 736 ; ils saccagèrent le monastère de Lérins et détruisirent presque tous les bourgs et villages de la contrée.
Le XIVe siècle ne fut pas moins malheureux pour le pays qui nous occupe : mis à contribution à deux reprises (1362-1364) par les Espagnols de Henri de Transtamare, écrasé sous le poids des impôts, il fut un des théâtres de la révolte des tuchins ou coquins, malheureux que l'excès de la misère poussa à l'insurrection. Le peuple appelle encore aujourd'hui matouchins (mali tuchini) les brigands et les voleurs.
Les guerres de François ler et de Charles-Quint attirèrent deux fois les ennemis dans la Provence. La première expédition fut celle du connétable de Bourbon, qui, repoussé de Marseille, se retira sur le Var à travers la province qu'il avait traversée un mois auparavant avec une présomptueuse confiance (septembre 1524). La seconde fut celle de Charles-Quint, lui-même (1536).
Battu à Aix, le puissant empereur fit une retraite encore plus désastreuse que le connétable ; car il trouva sur sa route des populations irritées de la désolation de leur pays. Embusqués dans toutes les gorges, derrière les buissons et les masures de leur difficile contrée, les paysans du Var firent un mal terrible aux impériaux. Ils déchargeaient leurs armes et se retiraient aussitôt dans des lieux sûrs. Pourtant les espions de l'empereur découvrirent un bois qui servait de retraite à un certain nombre d'entre eux ; on y mit le feu et on l'entoura d'un cordon de troupes, qui rejetaient dans les flammes les malheureux qui tentaient de s'échapper. Hommes, femmes, enfants, bestiaux, tout fut consumé.
Mais le plus fameux épisode de cette retraite est celui dont fut témoin le village du Muy, à peu de distance de Draguignan, sur l'Argens. Près de ce village, et sur la route que devait suivre l'armée impériale, s'élevait une vieille tour isolée. Cinq gentilshommes provençaux, Albode, Châteauneuf, Balbe, Escragnole et Boniface, s'y embusquèrent avec quinze soldats et trente hommes armés, tous pleins de courage et résolus, au péril de leur vie, à venger leurs compatriotes en immolant l'empereur lui-même. Quand l'armée passa, leurs yeux, qui guettaient avidement leur proie, furent éblouis par la riche monture et le magnifique costume d'un seigneur espagnol qui marchait entouré d'une troupe d'élite. Ils firent feu, croyant tuer Charles-Quint : ce n'était pas lui, c'était le jeune et brillant poète Garcilaso.
Les Espagnols, surpris de cette décharge soudaine, s'élancent vers la tour ; ils sont repoussés avec perte. Enfin Charles-Quint arriva avec du canon et vint à bout du glorieux asile de ces braves défenseurs de la patrie. Quelques-uns survivaient ; on leur promit la vie sauve, mais ils furent pendus par une insigne perfidie.
Depuis le XVIe siècle, le département du Var vit encore les ennemis de la France le franchir ou débarquer sur ses côtes : le prince Eugène et le duc de Savoie en 1707 ; les Autrichiens en 1746 ; les Anglais en 1793 ; les alliés en 1814. Et toujours les invasions dirigées de ce côté ont échoué ou n'ont eu que des résultats peu durables.
Les départements-(histoire)-Tarn et Garonne -82-
Lorsque, en 1808, Napoléon Ier traversa le midi de la France, il passa à Montauban. Touché des plaintes des habitants, qui gémissaient de voir leur glorieuse ville si industrieuse et si peuplée réduite à l'humble rang de chef-lieu d'arrondissement, il traça sur-le-champ, aux dépens des cinq départements du Lot, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne et du Gers, la circonscription d'un département nouveau dont Montauban fut le chef-lieu.
Un sénatus-consulte du 2 novembre 1808 consacra la volonté impériale. Si la nouvelle division rendait à Montauban un rang digne d'elle, celle que l'Assemblée constituante avait précédemment établie était cependant préférable au point de vue historique, puisqu'elle concordait jusqu'à un certain point avec l'ancienne division provinciale.
Le département de Tarn-et-Garonne, au contraire, fut formé sur un point limitrophe de cinq provinces anciennes dont chacune lui donna un lambeau ; il se compose, en effet, du bas Quercy et d'une partie du haut Languedoc, de l'Agénois, de la Lomagne et de la basse Marche du Rouergue. C'est assez dire que ce département n'a pas d'histoire qui lui soit propre et que nous sommes dans l'obligation de renvoyer le lecteur à celle des cinq départements énumérés plus haut. Nous rappellerons cependant eu peu de mots le sort des provinces qui ont contribué à le former.
Le Quercy était occupé, à l'époque de l'invasion romaine, par les Cadurci. II fut compris, après la conquête, dans l'Aquitaine, plus tard dans l'Aquitaine Ire. Les Wisigoths l'occupèrent au Ve siècle et en furent dépossédés au VIe par les Francs. Les rois francs successeurs de Clovis se partagèrent l'Aquitaine, et le Quercy échut a ceux d'Austrasie.
Au commencement du VIIIe siècle, Eudes, duc d'Aquitaine, s'en rendit maître et sa famille continua d'y régner jusqu'a la conquête qu'en fit Pépin le Bref (768). Il resta soumis a l'autorité plus ou moins effective des Carlovingiens jusqu'à la naissance du régime féodal. Les comtes de Toulouse le possédèrent alors aussi longtemps que dura leur puissance, anéantie en 1229 par le traité de Meaux. Réuni ensuite à la couronne de France, il fut abandonné aux Anglais par le traité de Brétigny (1360) ; mais Charles V le leur enleva, et depuis lors il n'a plus été détaché de la monarchie. Montauban était la capitale du bas Quercy, tandis que le haut Quercy avait pour capitale Cahors.
Le Rouergue était occupé par les Rutheni. Son histoire est à peu près la même que celle du Quercy. Il fut aussi compris dans l'Aquitaine Ire, conquis successivement par les Wisigoths, les Francs, Eudes d'Aquitaine et Pépin le Bref : Il eut, à l'époque féodale, des comtes particuliers ; passa à la maison d'Armagnac, qui le transmit elle-même a celle de Navarre, et fut enfin réuni par Henri IV a la couronne de France. Le Rouergue, dont la capitale était Rodez, se divisait en haute et basse Marche. La partie orientale du département de Tarn-et-Garonne (Caylus, Saint-Antonin) appartenait à la basse Marche de Rouergue.
On peut juger que le département de Tarn-et-Garonne a eu sa part a peu près de tous les événements considérables du midi de la France. Guerre des Francs et des Aquitains, guerre des Albigeois, guerre des Anglais, guerres de religion. Nous ne reviendrons sur ces événements, racontés ailleurs dans leur ensemble, que pour les détails particuliers aux localités de notre département.
Quoique le département de Tarn-et-Garonne ne soit pas des plus remarquables en fait d'antiquités, nous n'omettrons point de dire cependant qu'il possède plusieurs dolmens druidiques à Sept-fonds, Bruniquel, Saint-Antonin, Loze, Saint-Projet, etc. ; des tumulus, dont le plus remarquable est celui du Bretou ; des buttes, des camps retranchés, des .restes de camps romains a Gandalon, à Asques et à Bouloc, et quantité de ruines romaines et du Moyen Age.
Le Quercy et le Rouergue formaient, avant la Révolution, une généralité dont Montauban était la capitale ; c'est ce que l'on appelait la haute Guyenne, avec une assemblée provinciale particulière. L'Agénois, ancien pays des Nitiobriges, offre à peu près les mêmes vicissitudes dans son histoire que les provinces dont nous venons de parler et suivit le sort de la Guyenne ; il a fourni la partie occidentale de notre département (Moissac).
A la vicomté de Lomagne le déportement de Tarn-et-Garonne doit la partie sud-ouest de son territoire, sur la rive gauche de la Garonne (Beaumont-de-Lomagne, etc.). Cette vicomté, située jadis dans le bas Armagnac, suivit le sort de la province dont elle dépendait et appartient aujourd'hui presque entièrement au département du Gers.
Enfin le haut Languedoc formait le long de la Garonne, entre les diverses provinces dont nous venons de parler, une pointe où se trouvaient situés Castelsarrasin, Montech, etc. C'est cette pointe qui a été incorporée, assez naturellement du reste, au département de Tarn-et-Garonne.
Les départements-(histoire)- Tarn - 81 -
Castres
2ème partie
Le plan tracé par le pape était de ménager le comte, s'il ne paraissait pas empressé à secourir les hérétiques. Milon n'avait été nommé légat que pour donner le change a Raymond, qui s'était plaint de la raideur de l'abbé de Cîteaux.
La conduite indécise du comte de Toulouse favorisa les vues d'Innocent. Dans une assemblée réunie par lui à Aubenas (Vivarais), son neveu, Raymond-Roger Trencavel, vicomte de Béziers, Albi, Rasez, Carcassonne, lui conseillait valeureusement de convoquer tous ses amis, de mettre en défense toutes ses places fortes et de tenir tête à l'orage.
Effrayé d'un si grand danger, le comte répondit qu'il ne voulait pas se brouiller avec l'Église. II se rendit a Valence, où l'appelait le légat, et lui remit les clefs de sept de ses plus forts châteaux ; il se laissa ensuite conduire a Saint-Gilles. Là, en présence de vingt archevêques ou évêques, il fit amende honorable ; on lui mit au cou une étole, et le légat, le tirant par cette étole, l'introduisit dans l'église en le flagellant ; enfin la croix parut sur sa poitrine en signe qu'il allait prendre les armes contre ses propres sujets.
L'armée s'ébranla, passa par Montpellier, fondit sur Béziers, dont nous raconterons ailleurs la catastrophe. L'esprit de cette guerre se résume dans ce mot, qui, malheureusement, appartient bien à l'histoire d'Arnaud-Amaury : « Tuez-les tous, Dieu saura bien distinguer les siens. » - « Brûlez-les tous deux, disait de même Simon de Montfort ; si celui-ci parle de bonne foi, le feu lui servira pour l'expiation de ses péchés ; s'il ment, il portera la peine de son imposture. »
Après Béziers, ce fut le tour de Carcassonne, où fut pris traîtreusement le vicomte Raymond-Roger, qui mourut en prison peu de temps après, de dysenterie, dit-on. Il laissait un fils en bas âge, Raymond Trencavel II, né en 1207.
Le bel héritage des quatre vicomtés que cet enfant semblait destiné a recueillir lui fut enlevé, et le légat l'offrit successivement au duc de Bourgogne, aux comtes de Nevers et de Saint-Pol, qui tous le refusèrent. « Le légat, fort malcontent et embarrassé, offrit en dernier lieu la seigneurie à Simon, comte de Montfort, lequel la désirait et la prit. » Pour intéresser l'Église à lui conserver ces nouveaux domaines, Simon ordonna qu'un cens de trois deniers, par feu ou par maison, serait levé au profit de la cour de Rome, sans compter une redevance annuelle dont il fixa la somme.
Le chef des croisés n'occupait encore que Castres dans l'Albigeois ; il s'y rendit en personne, s'empara de Lombers, où cinquante chevaliers avaient formé un complot pour s'emparer de sa personne ; il entra dans Albi, dont l'évêque lui ouvrit les portes. Une révolte, excitée par le roi d'Aragon, ne tarda pas à le chasser de presque toutes ces places ; mais il y rentra bientôt l'épée à la main ; une bulle du pape le confirma dans la possession d'Albi (1210).
L'Albigeois était le chemin de Toulouse. Le comte voyait avec terreur approcher les croisés. Il courut à Paris et de Paris à Rome. Philippe-Auguste, qui approuvait peu la croisade et qui en avait refusé le commandement sous prétexte « qu'il avait à ses côtés deux grands lions menaçants, le roi d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne, » lui donna une lettre pour le pape. Innocent se montra bien disposé en sa faveur.
Mais les légats, plus zélés que le pape, l'évêque de Toulouse, Fouquet, troubadour transfuge, l'abbé de Cîteaux, Simon de Montfort, ne voulaient point se laisser arracher leur proie. Le concile d'Arles (1211) dicta au comte. des lois de fer. Raymond et le roi d'Aragon, Pierre II, qui intercédait en sa faveur, attendirent longtemps à la porte du concile, en plein air, « au froid et au vent. » Enfin on leur remit la charte qui contenait des conditions inacceptables.
Cette charte fut utile à Raymond ; il la montra partout, et ses sujets, chevaliers ou bourgeois, jurèrent de périr plutôt que d'accepter un tel esclavage. L'évêque Fouquet fut chassé de Toulouse ; défense faite aux habitants de donner des vivres aux croisés. Montfort, qui venait de prendre Lavaur, échoua devant la capitale du Languedoc.
La campagne fut tenue habilement et avec succès pendant l'hiver par les capitaines albigeois, particulièrement le comte de Foix. Montfort n'avait que peu de troupes dans cette saison ; la plupart des croisés ne donnant que le service de quarante jours, « le flot de la croisade tarissait vers L'automne pour ne revenir qu'au printemps. » (H. Martin.) II s'occupait de régler la conquête, de distribuer des fiefs aux hommes de la langue d'oil. Les moines se pourvoyaient de leur côté ; l'abbé de Cîteaux était élu évêque de Narbonne, et accolait à ce titre celui de duc ; l'abbé de Vaux-de-Cernai devenait évêque de Carcassonne.
Pierre II d'Aragon, libre du côté de l'Espagne par la bataille de Las Navas de Tolosa, intervint plus énergiquement. Raymond, qui était son beau-frère, remit entre ses mains « ses terres, son fils et sa femme. » Les représentations de Pierre émurent un instant le pape, qui suspendit la prédication de la croisade Hais, à l'instigation des chefs croisés, Innocent III revint sur ses dispositions indulgentes et exhorta Pierre à abandonner « le toulousain. »
Pierre n'en fit rien, et, le 10 septembre 1213, il assiégeait Muret. La grande bataille qu'il livra devant cette place, et qui lui coûta la vie, fut le coup fatal des Albigeois. Toulouse prise fut démantelée. Simon de Montfort fut institué « prince et monarque du pays » par les canons du concile de Montpellier, confirmés par le pape. Le quatrième concile de Latran, solennelle assemblée de 71 archevêques, 412 évêques et plus de 800 abbés et prieurs (1215), renouvela sa réfutation des doctrines hétérodoxes, le symbole de Nicée, et prescrivit des mesures qui, dans le Languedoc, devaient prévenir le retour de l'hérésie.
Le concile ratifia la fondation de deux ordres religieux nouveaux, spécialement établis en vue de l'hérésie albigeoise. « L'Église avait été ébranlée par la prédication hétérodoxe ; Dominique entreprit de la soutenir par la création d'un ordre exclusivement destiné à prêcher la foi catholique, et, sous les auspices de l'évêque Fouquet, il jeta les fondements de l'ordre des Prêcheurs dans Toulouse même, la métropole de l'hérésie. L'Église avait été attaquée au nom de l'inspiration mystique et du renoncement évangélique, François d'Assise transporta le mysticisme et la réalisation littérale de la pauvreté et de l'humilité chrétienne dans le sein de l'Église ; il fonda un ordre de moines qui renonçaient absolument, non plus seulement à la propriété individuelle, ainsi que les autres moines, mais a la propriété collective, et faisaient vœu de ne vivre que d'aumônes. »
C'est en vain que, du sein même de l'assemblée catholique, quelques voix courageuses protestèrent contre les effets désastreux de la croisade, qu'un chevalier ajourna le pape au jour du jugement s'il ne rendait pas au fils du vicomte de Béziers et d'Albi son héritage, que l'archidiacre de Lyon lui-même s'écria, montrant Fouquet : « Cet évêque fait vivre dans le deuil plus de cinq cent mille hommes, dont l'âme pleure et dont le corps saigne ! »
Innocent III, disposé à s'attendrir, ne put réserver au fils de Raymond VI que le marquisat de Provence, « s'il s'en rendait digne. » Tout le reste fut donné à Simon de Montfort, qui alla demander au roi Philippe-Auguste l'investiture du comté de Toulouse et du duché de Narbonne (1216), et qui se vit accueilli partout dans les campagnes de la langue d'oil à ce cri : « Béni soit celui qui. vient au nom du Seigneur ! ».
Les peuples de la langue d'oc pleuraient leur brillante et gracieuse civilisation broyée sous le fer des masses d'armes et jetée au feu des bûchers. « Ah ! s'écrie un troubadour, Toulouse et Provence, terre d'Agen, Béziers et Carcassonne, quelles je vous vis, et quelles je vous vois ! »
La mort d'Innocent IIII (1216) et celle de Simon de Montfort (1218) mirent fin à la première période de la guerre des Albigeois. Amaury, fils de Simon, confirmé dans la possession des conquêtes paternelles par le pape Honorius III, entra dans Albi. De son côté, Raymond VI entra dans l'Albigeois, qui devint le théâtre de la lutte. Raymond VII, lui ayant succédé (1222), enleva Albi à son rival, qui était dans le même temps attaqué d'un autre côté par Raymond Trencavel II, héritier des quatre vicomtés (1224). Amaury s'enfuit en France. L'hérésie releva la tête.
En 1222, Amaury avait offert à Philippe-Auguste ta cession de tous ses droits sur le comté de Toulouse. Ce monarque les avait refusés, et avait seulement autorisé son fils Louis à prendre part à la croisade. Devenu roi, Louis VIII reprit la croix et accepta l'offre d'Amaury ; puis avec 100 000 hommes il assiégea Avignon.
Le Languedoc, pendant ce temps, se soumettait à lui ; il parut à Albi et y séjourna quelque temps ; il reçut le serment de fidélité des habitants par l'intermédiaire de l'évêque, et c'est dans cette ville qu'il régla le sort des pays acquis par lui à la couronne ; il en confia le gouvernement a Humbert de Beaujeu, qui, bientôt abandonné à lui-même, déploya beaucoup d'énergie et d'habileté à poursuivre la guerre contre les hérétiques et contre Raymond VII.
Enfin le comte de Toulouse céda. En 1229, il reçut l'absolution de la main du cardinal légat dans l'église de Notre-Dame de Paris. Il s'engageait a démanteler trente une places fortes de ses États, entre autres, dans l'Albigeois, Lavaur, Gaillac, Rabastens, Montaigu, Puicelci ; les châteaux de Cordes et de Penne étaient remis à Louis IX pendant dix ans. La partie de l'Albigeois située sur la rive gauche du Tarn était réunie, avec Albi, au domaine royal ; la rive droite demeurait au comte. Castres fut inféodé a Philippe, neveu de Simon de Montfort.
Les deux parties de l'Albigeois eurent chacune un sénéchal, l'une pour le roi, l'autre pour le comte. Celle-ci était divisée en sept bailliages. La vaine tentative faite plus tard par Raymond VII, avec le secours de Henri III, roi d'Angleterre, et du comte de la Marche ayant échoué, Raymond Trencavel II, l'héritier dépouillé des quatre vicomtés, vendit tous ses droits a Louis IX, moyennant une pension de 600 livres sur la sénéchaussée de Beaucaire (1247).
Le siècle ne s'écoula pas sans que l'Albigeois de la rive droite du Tarn fût réuni à la couronne. Jeanne, fille de Raymond VII, et son mari, Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, en héritèrent à la mort de Raymond, et quand ils moururent à leur tour, ce pays fut réuni par les commissaires de Philippe le Hardi au domaine royal (1271).
La soumission du comte de Toulouse consomma la défaite de l'hérésie. Lui-même était obligé de se tourner contre elle, et s'engageait, par le traité de 1229, à payer pendant deux ans deux marcs d'argent, et, dans la suite, un marc à quiconque livrerait un hérétique, à confisquer les biens des sectaires, à les exclure des charges publiques, comme les juifs. II ordonna même de raser les maisons des protecteurs et fauteurs des hérétiques.
Saint Louis envoya a ses baillis une ordonnance dans le même sens, et le concile de Toulouse organisa l'inquisition permanente en établissant que les évêques « députeraient dans chaque paroisse un prêtre et deux ou trois laïques de bonne réputation, » qui visiteraient « toutes les maisons depuis le grenier jusqu'à la cave. » L'obligation de dénoncer commençait à quatorze ans pour les hommes, à douze ans pour les femmes ; on devait alors prêter un serment.
Les hérétiques convertis devaient porter sur la poitrine deux croix de couleurs tranchantes. Le concile de Narbonne (1244) obligea les hérétiques en voie de conversion a se présenter tous les dimanches a l'église, le corps en partie nu, avec une poignée de verges pour recevoir la discipline. Le comte de Béziers (1246) établit la peine du feu pour tous les partisans qui refuseraient d'abjurer. Le concile d'Albi (1254) ordonna la construction de prisons dans chaque diocèse pour recevoir les hérétiques.
Le pape Grégoire IX, en 1233, prétendit donner plus de rigueur encore à l'Inquisition en attribuant aux frères prêcheurs des pouvoirs absolus, supérieurs même à ceux des évêques. Les protestations de Raymond VII, de Louis IX, du haut clergé de France ne l'arrêtèrent pas. Raymond fut de nouveau excommunié ; mais toutes les populations étaient pour lui, et en plusieurs lieux maltraitèrent les inquisiteurs dominicains.
Ceux-ci n'en continuèrent pas moins leur sanglante mission jusqu'au règne de Philippe le Bel, qui d'abord envoya des commissaires (1302), puis vint lui-même (1304) dans le Languedoc pour faire cesser la tyrannie des dominicains. Un édit rendu par lui à Toulouse ordonna que les commissaires royaux visiteraient avec les inquisiteurs les prisons de l'Inquisition et veilleraient à ce qu'elles servissent « pour la garde et non pour la peine des prisonniers ; » que les évêques ou leurs vicaires instruiraient le procès des accusés sur le sort desquels il n'aurait pas été statué. Un peu plus tard, un décret du concile de Vienne, confirmé par Clément V, défendait aux inquisiteurs de procéder contre les hérétiques « sans le concert des évêques diocésains. »
Alors seulement, après un siècle de souffrances terribles, le Languedoc respira et le châtiment de l'hérésie albigeoise fut arrêté. Chose singulière, ruinée en Languedoc, elle s'était réfugiée et se relevait dans les pays étrangers, principalement en Lombardie . c'est de là qu'on vit dès lors partir souvent deux à deux, suivant la règle, des ministres parfaits, qui allaient à leur tour, à travers mille dangers, vêtus de bure, vivant d'aumônes, exhorter les habitants du Languedoc à leur rester fidèles.
L'histoire de l'Albigeois sera courte à achever après que nous avons terminé celle de l'hérésie albigeoise. Ce pays souffrit des guerres des Anglais et plus encore des ravages des routiers, quoiqu'il n'ait jamais été un des principaux théâtres de ces grandes luttes nationales.
Il fut agité au temps des guerres de religion comme toutes les contrées de la France. Les hérétiques y furent durement traités, et pourtant, en 1569, ils y possédaient trente-huit villes, bourgs ou villages, dont Gaillac, Lombers et Réalmont. L'année suivante, le fléau de la guerre cessant, celui de la famine commença avec accompagnement de fièvres pestilentielles, qui sévirent cruellement dans les pays d'Albi et de Castres.
Après la mort de Henri III, la Ligue établit son influence dans l'Albigeois. L'évêque d'Albi, d'Elbène, dont elle se méfiait, fut dépouillé de ses biens, et, en 1592, Antoine-Scipion de Joyeuse, maréchal de France de la création de Mayenne, battit les royalistes près de Montets ; ceux-ci eurent leur revanche à Vilennet, où ils enlevèrent le camp de Joyeuse, et ce malheureux maréchal alla en fuyant se noyer dans le Tarn. Son frère, Henri de Joyeuse, prit sa place dans le commandement et convoqua des états à Albi pour obtenir des subsides. Albi et Gaillac étaient les seules villes qui restaient à la Ligue. La paix de Folembray (1596) replaça tout le pays sous l'autorité royale.
Sous Louis XIII, la révolte du duc de Rohan et des protestants donna lieu à des événements militaires dans l'Albigeois. Lombers, Réalmont furent assiégées. Mais les protestants furent battus par le duc d'Angoulême, qu'accompagnait Alphonse d'Elbène, évêque d'Albi. Ce même évêque changea de rôle plus tard, et, moins fidèle à la cause royale, fut un des instigateurs de la révolte du duc d'Orléans, et jeta Albi et son diocèse dans le parti des rebelles. Les capucins et les jésuites d'Albi tournèrent contre lui les populations, et, quand la révolte fut apaisée, une commission ecclésiastique, nommée en vertu d'un bref d'Urbain VIII, le déposa (1634).
Depuis ce temps, on peut dire que les événements politiques n'ont que peu troublé le repos de l'Albigeois. La Révolution n'y commit que peu de violences. L'affaire de Fualdès, après la chute du premier Empire, fut la seule qui y réveilla les émotions endormies.
En 1790, l'Assemblée constituante avait réuni en un département les diocèses de Lavaur et de Castres ; cette dernière ville avait été choisie pour chef-lieu ; elle fut privée de ce titre par le Directoire, qui, pour la punir de quelques mouvements séditieux, le transféra à Albi. Le Concordat (1802) supprima le siège archiépiscopal d'Albi, érigé sous Louis XIV (1676) aux dépens de l'archevêché de Bourges, et comprit tout l'Albigeois dans le diocèse de Montpellier ; mais, sous la Restauration, ce siège fut rétabli, avec les évêchés de Cahors, Rodez, Perpignan et Mende pour suffragants.
Les départements-(histoire)- Tarn - 81 -
Partie 1
Le pays d'Albi était habité avant l'invasion romaine par un des peuples gaulois les plus belliqueux, celui des Volces Tectosages. Les Tectosages, dit-on, composaient en grande partie l'armée de Brennus. Au passage d'Annibal, ils tentèrent de lui fermer la route. On les voit ensuite s'enrôler dans les armées étrangères pour aller chercher des aventures dans les pays lointains, et étonner la Grèce et la Thrace de leur valeur indomptable.
Les Tectosages, selon quelques auteurs, faisaient partie de la confédération des Cadurques et ce serait eux que César désignerait sous le nom de Cadurci Eleutheri. Selon d'Anville, ils dépendaient des Rutheni provinciales. Le nom d'Albigeois, qui est resté à cette province, n'apparaît, pour la première fois, que dans la Notice de l'empire, qui est du commencement du Ve siècle ; on y rencontre la Civitas Albientium, et, dans la liste des dignités de l'empire, on trouve des cataphractarii Albigenses, que quelques-uns ont traduit par des cuirassiers albigeois.
Cette traduction n'est-elle pas téméraire, et ces cuirassiers, que la Notice nous montre cantonnés en Thrace, venaient-ils des rives du Tarn ? Voilà ce qu'on peut difficilement décider. On donne à ce nom d'Albigenses ou Albienses deux étymologies différentes : l'une, latine (albus, blanc), rappellerait les terres blanches des coteaux qui environnent Albi ; l'autre, celtique (alp ou alb, hauteur, sommet), l'éminence sur laquelle s'élevait l'ancien château de cette ville, Castelviel.
Toutefois, ce n'est que fort tard que le nom d'Albigeois fut appliqué au pays même dont a été formé le département du Tarn. Compris, après la conquête de César, dans la province Romaine, et sous Auguste dans l'Aquitaine, ce pays n'eut point de dénomination propre jusqu'au temps où Charlemagne forma un comté ayant pour chef-lieu Albi ; en devenant une circonscription administrative particulière, il reçut le nom particulier d'Albigeois.
Ni l'époque celtique ni l'époque romaine n'ont laissé beaucoup de monuments dans le département du Tarn. On n'y trouve que quelques dolmens, des pierres levées, des médailles et certains ornements. A peu de distance de la route qui conduit de Cordes à Saint-Antonin, dans la commune de Saint-Michel-de-Vax, on voit un dolmen composé d'une large pierre de 3m 60 de longueur sur 2m 56 de largeur, posée horizontalement sur deux blocs de rocher.
A Tonnac, on en voit un plus considérable encore, et sous lequel on a trouvé des ossements humains fluant aux monuments romains, ce sont, avec des tombeaux, bien conservés et des fragments de voies et d'aqueducs, des pavés en mosaïques, des médailles, des urnes, des fragments de poterie, que des fouilles ont mis au jour.
Dévasté par les Vandales, le pays fut occupé en 478 par les Wisigoths, et conquis par les Francs a la suite de la bataille de Vouillé (507). Ces nouveaux dominateurs n'y régnèrent point tranquilles. En 512, Théodoric les en chassa momentanément, et bientôt, sous les descendants de Clovis, l'Albigeois devient, comme tout le Midi, le théâtre, l'objet et la victime des querelles sanglantes de ces princes rivaux. Caribert en est maître en 564 ; en 574, Théodebert s'y précipite avec ses bandes austrasiennes, ne respectant rien, pillant, brûlant et ravageant églises et monastères.
En 575, le duc de Toulouse, Didier, chasse les soldats de Sigebert et s'empare du pays pour le compte de Chilpéric. En 576, c'est Mummol, le général du roi de Bourgogne, Gontran, qui vient à son tour désoler cette malheureuse contrée, d'où il emmène une foule de prisonniers. Quatre ans après (580), Chilpéric en redevient possesseur. Nous ne suivrons point ces vicissitudes presque annuelles, toujours accompagnées des plus barbares violences. En 615, apparaît le premier comte d'Albi, Syagrius, issu d'une très riche famille d'origine gauloise et frère des deux évêques de Cahors Rustique et Didier (saint Géry).
Dans leur décadence, les Mérovingiens perdirent la domination des pays méridionaux soumis à leur autorité. Eudes, duc d'Aquitaine, s'empara de l'Albigeois en 688. Ses successeurs ne jouirent pas paisiblement de cette conquête ; un demi-siècle n'était pas écoulé que l'Albigeois était en proie aux incursions dévastatrices des Sarrasins (720-732).
Cette invasion eut pour résultat indirect de ramener les rois francs, rudes libérateurs des chrétiens de la Gaule méridionale. En 766, Pépin le Bref s'empara de l'Albigeois en même temps que de tout le Languedoc, et c'est douze ans après que Charlemagne, définitivement maître de ces contrées, établit Aimon comte de l'Albigeois.
Le gouvernement de ce grand monarque profita au Languedoc, et surtout à l'Albigeois, par l'abolition de l'impôt militaire appelé foderum, que ce pays payait en proportion de la richesse de ses récoltes (795). Ermengaud, qui vivait au temps de Charles le Chauve, fut le dernier comte de l'Albigeois qui relevât des rois de France. Il se distingua par la prudence avec laquelle il mit la contrée en état de défense contre les Normands qui y portaient le ravage en 864. Garsinde, sa fille et son héritière, en épousant Eudes, comte de Toulouse, lui porta en dot cette province, qui fut depuis lors gouvernée par des vicomtes sous la suzeraineté des comtes de Toulouse.
Au commencement du Xe siècle, la contrée désignée sous le nom d'Albigeois comprenait, outre la vicomté d'Albi et d'Ambialet, celle de Lautrec et Paulin. Elle ne remonta au rang de comté qu'en 987. Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, l'ayant cédée à son frère Pons, celui-ci prit le titre de comte d'Albi. C'était l'année même où Hugues Capet commençait humblement la nouvelle dynastie française. On a remarqué avec quelle liberté, depuis plus d'un siècle, les pays du Midi disposaient d'eux-mêmes, se rapprochaient, s'unissaient, se séparaient à leur gré, non seulement ne voyant plus les rois, mais ne sentant plus même leur autorité. Aussi le nouveau monarque ne fut-il point reconnu dans l'Albigeois pendant d'assez longues années.
Le voyage que le roi Robert fit en 1031 dans l'Albigeois fut de peu d'effet pour l'autorité royale. Les seigneurs du Midi ne furent pas moins indépendants de fait que par le passé pendant le XIe siècle.
Ce siècle vit s'accroître considérablement la puissance des vicomtes d'Albi. Aton II, qui mourut en 1032, était vicomte d'Albi et de Nîmes. Bernard III, son successeur, s'intitule, dans l'acte de fondation du pont d'Albi, proconsul de Nîmes et prince d'Albi. Raymond-Bernard, qui vint après lui, y ajouta par un mariage le comté de Carcassonne et les vicomtés de Béziers et d'Agde (1061). C'est lui qui porta le premier le surnom de Trencavel, qui servit depuis à désigner cette puissante famille.
Bernard-Aton IV, homme tout à fait remarquable, porta enfin à son plus haut période cette agglomération de fiefs, qui était au moyen âge le secret des grandes puissances, en joignant la vicomté de Rasez à toutes les autres. A sa mort, malheureusement, cette couvre de la patiente ambition des Trencavel se brisa par un partage entre ses trois fils.
Mais les débris en furent encore imposants : les vicomtés d'Albi et d'Ambialet échurent d'abord à l'aîné, Roger, puis à sa mort a Raymond Trencavel, le second, lequel posséda en même temps Béziers, Carcassonne et Rasez (1150). Vicomte de Béziers avant de l'être d'Albi, Raymond Trencavel donna la priorité de rang a la première de ces deux villes. L'Albigeois, dont les seigneurs étaient naguère les dominateurs du Midi, déchut du rang où il avait été élevé et ne fut plus qu'une dépendance de la vicomté de Béziers. Mais ce qui devait faire à jamais sa célébrité, ce qui devait graver le nom d'Albigeois dans l'histoire en lettres ineffaçables, c'est l'hérésie et la croisade fameuses dont nous allons rappeler les principaux traits.
Depuis plus d'un siècle, des doctrines malsonnantes inquiétaient l'Église catholique. En 1022, sous le roi Robert, on brûlait à Orléans des manichéens ; c'est du moins sous ce nom que le concile désigna les malheureux qui périrent alors sur le bûcher. Soissons fut témoin d'un supplice semblable en 1115.
Les hérétiques se multipliaient partout, mais principalement dans le Midi. Ils avaient reçu, disait-on, les doctrines manichéennes des Bulgares, qui les tenaient eux-mêmes des Arméniens, et l'on ajoutait que leur pape résidait en Bulgarie. Aussi les appelait-on quelquefois bulgares ou boulgres par abréviation. Ces hérésiarques s'élevaient ; et leur voix était écoutée des peuples. Il y en eut à cette époque deux célèbres, Pierre de Bruys et Henri, qui prêchèrent avec un grand succès dans le Dauphiné, la Provence et la province de Narbonne.
Les auteurs catholiques les accusaient de piller les églises ; de brûler les croix et de s'abandonner à la débauche. Pierre de Bruys fut livré au bûcher dans la petite ville de Saint-Gilles « en punition des croix qu'il avait brûlées. » Henri, son disciple, ancien religieux qui avait quitté la vie monastique, ne fut point ébranlé par ce terrible avertissement, et, continuant de prêcher, se rendit à Toulouse, sans doute en traversant l'Albigeois. Ses sectateurs furent appelés henriciens.
Déjà, au milieu du XIIe siècle, les progrès de l'hérésie étaient assez considérables pour inspirer des alarmes au pape Eugène III, venu en France pour y prêcher la seconde croisade (1147). Ce pontife envoya à Toulouse le cardinal Albérie, évêque de Chartres et saint Bernard, accablé des infirmités de la vieillesse, mais toujours plein d'ardeur. Saint Bernard, qui était le véritable chef de cette mission par son génie, fut frappé de l'aspect religieux du pays. « Les églises, écrivait-il, sont sans peuple, les peuples sans prêtres, les prêtres sans ministère. »
Ce n'était point merveille : les hommes du Midi n'avaient sous les yeux qu'un clergé livré au luxe et aux mauvaises mœurs. Ils accueillirent avec dérision et outrage la pompe du légat, mais avec respect et enthousiasme l'austère simplicité du moine éloquent qui dominait son siècle, et dont l'ambition était toute religieuse. Verfeil, près de Toulouse, fut le seul lieu où saint Bernard n'obtint pas le silence du respect ; obligé de se taire devant les clameurs de la foule, il secoua contre ce lieu la poussière de ses sandales et se retira. La mission passa alors dans l'Albigeois.
Les doctrines hétérodoxes prospéraient dans cette province. Elles y étaient particulièrement favorisées par Raymond Trencavel, qui, sans cesse en guerre avec son suzerain, Raymond V, comte de Toulouse, protégeait par système les hérétiques pour s'en faire un appui, Presque tous les habitants d'Albi étaient henriciens. Ils rirent au légat une réception burlesque : montés sur des ânes et battant du tambour, ils allèrent au-devant de lui.
Quand il prêcha à Sainte-Cécile, il eut environ trente auditeurs. On ne traita pas de même saint Bernard : sa parole tomba sur mie foule pressée, avide de l'entendre, émue, que la cathédrale ne pouvait contenir. Elle écouta, non sans se troubler, la réfutation qu'il fit de point en point des doctrines henriciennes, et quand il s'écria : « Choisissez entre les deux doctrines ! » tous répondirent qu'ils détestaient leur erreur, qu'ils revenaient à la foi catholique. « Faites donc pénitence, ajouta-t-il, vous qui avez péché ! » Et il leur fait à tous lever le bras en signe qu'ils jurent d'être fidèles à l'Église. Mais leur retour aux saines doctrines ne devait pas être de longue durée : saint Bernard parti, ils oublièrent leur serment.
Il sembla à Guillaume, évêque d'Albi, qu'un concile spécialement convoqué pouvait seul porter remède à l'état de choses et venir à bout de l'hydre qu'il s'agissait d'étouffer. Ce concile fut indiqué pour la fin du mois de mai 1165, et dut se réunir dans une ville de l'Albigeois, alors forte et considérable, aujourd'hui très obscure, la ville de Lombers, à 30 kilomètres au sud d'Albi.
On y interrogea sur leur doctrine et leur profession de foi les hérétiques, qui s'appelaient les bons hommes, les parfaits ; ce dernier titre toutefois n'appartenait qu'à un petit nombre d'entre eux, puritains de la secte, qui se distinguaient par l'austérité de leur vie ; la foule ne portait que le nom de croyants. Affranchis par la révolte des obligations morales de la loi catholique, les croyants se passaient de toute morale et vivaient dans la licence, persuadés que les vertus des parfaits rachèteraient leurs vices.
Quant à cette dénomination d'Albigeois, qui est demeurée aux hérétiques de cette secte, répandue également dans tout le Languedoc, on peut admettre qu'elle prit naissance à cette époque, peut-être même à l'occasion de ce concile tenu dans l'Albigeois pour examiner et condamner la doctrine nouvelle.
Pour résumer l'exposé des croyances albigeoises, nous dirons que, aux yeux de ces hérétiques, Satan, principe du mal, était l'auteur du monde physique ; de là cette condamnation de la chair, de la vie d'ici-bas et du mariage, qui conduisit quelques femmes égarées à faire périr leurs enfants. Le Jéhovah de l'Ancien Testament n'est autre que Satan lui-même, et de plus tous les Pères de l'Ancien Testament sont damnés jusqu'à saint Jean-Baptiste, l'un des majeurs démons et pires diables. Le bon esprit, c'est Jésus-Christ ; mais il ne s'est point incarné, c'eût été s'asservir à la chair, au mauvais principe ; il n'a pris que les apparences de la chair, de la vie et de la mort, et est venu, pur esprit, régénérer les esprits des hommes.
Non seulement les Albigeois attaquaient ainsi le dogme, mais ils attaquaient aussi le clergé. L'habit noir des parfaits était un reproche aux somptueux vêtements des évêques. Ils avaient des cimetières particuliers où ils enterraient publiquement leurs adeptes. Enfin, ils recevaient, dit Pierre de Vaux-de-Cernai, des legs plus abondants que les gens d'église, tant les populations de ces contrées étaient séduites par eux !
« Moi, Gaucelin, évêque de Lodève, par ordre de l'évêques d'Albi et de ses assesseurs, je juge que ces prétendus bons hommes sont hérétiques, et je condamne la secte d'Olivier et de ses compagnons, qui est celle des hérétiques de Lombers, quelque part qu'ils soient. » Tel fut l'arrêt rendu par le concile de Lombers. Quatorze ans après, le concile de Latran (1179) énonçait, à propos des Albigeois, cette maxime : « Bien que l'Église rejette les exécutions sanglantes, elle ne laisse pas d'être aidée par les lois des princes chrétiens ; et la crainte du supplice fait quelquefois recourir au remède spirituel. » Nouveaux anathèmes au concile de Montpellier (1195).
Tant d'excommunications n'écrasaient pas les Albigeois. Ils n'en acquéraient que plus de célébrité, d'importance et d'audace. Au concile catholique de Lombers, ils opposèrent, deux ans après, un concile hérétique présidé par Niquinta, leur pape, à Saint-Félix-de-Caraman, où se réunirent des représentants des églises dissidentes de l'Albigeois, du pays de Toulouse, de Carcassonne et de la vallée d'Aran.
L'hérésie ne se contenait plus même dans le midi de la France, elle débordait sur le nord et sur les pays étrangers, l'Angleterre, la Catalogne, l'Aragon. Ce n'est pas qu'il y eût bien des divergences d'opinion dans cette diffusion de l'hérésie, et le nom d'Albigeois couvrait sans doute plus d'une secte. Néanmoins, c'était un formidable ensemble de rébellions contre l'unité catholique.
Le glaive temporel allait donc être tiré du fourreau. Quelle serait la main qui le ferait mouvoir ? Ce droit et ce devoir n'appartenaient-ils pas tout d'abord aux souverains temporels des pays qui étaient le siège de l'hérésie ? Mais, soit connivence, soit impuissance véritable, ces souverains cherchaient à s'affranchir de cette tâche. « Je ne puis trouver le moyen de mettre fin à de si grands maux, écrivait Raymond V au chapitre général de Citeaux, en 1177, et je reconnais que je ne suis pas assez fort pour réussir. »
Raymond V était sincèrement catholique. Son fils Raymond VI penchait vers l'hérésie : « Je sais, disait-il, que je perdrai ma ferre pour ces bons hommes, eh bien ! la perte de ma terre, et encore celle de ma tête, je suis prêt a tout endurer. »
II y eut, dès 1178, une petite guerre religieuse dirigée contre l'Albigeois proprement dit. Le fils de Raymond Trencavel, Roger II, suivait les errements paternels. Non seulement il était toujours en querelle avec son suzerain, le comte de Toulouse, dont il épousa pourtant la fille Adélaïde, mais il favorisait ouvertement les hérétiques ; il leur permettait de s'établir en maîtres à Lavaur et même à Lombers, qui naguère avait retenti des anathèmes lancés contre eux ; il leur laissait le champ libre pour provoquer les évêques à la discussion.
En démêlé lui-même avec l'évêque d'Albi, il finissait le débat un beau jour en le faisant mettre en prison, et en l'y faisant garder par des hérétiques Cette cruelle plaisanterie fut mal prise par la cour de home. Le légat, qui s'était rendu à Toulouse, envoya dans l'Albigeois Henri, abbé de Clairvaux, accompagné du vicomte de Turenne et de Raymond de Castelnau, qui devaient lui prêter main-forte. Roger se retira prudemment dans des lieux inaccessibles et se laissa sans autre souci excommunier dans la ville de Castres, dont son épouse Adélaïde avait ouvert les portes. Il fut déclaré traître, hérétique et parjure. Henri, qui avait prononcé l'anathème, devint lui-même légat du saint-siège peu de temps après, et résolut d'employer l'autorité étendue que lui donnait cette dignité à frapper l'hérésie avec quelque vigueur.
Il retourna dans l'Albigeois, entraînant sur ses pas les catholiques en armes, assiégea vivement Lavaur, qui ouvrit ses portes, et obligea Roger d'abjurer l'hérésie et de livrer les hérétiques pris dans cette place (1180). Mais à peine eut-il le dos tourné, que le vicomte et ses sujets revinrent aux doctrines qu'ils avaient feint de quitter, se riant des tentatives inutiles de l'Église. En 1194, Roger mourant laissait la tutelle de son fils à un seigneur hérétique.
Le saint-siège, qui ne pouvait être vaincu dans cette lutte, redoubla l'énergie de ses moyens. Dès 1198, les frères Gui et Raynier, de l'ordre de Cîteaux, parcouraient le Midi comme commissaires du pape, chargés de représenter sa puissance tout entière. Leurs successeurs, Pierre de Castelnau et Raoul, moines du même ordre, réunirent dans leurs mains tout le faisceau des foudres pontificales, en vertu d'une bulle qui les autorisait à « détruire, arracher et planter tout ce qui était nécessaire dans les pays infectés d'hérésie. »
Ces dictateurs commencèrent par suspendre tous les évêques modérés, dont la tiédeur eût pu ralentir leur marche impitoyable. L'opiniâtreté de l'hérésie résista encore a leurs efforts. Obligés de cacher leurs croyances et leurs réunions, les Albigeois en confiaient le mystère aux ténèbres de la nuit. Pierre de Castelnau se décourageait lui-même, lorsqu'il rencontra l'évêque d'Osma qui voyageait en France avec un de ses chanoines nommé Dominique. « Renoncez, lui dit l'évêque, à ces somptueux appareils, à ces chevaux caparaçonnés, à ces riches vêtements ; fermez la bouche aux méchants en faisant et enseignant comme le divin Maître, allant pieds nus et déchaux, sans or ni argent ; imitez la manière des apôtres. »
Mais le luxe était devenu tellement inséparable de la cour de Rome, que les légats n'osèrent point reprendre les simples habits de moine : ce serait, dirent-ils, une trop grande nouveauté ; ils ne pouvaient prendre cela sur eux. Ils se bornèrent à suivre l'évêque d'Osma et Dominique, qui se mirent à parcourir pieds nus les campagnes, soutenant des discussions solennelles contre les Albigeois. L'évêque mourut, Dominique resta seul.
C'est saint Dominique, le patron de l'Inquisition. Il avait la tendresse d'âme et les vertus d'un saint Vincent de Paul. Dans une famine, il vendit ses livres pour en donner l'argent aux pauvres ; une autre fois, il voulut se vendre lui-même pour racheter un captif. Mais il avait aussi la cruauté d'une logique inflexible qui lui faisait désirer, par amour des hommes, l'extermination des suppôts de l'enfer qui perdaient tant de milliers d'âmes.
Ce qu'il souhaitait avec la dernière ardeur, c'était le martyre, et le plus cruel de tous, afin de mériter une plus riche couronne. Qu'importaient à cet homme les outrages, la boue, les crachats, les bouchons de paille attachés par derrière à ses vêtements ? Il en remerciait le ciel. Ce n'était pourtant pas une preuve du succès de sa prédication ; aussi Castelnau retombait dans l'abattement, et répétait que l'affaire de Jésus-Christ ne réussirait pas dans ce pays jusqu'à ce que quelqu'un d'entre eux fût mort pour la défense, de la foi, et Dieu veuille, ajoutait-il, que je sois la première victime !
En 1207, il se rendit à la cour de Raymond VI, alors en guerre avec ses voisins, et le somma de faire la paix ; sur son refus, il lança une excommunication que le pape Innocent III confirma en termes accablants. Raymond céda sur un point, mais feignit de ne point entendre les injonctions du légat qui lui ordonnait de persécuter les hérétiques. La colère de Castelnau n'eut plus de bornes : il excommunia de nouveau Raymond, et l'accabla en face des injures les plus violentes. Le comte, à son tour, s'emporta, et répondit qu'il saurait bien le retrouver. Un de ses chevaliers recueillit cette parole, et Castelnau fut égorgé au moment où il s'embarquait sur le Rhône (1208).
L'épée du chevalier de Raymond VI déchira l'effroyable nuée des colères pontificales amoncelée depuis un demi-siècle sur le Languedoc. A la voix du pape Innocent III, à celle d'Arnaud, abbé de Liteaux, et des moines des nombreux couvents de cet ordre, tout le nord de la France se croisa ; ducs, comtes, évêques, chevaliers, brodèrent la croix sur leur poitrine (jusque-là elle se portait sur l'épaule ). Français, Normands, Champenois, Bourguignons, s'armaient avec joie pour aller combattre ces hommes du Midi, objet de leur aversion, cette gent empestée de Provence ; des Méridionaux catholiques les joignirent en grand nombre. Lyon était le rendez-vous de cette armée de 300 000 hommes. Arnaud-Amaury, abbé de Citeaux, homme de fer, et Milon, légat a latere, dirigeaient la croisade.
Les départements-(histoire)- Somme - 80 -
La Somme constitue l'ancienne province de Picardie, province dont le nom a été, pour les étymologistes, le texte de si longues et si stériles dissertations. Les Romains trouvèrent ce territoire occupé par de nombreuses tribus dont ils nous ont transmis les noms ; c'étaient, au nord, les Morini ; à l'ouest, les Ambiani, qui avaient pour capitale Somarobriva, et les Britanni ; les Veromandui, à l'est, et, au sud, les Bellovaci et les Sylvanectenses. Les Ambiani, les Morini et les Bellovaques prirent une large part à la guerre de l'Indépendance sous Vercingétorix ; mais, vaincus comme les autres peuples de la Gaule, ils se soumirent et firent partie de la seconde Belgique.
La résistance des habitants à la domination étrangère leur mérita l'estime des vainqueurs. D'importants privilèges, Marges franchises municipales, de nombreux embellissements dans les villes assurèrent la paix dans le pays jusqu'à l'arrivée des Francs. Clodion est le premier chef qui y pénétra, au commencement du IVe siècle ; c'est à peu près vers la même époque qu'apparaissent aussi les premiers propagateurs de la foi chrétienne, saint Firmin, saint Crépin et saint Crépinien, saint Valère, saint Ruffin, saint Quentin, saint Vaast, saint Valery, saint Ricquier, saint Lucien et les apôtres de l'Église irlandaise.
Leur lutte contre le druidisme et le paganisme romain fut laborieuse et rude ; les traits principaux du caractère picard se retrouvent aussi prononcés, à cette époque, qu'ils se sont maintenus depuis. La ténacité, l'obstination, la fidélité aux vieilles croyances furent de sérieux obstacles à l'établissement de la foi nouvelle. Mais hâtons-nous d'ajouter que la vérité, une fois connue et acceptée, ne trouva nulle part de plus zélés sectateurs ni de défenseurs plus intrépides.
Sous les princes de la première race, la Picardie demeura inféodée au domaine royal ; elle taisait partie de ce qu'on appelait alors la France. Ce fait s'explique quand on se rappelle que, jusqu'à Charlemagne, Soissons fut, à vrai dire, la capitale de la monarchie franque et la résidence la plus habituelle des rois. Sous les successeurs du grand empereur, l'immensité des possessions conquises nécessita la création de comtes ou lieutenants, chargés de gouverner les provinces au nom du souverain, qui en vivait éloigné.
C'est en 823 que nous voyons Louis le Débonnaire abandonner pour la première fois l'administration de la Picardie à un comte. On sait quels furent les rapides envahissements de ces nouveaux pouvoirs, et en combien de lieux et de circonstances ils parvinrent à se rendre indépendants. Grâce à l'inamovibilité des fiefs féodaux, les alliances de famille concentrèrent bientôt entre les mains de quelques seigneurs une puissance rivale de celle des rois. Le développement de ces usurpations remplit toute la seconde race et aboutit au triomphe définitif, au couronnement de la haute féodalité dans la personne des Capet, comtes de Paris.
La Picardie suivit la loi générale. Un Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui avait épousé une comtesse de Vermandois, voulut, après la mort de sa femme, retenir le comté d'Amiens, qui devait retourner à Aliénor, comtesse la Saint-Quentin, soeur cadette de la défunte. L'injustice de cette prétention était si flagrante, et l'ambition du comte Philippe prenait des proportions si menaçantes, que le roi de France crut devoir enfin intervenir ; il ne s'agissait ni de remontrances ni d'arbitrage, c'est une guerre sérieuse qu'il fallut entreprendre pour réduire l'ambitieux vassal ; et encore une dernière satisfaction lui fut-elle donnée par le traité de paix qui intervint . il fut convenu que le beau-frère et la belle-soeur jouiraient successivement de la province en litige, et qu'après leur mort elle appartiendrait à la, couronne.
C'est à Philippe-Auguste qu'on doit cet arrangement, qui fit rentrer la partie la plus importante de la Picardie dans le domaine national. Le Ponthieu, dont Abbeville est la capitale, passa successivement dans les maisons d'Alençon, de Dammartin, de Castille et d'Angleterre. Philippe de Valois le reprit sur Édouard III par confiscation ; ce comté, ainsi que celui de Santerre (territoire de Péronne), avait été rattaché à la couronne, lorsque Charles VII, en 1435, engagea au duc de Bourgogne, pour quatre cent mille écus, toutes les villes situées sur la Somme.
Le droit des rois de France étant enfin reconnu, cette aliénation ne devait être que momentanée. Le premier soin de Louis XI, deux ans après son avènement au trône, en 1463, fut d'acquitter la dette contractée par son père et de rentrer dans l'entière possession de la Picardie.
Depuis cette époque, la province n'a pas cessé d'être française. Elle comprenait alors l'Amiénois, le Boulonnais, le Ponthieu, le Santerre, le Vermandois, le Thiérache, le Pays reconquis, le Beauvoisis, le Noyonnais et le Laonnais ; on y réunit l'Artois. Dans la suite, les territoires de Beauvais, Noyon et Laon en furent détachés au profit de l'lle-de-France ; puis, en 1790, dans la dernière division du sol français en départements, Boulogne et Montreuil furent affectés au Pas-de-Calais ; l'Aisne eut les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins ; tout le reste forma le département de la Somme.
Depuis la réunion de la Picardie à la France, son histoire, comme province, se confond avec l'histoire générale du pays. L'intérêt et l'importance des événements qui s'y sont passés sont tout entiers dans les chroniques particulières des villes ; nous y renverrons donc le lecteur, nous contentant ici de quelques observations sur la physionomie générale de la province.
La grande lutte de Charles le Téméraire trouvera sa place dans la notice de Péronne, et les chroniques d'Amiens nous diront l'histoire de la rivalité des maisons de France et d'Espagne. Ce qu'il importe de constater ici, comme aperçu synthétique, c'est la profonde empreinte laissée sur le sol picard par chacune des grandes crises sociales qui ont tour à tour transformé notre pays. Le caractère des habitants, lent et paresseux dans ses évolutions spéculatives, défiant dans sa naïveté, après avoir opposé aux principes nouveaux une résistance obstinée, s'en est laissé pénétrer plus profondément qu'aucun autre.
Nous avons parlé de l'enracinement des croyances païennes en face de la Gaule presque entièrement convertie au christianisme ; dès que la vraie foi se fut emparée des intelligences et des coeurs, la Picardie devint le pays le plus religieux peut-être de la chrétienté. Est-il besoin de citer les fameuses écoles monastiques de Corbie et de Saint-Ricquier, les pèlerinages si célèbres et si fréquentés à Notre-Dame de Liesse, à Notre-Dame de Boulogne et à l'église du Saint-Esprit de Rue ?
L'époque des croisades surtout éclate en glorieux témoignages de la piété des Picards ; et, pour emprunter les paroles d'un historien moderne de la province, c'est un Picard, Pierre l'Hermite, qui prêche la première croisade et marche à l'avant-garde ; c'est un Picard, le baron Creton d'Estourmel, qui, le premier, plante sa bannière sur les murs de Jérusalem, et sa famille, en mémoire de ce fait d'armes, inscrit sur son blason cette noble devise : « Vaillant sur la crête » ; enfin, c'est un Picard, Godefroy de Bouillon, le plus glorieux peut-être, qui porta le premier la couronne de Jérusalem. Voilà pour le sentiment religieux.
Quant à l'esprit féodal, les preuves de son développement, en Picardie, sont bien plus nombreuses encore. Suivant le même auteur, on comptait dans la mouvance directe du comté de Ponthieu 250 fiefs et plus de 400 arrière-fiefs ; dans la mouvance du comté de Guines, 12 baronnies et 12 pairies.
La plupart des seigneurs avaient haute et basse justice, et sur aucun point du royaume peut-être le droit féodal ne présentait des usages plus bizarres, des symboles plus étranges. Les familles nobles, sous le règne de Louis XIV, étaient au nombre de 500, toutes d'origine ancienne ; et, parmi les plus illustres, nous citerons les maisons d'Ailly, de Boufflers, de Créqui, de, Rambures, d'Estrée, d'Humières, de Melun, de La Motte-Houdancourt, de Gamaches, de Mailly, de Rubempré, de Senarpont ; n'oublions pas qu'outre Godefroy de Bouillon, la noblesse picarde a donné huit rois au trône de, Jérusalem.
Non, cependant, que la sève du pays soit épuisée par cette exubérance de floraison aristocratique ; lorsqu'à bout de résignation et de patience, après un long et sérieux travail des esprits, l'indépendance municipale essayera ses premières manifestations, quels magnifiques exemples d'habile persévérance, de courageuse initiative et d'invincible fermeté, les villes de Picardie ne donneront-elles pas au reste de la France ?
Vers 1250, l'affranchissement des communes était à peu près complet dans la province entière. Cette vaillance proverbiale des Picards, mise au service des intérêts locaux, n'a jamais fait défaut non plus dans les grandes questions nationales ; depuis Bouvines jusqu'aux immortelles campagnes de la République et de l'Empire, les Picards ont toujours marché au premier rang parmi les défenseurs de la patrie ; le bataillon de la Somme fut toujours un de ceux qui se firent le plus remarquer par leur valeur et leur patriotisme.
Pendant la guerre de 1870-1871, le département de la Somme fut envahi par les Prussiens. Après les combats de Mézières, de Boves et de Villers-Bretonneux, ils occupèrent Amiens et sa citadelle, abandonnées par l'armée du Nord, qui, sous les ordres du général Faidherbe, ne tarda pas à reprendre l'offensive, en s'emparant de la forteresse de Ham, et en livrant, à Pont-Noyelles, aux Prussiens, un combat qui leur fit éprouver des pertes considérables.
Cependant, Péronne, assiégée et bombardée pendant plusieurs jours, dut capituler ; mais Abbeville ne fut occupée qu'après l'armistice, jusqu'au 22 juillet 1871, où les Prussiens évacuèrent le département. L'invasion lui avait coûté 22 850 443 fr. 27 cent. Puis le génie industriel s'est emparé, tout aussi puissamment qu'avant la guerre, du département de la Somme, le coton et la laine y étant travaillés sous mille formes diverses. Amiens était ainsi devenue au XIXe siècle une des villes manufacturières les plus importantes de France ; l'agriculture était très perfectionnée dans les localités où le sol avait pu répondre aux efforts des cultivateurs ; les vastes tourbières étaient soumises à une exploitation chaque jour plus savante.
Les départements-(histoire)-Deux Sèvres - 79 -
Des trois départements qui ont été formés avec l'ancien Poitou, celui des Deux-Sèvres occupe la région centrale ; confinant à l'est à la Vienne, et à la Vendée à l'ouest, il fait vers le sud-ouest une pointe dans la Saintonge, à laquelle il a emprunté 25 921 hectares de son territoire. Cette position explique l'absence d'une histoire particulière pour cette contrée, après les notices que nous avons données sur le haut et le bas Poitou, dans les parties de cet ouvrage qui s'y rapportaient plus directement. De la conquête romaine à l'établissement de la féodalité, nous n'avons pas à citer un seul fait qui ne rentre ou dans l'histoire générale de la province, ou dans les annales particulières des localités.
Comme le reste du Poitou, ce pays était habité par les Pictones, quand les Romains l'envahirent. Après avoir pris part à la lutte nationale, qui se termina par la chute d'Alésia et la défaite de Vercingétorix, ils se soumirent à César, et firent partie de l'Aquitaine, dont ils suivirent la fortune, tour à tour conquis par les Wisigoths et par les Francs. Au commencement du VIe siècle, saint Agapit et saint Maixent prêchèrent dans le pays la foi nouvelle, et y fondèrent une abbaye. Vers 732, les Sarrasins y parurent, mais pour être bientôt dispersés par Charles-Martel.
Sous les Carlovingiens, quand le pouvoir des grands vassaux se substitua, dans la France entière, à l'autorité royale, quand les puissants comtes de Poitiers, créés par Charlemagne, eurent affermi leur domination sur les vastes territoires devenus leurs fiefs héréditaires, on vit se reproduire en petit, dans leur province, ce qui s'était passé dans le royaume. Les barons, qu'ils avaient préposés à l'administration des diverses parties de leurs domaines, affectèrent vis-à-vis d'eux la même indépendance que les comtes affectaient eux-mêmes envers le roi de France, et de même que l'État n'était plus que l'assemblage fictif de provinces à peu près indépendantes, le Poitou ne fut plus que la réunion de seigneuries obéissant à des maîtres différents, soumises chacune à des lois et à des usages particuliers et trop souvent en guerre les unes contre les autres.
C'est alors que prirent naissance ces désignations de Niortais, de Bressuirois, de Mellois, souvenir rajeuni des subdivisions gauloises, qui donnaient à chaque canton ou pagus ses frontières, son administration et sa petite capitale. Ce fractionnement était un obstacle à toute influence sérieuse des populations dans les grandes affaires du pays. Il fallait qu'un danger commun ou qu'un principe nouveau brisât les vieilles barrières, ralliât toutes ces forces disséminées et refit un corps de ces membres épars.
Ce résultat, que l'ancien ordre de choses ne permettait pas d'espérer de la paix, on l'obtint d'abord de la lutte contre les Anglais, et plus tard, quelque contradictoire que paraisse cette assertion, des guerres civiles et religieuses qui bouleversèrent la province. L'émotion répandue par ces alternatives de succès et de revers finit par pénétrer jusqu'au fond des contrées les plus insouciantes ou les plus étrangères aux grands intérêts qui étaient en jeu ; les sympathies des populations devenant un appoint important dans les opérations de la guerre, on se préoccupa de part et d'autre de se concilier leur intérêt, dont jusque-là on avait fait si bon marché.
C'est ainsi que nous voyons en quelque sorte mis aux enchères le concours de la bourgeoisie des villes, et cette précieuse alliance achetée au prix de chartes communales, de privilèges commerciaux, qui initiaient les habitants à la vie publique. Cette révélation de droits nouveaux, rayonnant des cités dans les campagnes, y éveilla des sentiments de solidarité dans lesquels était en germe le nationalisme français.
Après une si longue ignorance, et cet isolement séculaire de tous les intérêts généraux, il dut y avoir beaucoup d'hésitation et de grandes incertitudes. Les princes anglais, ducs héréditaires de Guyenne, comtes de Poitou, étaient-ils bien des étrangers ? Et le roi de Paris, qui était si loin et qu'on ne voyait jamais, était-il bien le monarque légitime ?
Il fallut de longues années et de rudes épreuves pour que la vérité se dégageât des événements. Les trois siècles qui séparent le règne de Louis le Jeune de celui de Charles VII y suffirent à peine ; mais, au XVe siècle, le résultat était cependant en grande partie obtenu : le Poitou était province française et avait le sentiment de sa nationalité. Un autre progrès s'était encore accompli, le pouvoir s'était centralisé, et le roi, vainqueur de l'étranger, rattachait plus directement à son autorité souveraine les provinces dont il était le libérateur. Les habitants du territoire des Deux-Sèvres commencent donc à sortir de la passivité où le régime féodal les avait tenus jusqu'alors, et entrent dans la sphère d'action au milieu de laquelle s'agitent les siècles suivants.
Pendant la période anglaise, quoique le pays fût souvent le théâtre de la lutte et se trouvât presque toujours atteint par ses résultats, les habitants n'eurent encore qu'un rôle relativement passif, et furent, pour ainsi dire, moins acteurs que spectateurs ; c'est seulement dans la période suivante que leur initiative commence à se dessiner. Il semble que la population tout entière prît à coeur de se venger de la longue insignifiance de son passé par l'ardeur avec laquelle elle se jeta dans le grand drame religieux du XVIe siècle. Il n'y eut pas une ville, pas une bourgade qui ne se mêlât alors aux révoltes des protestants, comme plus tard aux agitations de la Ligue.
Ce fut à Châtillon, en 1568, que les chefs du parti réformé se rassemblèrent pour la première fois après s'être assurés des places voisines, telles que Thouars, Parthenay, Oyron, etc. Dandelot, frère de l'amiral Coligny, fit capituler Niort et passa au fil de l'épée la garnison de la tour Magné. Saint-Maixent se rendit à lui dans le même temps. Les armées des ducs de Montpensier et d'Anjou se rencontrèrent près de Pamproux, où la campagne se termina par une escarmouche. Les chefs protestants et la reine de Navarre passèrent l'hiver à Niort, où ils s'occupèrent à réunir des forces, à pourvoir aux finances de leur parti par la vente des biens ecclésiastiques, et à se ménager les secours de l'Angleterre.
Après la journée de Moncontour, si fatale aux protestants, les villes de Châtillon, de Thouars et d'Oyron furent évacuées ; l'amiral Coligny recueillit les débris de l'armée à Niort, et, après y avoir laissé garnison, se retira à La Rochelle. Niort capitula à l'arrivée du duc d'Anjou, et tout le Poitou se soumit.
Une tranquillité, du moins apparente, régna jusqu'en 1588. A cette époque, les protestants, menacés dans La Rochelle, se remirent en campagne. D'Aubigné s'empara de Niort et de Saint-Maixent. Thouars et les places environnantes se rendirent aux protestants un an après. L'avènement de Henri IV au trône ramena la paix.
La guerre ne recommença qu'en 1621, sous Louis XIII, lorsque le projet d'établir une république protestante surgit dans le conseil des chefs protestants. La Bretagne et le Poitou devaient être un des huit cercles de cette république. L'énergie déployée en cette circonstance par le cardinal de Richelieu et la présence du roi en Poitou déterminèrent la soumission de Niort et de Saint-Maixent ; la prise de La Rochelle, en 1628, mit le sceau à la paix définitive.
Cent cinquante ans de paix succédèrent a ces longues agitations ; mais le souvenir des rivalités locales, le réveil des haines mal éteintes donnèrent, en 1792, à l'explosion contre-révolutionnaire un caractère particulier d'obstination. Quatre-vingt-sept communes du département se soulevèrent et prirent une part active à la lutte.
Les arrondissements de Bressuire et de Parthenay fournirent aux rebelles leurs principaux chefs, La Rochejacquelein entre autres. Pendant que Niort devenait le quartier général de l'armée républicaine, Châtillon était le siège du conseil supérieur de l'armée royale. Thouars fut la première ville importante dont les Vendéens s'emparèrent ; Parthenay, Bressuire et un grand nombre de villes de la Gâtine et du Bocage furent tour à tour prises ; reprises, incendiées, démantelées, détruites même pendant cette déplorable guerre civile.
Nulle part ne fut plus manifeste et plus tranchée la ligne qui séparait alors l'opinion des villes de celle des campagnes. Autant la naïve ignorance, le culte du passé, les pieuses traditions de famille firent des uns les aveugles instruments des agents royalistes, autant l'intelligence des autres fut prompte à comprendre le problème posé parla Révolution, autant cette conscience de l'avenir les rattacha étroitement à sa cause.
C'est cette foi également ardente et sincère des deux côtés qui donna à la lutte ses proportions gigantesques ; l'héroïsme des uns n'eut de comparable que le dévouement des autres, et aux fabuleux exploits des intrépides paysans il n'y a à opposer que les glorieuses et stoïques expéditions de ces gardes nationaux des villes, eux aussi soldats improvisés, quittant, eux aussi, leur foyer, leur famille, et sachant aussi mourir pour la cause qu'ils avaient embrassée. Depuis la pacification, nous ne trouvons dans l'histoire du département qu'un seul fait important à noter, c'est la fameuse conspiration de Berton, en 1822.
Si la guerre civile a trop longtemps désolé le département des Deux-Sèvres, il n'a pas eu, en compensation, à souffrir de la guerre étrangère. Situé loin de la frontière, il a dû à sa position de n'avoir subi ni les hontes ni les malheurs des invasions. Ce qui ne l'empêcha point de payer largement sa dette à la patrie, en envoyant ses enfants aux armées qui, en 1814 et 1815 d'abord, puis en 1870 et 1871, luttèrent si vaillamment, mais hélas ! si inutilement, pour repousser l'étranger.
Quoique, depuis cinquante ans, les moeurs se soient bien modifiées dans la contrée qui nous occupe ; quoique, là comme ailleurs, s'accomplisse chaque jour l'œuvre de progrès et d'assimilation, le département des Deux-Sèvres est encore un de ceux qui a gardé, dans certaines parties, le plus de son ancienne originalité ; nous en emprunterons quelques traits à un de ses plus habiles administrateurs, M. Dupin, qui y fut préfet dès les premières années de l'Empire :
« Le département des Deux-Sèvres, composé de trois parties bien distinctes, savoir : le Bocage, qui comprend tout le nord-ouest, c'est-à-dire la presque totalité des premier et deuxième arrondissements et une partie du troisième ; le Marais, qui occupe une portion sud-ouest du troisième arrondissement, et, enfin, la Plaine, offre les mêmes différences dans la constitution physique et morale de ses habitants.
« 'homme du Bocage a une taille médiocre, mais assez bien prise ; tête grosse et ronde, teint pâle, cheveux noirs, yeux petits, mais expressifs ; son tempérament est bilieux et mélancolique ; son esprit est lent, mais non sans profondeur ; son cœur est généreux, mais irascible ; sa conception peu facile, mais sure. Il a conservé toute la simplicité des mœurs anciennes, quoique la guerre en ait un peu altéré la pureté. Il est bon, hospitalier, juste et d'une fidélité inviolable à ses engagements ; mais taciturne a l'excès, méfiant pour tout ce qui vient de l'autorité, fortement attaché au sol qui l'a vu naître, plus attaché encore à la religion de ses pères, et capable des actions les plus héroïques pour la défense de sa foi.
« Dans tous les temps, on l'a vu prendre part aux guerres religieuses. Son humeur mélancolique et les préjugés superstitieux qui le gouvernent tiennent essentiellement au pays qu'il habite. II vit isolé dans sa chaumière, ne voyant autour de lui aucune autre. habitation. S'il sort pour cultiver son champ, il y est encore seul ; de larges fosses, des haies impénétrables lui interdisent la vue de son semblable. Il n'a d'autre société que celle de ses bœufs, à qui il parle sans cesse, et pour qui même il fait des chansons. S'il veut vendre quelques bestiaux à une foire, la foire est rarement à plus d'une lieue ; souvent même les marchands viennent le trouver dans son enclos. Il n'y a dans ces contrées aucune ville qui répande la civilisation, aucune routé qui y conduise les étrangers, qui favorise la circulation, qui permette aux habitants de se fréquenter, et aux passions humaines de s'adoucir et de s'user par un frottement journalier.
« La Plaine est traversée par plusieurs grandes routes, et ses habitants sont plus civilisés que ceux du Bocage ; ils ont un caractère moins prononcé et plus confiant ; ils aiment le repos, la danse, le vin, sans toutefois en faire excès ; leur taille est plus élevée, leur physionomie plus ouverte, leur carnation plus vive. Ils sont aussi braves, mais moins industrieux et plus processifs ; ce qui provient sans doute de ce que leurs propriétés n'ont pas des limites aussi immuables. Quoique leur esprit, plus flexible, se soit plus facilement détaché des prêtres, il n'est pas moins ouvert à tous les préjugés de l'ignorance. Il existe pourtant, dans la Plaine, une différence assez notable entre les catholiques et les protestants ; ceux-ci sont, en général, plus laborieux et plus instruits.
« L'habitant du Marais est encore plus grand que celui de la Plaine ; il a plus d'embonpoint, ses membres sont plus massifs, mais il manque de santé et d'agilité ; il est grossier, apathique et ne pousse pas loin sa carrière. Une cabane de roseaux, un petit pré, quelques vaches, un bateau qui sert a la pêche, et souvent à voler du fourrage le long de la rivière, un fusil pour tuer les oiseaux d'eau, voila toute sa fortune et tous ses moyens d'industrie. »
Au XIXe siècle, les usages, sauf les cérémonies des noces, qui offrent quelques traits particuliers, n'ont rien de remarquable. Les fêtes et divertissements tiennent aux travaux champêtres et à la croyance religieuse. C'est ainsi que la récolte des châtaignes, dans certaines contrées, et, dans d'autres, la tonte des brebis, le fanage, la moisson sont accompagnés de jeux et de danses ; que le jour de tel saint il faut se régaler de crêpes pour empêcher le blé de se carier, etc.
Pendant l'été, il y a beaucoup de ballades ou fêtes champêtres. C'est là que les hommes boivent et que les jeunes gens dansent au son de la musette, ou plus souvent à la voix d'une vieille femme qui chante gravement un air monotone et sans paroles ; c'est là que se forment les inclinations, que s'arrangent les mariages. Une jeune fille qui paraît à la ballade sans un garçon qui lui tire les doigts est méprisée de ses compagnes. C'est aussi aux ballades qu'on choisit les domestiques : ils y viennent parés d'épis, s'ils se destinent aux travaux de la moisson ; de fleurs, s'ils veulent servir aux travaux du ménage.
Les fêtes de l'été ont donné naissance aux inclinations, les mariages se concluent en automne. Le fiancé, accompagné d'un de ses parents et d'un parent de sa prétendue, va faire les invitations. Il a grand soin de régler l'ordre de ses visites sur les différents degrés de parenté ; c'est une étiquette a laquelle on tient strictement. Il attache dans chaque maison, au lit du maître, un petit bouquet de laurier, orné de rubans, et fait son invitation par un compliment très long, qui est le même pour tous et de temps immémorial. Ces visites sont accompagnées de fréquentes libations.
Le jour des noces est suivi d'un lendemain plus joyeux et plus bruyant encore ; l'épisode le plus caractéristique de la cérémonie est le bouquet symbolique offert a la mariée par les jeunes filles, ses compagnes, accompagnant leur offrande d'une chanson qui n'a pas varié depuis trois cents ans, et qui retrace toutes les peines réservées à la jeune femme dans son ménage.