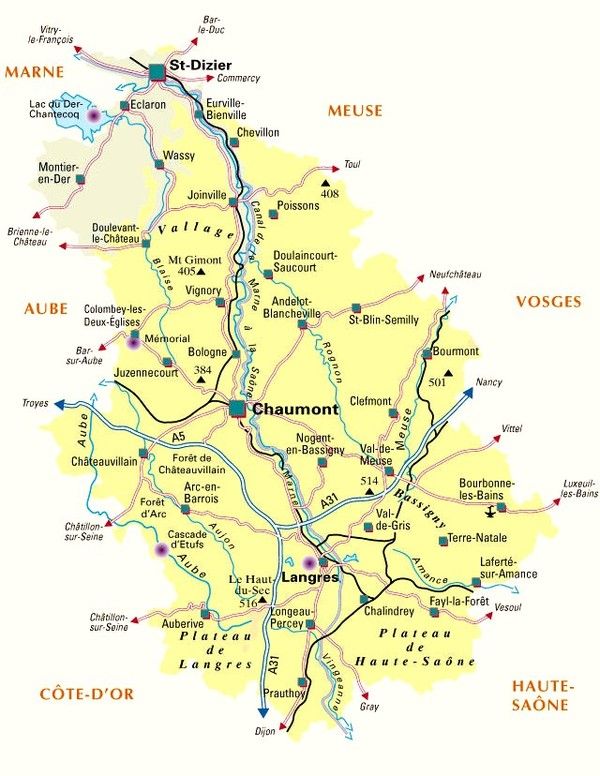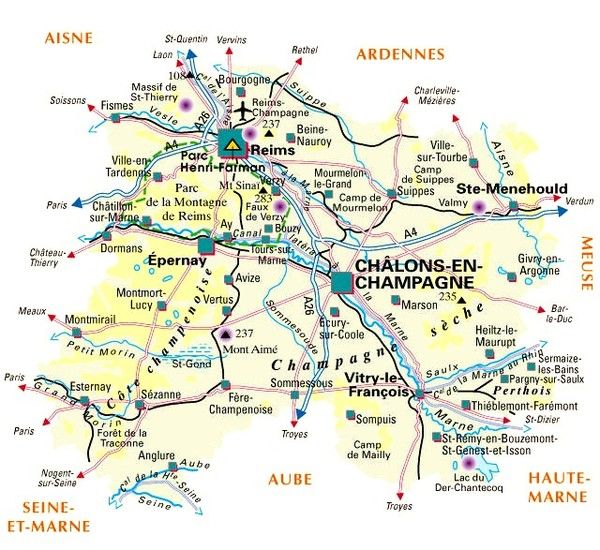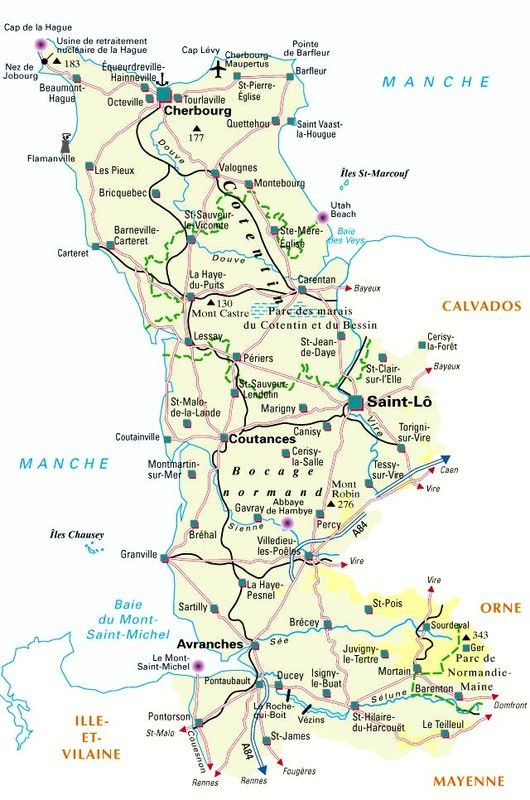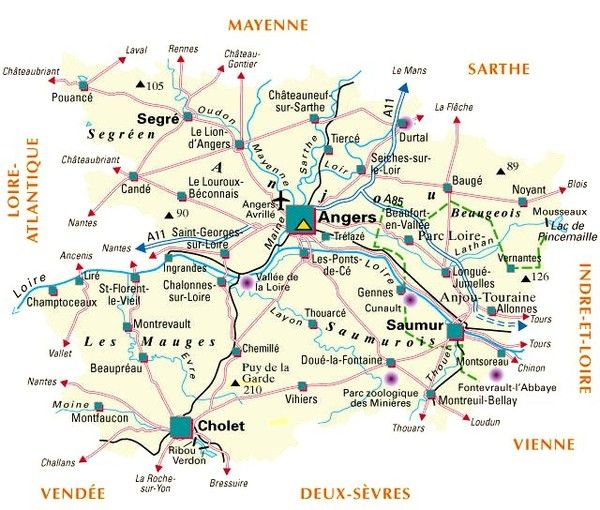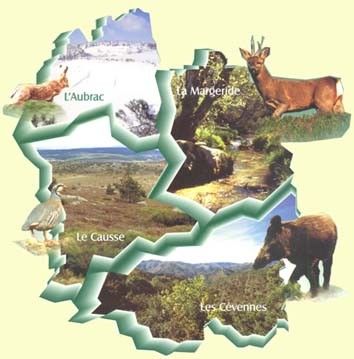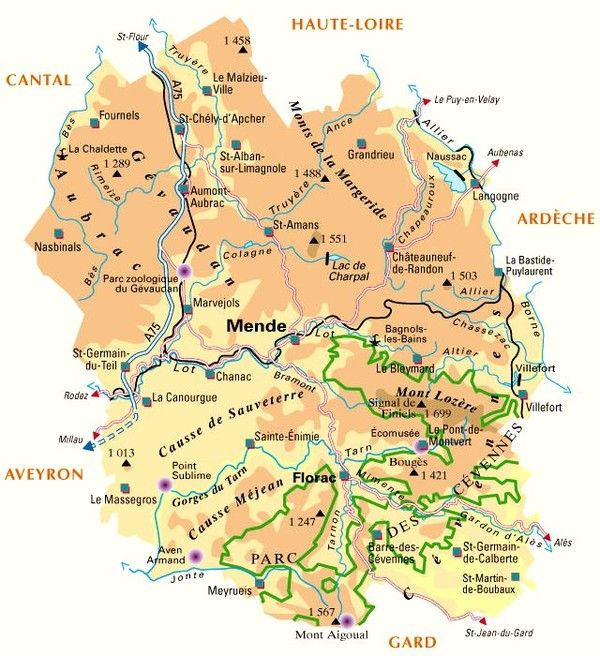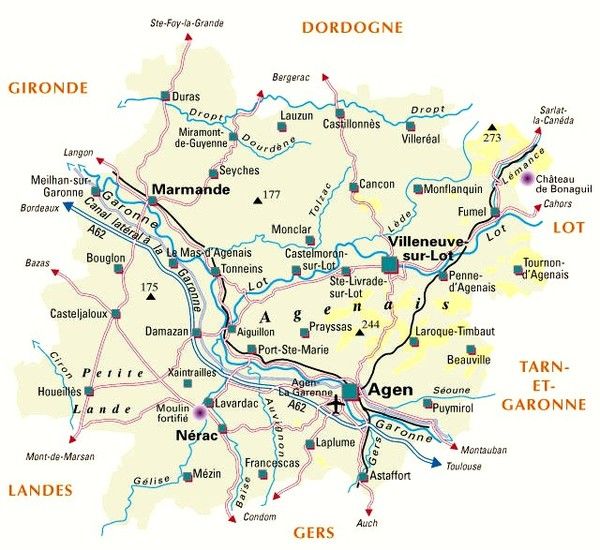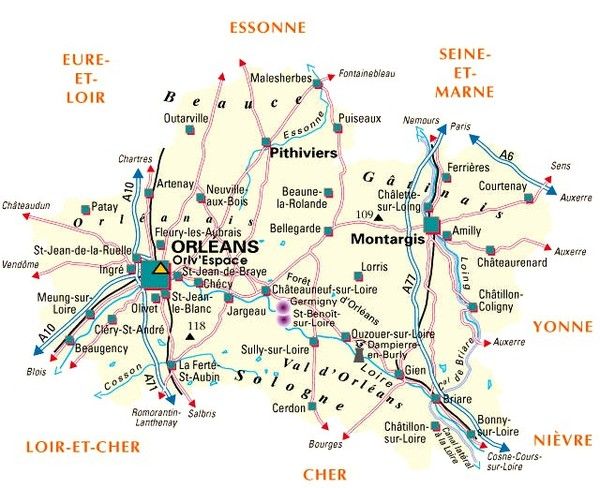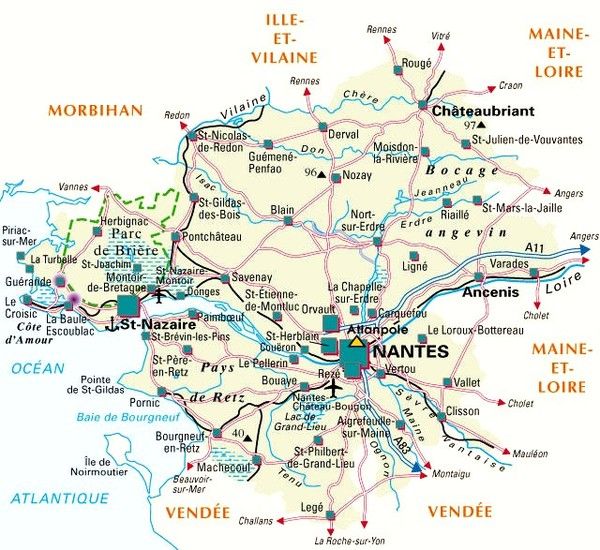Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Les départements-(histoire)-
Les départements et leur histoire-Haute Marne-52-
Antérieurement à la conquête romaine, le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Haute-Marne était occupé par les Lingones, l'un des peuples les plus anciens et les plus puissants des Gaules. Cantonnés sur la limite de la Belgique et de la Celtique, ils confinaient, au nord, avec les Remi et les Leuci ; au sud, avec les &Aeligdui ; à l'ouest, avec les Senones et les Tricasses ; à l'est, la Saône les séparait des Sequani.
Ils avaient pour capitale Langres, qui a pris le nom du peuple, mais qui s'appelait auparavant Andomadunum. Ainsi que les autres peuplades gauloises, les Lingons reconnaissaient, sous le nom de Diex, et non Dis, comme plusieurs auteurs l'ont écrit, un esprit souverain et créateur de l'univers, un Dieu qui punit le vice et récompense la vertu. Ils croyaient aussi à l'immortalité de l'âme. C'était en plein air, au sein des forêts, que s'accomplissaient leurs mystères sacrés. On retrouve encore, en plusieurs endroits de la Haute-Marne, de ces grandes pierres druidiques sur lesquelles ils sacrifiaient à leur divinité. D'après l'inventaire des monuments mégalithiques de la Champagne, publié par M. A. Daguin, on compte dans la Haute-Marne : 5 dolmens, 6 menhirs, 1 cromlech (les Fourches, près de Langres), 1 pierre branlante, 12 pierres diverses.
Six cents ans avant l'ère chrétienne, les Lingons, unis aux Boïens, passèrent les Alpes Pennines. Ayant traversé le fleuve sans fond (c'est ainsi que les Celtes désignaient le Pô), ils chassèrent les Étrusques de la rive droite, et s'y établirent. Braves, impétueux, on les voyait fendre sur l'ennemi avec tant de rapidité, que quelques auteurs font dériver leur nom du mot grec liggein, qui signifie fondre. Cependant, trop faibles pour lutter contre de puissants voisins, ils furent à leur tour conquis, et chassés par les Romains du territoire qu'ils occupaient au delà des Alpes.
César les trouva établis sur l'une et l'autre rive de la Marne, formant une cité (civitas) populeuse et puissante. Compris dans cette partie de la Gaule vierge encore des armes romaines, et connue sous le nom de Gallia comata, Gaule chevelue, ils y dominaient, suivant Tacite, sur d'autres peuples. Il paraît qu'ils pratiquaient l'agriculture. Claudien vante leurs champs fertiles et leurs riches moissons, qui, de son temps, servaient à l'approvisionnement de Rome.
César, loin de les combattre, rechercha leur alliance. Il mande au sénat, comme une nouvelle très favorable, qu'il a gagné l'amitié des Lingons. Ceux-ci lui fournirent des vivres et des contingents dans sa guerre contre les Helvètes. C'est sur le territoire Lingon, près de la source de l'Aube, que six mille Helvètes, vaincus par les Romains, furent vendus comme esclaves ou massacrés. A quelque distance d'Auberive, on trouve la vallée où cette action sanglante se passa, qui fut désignée sous le nom de Vaux-Sang (vallis Sanguinis).
Alliés du peuple romain, faederati, suivant l'expression de Pline, les Lingons lui restèrent fidèles. Vainement l'héroïque Vercingétorix essaya-t-il de les rallier à la cause de l'indépendance nationale. Dans cette lutte suprême du courage gaulois contre l'étranger, ils restèrent indifférents , comme si, dans leurs courses aventureuses, ils avaient perdu le souvenir et le sentiment de la patrie. Plus tard même, quand Julius Vindex voulut renverser Néron, ils se déclarèrent contre lui, et soutinrent avec les Trévires, dit Tacite, les intérêts de Néron ; ce dont Galba les punit en privant leurs villes de leurs murailles et d'une partie de leur territoire.
C'était trop de honte ; ils se réveillèrent enfin. Vitellius et Vespasien se disputaient l'empire ; les légions étaient divisées ; le sang de Vercingétorix avait engendré des vengeurs dans les Gaules. Ce n'était plus seulement l'indépendance qu'elles réclamaient, c'était l'empire ; les druides, sortant de leurs retraites, prêchaient la guerre sacrée ; sur les bords du Rhin, Velléda, la prophétesse, avait parlé ; ses oracles promettaient la victoire aux fils des vieux Celtes.
De toutes parts on courait aux armes. Conduits par Julius Sabinus, leur chef, les Lingons se rallièrent à l'empire gaulois, et jurèrent de le défendre. Julius Sabinus était d'une naissance illustre ; il remontait à Jules César. Puissant et renommé parmi les Lingons, son courage, quoi qu'en dise Tacite, qui représente ce chef gaulois comme un fou ambitieux, n'était pas au-dessous de sa fortune. Proclamé césar, il marcha contre les Sequani, restés fidèles aux Romains.
Après plusieurs combats, il fut vaincu. Réduit à la dernière extrémité, il hésita sur ce qu'il deviendrait. La fuite en Germanie lui était facile ; mais, uni depuis peu par amour à une jeune Gauloise nommée Éponine, il préféra braver tous les périls plutôt que de se séparer de celle qu'il ne pouvait ni abandonner ni emmener avec lui. Dans une de ses maisons de campagne existaient de vastes souterrains, construits jadis pour les usages de la guerre, et propres à recevoir des vivres, des meubles, tout ce qui était nécessaire à la vie de plusieurs hommes. L'entrée en était secrète et connue seulement de deux affranchis dévoués à Sabinus.
Ce fut dans cette maison que se rendit le noble Gaulois, annonçant qu'il allait terminer sa vie par le poison, et il congédia ses serviteurs et tous ses esclaves. Les deux affranchis mirent alors le feu au bâtiment ; et le bruit se répandit en tout lieu que Sabinus s'était empoisonné, et que son cadavre avait été la proie des flammes. A cette nouvelle, trop bien confirmée par le témoignage de Martial, l'un des affranchis fidèles, une douleur inexprimable s'empara d'Éponine ; elle se jeta la face contre terre, pleurant et sanglotant, et resta trois jours et trois nuits dans son désespoir, refusant toute nourriture. Sabinus, attendri et effrayé, lui envoya de nouveau Martial pour lui révéler qu'il n'était point mort, qu'il vivait dans une retraite inconnue, mais qu'il la priait de persévérer aux yeux du monde dans son affliction, afin d'entretenir une erreur à laquelle il devrait son salut.
Qu'on se représente, s'il se peut, l'état d'Éponine à cette nouvelle ; l'allégresse dans l'âme, elle prit tous les signes du deuil, et joua si bien, selon l'expression d'un ancien, la tragédie de son malheur, que personne n'en conçut le moindre doute. Bientôt, brûlant de voir son époux, elle se fit conduire pendant la nuit au lieu de sa retraite, et revint avant le jour ; elle y retourna, s'enhardit peu à peu à y rester ; puis elle n'en voulut plus sortir... Là elle devint deux fois mère : « Seule comme la lionne au fond de sa tanière, dit un écrivain grec qui connut l'un de ses fils, elle supporta les douleurs de l'enfantement, et nourrit de son sein ses deux lionceaux. »
Par intervalles, elle allait en Italie observer et consulter leurs amis communs. Mais les deux époux furent enfin découverts et conduits prisonniers à Rome. Amenée devant l'empereur, Éponine se prosterna à ses pieds, et lui montrant ses enfants : « César, dit-elle, je les ai conçus et allaités dans les tombeaux afin que plus de suppliants vinssent embrasser tes genoux. » Ses paroles, sa douceur, son héroïsme, arrachèrent des larmes à tous les assistants ; mais Vespasien, inflexible, ordonna de traîner sur-le-champ Sabinus au supplice. Éponine alors se releva, et d'une voix forte et pleine de dignité, elle réclama que des destinées si longtemps communes ne fussent point désunies à ce dernier moment. « Fais-moi cette grâce, Vespasien, s'écria-t-elle, car ton aspect et tes lois me pèsent mille fois plus que la vie dans les ténèbres et sous la terre ! »
Depuis longtemps les Gaules étaient pacifiées. Le sang de l'héroïque Éponine et du malheureux Sabinus fut le dernier versé pour la cause de la vieille indépendance gauloise. La Gaule se résigna à devenir romaine. Cependant, les Lingons résistèrent encore et ne firent la paix avec Rome que sous Domitien. Toujours libres et indépendants, Valentinien voulut les rendre tributaires. « Que l'empereur sache, lui répondirent-ils, que les Lingons aiment avant tout la liberté. S'il veut les forcer à faire quelque chose qui y soit contraire, il verra combien ils sont prompts à prendre les armes ! »
Cette réponse fière et courageuse arrêta les volontés de l'empereur, et les Lingons continuèrent d'envoyer, selon leur coutume, une main droite d'argent aux légions romaines en signe d'alliance. Mais s'ils restèrent libres en face des dominateurs du monde, ils n'échappèrent pas à la servitude commune quand les barbares se ruèrent sur l'empire. A la fin du IIIe siècle, les Vandales ravagèrent leur territoire, et le couvrirent de sang et de ruines. « Plus tard, dit Arthur Daguin, le pays de Langres fut conquis par les Francs ; mais, depuis trois siècles déjà, le christianisme y avait pénétré par le zèle de saint Bénigne, l'apôtre de la Bourgogne, envoyé par saint Irénée vers l'an 160 ; et plusieurs auteurs très autorisés placent vers l'an 200 l'épiscopat de saint Sénateur, premier évêque de Langres.
« Dans les siècles. suivants, le territoire des Lingons se présente comme divisé en comtés. Les chroniques nous ont transmis les noms de ceux d'Attouar, de Bar-sur-Aube, de Bar-sur-Seine, du Bassigny, de Bologne et d'Andelot, de Nijon, de Duesmois, de Langres, de Lassois, de Mémont, du Moge, d'Ousche et de Tonnerre. Tous ces comtés paraissent avoir relevé de celui de Langres dont les évêques devinrent titulaires en 967. Après l'avoir aliéné vers l'an 1000, les évêques de Langres le rachetèrent en 1178 ou 1179, et en offrirent la suzeraineté au roi de France, à condition que ce comté ne serait jamais séparé de la couronne. C'est, croit-on, en retour de ce don que les évêques reçurent les titres de duc de Langres et de pair de France. »
Au Moyen Age, le Langrois et le Bassigny comptaient un grand nombre d'abbayes : Auberive, Beaulieu, Belmont, Benoîtevaux, Lacrêtre, Longuay, Morimond, Poulangy, Septfontaines, Val-des-Écoliers, Vaux-Ia-Douce, dont la plupart suivaient la règle de saint Bernard. Pendant que ces laborieux solitaires s'efforçaient de rendre la vie à ce pays si bouleversé par les barbares, les seigneurs Langrois ne cessaient de l'agiter par leurs querelles particulières.
Plus tard, Philippe le Bel leur fit défense de guerroyer entre eux. C'était, disaient-ils, leur enlever leur plus beau privilège : ils s'en plaignirent à Louis le Hutin, qui rapporta la défense. Dès lors plus de repos pour ce malheureux pays. Partout et toujours l'anarchie et la guerre ! Champs ravagés, paysans rançonnés, pillés, vexés, bourgs et villages réduits en cendres, tels furent les résultats des longues luttes féodales des sires de Vergy, d'Aigremont et de Châteauvillain, etc.
Puis vinrent les Anglais et leurs partisans qui, de 1350 environ jusqu'en 1435, guerroyèrent dans le pays et le désolèrent. « Pour retourner au service du roi au milieu des garnisons ennemies , disent les Langrois dans une supplique, il a fallu faire le sacrifice de tous nos biens ; car ces garnisons, logées tout à l'entour de la ville, ont pillé et incendié de toutes parts, tué les gens, bouté le feu, extirpé et copé nos vignes et nos blés, dégasté nos biens, maisons et héritages. Pour ce faict, ajoutent-ils, la chose nous est venue de si grand'charges et sommes tombés en si grande pauvreté que nous n'avons de quoi vivre ; contraints, ne pouvant l'acheter à argent, de bailler ès marchands, pour avoir du blé, plusieurs de nos biens meubles, c'est à sçavoir : pos, poelles, chaudrons, lis, linges et autres meubles. »
Telle était la misère des Langrois ; mais hélas ! leurs maux n'étaient pas finis. A peine délivrés de l'étranger, ils virent s'abattre sur leur territoire une foule d'aventuriers, connus sous le nom d'écorcheurs et de retondeurs. Le bâtard de Bourbon occupait le pays de Langres à la tête de ces bandits. Il s'était emparé de La Mothe, d'où il mettait tout le pays à contribution. Chargé de butin, il se disposait à se ruer sur la Bourgogne, quand Jean de Vergy surprit sa bande et la dispersa. Pour lui, arrêté à Bar-sur-Aube, jugé et condamné, il fut jeté à la rivière dans un sac.
Après la guerre vint la famine, en 1437. Migneret révèle dans son Histoire de Langres qu' « on voyait dans les villes les pauvres se rassembler sur Ies fumiers et y périr de faim. Cette famine fut suivie de la peste ; les loups, accoutumés à se nourrir de cadavres humains, se jetaient sur les vivants jusque dans les villes."
Au XVIe siècle, ce pays souffrit peu des guerres religieuses ; le parti des politiques y dominait, et, malgré le voisinage des Guises, malgré la sanglante provocation de Wassy, fidèle au roi, il sut rester sage et tranquille. Mais, dans les querelles de la maison d'Autriche et de la France, il fut en proie à toutes les calamités de la guerre.
On sait que, après le siège de Dôle par le prince de Condé, les armées réunies de la Lorraine, du comté de Bourgogne et de l'empire envahirent le territoire. Cette guerre, qui dura de 1636 à 1642, « a laissé, ajoute Migneret, des souvenirs ineffaçables dans l'esprit de la population. Chaque village brûlé ou détruit a transmis l'histoire de son malheur aux générations actuelles ; quelques contrées portent encore le nom redouté de Galas (général des impériaux), et des personnes dignes de foi nous ont assuré avoir entendu, dans leur jeunesse, ajouter aux litanies des saints cette expression naïve dé la terreur que les généraux inspiraient : A Forfats, Galas et Piccolomini, libera nos, Domime ! »
Jusqu'en 1814, ce pays vécut tranquille ; mais, dans cette année désastreuse, il fut occupé par les alliés. Napoléon chassa l'ennemi de Saint-Dizier. Voulant occuper Troyes avant lui, et empêcher la jonction des deux armées, autrichienne et prussienne, il traversa la forêt du Der, atteignit le 28 janvier Montierender et arriva le 29 à Brienne, d'où il chassa Blücher.
Après les combats des 20 et 21 février sur l'Aube, il s'était porté par Saint-Dizier et Joinville sur Doulevant. Ce mouvement hardi jeta la terreur parmi les coalisés ; se voyant menacés sur leurs derrières, les Autrichiens évacuèrent Chaumont et se retirèrent sur Langres. Plus encore que les villes, les campagnes eurent à souffrir de l'invasion. Aussi les paysans étaient-ils exaspérés. Réfugiés dans les bois, ils ne craignaient pas d'attaquer les corps isolés et les convois. Ceux de Perrancey, Vieux-Moulins et Noidant, entre autres, armés de vieux fusils et de fourches, se jetèrent sur les Cosaques et en tuèrent un grand nombre. Un escadron autrichien se porta sur Vieux-Moulins, avec l'ordre d'amener prisonnier tout ce qu'il trouverait. Il n'y avait plus que quelques vieillards.
Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département de la Haute-Marne eut à subir l'invasion des armées ennemies et à payer d'énormes réquisitions. La première armée (Ier, VIIe et VIIIe corps), sous les ordres du général de Manteuffel, occupa Joinville, Bologne, Chaumont, Nogent et Châteauvillain ; la deuxième armée, commandée par le prince Frédéric-Charles, occupa Saint-Dizier, Montierender, Joinville, Châteauvillain et Montigny ; enfin, la troisième armée, commandée par le prince royal Frédéric-Guillaume de Prusse, passa à Saint-Dizier et Blesmes. Les pertes subies par le département de la Haute-Marne, durant cette guerre funeste, ont été évaluées officiellement à 7 401 293 fr. 40.
Les départements et leur histoire - Marne - 51 -
Lorsque les Romains pénétrèrent dans les Gaules, ils trouvèrent la partie sud-est du territoire, qu'ils désignèrent après leur conquête sous le nom de Belgica secunda, occupée par deux peuplades, les Remi et les Catalauni, dont tous leurs auteurs s'accordent à vanter le courage et la puissance. Ces contrées qui devinrent, sous la monarchie franque, les domaines indépendants des évêques de Reims et de Châlons, quoique enclavées dans la Champagne et rattachées par certains liens de vassalité aux comtes de cette province, ont formé presque en entier le département actuel de la Marne.
Tout ce qui précède la période romaine est resté dans l'obscurité la plus profonde ; mais il est permis de supposer, pour ces populations, de glorieux antécédents, sur la foi de César lui-même, leur ennemi et leur vainqueur, écrivant dans ses immortels Commentaires : Gallorum omnium fortissimi Belgii ; ce à quoi Strabon ajoute : Inter istas gentes Remi sunt nobilissimi (De tous les Gaulois, les Belges sont les plus braves, et parmi eux les Rémois sont les premiers à citer). De pareils titres de noblesse peuvent consoler de quelques lacunes dans l'histoire ; il est à regretter cependant qu'aucun document, qu'aucun débris de monuments religieux ou civils ne vienne jeter la moindre clarté sur un passé qui avait- valu à nos ancêtres une si glorieuse renommée et une position si importante.
César et ses successeurs, qui se connaissaient en valeur et savaient l'honorer, firent tous leurs efforts pour s'attacher les Remi et les Catalauni ; ils y parvinrent et s'en firent des alliés aussi fidèles que les Éduens l'étaient dans la partie celtique de leur nouvelle conquête ; aussi n'avons-nous à citer aucune révolte contre la domination des vainqueurs. De nombreuses fouilles archéologiques ont été pratiquées dans le département et ont amené d'importantes découvertes en objets gallo-romains, notamment dans la contrée sise entre Reims et Sainte-Menehould, et aux environs de Sézanne. MM. de Baye à Baye, Counhage à Suippes, de Barthélemy à Courmelois, Werlé à Reims, ont de précieuses collections. On a découvert à Coizard, arrondissement d'Épernay, une station extrêmement importante de l'âge de la pierre polie, connue de tout le monde savant.
Ce qui, partout ailleurs, est une occasion de déchirements et de persécutions s'accomplit dans cette contrée sans que l'harmonie en paraisse troublée ; les temples s'y élèvent en l'honneur de Jupiter, de Mars et d'Apollon, sans protestation des cultes abolis ; le christianisme y apparaît à son tour dès le IIIe siècle, sans que des mesures bien rigoureuses signalent les vengeances du paganisme menacé ; enfin les barbares eux-mêmes semblent respecter ce territoire comme un terrain neutre et consacré à la paix, et lorsque Attila en menace la capitale, on voit combattre, pour sa défense, sous le même drapeau, les Francs de Mérovée, les Wisigoths de Théodoric et les légions d'Aétius.
La substitution de la monarchie de Clovis à la domination romaine s'y opéra aussi sans secousses ; sous les premiers successeurs de ce prince, le pays fit partie du royaume d'Austrasie ; dont Reims fut même quelque temps la capitale.
Des lieutenants royaux, avec le titre de comtes, administraient la province. Elle suivit le sort de l'État auquel elle était incorporée pendant les règnes si agités des rois de la première race, sans qu'aucun épisode notable signale son histoire particulière. Sous Charlemagne, l'extension des limites de l'empire la fit passer dans la Neustrie ; mais, au milieu de tous ces bouleversements, deux pouvoirs s'étaient maintenus et avaient grandi : c'étaient ceux des évêques de Reims et de Châlons.
Dès le temps de Clovis, ils étaient en possession de privilèges considérables que chaque siècle avait vus augmenter ; depuis longtemps, l'autorité royale sur les villes épiscopales n'était plus que nominale. Les prélats, à leur dignité religieuse, avaient ajouté le titre et les pouvoirs de comtes : l'évêque de Châlons battait monnaie ; tous les deux étaient pairs de France et pouvaient réunir une armée de soixante mille vassaux dans la querelle des investitures, quand Louis le Gros se fit le défenseur des prétentions de la papauté. Il ne faut donc pas s'étonner de voir, à l'époque du morcellement de la France féodale, l'influence des sièges épiscopaux de Châlons et de Reims prévaloir contre le menaçant voisinage des comtes de Vermandois et de Champagne.
Pendant la crise qu'amena l'affaissement du pouvoir central sous les derniers carlovingiens, il y eut des luttes, des alternatives de succès et de revers ; les prélats, aussi guerriers que pasteurs, subirent les chances des batailles auxquelles les entraînaient les nécessités de leur puissance territoriale ; mais, encouragés par les sympathies et l'influence des rois de France, qui redoutaient moins leur pouvoir que l'agrandissement des vassaux laïques de la couronne, ils maintinrent leur autorité sur leurs deux capitales et sur un rayon qui répond à peu près exactement à la circonscription actuelle du département ; tout ce que put obtenir contre elle la dynastie héréditaire des comtes de Champagne, fondée par le fameux Thibaut, fut la reconnaissance d'un fait pour ainsi dire géographique, l'incorporation des deux évêchés dans le territoire de la Champagne, l'hommage, à ce titre seulement, aux comtes de la province ; mais sans aucune atteinte aux privilèges séculaires, sans aucun empiètement sur les droits et sur l'indépendance des prélats.
Grâce à cet état de choses, il y eut, au milieu de la Champagne proprement dite, une Champagne rémoise et une Champagne châlonnaise, qui, le plus souvent, restèrent en dehors des discordes et des guerres dont fut agitée la France, et purent même garder la neutralité dans les nombreuses et sanglantes querelles que vidaient sur leurs frontières nos rois et les comtes de Champagne. Quoique ce fussent surtout les villes qui profitassent des bienfaits de la paix, et quoique la prospérité s'y révélât à des signes plus apparents, les campagnes avaient trouvé aussi, sous ce régime, leur part de sécurité et de bien-être, lorsque l'invasion anglaise, au XIIIe siècle, vint réclamer de leur patriotisme sa part de dévouement et de sacrifices.
Les commencements de cette longue et terrible guerre coïncident avec la réunion de la Champagne à la couronne de France, Jeanne, unique héritière de Henri III, quatorzième comte de Champagne, ayant épousé Philippe le Bel en 1284. Cette cession, qui ne fut solennellement enregistrée qu'en 1361, sous le roi Jean, souleva des difficultés dont le détail appartient à l'histoire du comté de Champagne ; nous avons à constater seulement qu'à dater de cette époque furent rompus les derniers liens de vassalité qui rattachaient les domaines des évêques à la maison de Champagne.
La première attaque sérieuse fut dirigée par Robert Knolles et Eustache d'Auberticourt, que repoussa Henri de Poitiers, évêque de Troyes. A ces assaillants succéda bientôt Édouard d'Angleterre, qui, profitant de la captivité du roi Jean, fondit sur la Champagne, où il rencontra toutefois une vigoureuse résistance.
Le traité de Brétigny exposa le pays à de nouvelles calamités ; il fallut que Du Guesclin vînt le délivrer des bandes indisciplinées de malandrins et de tard venus, qui pillaient les villes et ravageaient les campagnes. De 1368 à 1380, eurent lieu de nouvelles expéditions des Anglais, sous les ordres des ducs de Lancastre et de Buckingham, et, cinquante ans plus tard, la victoire de Gravant, remportée par Salisbury, qui put croire un instant avoir arraché la province entière à la France. Qu'on se représente, en effet, ce malheureux pays isole au milieu de territoires hostiles : Bourgogne, Flandre, Alsace et Lorraine.
Le découragement et le désespoir se seraient emparés de caractères moins solidement trempés que celui des Champenois. Une désolation si profonde, un danger si immense ne fit que réveiller leur courage en leur inspirant pour la mère patrie une pitié héroïque et sublime. Michelet, en parlant de Jeanne d'Arc, a décrit ce qui dut se passer dans ces cœurs champenois, que César avait si bien devinés.
Il ne nous appartient pas de toucher à cette grande épopée nationale dont l'expulsion de l'Anglais fut le dénouement ; constatons seulement que, dans cette crise suprême, le tribut de sang payé par la brave contrée qui nous occupe fut tel, qu'on dut recourir à des mesures extraordinaires pour repeupler les campagnes et les villes. Une paix sérieuse et durable eût été le meilleur moyen d'arriver à ce but ; mais cette heure réparatrice n'était point encore venue.
La lutte de Louis XI et de Charles le Téméraire, les guerres de François Ier et de Charles-Quint, la peste, qui ajouta ses ravages à tant d'autres fléaux, mirent obstacle pendant longtemps à la cicatrisation des plaies anciennes. Quoique l'influence des évêques de Reims et de Châlons et le royalisme de la population eussent atténué les effets de la Réforme et de la Ligue, la solidarité entre les diverses provinces de la monarchie était dès lors assez étroite pour qu'on ne pût espérer la prospérité des unes au milieu de la désolation des autres; le mal n'était donc pas réparé lorsque, pendant la minorité de Louis XIV, le pays eut à subir, en 1650, une invasion des Espagnols.
Ce dernier assaut précéda une paix de plus d'un siècle, le théâtre de la guerre ayant été éloigné sous les règnes qui suivirent; mais les conditions de cette paix intérieure ne permettaient pas encore d'en espérer de bien heureux résultats : aggravation des impôts, exigences du recrutement, suppression des vieilles franchises, grâce à la centralisation administrative et au despotisme, aux exactions des agents royaux, tel est le prix auquel les malheureuses provinces payaient les somptueuses prodigalités de Versailles. Aussi se ferait-on difficilement une idée des espérances enthousiastes qui saluèrent les premières promesses de la Révolution de 1789.
Lorsque la France fut envahie et que les Prussiens eurent pénétré en Lorraine, on peut dire que la Champagne se leva comme un seul homme. Dumouriez, pour ses opérations de l'Argonne, trouva un précieux concours dans cette héroïque population. La journée de Valmy inaugura toute une série de victoires auxquelles prirent une large part les volontaires champenois, et, dans cette grande lutte de la France contre l'étranger, le département de la Marne est du nombre de ceux qui ne désespérèrent point de la sainte cause qu'ils avaient embrassée et qui restèrent fidèles jusqu'au dernier moment au gouvernement que la France s'était alors donné.
Les vastes plaines qui se déploient au nord et à l'est de Châlons ont toujours fait de ce territoire une route ouverte aux invasions. Après nos revers de 1813, lorsque les puissances coalisées reprirent l'offensive, la Champagne était désignée d'avance comme le point le plus exposé à leurs attaques ; c'est aussi ce point que choisit Napoléon pour y concentrer les efforts de la résistance.
On a trop souvent célébré les merveilles de cette campagne de 1814 pour que nous essayions d'en dire autre chose que ce qui se rattache spécialement aux différentes localités dans les noms se présenteront dans cette notice ; nous n'avons à constater ici que l'attitude générale du département dans ces graves circonstances. La population fut digne d'elle-même et de tout son passé ; Napoléon n'avait pas trop présumé du dévouement des braves Champenois.
En 1870, après la dispersion de nos armées, les plaines ouvertes de ce département ne pouvaient offrir aucun point de sérieuse résistance aux masses envahissantes de l'ennemi ; l'occupation allemande y fut longue et coûteuse : les réquisitions, les emprunts forcés, les dévastations et les charges de toute nature s'y traduisirent par une dépense de 26 237 675 francs.
Les départements et leur histoire - Manche - 50 -
(Région Basse-Normandie) Le territoire de ce département faisait partie de l'Armorique : les Unelli habitaient la presqu'île ; au sud se trouvaient les Abrincatui. Cette sorte de division se maintint jusqu'à la Révolution et forma les deux pays distincts du Cotentin et de l'Avranchin. Le pays était déjà très peuplé au temps de César, et fournit des troupes nombreuses à Viridorix lors de la révolte de cette partie de la Gaule contre les Romains. C'est à un kilomètre de Gavray que se trouvait le Camp de Sabinus, chez les Unelles, découvert en 1874 par le professeur C. Clouet. Exposé, comme tous les pays voisins de la mer, aux incursions des pirates du Nord, ce pays reçut la visite de Charlemagne, qui, en y bâtissant des forteresses, essayait ainsi de le préserver des désastres qu'il entrevoyait dans l'avenir. Cette contrée n'échappa point cependant à l'invasion normande, et fut soumise par Rollon ; mais, placée à l'extrémité du nouveau duché, elle participa toujours à l'esprit d'indépendance et de rébellion qui animait ses voisins de Bayeux, et se révolta plusieurs fois. Ce fut du Cotentin que sortirent ces chevaliers qui conquirent la Sicile : le village d'Hauteville, à 12 kilomètres de Coutances, est le berceau de ces vaillants enfants de Tancrède, Guillaume Bras de Fer, Drogon, Humfroy, Robert Guiscard, dont les exploits étonnèrent le midi de l'Europe. Au commencement du XIIIe siècle, le pays passa, avec le reste de la Normandie, sous l'autorité de Philippe-Auguste. Le roi Jean eut l'imprudence de le céder à Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui se hâta d'y appeler les Anglais. On trouvera à l'histoire des villes l'indication des sièges et combats dont la contrée fut le théâtre pendant la guerre de Cent ans, et qui y causèrent de grands désastres, renouvelés au XVIe siècle par les guerres religieuses. La lutte s'y prolongea, ardente et cruelle, entre les chefs protestant et catholique, Montgomery et Matignon. On doit remarquer cependant que le marchal de Matignon sut, par sa fermeté et son humanité, soustraire le pays aux sanguinaires exécutions de la Saint-Barthélemy. Dans la première partie du XVIIe siècle, le pays fut bouleversé par une de ces jacqueries, si fréquentes dans l'ancien régime, dont l'histoire nous parle à peine. Le Cotentin fut le foyer où éclata l'insurrection des Nu-Pieds, de ces paysans armés qui épouvantèrent la Normandie par leur désespoir et par leurs excès. En 1639, les impôts excessifs qui pesaient sur le peuple avaient produit déjà un sourd mécontentement, qui éclata bientôt en menaces furieuses quand le bruit courut que des commissaires arrivaient pour établir la gabelle dans toute sa rigueur, le sel baillé par impôts, dans Ie Cotentin et dans quelques autres cantons de la Normandie, qui en avaient été jusqu'alors exempts. Un honnête gentilhomme du pays courut trouver le roi et peignit si vivement le désespoir populaire que la commission fut révoquée. Il était trop tard ; la rébellion avait éclaté. Des agents de troubles, soldés par l'Angleterre et par l'Espagne, firent passer pour le chef des monopoleurs et des maltôliers l'homme qui venait de préserver la contrée de la gabelle, et poussèrent le peuple aux derniers excès, afin de le compromettre irrévocablement. Le mouvement, commencé à Avranches, se propagea dans toute la basse Normandie. Partout une multitude furieuse courait sus aux officiers de finance, aux partisans et à leurs commis, saccageait leurs bureaux, démolissait ou brûlait leurs maisons. Il suffisait de crier au monopoleur sur le premier passant pour qu'il fût massacré à l'instant. Des bandes armées s'organisèrent dans les campagnes et répandirent partout des proclamations menaçantes au nom d'un chef mystérieux, qui s'intitulait le général Jean Nu-Pieds. Des aventuriers, des hobereaux ruinés, un prêtre, se donnaient comme les lieutenants de ce général imaginaire. La perception des impôts fut presque généralement interrompue. La répression fut impitoyable. Le colonel Gassion, après avoir soumis Rouen et Caen, jusqu'où la révolte s'était propagée, marcha avec quatre mille hommes sur Avranches. La fleur de la noblesse du pays le suivait, dit Tallemant des Réaux. Les Nu-Pieds s'y étaient retranchés derrière des barricades ; mais le château était au pouvoir de leurs adversaires et ne cessait de tirer sur eux. Leur défense fut désespérée. « Pendant quatre heures et demie, dit Tallemant, quelques rebelles arrêtèrent Gassion à l'entrée d'un faubourg, où ils n'avaient pour toute défense qu'une méchante barricade. Il y courut grand danger ; car un des rebelles, vaillant autant qu'on peut l'être, et tellement dispos qu'il sautait partout où il pouvait mettre la main, tua le marquis de Courtaumer, croyant que c'était le colonel Gassion. Ce galant homme sauta quatre fois la barricade, et après se sauva. Gassion fit tout ce qu'il put pour le trouver, lui faire donner grâce et le mettre dans ses troupes ; mais cet homme n'osa s'y fier. » Tout fut tué et égorgé : ceux qu'on atteignit dans leur fuite furent livrés au chancelier Séguier, et l'homme de justice se montra plus impitoyable que l'homme de guerre, car il finit par atteindre ce nu-pieds dont Tallemant racontait les prouesses, et le fit rouer vif à Caen. Il fit également périr ou envoya aux galères tous les autres prisonniers. A la fin du siècle, la révocation de l'édit de Nantes porta un coup terrible a la prospérité du pays. Beaucoup de protestants émigrèrent. Dans son Histoire des réfugiés protestants, Weiss raconte qu'« à Saint-Lô, sur environ 800 protestants, 400 sortirent du royaume. La population protestante de Coutances émigra tout entière., et les belles manufactures de toiles qu'elle possédait furent transférées soit dans la ville voisine de Cérizy, soit dans les îles de Jersey, de Guernesey, et de là en Angleterre. Dans l'élection de Mortain, sur environ 300 réformés, plus de la moitié s'établirent en Angleterre et en Hollande. L'émigration des maîtres, que leurs plus habiles ouvriers s'empressaient de suivre, ruina pour plusieurs années diverses branches de commerce et d'industrie. » Un moment, pendant la Révolution, la guerre civile désola le sud du département. Les Vendéens s'approchèrent d'Avranches et de Granville ; mais ils furent bientôt repoussés. En 1830, le roi Charles X traversa le département pour aller s'embarquer à Cherbourg, avec sa famille, sur le Great Britain et le Charles-Caroll, deux vaisseaux américains qui appartenaient à un membre de la famille Bonaparte. |
Les départements et leur histoire-Maine et loire-49-
Les Andes ou Andegaves occupaient, à l'époque de la conquête romaine, cette partie de la Gaule qui a formé depuis la province d'Anjou et forme aujourd'hui le département de Maine-et-Loire. Les Andes, avec leurs voisins les Aulerces Cénomans, avaient pris part à une des émigrations les plus importantes des Gaulois et envoyé, dans la partie de l'Italie qui plus tard reçut le nom de Gaule Cisalpine, l'excédent de leur population.
Aussi quelques Angevins, trop zélés pour la gloire de leur pays, n'ont-ils pas manqué de considérer sans autre preuve les Andes comme fondateurs du village d'Andes, voisin de Mantoue et patrie de Virgile. Sans doute il serait bien agréable pour le patriotisme local de compter parmi les Angevins célèbres l'auteur de l'Énéide ; mais c'est là une assertion qui trouvera toujours beaucoup d'incrédules ; surtout hors du département de Maine-et-Loire.
Une gloire mieux constatée, c'est celle d'avoir, sous la conduite du vaillant Dumnacus, résisté bravement aux lieutenants de César. Vaincus néanmoins par Fabius, ils restèrent pendant cinq siècles soumis aux Romains. Mais lorsqu'au Ve siècle l'empire romain, miné depuis si longtemps à l'intérieur par la corruption césarienne, se vit de tous côtés envahi par les barbares, les Andes, comme leurs voisins, se hâtèrent de ressaisir leur indépendance ; ils s'unirent aux Bretons et firent partie de la confédération armoricaine. Leur principale ville, Juliomagus, rejeta le nom qui indiquait son origine impériale pour prendre celui d'Andegavia, depuis Angers.
Mais les Angevins n'échappaient à la domination romaine que pour retomber bientôt sous la domination plus dure des barbares. Les Saxons et les Francs furent successivement les dévastateurs et les maîtres du pays ; ce fut sous Childéric Ier que l'Anjou devint la proie des Francs. Cependant les Angevins s'étaient convertis au christianisme ; opiniâtrement attachés à leurs croyances primitives, ils avaient gardé dans les campagnes le culte des druides et repoussé le polythéisme romain.
Mais l'unité de Dieu, qui faisait le fond de leur religion nationale, devait les rendre moins hostiles au christianisme, qui d'ailleurs se montra ici fort accommodant et sut ménager des coutumes si profondément enracinées dans les moeurs du pays, que quelques-unes se sont conservées jusqu'à nos jours, telles que les processions à certains chênes, les cérémonies du gui l'an neuf, etc. « Ce qui est digne de remarque, dit M. Bodin dans ses Recherches sur l'Anjou, c'est que nos premiers évêques, qui détruisirent avec tant de zèle tous les temples des Romains, respectèrent toujours ceux des druides. »
Le premier de ces évêques fut Defensor, qui vivait dans la seconde moitié du IVe siècle. Parmi ses successeurs, saint Maurille et saint Lezin se signalèrent par leurs vertus. Ce dernier, avant d'entrer dans les ordres, avait été comte d'Angers sous le nom de Sicinius. Rainfroy, au VIIIe siècle, reçut de Charles Martel, comme bénéfice militaire, le titre et la puissance de comte d'Angers. Sur les ruines du Capitole il éleva un palais, qui devint plus tard celui de l'évêque.
On croit que parmi ses successeurs il faut placer Roland, fils de Milon et neveu de Charlemagne, le fier paladin tué à Roncevaux ; mais toute cette période est obscure. On trouve un peu plus tard l'Anjou divisé en deux comtés , comté d'outre-Maine et comté deçà Maine, qui ont chacun pour comtes Robert l'Angevin et Érispoé. Robert l'Angevin ou le Fort, placé là par Charles le Chauve pour protéger la France contre les envahissements des Bretons et des Normands, justifia par sa fidélité et sa valeur la confiance de son suzerain ; mais il fut tué dans un combat contre Hastings, le fameux chef danois. Robert le Fort est le bisaïeul de Hugues Capet, le plus ancien des ancêtres connus de la maison qui régna si longtemps sur notre pays et règne encore en Espagne.
Hastings vainqueur s'empara d'Angers, que la terreur avait rendue déserte, et où s'installèrent ses sauvages compagnons avec leurs femmes et leurs enfants. Il en fut chassé bientôt par Charles le Chauve, aidé de Salomon, roi de Bretagne. Selon une tradition douteuse, celui-ci aurait, par une tranchée, détourné la rivière, .dont le lit se trouva un moment à sec ; et alors Hastings, voyant qu'il ne pouvait plus tenir, aurait offert à Charles le Chauve une somme énorme et la promesse de quitter à tout jamais la France ; Charles aurait eu la lâcheté et l'ineptie d'accepter ces conditions de la part d'un ennemi sans foi qu'il pouvait écraser ; et Hastings, aussitôt libre, aurait continué sur les bords de la Loire ses brigandages et ses dévastations ; l'exactitude de ce récit est, nous devons le dire, révoquée en doute par M. Bodin. Quoi qu'il en soit, Angers délivrée devint le centre d'un comté héréditaire, dont Ingelger fut le premier possesseur ; c'est l'origine de la première maison d'Anjou.
Ingelger, dès l'âge de seize ans, s'était signalé par une action chevaleresque, qui lui avait attiré l'admiration de tous et la bienveillance de Charles le Chauve. Sa marraine, la comtesse de Gâtinais, jeune et belle, avait trouvé un matin auprès d'elle son mari mort subitement. Un seigneur, nommé Gontran, parent du comte, accuse la veuve d'adultère et d'assassinat. La cause est portée devant Charles le Chauve. Gontran soutient son accusation ; les seules preuves qu'il allègue sont le mépris et l'aversion témoignés par la comtesse pour son vieux mari ; il réclame du souverain l'héritage du comte, son parent, dont la veuve va être investie si elle est déclarée innocente ; en terminant, il en appelle au jugement de Dieu et jette son gage de combat.
Nul n'osera sans doute relever le défi d'un homme connu par son adresse et son audace ; la comtesse s'évanouit. Mais déjà Ingelger avait relevé le gant et, se présentant devant Charles, l'avait supplié de lui permettre le combat. Après avoir longtemps résisté, Charles cède ; le combat a lieu le lendemain. Dès la première passe, la lance de Gontran perce le bouclier du page et y reste fixée, tandis qu'Ingelger lui passe la sienne au travers du corps, le renverse de cheval et, mettant lui-même pied à terre, l'achève avec le poignard de miséricorde.
La comtesse, qui lui devait l'honneur, lui légua tous ses biens. Plus tard le roi lui donna le comté d'Anjou, et, par un mariage avec la nièce des riches et puissants évêques d'Orléans et de Tours, Ingelger devint un des plus importants des grands vassaux.
Ce fut pourtant à cette époque, marquée par ces brillants exploits, que les Angevins perdirent leur liberté, qu'avaient respectée les Romains. Réduits au servage, ils ne furent plus que les hommes des seigneurs francs ou normands établis dans le pays.
Foulques le Roux, fils d'Ingelger, hérita de son comté d'Anjou de deçà Maine, et lorsque Eudes, comte d'Anjou d'outre-Maine, eut contraint le roi Charles le Simple à lui céder plus de la moitié de son royaume, il donna son comté à ce même Foulques, et les deux comtés d'Anjou n'en formèrent plus qu'un seul.
Nous ne raconterons pas ici la monotone histoire des comtes d'Anjou, successeurs de Foulques Ier, et qui tous s'appellent Foulques ou Geoffroy ; des envahissements, des violences, des générosités envers le clergé, voilà leur histoire ; c'est celle de presque toutes les grandes maisons de cette époque. Mais le règne du dernier comte, Geoffroy V Plantagenet, marquant une époque de nos annales, mérite qu'on s'y arrête un instant.
Geoffroy Plantagenet, ainsi surnommé parce qu'il portait sur son casque une branche de genêt, avait épousé Mathilde, fille et unique héritière de Henri Ier, roi d'Angleterre. A la mort de ce dernier, il eut, pour faire valoir ses droits, à soutenir une sanglante guerre contre Étienne, neveu de Henri ; il lui enleva la Normandie, et son fils Henri devint roi d'Angleterre sous le nom de Henri II ; outre l'Anjou, le Maine, la Normandie et ses possessions d'outre-mer, il y adjoignit bientôt la Bretagne et la Guyenne par son mariage avec Éléonore de Guyenne. C'est là l'origine de la longue guerre entre la France et l'Angleterre, dans laquelle l'Anjou joua, pour son malheur, un rôle important.
Après la mort de Richard Cœur de Lion, son neveu, Arthur, était devenu l'héritier du trône ; Jean sans Terre, son oncle, le dépouille de ses biens, l'enferme dans une prison et bientôt le fait périr. Philippe-Auguste confisque alors les possessions de Jean sans Terre ; l'Anjou est réuni à la couronne. Saint Louis, en 1246, donna ce comté à Charles, son frère, qui fut la tige de la maison d'Anjou, appelée bientôt à régner sur le royaume de Naples. On sait comment, invité à exercer contre le légitime possesseur de ce royaume les vengeances du pape Urbain IV, il déshonora sa conquête par ses atrocités, et comment son usurpation fut châtiée en un jour par le massacre connu sous le nom de Vêpres Siciliennes, où périrent égorgés les plus brillants chevaliers de la Provence, du Maine et de l'Anjou.
Charles II, de race impitoyable, chassa les juifs de l'Anjou, et son zèle religieux le porta à les dépouiller de leurs biens, comme celui de son père l'avait déterminé à usurper le royaume de Naples, puisque usurper est le mot décent dont on se sert pour désigner les vols commis par les souverains. Ce prince maria sa fille Marguerite à Charles de Valois, fils de Philippe le Hardi, roi de France.
Ce fut ainsi que l'Anjou entra dans la maison de Valois. Philippe le Bel érigea ce comté en duché-pairie en faveur de son frère, Charles III. Ce duché devint bientôt l'apanage du prince Jean, qui, sous le nom de Jean II, fut roi de France, vaincu et pris à la bataille de Poitiers. Il avait déjà cédé l'Anjou à son second fils, Louis, qui fut fait prisonnier avec son père. Celui-ci devenu libre, son frère, Charles V, érigea en sa faveur en duché héréditaire l'Anjou, que Louis n'avait possédé jusqu'alors qu'à titre d'apanage.
Ravagé par les Anglais et par des bandes de soldats licenciés, le pays était alors en proie à une misère effroyable, qu'augmentaient encore l'avidité du nouveau duc et ses guerres lointaines en Italie, où il chercha vainement à s'emparer du royaume de Naples. Pendant cette expédition malheureuse, le trésor de l'armée étant épuisé, Pierre de Craon, chambellan du duc, est envoyé en Anjou pour se procurer des fonds. Il fait un appel à la fidélité des Angevins, réunit cent mille ducats d'or, retourne en Italie et, arrivé à Venise, y dissipe cet argent avec des joueurs et des courtisanes. Louis mourut sans avoir été secouru. Pierre de Craon, ce digne chambellan, est encore connu dans notre histoire par l'assassinat d'Olivier de Clisson, qu'il fit attaquer la nuit, à Paris, au sortir de l'hôtel Saint-Pol, par plusieurs hommes armés. Olivier de Clisson, laissé pour mort, guérit de ses blessures.
Ce fut en se dirigeant vers l'Anjou pour tirer vengeance de ce crime que le roi Charles VI fut atteint de cette démence fatale qui livra la France aux fureurs rivales de ses parents et aux dévastations des étrangers. Condamné par le parlement, enfermé dans la tour du Louvre, Pierre de Craon, dont les biens devaient être confisqués, obtint du roi des lettres d'abolition pour son double crime. Le parlement, indigné, refusa l'entérinement des lettres de grâce et confirma son premier arrêt par un autre plus sévère, mais qui ne fut pas plus exécuté que le premier.
Deux ans auparavant, Pierre de Craon avait, après avoir fait un pèlerinage, cru expier complètement son crime en léguant aux cordeliers de Paris une somme d'argent pour assister les condamnés avant leur exécution. Jusque-là on refusait aux criminels des confesseurs ; Pierre de Craon avait obtenu qu'on leur en accorderait à l'avenir. Tout en louant cette bonne intention, il est difficile de ne pas songer que Pierre de Craon, en s'intéressant si fort aux assassins et aux voleurs, agissait un peu par esprit de corps. Mais d'ailleurs l'action était bonne, et, comme le remarque M. Bodin, c'est la seule de ce genre qu'on trouve dans toute la vie du puissant baron d'Anjou.
La province fut affreusement ravagée au XVe siècle par les Anglais, et, en 1444, le duc de Sommerset l'envahit avec six mille Anglais. Il s'installa aux portes d'Angers avec ses capitaines dans l'abbaye de Saint-Nicolas, et, le soir de son arrivée, il soupait aux lumières dans une des salles du château, lorsqu'un coup de fauconneau, habilement pointé par les habitants d'Angers, tua à côté du comte le sire de Froyford. Cet accident inattendu frappa tellement le chef anglais, qu'il se retira aussitôt.
Le dernier prince de la quatrième maison d'Anjou fut René, le bon roi René, roi de Naples in partibus, et qui, après de vaines tentatives pour reprendre son royaume, se résigna à vivre tranquillement comme un bon seigneur, ami des arts et des lettres, dans ses riches possessions de Provence. Malheureusement il légua à la maison de France tous ses droits à la possession du royaume de Naples ; de là les interminables guerres d'Italie du XVIe siècle et ces luttes insensées, si funestes à Charles VIII, à Louis XII, à François Ier.
Il est digne de remarque que deux fois les princes qui ont gouverné l'Anjou se soient trouvés devenir la cause d'une guerre sanglante pour la France ; aux Plantagenets commence l'effroyable guerre qui, pendant un siècle, livre la France aux armes anglaises, et le bon roi René, léguant à Louis XI ses droits sur les Deux-Siciles, devient l'innocente cause de cette lutte contre l'Espagne et l'empire, si longtemps poursuivie encore après Maximilien et Charles-Quint.
Depuis la mort de René, l'Anjou, réuni à la couronne, n'est plus qu'un apanage, donné successivement à plusieurs princes de la maison de France, dont les plus connus sont Henri de Valois (depuis Henri III) et Philippe, fils de Louis XIV, qui devint roi d'Espagne en 1700. Ainsi l'histoire du duché d'Anjou cesse réellement dès le XVIe siècle ; mais malheureusement pour le pays, la guerre civile a trop souvent depuis fourni aux annales de cette province de tragiques épisodes, que nous allons rapidement rappeler.
Voisin du Poitou, où les calvinistes comptaient de nombreux partisans, l'Anjou sentit le contrecoup de ces agitations religieuses, auxquelles la partie du pays située au sud de la Loire prit une part active, tandis que le nord restait fidèle au catholicisme et s'attachait à la sainte Ligue. D'Andelot, l'un des principaux chefs calvinistes, traversa le pays en se rendant en Poitou et eut à livrer plusieurs combats sanglants.
Saumur s'était surtout prononcé pour la religion réformée, et la Saint-Barthélemy y fut exécutée par le comte de Montsoreau avec une impitoyable férocité. Angers n'échappa point à ces horreurs et eut bientôt après, ainsi que le pays tout entier, à subir l'atroce tyrannie de Bussy d'Amboise, nommé par Charles IX gouverneur d'Anjou. « Je sais, disait-il à celui qui osait lui faire quelques remontrances, je sais comme le vilain doit être traité ; » et ses soldats pillaient et massacraient le vilain, et traitaient l'Anjou en pays conquis.
Un crime débarrassa le pays de ce misérable. Bussy d'Amboise était un des débauchés les plus effrénés de cette époque ; il était aimé de la femme d'un des autres chefs catholiques du pays, la dame de Montsoreau, et se vanta au duc d'Anjou de sa bonne fortune. Ni celui-ci, ni le roi, son frère, ne furent discrets, et Montsoreau apprit bientôt la faute de sa femme ; il lui fait écrire à Bussy une lettre par laquelle elle lui donne un rendez-vous, au château de La Coutancière, près de Saumur, et se trouve au lieu désigné avec dix ou douze des siens ; Bussy vient accompagné de son ami Colasseau, lieutenant criminel de la sénéchaussée de Saumur. Brusquement attaqué par le comte et ses domestiques, il se défend avec fureur, couche sur le carreau quatre de ses adversaires ; son épée se rompt, il se défend avec les meubles qu'il trouve sous sa main ; mais un coup de dague, porté par derrière, l'étend mort aux pieds du comte de Montsoreau. Quant à Colasseau, on l'étouffa en lui enfonçant violemment la langue dans le gosier. Les deux cadavres furent jetés dans le fossé. C'est ainsi que périt, sous les coups d'un de ses complices, le bourreau de l'Anjou.
En 1586, la guerre recommença et désola encore les environs de Saumur. Cette ville était une position importante, recherchée par les deux partis. Elle s'était montrée favorable au calvinisme, et c'était là que le roi de Navarre avant abjuré le catholicisme qu'on lui avait imposé, le poignard sur la gorge, le lendemain de la Saint-Barthélemy.
Plus tard, lorsque Henri III, pour résister à la Ligue, fut obligé de se rapprocher du roi de Navarre, celui-ci voulut qu'on lui garantit un passage sur la Loire ; on lui donna Saumur, dont il fit gouverneur le fidèle Duplessis-Mornay. Mornay en fit augmenter les fortifications et ne le quitta que pour aller à Ivry prendre part à la défaite du duc de Mayenne ; il arriva la veille de la bataille, ce dont j'ai à louer Dieu, dit-il dans ses Mémoires ; il amenait avec lui une troupe d'Angevins, qui se signala par sa valeur et sa ferme contenance devant l'ennemi : « Et la cornette et celui qui la portait furent remarqués d'avoir toujours poussé en avant, quelque ébranlement qui fût en quelques autres ; » et le pieux calviniste ajoute toujours : « Ce dont j'ai beaucoup à louer Dieu. »
Plus tard, en 1697, il fut outragé et faillit être assassiné par un gentilhomme, nommé Saint-Phal de Beaupréau, et par ses gens dans les rues d'Angers ; quelques habitants de la ville, qui se trouvaient là, sauvèrent Duplessis des mains des assassins. Ce fut à cette occasion que Henri IV écrivit à son fidèle compagnon la lettre célèbre : « Monsieur Duplessis, j'ai un extrême déplaisir de l'outrage que vous avez reçu, auquel je participe et comme roi et comme votre ami. Comme le premier, je vous en ferai justice et me la ferai aussi. Si je ne portois que le second titre, vous n'en avez nul de qui l'épée fust plus prête a dégainer que la mienne, ni qui vous portât sa vie plus gaiement que moi. » Henri contraignit Saint-Phal a demander publiquement pardon a Duplessis-Mornay.
Ce fut à Angers que le duc de Mercœur, le dernier représentant armé de la sainte Ligue, vint faire sa soumission entre les mains de Henri IV en 1598 ; l'une des conditions de sa soumission fut la promesse d'unir sa fille et son unique héritière avec César de Vendôme, fils naturel du roi et de Gabrielle d'Estrées. Ce mariage fut célébré onze ans après à Paris.
Pendant les troubles que l'ambition de Marie de Médicis excita en 1620, Les Ponts-de-Cé furent témoins d'un combat livré aux troupes qui soutenaient le parti de la reine mère par les troupes royales ; le roi Louis XIII y assista ; la défaite des troupes rebelles contraignit la reine mère à se soumettre immédiatement, et ce fut près d'Angers qu'eut lieu l'entrevue de la mère et du fils ; scène de réconciliation et de tendres affections à laquelle l'avenir devait bientôt donner un éclatant démenti. Peu de temps après, Louis XIII ôta à Duplessis-Mornay le gouvernement de Saumur, qu'il avait gardé avec honneur pendant trente-deux ans ; l'inflexible huguenot était devenu suspect au roi, ou plutôt au cardinal de Richelieu.
Pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'Anjou, enfin pacifié, jouit d'un repos que troubla seule la révocation de l'édit de Nantes. Mais la malheureuse contrée devait être, pendant la Révolution, le théâtre presque continuel de la guerre civile.
Ce fut dans le département de Maine-et-Loire, à Saint-Florent, que s'alluma, en 1793, l'incendie qui devait dévorer tout le pays voisin. Excités depuis 'longtemps par les prêtres, les paysans éprouvaient d'ailleurs une aversion profonde pour la République, qui prétendait les contraindre à défendre la France contre l'invasion étrangère. Le 10 mars 1793, le tirage devait avoir lieu à Saint-Florent ; les jeunes gens s'y refusent. La garde nationale veut les y obliger ; ils se jettent sur elle, la désarment, prennent pour chefs un voiturier, Cathelineau, et le garde-chasse du château de Maulévrier, Stofflet. Ils s'emparent de Chemillé et de Cholet et donnent la main aux insurgés de la Vendée, qui se soulevaient en même temps. Tel fut le signal de cette affreuse guerre, si héroïque et si sanglante.
Ils organisent leur insurrection avec Stofflet et Cathelineau ; plusieurs nobles, Bonchamp, d'Elbée, Lescure, Charette et La Rochejaquelein se mettent à leur tête ; ils s'emparent de Saumur ; tout leur réussit d'abord. Ils ont affaire à des chefs inexpérimentés et à des gardes nationales réunies a la hâte, manquant de tout, tandis que les Vendéens trouvent partout des vivres, des munitions, une complicité toujours assurée. L'incendie se propage et embrase les départements de l'ouest. Châtillon, Vihiers, Chantonnay, Les Ponts-de-Cé tombent au pouvoir des Vendéens ; mais bientôt l'armée de Mayence, transportée du Rhin sur les bords de la Loire, vient changer la face des événements. Aubert-Dubayet, Kléber et Marceau conduisent à la victoire les troupes qu'avait tant compromises l'impéritie de Ronsin et de Rossignol. C'est dans le département de Maine-et-Loire que l'insurrection avait commencé ; c'est là qu'elle devait essuyer son premier échec important.
Battus à Saint-Symphoricn le 6 octobre 1793, le 9 à Châtillon, puis à Mortagne, où Lescure fut tué, les Vendéens, au nombre de quarante mille, s'avancent, le 15 octobre, sur Cholet, défendu par vingt-deux mille républicains. Ceux-ci ne s'attendaient pas à être attaqués, et le désordre se met d'abord dans leurs rangs. Mais Kléber, Marceau, Beaupuy accourent et rétablissent le combat ; l'artillerie foudroie à bout portant les insurgés ; le représentant du peuple Merlin pointe lui-même les pièces et, par son exemple, raffermit le courage des soldats. Bientôt les Vendéens écrasés fuient de toutes parts ; d'Elbée, Bonchamp sont blessés à mort. Beaupuy et Westermann poursuivent les fuyards avec la cavalerie et, par un coup d'audace, pénètrent dans Beaupréau, où la masse de l'armée vendéenne s'est réfugiée ; tout se disperse devant eux.
Le lendemain, ils voient arriver vers eux une troupe désarmée de quatre mille hommes environ poussant les cris singulièrement unis de Vive Bonchamp ! vive la République ! C'étaient quatre mille républicains faits prisonniers antérieurement par les Vendéens, et que ceux-ci avaient enfermés dans Saint-Florent. Bonchamp, près d'expirer dans ce bourg où on l'avait transporté, avait demandé leur grâce au moment où ils allaient être égorgés. Les prisonniers, délivrés sur la demande du mourant, rejoignaient l'armée républicaine.
Depuis ce moment, l'insurrection, frappée à mort, prolonge vainement son agonie désespérée. Battus près de Granville, rejetés sur la Loire, ils sont définitivement écrasés, le 25 décembre, à Savenay par Kléber et Marceau. La grande guerre de la Vendée était terminée.
Stofflet cependant continue dans l'Anjou une guerre d'escarmouches, derniers et impuissants efforts d'une cause perdue. Il résista même après la soumission de Charette ; déclarant celui-ci traître à la royauté, il fit prononcer contre lui une sentence de mort. Mais bientôt, se voyant abandonné, il est contraint de se soumettre, et le dernier des chefs vendéens signe la paix à Saint-Florent, où avait commencé l'insurrection.
Cependant, en 1796, l'insurrection se rallume ; Stofflet tente de la propager dans l'Anjou ; mais, trahi, livré par les siens, il est conduit à Angers et fusillé le 26 février. La révolte avait été promptement étouffée par le général Hoche.
En 1815, pendant les Cent-Jours, M. d'Autichamp chercha à soulever l'Anjou et à l'associer aux mouvements royalistes organisés dans l'Ouest. Mais le général Lamarque anéantit en un combat cette révolte. Cette triste échauffourée se termina le 21 juin ; trois jours auparavant, la défaite de Waterloo avait livré de nouveau la France à l'étranger.
Les départements et leur histoire - Lozère - 48 -
suite et fin
Alors le Gévaudan se divisait en pays haut et pays bas : le haut était presque tout entier dans les montagnes de la Margeride et d'Aubrac ; le bas faisait partie des hautes Cévennes, et occupait la montagne de la Lozère. Cette montagne forme une chaîne connue sous divers noms, et qui s'étend jusqu'aux frontières du Rouergue et du diocèse d'Alais ou basses Cévennes. C'est là qu'est Le Pont-de-Montvert et le Bougès, une des montagnes de la Lozère dont le plus haut sommet, couvert de bois de hêtres, en a pris le nom d'Altefage, mot corrompu du latin, et qui signifie un hêtre élevé. Ces lieux sauvages servaient d'asiles aux proscrits. Comme les chrétiens dans les catacombes, ils s'y réunissaient la nuit, lisant la Bible, chantant des psaumes et s'exhortant au courage et à la patience.
Or, il y avait au Pont-de-Montvert un prêtre d'une famille noble et guerrière : il s'appelait l'abbé du Chayla. C'était un homme naturellement impérieux, sombre et violent ; mais, à la suite de graves maladies, il se relâcha de ses austérités. « Il mena, dit son biographe, une vie moins dure. » Il allait à cheval, pratiquait un peu moins l'abstinence, le jeûne, et traitait bien ses hôtes. Il paraît qu'il aimait aussi le jeu. Il avait été missionnaire à Siam. De retour dans son pays natal, il avait été nommé inspecteur des missions des . Cévennes ; animé d'un zèle que plusieurs, ajoute son biographe, ont traité d'indiscret, il faisait une rude guerre aux protestants. Pour mieux réussir, il prit avec lui une mission volante, composée de plusieurs missionnaires, tant séculiers que réguliers, et se transportait partout où il y avait des hérétiques à combattre ; mais, loin de travailler pour le bien de la religion et de l'État, sa mission ne leur suscitaient que des ennemis.
Il avait fait de son château une prison, et ce que l'on racontait des tortures qu'il y faisait subir à ceux qu'il voulait convertir le rendait la terreur de la contrée. Un jour, à la tête d'une compagnie de soldats, il surprit une assemblée de protestants dans les montagnes. Plus de soixante personnes des deux sexes qui s'y étaient réunies pour prier furent enlevées ; l'abbé commença par en faire pendre quelques-unes et fit conduire les autres dans son château ; cependant plusieurs parvinrent à s'en échapper, convoquèrent leurs frères et leur firent le récit de ce qu'ils avaient souffert. Ils disaient que l'abbé faisait fendre des poutres avec des coins de fer et forçait ensuite ses prisonniers de mettre leurs doigts dans ces fentes dont il faisait retirer les coins.
C'est ce qu'on appelait les ceps de l'abbé du Chayla. A ce terrible récit, la colère et le désespoir se peignent sur tous les visages. Tous jurent de venger leurs frères persécutés. Ils s'arment et se rendent à l'entrée de la nuit au Pont-de-Montvert, devant le château : le silence y régnait, lés portes en étaient barricadées : l'abbé, qui avait eu vent de la conjuration, s'était mis en état de résister. Il avait avec lui quelques soldats et des domestiques résolus à vendre chèrement leur vie. Mais les assaillants enfoncent les portes, et mettent le feu au château. Déjà le toit est en flammes ; l'abbé essaye de se sauver à l'aide d'une échelle de corde par une fenêtre qui donnait sur le jardin mais, en glissant, il se laisse tomber et se casse une jambe.
Néanmoins il parvient à se traîner dans une haie vive qui servait de clôture au jardin ; il y est bientôt découvert. « Allons garrotter ce persécuteur des enfants de » Dieu, » s'écrièrent les assaillants ; et craignant pour sa vie, le malheureux abbé vient se jeter aux pieds de leur chef ; en vain celui-ci voulut-il le sauver ; plusieurs de sa troupe reprochèrent à l'abbé toutes ses violences, ajoutant qu'il était temps de les expier. « Hé ! mes amis, leur criait le pauvre abbé, si je me suis damné, en voulez-vous faire de même ? » A ces mots il fut frappé. « Voilà pour ce que tu as fait souffrir à mon père ! » lui dit l'un. « Voilà pour avoir fait condamner mon frère aux galères ! » ajouta un autre. On dit qu'il reçut cent cinquante-deux blessures. Il expirait au moment où l'on arrivait à son secours.
Telle est la version protestante de la mort de l'abbé du Chayla. Voici maintenant la relation catholique d'après son biographe, M. Rescossier, doyen du chapitre de Marvejols : sur le soir, il y eut une conférence avec les autres missionnaires, dans laquelle on parla des peines du purgatoire ; et sur la fin on agita cette question : si ceux qui souffraient le martyre étaient sujets à ces peines.
Rescossier raconte que, chacun s'étant retiré dans son logis pour se coucher, on le vint avertir qu'il y avait quelques étrangers qui commençaient à arriver dans le lieu. Il crut que c'était une fausse alarme, jusqu'à ce qu'il entendit un grand tumulte de gens qui avaient investi sa maison et qui tiraient des coups de fusil contre les fenêtres. Croyant qu'ils ne demandaient que l'élargissement de quelques prisonniers qu'on avait pris dans les assemblées des fanatiques, il donna ordre qu'on les fit sortir. Ces malheureux ne virent pas plus tôt la porte ouverte qu'ils se jetèrent en foule dans la maison ; ils enfoncèrent une porte d'une salle basse où on avait dressé un autel pour y dire la sainte messe, et, ayant fait un bûcher au milieu de cette chapelle, ils y mirent le feu pour faire périr M. l'abbé dans l'incendie de cette maison. Il essaya de se sauver par la fenêtre à l'aide de ses draps de lit ; mais ces liens n'étant pas assez longs, il tomba d'assez haut. Cette chute fracassa une partie de son corps ; il se 'raina dans des broussailles, où il resta jusqu'à ce qu'il fût découvert, à la faveur de la lumière que jetait l'incendie de sa maison.
On courut sur lui ; on le traîna par la rue de ce bourg (Le Pont-de-Montvert) qui va au pont. On lui fit toutes les insultes imaginables, le prenant par le nez, par les oreilles et par les cheveux, le jetant par terre avec la dernière violence, et le relevant en même temps, vomissant mille injures atroces contre ce saint prêtre, lui disant qu'il n'était pas aussi proche de la mort qu'il pensait, qu'il n'avait qu'à renier sa religion et à commencer de prêcher le calvinisme pour se garantir du péril. Cette proposition scandalisa notre saint abbé, qui demanda à faire sa dernière prière.
On lui permit ce qu'il demandait. Alors, se jetant à genoux au pied de la croix qui est sur le pont, et élevant les mains vers le ciel, il recommanda son âme à Dieu avec une ferveur extraordinaire. Ces impies, transportés de rage de le voir à genoux au pied de cette croix, ne purent plus se retenir. Celui qui les commandait donna le signal de tirer un coup de fusil dans le bas-ventre de notre saint abbé. Alors cette troupe se jetant sur. lui comme à l'envi, et chacun voulant avoir la satisfaction de lui donner le coup de la mort, ils criblèrent tout son corps de coups de poignard. Ceux qui ont fait la vérification de ses blessures ont rapporté qu'il en avait vingt-quatre de mortelles, et que les autres étaient dans un si grand nombre, qu'on ne pouvait les compter.
L'abbé du Chayla fut enseveli à Saint-Germain-de-Calberte, dans le tombeau qu'il y avait fait préparer de son vivant ; et son convoi fut suivi de toute la population catholique des paroisses voisines du Pont-de-Montvert. On se dira qu'il aurait mieux fait de se contenter de l'emploi de missionnaire sans y joindre celui d'inspecteur ; car par là il avait aigri tous les esprits en dénonçant leurs prédicants et ceux qui assistaient à leurs assemblées, ou en faisant renfermer leurs enfants dans des séminaires et dans des couvents pour y être instruits ; mais, dit encore .son biographe, peut-on nier qu'il ne soit permis à un prêtre de dénoncer ceux qui sont rebelles à l'État et à la religion ?
Tel fut le prélude de l'insurrection des camisards, l'un des événements les plus remarquables de l'histoire du XVIIe siècle. « Comparable dans son commencement à une étincelle qu'une goutte d'eau eût pu éteindre, elle s'alluma, dit un historien, au point de fixer toute l'attention de la cour, qui craignait avec raison que l'embrasement ne devînt général. » Alors, en effet, les montagnards cévenols se réunirent et s'armèrent pour la défense commune. Ils choisirent pour chefs les plus braves d'entre eux : Roland, Cavalier, Ravenel, et Catinat.
Roland s'établit dans les montagnes, et Cavalier dans la plaine. Pendant trois ans que dura cette guerre, l'on vit une poignée d'hommes mal armés, sans expérience, tenir tête à des troupes régulières, nombreuses et aguerries, commandées par des généraux habiles : Montrevel, qui se plaignait de voir sa réputation compromise avec « des gens de sac et de corde, » fut remplacé par Berwick et Villars.
Ces derniers, en ouvrant des routes à travers les Cévennes, abrégèrent la durée de cette guerre en facilitant aux troupes les abords de ces montagnes et en rendant impossibles les soulèvements des protestants. Ces routes furent en même temps un bienfait pour le pays et réparèrent un peu les souffrances que ses habitants avaient éprouvées pendant un demi-siècle ; souffrances dont le souvenir arrachait des larmes à l'évêque Fléchier, et qui n'auraient pas eu lieu si les prêtres des Cévennes avaient suivi ses sages conseils.
Quant à Jean Cavalier, le héros des camisards, après avoir traité de la paix avec le maréchal de Villars, en 1704, il passa en Angleterre, y prit du service et mourut gouverneur de Jersey.
Avant 1789, le Gévaudan avait ses états particuliers, qui chaque année s'assemblaient alternativement à Mende ou à Marvejols ; ils étaient présidés par l'évêque de Mende, qui s'y rendait assisté de son grand vicaire ; mois celui-ci n'y avait ni rang ni voix délibérative. Seulement, en l'absence de l'évêque, il présidait. Cinquante membres, y compris l'évêque président, composaient l'assemblée ; savoir : sept du clergé, vingt de la noblesse et vingt-deux du tiers état. Un chanoine, député du chapitre de Mende le dom d'Aubrac, le prieur de Sainte-Énimie, le prieur de Langogne, l'abbé de Chambons, le commandeur de Palhers et le commandeur de Gap-Francès y représentaient le clergé. Huit barons, qui entraient annuellement aux états du pays et par tour de huit en huit ans aux états généraux du Languedoc ; savoir : les barons de Toumels, du Roure, de Florac, de Bèges (auparavant de Mercoeur), de Saint-Alban (auparavant Conilhac), d'Apcher, de Peyre, de Thoras (auparavant Senarer) ; douze gentilshommes possesseurs de terres, ayant le titre de gentilhommeries ; savoir : Allenx, Montauroux, Dumont, Montrodat, Mirandal, Séverac, Barre, Gabriac, Portes, Servières, Arpajon et La Garde-Guérin, dont le possesseur prenait dans l'assemblée la qualité de consul noble de La Garde-Guerin ; tels étaient les représentants de la noblesse.
Ceux du tiers étaient : les trois consuls de Mende, soit que les états se tinssent à Mende ou à Marvejols. ; les trois consuls de Marvejols, quand les états se tenaient dans cette ville, et seulement le premier consul quand ils s'assemblaient à Mende ; un député de chacune des seize villes ou communautés. Quant aux barons et aux gentilshommes, ils pouvaient se faire représenter par des envoyés qui n'avaient pas à faire preuve de noblesse ; il suffisait qu'ils fussent d'un état honorable, tel que celui d'avocat ou de médecin. Chaque année, l'assemblée instituait ou confirmait le syndic et le greffier ; c'étaient les officiers du pays. A Marvejols, un bailli et des officiers royaux ; à Mende, un bailli et des officiers nommés par l'évêque administraient alternativement la justice du bailliage du Gévaudan. Ces deux baillis étaient alternativement commissaires ordinaires dans les assemblées du pays.
A la Révolution, le Gévaudan forma le département de la Lozère. C'était avant ce temps un pays stérile et pauvre : les habitants quittaient leurs montagnes pour aller cultiver la terre dans les provinces méridionales. Ils passaient en grandes bandes jusqu'en Espagne, dans le royaume d'Aragon.
On prétend qu'ils en rapportaient beaucoup d'argent ; mais, s'ils mettaient à contribution la paresse des Espagnols en travaillant pour eux, d'un autre côté, ils étaient peu estimés de ceux-ci, qui les regardaient comme des mercenaires et les appelaient gavachos, terme de mépris que par la suite ils ont étendu à tous les Français. Certains écrivains , grands amateurs d'étymologies, prétendent même que c'est de l'ancien nom des Gabales que les Espagnols ont formé le mot gavacho, dont ils se servent comme d'un sobriquet injurieux.
Plus tard, cependant, les montagnards des Cévennes trouvèrent dans l'industrie des ressources contre la pauvreté. Ils n'émigrèrent plus et s'occupèrent à tisser des cadis et des serges dont la renommée se répandit jusque dans les pays étrangers. « Il n'y a presque pas de paysan qui n'ait chez lui un métier sur lequel il travaille dans la saison où il ne cultive pas la terre, et surtout pendant l'hiver, qui est très long dans ces montagnes durant six mois entiers. Les enfants mêmes filent la laine dès l'âge de quatre ans. » Ainsi s'exprimait un voyageur en 1760.
Tel était encore au XIXe siècle ce pays. Vivant au milieu d'âpres montagnes, dans une contrée pauvre et aride, exposés aux atteintes d'un climat rigoureux, les cultivateurs de la Lozère, dit M. Dubois, ont nécessairement des moeurs agrestes, des habitudes rudes et grossières. Néanmoins, leur caractère est bon et simple. Ils sont naturellement doux et même affables envers les étrangers, paisiblement soumis aux autorités qu'ils respectent, remplis de vénération et de dévouement pour leurs parents qu'ils aiment.
Leur vie est alors laborieuse et pénible. La plupart ont à lutter contre la stérilité naturelle du pays qui les environne. Leur nourriture est simple et frugale : elle Se compose de laitage, de beurre, de fromage, de lard, de vache salée, de légumes secs, de pain de seigle. Ils y joignent des pommes de terre ou des châtaignes. Leur boisson habituelle est l'eau de source ; mais on les accuse d'aimer le vin et de se laisser aller à l'ivrognerie quand les foires ou d'autres occasions les conduisent dans les villages où se trouvent des cabarets. Leurs habitations, généralement basses et humides, sont incommodes et malsaines. Les trous à fumier qui les avoisinent répandent à l'entour des miasmes putrides.
Les cultivateurs sont fort attachés à leur religion et aiment les cérémonies religieuses : tous, catholiques et protestants, ont un égal respect pour les ministres de leur culte. Ils conservent aussi avec ténacité leurs vieilles habitudes, tiennent a leurs préjugés, à leur routine agricole, au costume grossier qu'ils portent depuis leur enfance. Ils sont peu empressés de changer, même quand leur intérêt doit profiter du changement. Leur lenteur, leur apathie et leur indifférence suffisent pour raire avorter tous les projets d'améliorations.
Les jeunes gens ont un grand attachement pour leur village : ils se soumettent avec répugnance à la loi qui les astreint au service militaire, et le département est un de ceux où l'on compte le plus de retardataires ; néanmoins, lorsqu'ils ont rejoint leur bataillon, ils se montrent soldats intrépides et disciplinés. Ils sont d'abord très propres aux fatigues de la guerre, étant d'une constitution forte et d'un robuste tempérament.
Au XIXe siècle, les habitants des villes ont plus d'aménité dans le caractère que les habitants des campagnes ; comme eux, ils sont économes et laborieux et cependant hospitaliers et charitables. Les habitants de la Lozère ont généralement de l'intelligence, de l'esprit naturel et un jugement sain. S'ils paraissent moins cultiver les lettres et les arts, du moins réussissent-ils mieux dans l'étude des sciences naturelles et mathématiques.
Les départements et leur histoire - Lozère - 48 -
Avant la conquête romaine, le pays qui forme aujourd'hui le département de la Lozère était habité par les Gabali ou Gabales, nom qui, en langue celtique, signifie montagnards ou habitants des hautes terres. César, Ptolémée, Strabon et Pline font mention de ce peuple, que les Arvernes confinaient au nord, les Vellaves et les Helviens à l'ouest ; au midi, les Volces, et à l'orient, les Ruthènes. Ils avaient pour cité Gabalum, aujourd'hui Javols.
Peuple libre comme les Arvernes (Arverni et Gabali liberi, suivant l'expression de Pline), ils furent les compagnons de Bellovèse et traversèrent les Alpes à la suite d'Asdrubal. Rome les eut toujours pour ennemis, jamais pour sujets ; et lorsque plus tard, ayant pris parti pour les Allobroges, ils furent vaincus, ils restèrent indépendants. A l'abri derrière leurs montagnes couvertes de neige, ils se gouvernaient par leurs propres lois et n'obéissaient qu'à des chefs élus par eux.
Il paraît que leur pays abondait en mines d'argent, déjà exploitées du temps des Romains. Pline vante les fromages de la montagne de Lozère (mons Lezurae). Ce pays est un de ceux qui ont conservé le plus de traces de l'ère celtique. A Javols, à L'Aumide, aux Fonds, à Grèzes, à Malavillette, au Montet, on voit encore des dolmens, des menhirs, des pierres druidiques, et l'on croit que la fontaine de la Canourgue est une fontaine gauloise. A Sainte-Hélène, sur la rive droite du Lot, le voyageur s'arrête devant un peulven qu'on appelle dans le pays lou Bertet de las fadas, le Fuseau des fées.
Après avoir laissé des garnisons à Narbonne et dans la Province, César franchit les Cévennes et campa dans le pays des Cabales avant de pénétrer dans l'Arvernie. C'est, dit-on, dans la plaine de Montbel, près de la forêt de Mercoire, que le général romain fit reposer ses légions. Surpris de cette brusque apparition, les Gabales se lèvent en armes, forcent les Helviens leurs voisins, qui s'étaient déclarés pour César, à rentrer dans leurs murs (intra oppida murosque) ; puis ils vont se joindre à l'armée nationale, rassemblée par Vercingétorix.
Après le désastre d'Alésia, ceux d'entre eux qui avaient survécu à la ruine de la patrie rentrèrent dans leurs montagnes ; mais là encore Rome victorieuse dut compter avec eux et respecter leurs libertés et leurs lois. Cependant Auguste les affranchit des liens qui les unissaient aux Arvernes, et les comprit dans l'Aquitaine. Alors Gabalum, colonie romaine, devint la résidence d'un préteur ou proconsul. Il y avait un temple, un palais, un cirque, dont on voit encore les vestiges ; un castrum s'élevait dans le Valdonnez, et la grande voie romaine, ouverte par Agrippa, qui conduisait de Lugdunum à la cité des Tectosages (Toulouse), avait, entre le Mas de la Tieule et le Bouchet, un embranchement sur Gabalum.
Peu à peu, la civilisation romaine tempéra la rudesse et l'âpreté de ce pays. Du temps de Strabon, les arts et les sciences y avaient pénétré, et les habitants commençaient à y parler la langue latine. Ils se livraient à l'agriculture, au commerce et à l'exploitation des mines ; mais leurs richesses firent leur malheur en excitant la cupidité et l'avarice des préteurs romains, et c'est pour se venger de leurs exactions qu'ils se révoltèrent sous Tibère.
Bientôt le christianisme vint achever l'oeuvre de la colonisation, et ce peuple libre et fier, dont Rome n'avait conquis que le territoire, courba la tête sous le joug de la croix. C'est, suivant quelques-uns, à saint Martial, selon d'autres, à saint Séverin, qu'il dut de connaître l'Evangile. Quoi qu'il en soit, la cité des Gabales avait, au IIIe siècle, son église et son siège épiscopal relevant de la métropole de Bourges, et la persécution y avait fait plus d'un martyr.
Quand les Vandales, au Ve siècle, parurent pour la seconde fois dans ce pays, saint Privat en était évêque. Après le sac de Gabalum par ces barbares, il se réfugia avec son troupeau dans la petite forteresse de Grèzes (Gredonense castellum), y soutint un siège contre l'ennemi et le força de se retirer.
Cependant, au VIe siècle, il y avait encore dans ce pays des restes de l'antique religion druidique. Tous les ans, le peuple se rendait auprès d'un étang du mont Helanus (le lac Saint-Andéol), dans lequel on jetait par manière de sacrifices, qui du linge et des vêtements, qui du fromage, du pain et de la cire. Alors, pour détourner les Cabales de ce culte grossier, le saint évêque Evanthius fit construire à peu de distance du mont Helanus une église, où il engagea te peuple à venir offrir au vrai Dieu ce qu'il destinait à l'étang. C'est ainsi que le christianisme faisait tourner à son avantage les pratiques les plus grossières du paganisme.
A la chute de l'empire romain, les Wisigoths s'emparèrent du pays des Cabales ; mais Clovis les en chassa. Alors, ainsi que nous l'apprend Grégoire de Tours, ce pays s'appelait Terminus Gabalitanus ou Regio Gabalitana. Plus tard, il forma le Pagus Gavaldanus, dont parlent les écrivains du Moyen Age ; d'où le nom moderne de Gévaudan. Sous les rois francs, le Gévaudan eut des comtes particuliers. Au temps de Sigebert, roi d'Austrasie, il était gouverné par un certain Pallade, originaire d'Auvergne. Homme violent et emporté, ce Pallade, au dire des vieux chroniqueurs, vexait et pillait le peuple. Accusé devant le roi par l'évêque Parthenus, il prévint son châtiment en se transperçant de son épée.
A la fin du VIe siècle, sous le règne de Childebert, un autre comte du nom d'Innocent gouverna ce pays en digne successeur de Pallade. Il persécuta entre autres saint Louvent (Lupentius), abbé du monastère de Saint-Privai de Gabalum (Gabalitanae urbs), et l'accusa, pour faire sa cour à la reine Brunehaut, d'avoir mal parlé de cette princesse et de la cour d'Austrasie. Cet abbé ayant été mandé à Metz, où se trouvait Brunehaut, se justifia et fut renvoyé absous ; mais il ne put échapper à la vengeance du comte, qui fut l'attendre à son retour, se saisit de sa personne et l'emmena à Pont-Yon en Champagne, où, après divers tourments qu'il lui fit souffrir, il lui permit de se retirer. Ce n'était qu'un piège, car à peine le pauvre moine libre et parti, te comte le poursuivit, et l'ayant surpris au passage de la rivière de l'Aisne, il l'égorgea et jeta son corps dans la rivière. Après son crime, le comte se présenta à la cour d'Austrasie. On a prétendu qu'il obtint pour récompense l'évêché de Rodez, mais ce fait n'est rien moins que prouvé.
Réuni à l'Aquitaine, ce pays en suivit le sort : il obéit successivement aux rois d'Aquitaine et aux comtes de Toulouse. Raymond de Saint-Gilles, l'un d'entre eux, l'aliéna, dit-on, en faveur des évêques de Mende. Cependant, au XIe siècle, un certain Gilbert, qui épousa Tiburge, comtesse de Provence, se qualifiait de comte de Gévaudan. Ce Gilbert laissa une fille qui, mariée à Raymond Bérenger, comte de Barcelone, lui apporta tous ses droits sur le Gévaudan ; mais l'évêque de Mende se disait aussi seigneur et comte du pays.
De là de longs démêlés avec les comtes de Barcelone, qui néanmoins continuèrent à jouir de la seigneurie directe du Gévaudan, où ils possédaient le château de Grèzes. Jacques, roi d'Aragon et comte de Barcelone, céda, en 1225, ce château et le Gévaudan à l'évêque et au chapitre de Mende ; « mais il y a lieu de croire, dit un historien, que cette cession ne regardait que le titre seigneurial, et que Jacques se réservait le domaine utile, puisque, par une transaction passée en 1255 avec saint Louis, le roi d'Aragon renonça alors non seulement à ses droits sur la terre de Grèzes, mais encore à tous ceux qu'il avait sur le Gévaudan. »
Dès lors, ce fut contre les rois de France que l'évêque de Mende eut à faire valoir ses prétentions ; mais la lutte était inégale. Après avoir conservé jusqu'en 1306 la souveraineté du pays, il dut, pour mieux s'assurer la possession du reste, en céder la moitié au roi Philippe le Bel, qui lui laissa le titre de comte de Gévaudan.
Au XIVe et au XVe siècle, ce pays fut ravagé par les Anglais, et par les guerres civiles et religieuses dans les deux siècles suivants. Alors, comme les vallées des Alpes, les Cévennes étaient peuplées d'Albigeois et de Vaudois dont les familles s'étaient réfugiées dans ces montagnes pendant la persécution ; mais là encore l'inquisition les avait poursuivis, et grand était le nombre des victimes qui avaient péri sur le bûcher ou sous le poignard dans ces terribles jours qui suivirent la Saint-Barhélemy.
Cependant les religionnaires prirent les armes. Après s'être rendus maîtres de Marvejols et de Quézac (1562), ils marchèrent sur Mende, qui leur ouvrit ses portes, et de là sur Chirac ; mais comme la place était sur le point de se rendre, le capitaine Treillans, qui commandait un corps catholique, arrive à son secours et force les assiégeants à se retirer. Poursuivant son succès, il reprend Mende, où deux autres chefs catholiques, d'Apcher et Saint-Remisi, viennent le rejoindre.
Bientôt les protestants se présentent de nouveau devant Chirac : la ville fut emportée et mise à feu et à sang. Il y périt plus de quatre-vingts catholiques ; on brûla l'église et la place fut démantelée. De là les religionnaires marchèrent sur Mende ; mais d'Apcher, qui s'y était renfermé avec plusieurs gentilshommes de l'arrière-ban, fit bonne contenance, et la capitale du Gévaudan resta au pouvoir des catholiques. Vint l'édit de Nantes (1598) ; mais la tranquillité dont jouirent les religionnaires des Cévennes ne fut pas de longue durée. Sans cesse menacés dans leurs privilèges, leur liberté et leur vie ; patients et fidèles, ils se reposaient sur la foi des traités et sur le souvenir des services qu'ils avaient rendus à la monarchie en refusant de prendre part à la révolte de Montmorency, et plus tard à celle de Condé.
Cependant la persécution était proche. Colbert, qui prévoyait qu'elle aurait pour résultat l'émigration d'une population essentiellement industrielle et l'exportation de grands capitaux, s'y opposa de tout son pouvoir. « Vous êtes roi, disait-il à Louis XIV, pour le bonheur du monde, et non pour juger les cultes. » Mais les conseils de Mme de Maintenon l'emportèrent, et l'édit de Nantes fut révoqué (1685).
Depuis longtemps, les protestants du Dauphiné et du Vivarais s'étaient insurgés contre la révocation de l'édit, que ceux des Cévennes, toujours soumis, n'avaient pas songé à remuer. « Néanmoins, dit Rabaut Saint-Étienne, on les ménageait alors parce que l'on appréhendait sans doute que les mauvais traitements que l'on faisait souffrir à leurs frères ne les jetassent dans le désespoir. On leur permit même de convoquer une assemblée générale des députés et des gentilshommes de leur province pour y passer un acte de fidélité au roi. » Cette assemblée eut lieu à Colognac, en septembre 1683. Cinquante pasteurs protestants, cinquante-quatre gentilshommes, trente-quatre avocats, médecins ou bourgeois notables, y protestèrent de leur attachement au roi, exhortant tous leurs coreligionnaires à la modération et à la patience.
Après la paix de Ryswick(1697), les protestants espérèrent encore ; mais, au lieu de leur être favorable, cette paix tourna contre eux, et les maux qu'ils avaient soufferts depuis la révocation et qui s'étaient un peu relâchés pendant la guerre se renouvelèrent avec plus de violence que jamais. Pressés d'abjurer, ils répondirent qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie au roi, mais que leur conscience étant à Dieu, ils ne pouvaient en disposer. Alors la terreur et la proscription régnèrent dans ce pays. D'abord on leur envoya des dragons pour les convertir. Ces missionnaires bottés, comme ils les appelaient, entraient dans les maisons l'épée à la main : « Tue ! tue ! criaient-ils, ou catholique ! » C'était leur mot d'ordre.
Ces moyens expéditifs ne suffisant pas, on en inventa d'autres : on pendait ces pauvres gens à leurs cheminées par les pieds pour les étouffer par la fumée ; d'autres étaient jetés dans des puits ; il y en eut auxquels on arracha les ongles ou qu'on larda de la tête aux pieds d'aiguilles et d'épingles. C'est ainsi qu'on leur extorquait parfois leurs signatures ; mais ces. conversions à la dragonne ne faisaient que des hypocrites.
Tel était, au commencement du XVIIIe siècle, le sort des protestants des Cévennes, et non seulement on les surchargea de gens de guerre, mais d'impôts. Les prêtres, abusant de leur influence, firent peser sur eux une capitation extraordinaire, et plus de vingt paroisses du Gévaudan se trouvèrent tout à coup ruinées par ces exactions. Au mois de juin 1702, de pauvres paysans qui n'avaient pu payer ayant été pendus, ceux des villages voisins se soulevèrent, surprirent pendant la nuit les receveurs du droit de capitation et les pendirent à des arbres leurs rôles au cou ; et comme ils s'étaient déguisés en mettant deux chemises, l'une par-dessus leurs vêtements et l'autre sur la tête, on les appela camisards, du mot camise (en patois du pays chemise).
Cependant les historiens varient sur l'origine de ce mot : les uns le font dériver du mot cami (chemin), les autres le font remonter au siège de La Rochelle, les protestants qui entreprirent de secourir cette place s'étant couverts chacun d'une chemise pour se faire reconnaître ; d'autres- enfin prétendent que, comme les camisards étaient vêtus la plupart à la manière des paysans des Cévennes qui portaient alors un justaucorps de toile, ressemblant de loin à une chemise, ils en ont tiré leur nom. Quoi qu'il en soit, il est certain que ce sobriquet fut particulier à ceux des Cévennes.
Cependant la persécution ne se lassait pas. Les prisons regorgeaient de protestants ; on confisquait leurs biens. Des pères de famille, des vieillards étaient condamnés aux galères ; d'autres périssaient dans les supplices : roués, brûlés ou pendus. Une pauvre fille fut exécutée au Pont-de-Montvert ; une autre fouettée par la main du bourreau. Chaque jour des proscriptions et des victimes. On arrachait les enfants des bras de leurs mères, et l'on jetait celles-ci dans des couvents pour être converties. « Bien plus, dit le savant Tollius, on soulevait les enfants contre leurs parents en les émancipant, en dépit de leur jeune âge. » Plus de temples que les couvents ; point d'autre sépulture que les grands chemins ; partout l'inquisition avec ses missionnaires expéditifs. Tels sont, en substance, les détails sur lesquels s'accordent les historiens protestants.
Les départements et leur histoire-Lot et Garonne-47-
Le département du Lot-et-Garonne correspond à peu près au territoire qu'occupait avant l'invasion romaine la peuplade celtique des Nitiobriges. Cette peuplade et celle des Bituriges Vivisques étaient les deux seules appartenant à la grande nation des Celtes, dont la domination s'étendit sur la rive gauche de la Garonne.
Ce territoire formait le Pagus Aginnensis, ainsi appelé de la capitale Agedinum. Loin de s'associer à cette énergique résistance nationale dont leurs voisins leur offrirent tant d'exemples, les Nitiobriges trahirent la cause commune en livrant le passage de la Garonne aux Romains, lorsque Crassus, lieutenant de César (56 ans avant J.-C.), attaqua l'Aquitaine. La petite peuplade des Sotiates opposa seule de la résistance dans la forteresse de Sos, dont le nom se retrouve aujourd'hui à l'extrémité sud-ouest du département. C'est là que le chef Adcantuan se défendit avec un courage héroïque ; il pratiquait des mines jusque sous les travaux des assiégeants ; il faisait des sorties terribles, accompagné de ses six cents Soldures, ces hommes qui se dévouaient à la vie à la mort à un chef de tribu.
Une capitulation honorable lui fut accordée. Les Nitiobriges avaient accepté le titre flétrissant d'alliés de la république romaine. Pourtant, lorsque Vercingétorix, assiégé dans Alésia, fit un dernier appel au patriotisme des Gaulois, ils revinrent à de meilleurs sentiments et fournirent cinq mille hommes sous le commandement de Teutomar, fils d'Ollovicon ; malheureusement, ce chef imprudent se laissa surprendre sous les murs de Gergovie, tandis qu'il faisait la méridienne dans sa tente, et vit son camp enlevé avant qu'il eût pu se reconnaître ; il n'eut que le temps de sauter demi nu sur son cheval et faillit tomber aux mains des ennemis.
L'époque celtique n'a pas laissé des traces bien nombreuses dans le département de Lot-et-Garonne ; pourtant, on trouve dans les environs d'Agen et de Tournon des dolmens et des peulvens assez bien conservés ; à La Plaigne, près de La Montjoie, arrondissement de Nérac, on voit des ruines d'un vaste édifice qu'on suppose avoir été un temple druidique ; enfin on a déterré aussi en plus d'un endroit des monnaies gauloises, des haches en silex, en porphyre, en bronze, débris de la demi civilisation qui précéda dans ces lieux la civilisation romaine.
Quand les Romains, maîtres de la Gaule, la divisèrent en dix-sept provinces, le Pagus Aginnensis, que nous appellerons désormais Agénois, fut compris dans la seconde Aquitaine, dont il forma l'angle méridional. L'Aquitaine était renommée pour la fertilité de son sol, même à cette époque de décadence où tant de parties de l'empire étaient devenues désertes, puisque Salvien l'appelle le « coeur des Gaules, les mamelles de la fécondité, l'image du paradis. »
Or, dans l'Aquitaine, l'Agénois se distinguait encore par la richesse de ses belles vallées de la Garonne, du Lot et de la Baïse, par la grâce et la fraîcheur des nombreux vallons qui entrecoupent ses plateaux élevés ; il n'est donc pas surprenant que les riches Romains se soient plu à l'habiter, à y construire de somptueuses villas dont les fouilles, particulièrement celles que l'on a faites à Nérac et à Sainte-Pompogne, nous ont révélé l'existence. Statues, figurines, vases antiques, amphores, médailles, monnaies impériales, admirables mosaïques ont été recueillies avec soin.
Les voies romaines sillonnaient le pays ; l'une d'elles subsiste encore aujourd'hui et conduit les voyageurs des rives de la Garonne vers la ville de Sos et l'Armagnac ; on l'appelle la Ténarèse (iter Caesaris). Quiconque allait à Bordeaux, venant du centre de l'empire, traversait l'Agénois. Agen possédait une école qui le disputait à celtes de Toulouse et d'Auch, sinon à celles de Bordeaux.
Le christianisme fut apporté dans l'Agénois, vers 250, par saint Vincent, qui fut martyrisé à Vellanum. Les légendes parlent également de saint Maurin, martyrisé au lieu même où s'éleva depuis l'abbaye de Saint-Maurin, sur les confins de l'Agénois et du Quercy.
L'Aquitaine ayant été cédée par Honorius aux Wisigoths, l'Agénois appartint à ces nouveaux maîtres jusqu'en 507, que les Francs de Clovis les chassèrent du bassin de la Garonne. Les rois francs se le disputèrent. Gontran l'enleva à Chilpéric et le perdit en 587. Dagobert le comprit dans le royaume qu'il constitua à son frère Caribert. En 732, les Sarrasins l'envahirent. Pépin s'en empara sur Waïfre. Charlemagne, à la fin du VIIIe siècle, l'érigea en comté en faveur d'Ermiladius, arrière-petit-fils du duc Eudes.
Ce comté devint héréditaire et passa sous le régime féodal après la chute des Carlovingiens, révolution qui s'accomplit partout au milieu des incursions dont les Normands criblaient notre pays. Pour ces pirates, les fleuves étaient des routes ouvertes. Ils remontèrent ainsi la Garonne jusqu'à Toulouse, en 863, semant l'incendie et la mort sur ces beaux rivages. Pépin, roi d'Aquitaine, les avait appelés pour se maintenir avec leur secours contre ses sujets révoltés.
Enfin ce fléau s'épuisa. L'Agénois avait passé pendant ce temps à Wulfrin, comte d'Angoulême et de Périgord. Garcias le Courbé, duc de Gascogne, le lui enleva en 886. En effet, depuis que les Gascons, au VIe siècle, descendant du versant des Pyrénées, s'étaient répandus vers le nord, la domination de leurs ducs atteignait la Garonne ; elle la dépassa dès lors, et, jusqu'en 1030, ils demeurèrent maîtres de l'Agénois ; ce comté fut alors donné en dot à la fille d'un des ducs gascons, laquelle le porta à la maison de Poitiers.
Au siècle suivant, Éléonore de Guyenne, à son tour, le porta successivement aux rois de France et aux rois d'Angleterre, qui le gardèrent peu de temps, Richard Coeur de Lion l'ayant donné en dot (1196) à sa soeur Jeanne lorsqu'elle épousa Raymond VI, comte de Toulouse. Ces comtes, déjà suzerains de l'Agénois depuis deux siècles, en devinrent alors seigneurs directs.
Avec la domination toulousaine, l'hérésie albigeoise se répandit dans l'Agénois. Au reste, ce pays était particulièrement préparé à la recevoir puisque, dès la fin du r siècle et le commencement du XIe, il s'y trouvait un grand nombre de manichéens condamnés par plusieurs conciles et qu'un auteur contemporain, Rodolphus Ardens, désignait sous le nom d'Agénois. Il souffrit considérablement de la fatale croisade qui coûta alors au midi de la France sa prospérité et sa brillante civilisation. « O terres d'Agen, de Béziers, de Carcassonne, s'écrie un troubadour, quelles je vous vis et quelles je vous vois ! »
Simon de Montfort y exerça le pouvoir en souverain et y établit un sénéchal. Moins heureux, son fils Amaury fut chassé et ne rentra qu'avec le secours de Louis VIII, auquel il céda ses droits peu de temps après. La mort de ce roi retarda la chute de l'Agénois sous la domination directe de la couronne de France ; il fut au nombre des pays que le traité de Meaux (1229) laissa à Raymond VII, et tomba des mains de ce dernier dans celles de son gendre Alphonse, frère de saint Louis, en 1245, et enfin de celles d'Alphonse à la couronne, en 1271.
Cependant les rois d'Angleterre protestaient et redemandaient l'Agénois comme un des pays que saint Louis s'était engagé à céder par son traité avec Henri III. Henri III lui-même avait élevé cette prétention à la mort de Raymond VII, et chargé Simon de Montfort, comte de Leicester et deuxième fils du chef de la croisade anti-albigeoise, de réclamer la restitution de cette province aux exécuteurs testamentaires du dernier comte.
Mais l'énergique opposition des habitants fit échouer cette réclamation. Des députés furent envoyés à la cour de France, et prêtèrent dans les mains de la reine mère leur serment de fidélité au comte Alphonse et à la comtesse Jeanne, « absents pour le service de Jésus-Christ, » c'est-à-dire à la croisade avec saint Louis. Henri III renonça à faire de nouvelles démarches ; mais Édouard Ier, son successeur, reprit l'affaire et la mena à meilleure fin.
En effet, par le traité d'Amiens (1279), il se fit restituer l'Agénois et il en donna la jouissance à sa mère Éléonore. Cette province ne demeura pas longtemps sans contestation au pouvoir des Anglais. Lorsqu'en 1292 une querelle de matelots brouilla Philippe le Bel et Édouard, le roi de France, hautain et ambitieux, signifia au roi d'Angleterre, alors dans l'Agénois, une citation appuyée par de nombreux griefs, relatifs en grande partie à cette province. Il l'accusait, par exemple, d'avoir pendu deux sergents d'armes à qui la garde de Castelculier, près d'Agen, était confiée ; d'avoir « arrêté et détenu en prison un grand nombre de personnes, notamment maître Raymond de Lacussan, avocat d'Agen, parce qu'ils disaient qu'il était licite d'appeler du sénéchal de Gascogne et de toute la terre d'Agénois au roi de France. »
Philippe le Bel envoya une armée qui s'empara du pays (1295) ; la guerre s'y fit avec des succès divers jusqu'en 1299. Elle recommença en 1324 à l'avantage des Français, puis en 1337, et cette fois le comte de Derby donna la supériorité aux armes anglaises ; Jean, duc de Normandie, fils du roi de France Philippe VI, échoua au siège d'Aiguillon (1345). Agen restait pourtant aux Français, et leurs 'plus habiles généraux, les comtes d'Armagnac, de Foix, de L'Isle-Jourdain, le roi de Navarre, le sire de Craon soutenaient dans l'Agénois une lutte opiniâtre contre les capitaines anglais.
Le traité de Brétigny rendit ces efforts inutiles en livrant à Édouard cette province parmi tant d'autres. Charles V reprit les armes si honteusement déposées sous le règne de son père l'Agénois fut reconquis et fortement occupé par le duc d'Anjou. Pourtant les hostilités y recommencèrent sous Charles VI et s'y prolongèrent avec des succès divers et de grandes complications pendant tout son règne et pendant la première partie du règne de son successeur. La reprise d'Agen (1439) fut enfin le signal de la retraite définitive des Anglais. Bientôt après se termina cette terrible guerre de Cent ans dont l'Agénois avait été presque continuellement, comme on peut le remarquer, un des principaux théâtres.
Momentanément aliéné par Louis XI en faveur de son frère le due de Berry, l'Agénois fut réuni à la couronne. Mais la partie sud-ouest du département de Lot-et-Garonne, celle où se trouvaient situées les deux villes alors importantes de Nérac et de Casteljaloux, appartenait à la maison d'Albret. Cette puissante maison accrut ses possessions déjà considérables par le mariage du comte Henri d'Albret avec Marguerite de Valois, soeur de François Ier, qui lui apporta en dot l'Armagnac.
La faveur que cette savante princesse accorda aux réformés propagea dans le pays la religion nouvelle et en fit comme une lice ouverte où se rencontrèrent, pendant les guerres de religion,. les plus fameux chefs des deux partis, entre autres le terrible Montluc. En 1572, l'Agénois, avec le Quercy, fut donné en apanage par Charles IX à sa soeur, la seconde Marguerite de Valois, qui épousait Henri de Navarre.
Celui-ci domina dès lors, en son nom et au nom de sa femme, dans toute l'étendue du pays qui forme le département ; mais il se fit des ennemis dans sa nouvelle province par ses scandales amoureux, et se vit bientôt obligé de la défendre contre les troupes royales, puis contre sa femme elle-même lorsqu'elle se fut tournée du côté de la Ligue. Avec Marguerite de Valois finit, en 1616, la liste des comtes apanagistes de l'Agénois. Toutefois, la soeur du cardinal de Richelieu, Mme de Combalet, acquit, en 1642, l'engagement du pays d'Agénois moyennant soixante mille francs, et les ducs d'Aiguillon, branche cadette de la maison de Richelieu, en ont joui jusqu'en 1789 ; les cinés de cette branche prenaient même le titre de comtes d'Agénois.
Quoique réuni définitivement à la couronne au commencement du XVIIe siècle, l'Agénois n'en fut pas moins un des pays qui ressentirent le plus vivement tous les troubles qui agitèrent les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. C'était un des derniers foyers de la Réforme. Dès 1614, Louis XIII fut obligé d'aller assiéger Tonneins. Sept ans après (1621), la défense des protestants dans l'Agénois ayant été confiée au marquis de La Force, Louis XIII s'y rendit de nouveau à la tête d'une armée : tout le pays se soumit, moins Clairac, qu'il fallut assiéger.
Mais, à la nouvelle de l'échec des troupes royales devant Montauban, la révolte éclata de nouveau et obligea le roi de revenir sur ses pas ; la supériorité de ses forces lui donna promptement la victoire, et cette fois, avant de se retirer, il fit démanteler la plupart des villes et châteaux de l'Agénois. Pendant les troubles de la Fronde, le prince de Condé s'efforça d'entraîner cette province dans le parti des rebelles. Mais la plupart des habitants se déclarèrent pour le duc d'Harcourt qui y commandait les troupes royales, et firent leur soumission au roi.
Depuis lors, plus rien de nouveau jusqu'en 1789. Nous ferons seulement observer que cette province non seulement n'est demeurée étrangère à aucun des grands épisodes de l'histoire de France, mais encore que, grâce sans doute à sa position à peu près centrale dans la Guyenne et la grande vallée de la Garonne, elle y a presque toujours joué un rôle considérable : croisade contre les Albigeois, guerre de Cent ans, guerres de religion, s'y sont en quelque sorte concentrées.
Les départements et leur histoire - Lot - 46 -
Le département du Lot et celui de Tarn-et-Garonne ont été formés de la province qui portait, avant 1789, le nom de Quercy. Ce nom, que l'on a voulu faire dériver des chênes (quercus) dont le pays était autrefois couvert, vient des Cadurci, le peuple gaulois qui occupait cette contrée avant l'invasion romaine.
Les Cadurci étaient de race celtique. Établis dans les bassins du Tarn, du Lot et de la Dordogne, presque au pied des montagnes d'Auvergne, dont les ramifications donnaient à leur pays cet aspect aride et escarpé qui rappelle l'Afrique au voyageur, ils étaient sur la zone même où se rencontraient les peuples celtiques et les peuples ibères. A leur droite et à leur gauche, les Petrocorii (Périgord) et les Rutheni (Rouergue) étaient Celtes comme eux ; plus au sud et plus à l'ouest, l'origine ibérienne des habitants se reconnaissait et se reconnaît encore à leurs caractères, physiologiques.
Si les monuments celtiques ne sont pas aussi nombreux dans ce département que dans certains autres, ils n'y manquent point cependant. On y trouve particulièrement des monuments funèbres, des tombelles, dont quelques-unes renferment plusieurs cercueils de pierre superposés, par exemple celle qu'on nomme Puy-les-Martres (Puy-des-Martyrs) ; des dolmens, qui sont également des monuments funèbres, comme l'attestent les squelettes mis à découvert par les fouilles, et dont le principal est celui qu'on appelle la Pierre Martine, près de Livernon : il a plus de 7 mètres de longueur et plus de 3 de largeur ; sa table supérieure oscille sur ses supports pendant une minute à la moindre pression de la main ; auprès des squelettes, on a trouvé des flèches et des haches en silex, des fragments de poterie, des ornements en os ou en pierre, des épées et des poignards en cuivre. Près de Prayssac, sur la montagne de Roquebert, on voit un cromlech assez considérable.
Les Cadurci formaient une cité qui dépendait de la grande confédération des Arvernes. Ils prirent part avec ce peuple puissant à l'énergique résistance qu'il opposa aux généraux de Rome. Ils combattirent avec Britich sur les bords du Rhône contre Fabius. Plus tard, dans la grande lutte contre César, ils fournirent leurs contingents au camp d'Alésia, où Vercingétorix avait convoqué la Gaule entière, et enfin leur pays eut l'honneur de servir de théâtre aux derniers efforts de l'indépendance gauloise.
On s'est demandé où était située la ville d'Uxellodunum. Cahors, Luzech, Puech d'Usselou, Capdenac se sont disputé ce nom. Le Puech-d'Usselou ou Puy-d'Issolu, selon d'Anville, est l'ancienne Uxellodunum. Des recherches et des fouilles pratiquées sous la direction du commandant Stoffel, plaidèrent en faveur de cette opinion, malgré les assertions de Champollion-Figeac et de la commission de topographie des Gaules, qui penchèrent, celle-ci pour Luzech, et celui-là pour Capdenac. Uxellodunum était une place fortement située sur un rocher à pic, au pied duquel serpentait une rivière. Le lieutenant de César, Caninius, qui venait de vaincre Dumnacus, s'avança à la poursuite de Drapès et de Lucterius jusqu'à la place dont nous parlons et où les fugitifs se jetèrent.
Lucterius était du pays ; c'était un Cadurque à qui ses richesses et son esprit ambitieux avaient donné dès longtemps une grande influence et qui venait de l'accroître encore par des services rendus à la cause de la Gaule tout entière. Arrêté devant cette place inexpugnable, Caninius eut le bonheur de s'emparer de Drapès et de mettre en fuite Lucterius, à la suite d'une sortie qu'ils venaient de faire pour aller chercher des vivres, dont la disette se faisait sentir dans la ville.
Avoir privé la ville de ses deux meilleurs défenseurs, ce n'était pourtant point l'avoir prise, et l'arrivée de César ne fut pas inutile à son lieutenant. Il commença par empêcher les habitants de venir puiser de l'eau à la rivière, et, comme ils étaient obligés pour cela de descendre le flanc escarpé de la montagne, il y réussit facilement en disposant en face des archers et des machines à projectiles. Privés de l'eau de la rivière, les assiégés recoururent à celle d'une fontaine qui coulait au pied de leurs murs. César voulut également les en écarter et fit construire près de ces murs une tour de bois à dix étages d'où les traits pleuvaient sur eux ; ils s'en débarrassèrent en faisant rouler contre elle des tonneaux de suif et de bitume enflammé.
César trouva alors un moyen fort efficace ; une tranchée creusée dans le roc détourna les eaux de la source qui tarit subitement à la vue des assiégés ; ce qui les jeta dans un tel désespoir qu'ils virent dans cet événement moins l'habileté humaine qu'un arrêt du ciel. Ils se rendirent. César leur laissa la vie et leur fit couper les mains, « afin de rendre plus visible à tous le châtiment des méchants, » comme dit singulièrement son compagnon de guerre et le continuateur de ses Commentaires, Hirtius.
Drapès se laissa mourir de faim. Lucterius fut livré par la trahison d'un Arverne nommé Epasnact, « grand ami du peuple romain, » et mourut par la main du bourreau. La Gaule, saisie de terreur, n'osait plus remuer ; elle tremblait au seul nom de César ; et les voisins des Cadurques, redoutant leur sort, chantaient entre eux à voix basse ce refrain demeuré traditionnel :
| Prends garde, fier Pétrocorien, Réfléchis avant de prendre les armes, Car, si tu es battu, César te fera couper les mains ! |
Le pays des Cadurques fut compris, sous Auguste, dans la Gaule Aquitaine, et, sous Honorius, dans la Première Aquitaine. Il reçut, comme toutes les provinces gauloises, en dédommagement de la liberté perdue, les bienfaits de la civilisation romaine, des routes, des aqueducs, des édifices, dont nous parlerons à propos de Cahors. On ne cite guère néanmoins que trois localités du département qui datent de l'époque romaine : Cahors ; Duravel (Diolidinum), et Mercuès (Mercurii Castrum).
Au Ve siècle, le Quercy eut sa part des malheurs de la Gaule et fut ravagé successivement par les Vandales, les Alains, les Suèves, enfin les Wisigoths qui s'y établirent, et en furent chassés par Clovis. Il suivit le sort de l'Aquitaine sous les rois francs de la première et de la deuxième race. Celle-ci, toute belliqueuse et résolue à dompter enfin le midi de la Gaule, toujours rebelle au nord, entreprit ces guerres terribles que signala la résistance des princes vascons Hunald et Waïfre. Associé par sa situation géographique à la lutte des Méridionaux, le Quercy fut un des principaux théâtres de cette guerre défensive que favorisaient ses montagnes et ses nombreux défilés. Après le triomphe des Carlovingiens, il forma, avec le Rouergue, l'un des neuf comtés établis par l'empereur d'Occident dans le royaume d'Aquitaine, échu à son fils.
Quoique éloigné de la mer, le Quercy n'en fut pas moins exposé, pendant les trois siècles qui suivirent la mort de Charlemagne, aux ravages des Normands. Avoir des fleuves et des rivières navigables, c'est une richesse pour un pays ; mais, à cette époque désastreuse, c'était une calamité. Les Normands remontèrent la Dordogne jusqu'à Souillac, le Lot et le Célé jusqu'à Figeac, répandant partout la désolation.
Le régime féodal rendit au pays la sécurité. On regarde comme le premier comte héréditaire du Quercy un certain Rodolphe, qui vivait en l'an 900. Mais sa postérité ne posséda ce comté que pendant soixante ans. Robert, arrière-petit-fils de Rodolphe, ayant fait la guerre à Pons, comte de Toulouse, en fut complètement dépouillé. Depuis cette époque, le Quercy fut possédé, conjointement avec le Rouergue, par une branche de la maison des comtes de Toulouse que l'on croit avoir été la branche aînée.
Enfin, en 1065, Berthe, comtesse de Quercy et de Rouergue, étant morte sans postérité, ces deux pays furent réunis au domaine des comtes de Toulouse et suivirent les destinées de la maison de Saint-Gilles. Le divorce d'Éléonore et de Louis VII, suivi du mariage de cette princesse avec le roi d'Angleterre, Henri II, livra la Guyenne aux Anglais et leur donna des prétentions sur le comté de Toulouse. Henri II entreprit aussitôt la guerre contre Raymond V et marcha sur Toulouse ; n'ayant pu s'en emparer, il prit du moins Cahors (1159) ; mais la paix qui se fit bientôt après lui enleva sa conquête.
En 1188, la guerre recommença. Raymond V, offensé par l'un des fils du roi d'Angleterre, le fameux Richard Coeur de Lion, fit arrêter deux chevaliers anglais qui revenaient d'un pèlerinage à Saint-Jacques en Galice. Outré de colère, Richard se jeta sur le Quercy, y prit dix-sept châteaux et demeura en possession de cette province jusqu'en 1196. Devenu alors roi d'Angleterre, il fit la paix avec Raymond VI, qui avait succédé à Raymond V, et, renonçant à ses prétentions sur le comté de Toulouse, lui rendit le Quercy.
La guerre des Albigeois répandit la désolation dans tout le Midi. Le Quercy fut envahi par Simon de Montfort et la possession lui en fut confirmée par le légat du pape. Un peu plus tard, Raymond VI ayant recouvré ses États, les transmit à son fils Raymond VII ; mais celui-ci trouva un adversaire plus redoutable encore dans le roi de France. Le comté de Toulouse et ses dépendances furent presque entièrement annexés au domaine de la couronne. Le Quercy appartenait en effet au roi de France sous le règne de saint Louis ; mais il fut au nombre des provinces que ce monarque abandonna à l'Angleterre par le traité de 1259, sous condition d'hommage lige. Plus tard, conquis par Du Guesclin sous Charles V, puis repris par les Anglais, il resta en leur pouvoir jusqu'à l'époque où ils furent chassés de France, c'est-à-dire jusqu'en 1453.
Louis XI incorpora le Quercy à la Guyenne, qu'il donna à son frère Charles de Berry. A la mort de ce dernier (1472), la province fut pour toujours réunie au domaine royal. Avant cette réunion, le Quercy avait ses états provinciaux. Ces états votaient les subsides que le pays accordait au comte ; ils continuèrent d'exister et de voter les subsides pour le roi. Ils se composaient des trois ordres. Le tiers se formait des députés de 24 communes, villes et bourgs, dont les principales étaient Cahors, Montauban, Figeac et Moissac. Ils se réunissaient dans une de ces quatre villes. L'évêque de Cahors en avait la présidence. En 1552, Henri II institua à Cahors un présidial.
Les guerres de religion mirent en évidence un contraste, une rivalité même qui a toujours existé entre le haut et le bas Quercy. Le haut Quercy, où se trouvait Cahors, resta fidèle au catholicisme ; le bas Quercy, plus méridional, se déclara pour les calvinistes qui y trouvèrent une de leurs plus fortes places, Montauban. Malgré cette hostilité si marquée, l'unité administrative du Quercy subsista jusqu'à la fin de la monarchie, si ce n'est qu'une faible partie de la province, celle qui était située au nord de la Dordogne, relevait du parlement de Bordeaux, tandis que tout le reste relevait de celui de Toulouse.
L'organisation nouvelle de 1779, qui réunit, sous le nom d'administration de la haute Guyenne, le Quercy et le Rouergue, n'amena point encore de séparation, et il en fut de même en 1790, de l'organisation départementale, qui enveloppa tout le Quercy dans l'unique circonscription du département du Lot. Sans doute les circonstances étaient trop graves et les préoccupations trop considérables pour que les législateurs de la France eussent le temps de songer aux petites jalousies de Montauban contre Cahors ; mais, en 1808, comme Napoléon Ier revenait de Rayonne où il avait disposé de la couronne d'Espagne, les Montalbanais profitèrent de son passage pour lui exposer les griefs de leur vanité et solliciter le rang de chef-lieu de département. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et un sénatus-consulte, en détachant le bas Quercy pour en former le département de Tarn-et-Garonne, resserra celui du Lot dans les limites du haut Quercy.
Les départements et leur histoire - Loiret - 45 -
Plusieurs peuples gaulois ont primitivement habité le territoire qui forme le département du Loiret ; les Carnutes occupèrent la partie septentrionale, et les Senones s'étendaient vers l'est, dans le pays appelé depuis Gâtinais. Ces deux confédérations ne se montrèrent pas hostiles à César dans les premières années de la guerre qu'il fit en Gaule.
Mais, en l'année 52, lorsque toutes les populations se furent soulevées à la voix de Vercingétorix, un Senonais et un Carnute s'efforcèrent d'arracher leurs compatriotes à la servitude romaine. Le premier, Accon, échoua dans sa tentative et fut mis à mort ; le second, Cotuatus, fut plus heureux. César s'était emparé de la ville principale de la contrée, Genabum (Orléans), et y avait réuni une partie de son armée et de ses munitions ; Cotuatus surprit cette place, fit périr le commandant romain Fusius et tous les Italiens qu'il avait autour de lui.
A cette nouvelle, César accourt, amenant avec lui les légions qu'il tenait en réserve à Agendicum (Sens), soumet les Senones révoltés et surprend Orléans. Les habitants jettent un pont sur la Loire et s'efforcent de fuir ; César tait mettre le feu à leur ville, et presque tous périssent dans les flammes en expiation du meurtre des Romains. Le conquérant s'empara ensuite de la capitale des Bituriges, Avaricum, puis d'Alise ; le héros de l'Arvernie fit sa soumission, et la Gaule fut domptée. Les Carnutes se résignèrent désormais à la domination romaine. Sous les empereurs, la capitale du pays, restaurée par Aurélien, prit de son bienfaiteur le nom d'Aurelianum,, et Dioclétien rangea la partie du territoire des Carnutes et des Senones qui nous occupe dans la 4sup>e Lyonnaise (292). Ce fut à peu près à cette époque que le christianisme fut apporté dans la contrée par saint Albin et qu'Orléans eut son premier évêque.
A l'époque des invasions, la position centrale des Carnutes et des Senones les exposait aux ravages de ces troupes immenses qui traversaient la Gaule du nord au sud. Orléans vit d'abord les Vandales, les Alains, puis les Huns et leur terrible chef Attila. Cette dernière invasion était plus désastreuse que toutes les précédentes ; l'évêque de la ville, saint Aignan, se rendit sous la tente du barbare pour le fléchir ; Attila imposa de si dures conditions, que les habitants et le prélat lui-même préférèrent t courir les risques d'un siège plutôt que de se soumettre.
Leur ville, pressée de tous les côtés par des hordes innombrables, allait être emportée ; ses habitants s'abandonnaient à un affreux désespoir ; le pieux évêque était à l'autel environné des prêtres, n'espérant plus que dans la miséricorde céleste, quand du haut des murailles on signala les premiers cavaliers de l'armée romaine que le patrice Aétius amenait contre les barbares ; les Huns abandonnèrent leur proie ; poussés par ce nouvel ennemi, ils remontèrent vers le nord. On sait le résultat de la rencontre qui eut lieu à Châlons-sur-Marne (451). Orléans était sauvé, mais tout le pays et les villes moins fortes avaient été si horriblement saccagés, que plusieurs d'entre elles ne se relevèrent pas de ce désastre.
Ceux des barbares qui s'établirent les premiers d'une manière définitive dans ce pays furent les Francs ; la victoire de Soissons livra à Clovis la Gaule jusqu'aux bords de la Seine (486). Son alliance avec la nièce du roi Gondebaud, Clotilde, étendit sa domination jusqu'à la Loire. Les évêques de toute la Gaule centrale accueillirent avec empressement un roi qui, bien que païen encore, favorisait le catholicisme. Orléans fut l'une des premières villes qui reconnurent son autorité, et le chef franc en fit sa principale place d'armes, lorsqu'il porta ses armes au midi de la Loire contre les Wisigoths.
A la mort de Clovis, un de ses quatre fils entra en possession de cette importante cité et prit le titre de roi d'Orléans (511). Ce jeune prince, Clodomir, périt en 524 dans une guerre contre les Bourguignons ; il laissait trois jeunes enfants : deux furent égorgés par leurs oncles Childebert et Clotaire ; le troisième, Clodoald, n'échappa à un sort pareil qu'en faisant couper sa longue chevelure, insigne de la dignité royale chez les Francs, et en se consacrant à Dieu ; il fonda auprès de Paris un monastère qui a été l'origine du village de Saint-Cloud.
Les États de Clodomir furent partagés entre Childebert et Clotaire. Cc dernier en fut seul possesseur et hérita de toute la monarchie franque à la mort de son frère, en 558. Trois années plus tard (561), Clotaire mourut ; il n'y eut plus de roi d'Orléans ; cette ville échut à Gontran, roi de Bourgogne, dans le partage que les quatre fils de Clotaire firent à leur tour des États de leur père. Cette période est pour toute la Gaule une époque d'anarchie.
Les pays des Carnutes et des Senones eurent leur part des calamités générales ; Orléans et son territoire furent plus d'une fois dévastés dans les guerres que se firent les rois francs, et dans la lutte de Frédegonde et de Brunehaut ; cette cité vit aussi quelques bandes de l'armée arabe d'Abd-el-Rhaman ; mais la victoire de Charles Martel, à Poitiers (732), lui épargna de nouveaux désastres. Vingt ans après cette victoire qui sauvait la Gaule, la famille d'Héristal recueillait les fruits des services qu'elle avait rendus aux Francs, en remplaçant sur le trône la dynastie des Mérovingiens.
A cette époque, les ducs d'Aquitaine s'efforcèrent de conquérir leur indépendance au midi de la Loire ; les soumettre fut en partie l'oeuvre du règne de Pépin ; Orléans et son territoire virent plus d'une fois les opiniâtres ennemis du roi franc. Hunald et Waïfer reportèrent au nord de la Loire les ravages que le fils de Charles-Martel n'épargnait pas au midi. Le règne glorieux de Charlemagne fut une trêve entre deux époques calamiteuses ; grâce à une administration bienfaisante et à une répression sévère des excès et des actes injustes, Orléans et les pays qui l'environnent jouirent d'un bien-être inaccoutumé.
A cette époque existaient déjà les noms de Sologne et de Gâtinais, qui, sans jamais indiquer des divisions administratives et provinciales, se sont perpétués jusqu'à nous. Quand les Francs eurent envahi la Gaule, les anciennes divisions établies par les Romains s'effacèrent et furent remplacées par des divisions nouvelles tout à fait arbitraires, qui prirent, selon leur étendue, le nom de pagi majores ou pagi minores. Les pagi majores reproduisaient à peu près les cités -dans toute leur étendue ; les pagi minores en étaient des subdivisions ; quant aux noms particuliers de ces pagi, ils eurent tous une origine diverse et souvent obscure.
Dans le territoire qui aujourd'hui forme le Loiret, se trouva le vaste pagus d'Orléans, et en partie les pagi minores de Magdunum (Meung) ; de Sigalonia (Sologne) , peut-être ainsi nommé de secale ou segale, seigle, ou de siligo, sorte de froment qu'on recueille aussi dans les terres de Sologne, peut-être encore de Sabulonia, nom qui devrait son origine à la nature du sol ; de Belsia (Beauce) ; de Gastum (Gâtinais), dont nous pouvons avancer une étymologie dans le mot gastini, venant de vastare, abatis d'arbres, mais qui, peut-être bien, a tout simplement son origine dans le mot vastum, à cause de son étendue.
Charlemagne régularisa ces divisions qui s'étaient établies d'elles-mêmes ; dans la plupart des pagi, il plaça des comtes pour les administrer ; ces bénéficiaires, tous amovibles et viagers, parvinrent à se rendre héréditaires sous les faibles successeurs de l'empereur carlovingien, quand ils ne furent plus surveillés par les legati et par les missi dominici, officiers impériaux qui rattachaient au centre les extrémités de l'empire et donnaient l'unité à la vaste administration de leur roi.
En 861, Charles le Chauve accorda à Robert le Fort, tige des rois capétiens, le gouvernement du duché de France ; le comté d'Orléans et tout le Gâtinais étaient compris dans cette vaste donation ; ce fut un bienfait pour ces provinces ; elles avaient été ravagées à plusieurs reprises par les bandes de pirates normands qui, remontant les grands fleuves sur leurs bateaux, prenaient les villes riveraines et mettaient tout à feu et à sang sur leur passage.
Orléans avait été pris et dévasté en 856 ; Robert et ses successeurs surent faire en partie respecter par ces pirates la province qu'ils gouvernaient. Sous ces puissants seigneurs, les principales villes eurent leurs comtes particuliers ; la capitale du Gâtinais ; Château-Landon, avait été donnée par Louis II, le Bègue, à son sénéchal Ingelger, avec la main de l'héritière du comté, Adèle, fille de Geoffroy Ier. Les sires de Beaugency, Courtenay, Gien, Pithiviers, Sully furent autour d'Orléans les membres principaux de la hiérarchie féodale. Les évêques d'Orléans étaient à la même époque devenus grands vassaux ; ils possédaient en fiefs les terres de leurs églises, à charge seulement de service militaire.
Lorsque Hugues Capet remplaça sur le trône les Carlovingiens, ses vastes possessions se trouvèrent, par le fait de son usurpation, réunies à la couronne, et ce fut dans la tour d'Orléans que le nouveau roi fit enfermer son compétiteur, l'héritier légitime, Charles de Lorraine, qui avait essayé de faire valoir son droit par les armes. Quelques-uns des vassaux secondaires s'étaient affranchis autour d'Orléans de la suprématie des ducs de France ; il en avait été ainsi des comtes du Gâtinais ; Philippe Ier, quatrième capétien, recouvra ce comté en 1062.
Philippe mourut en 1108 et fut inhumé dans le monastère de Saint-Benoit-sur-Loire, qu'il avait particulièrement aimé et comblé de largesses de son vivant. Louis VI, son successeur, se fit sacrer à Orléans par l'archevêque de Sens ; la vie de ce roi se passa, on le sait, à lutter dans un cercle restreint autour de ses domaines , contre des seigneurs féodaux ; le seigneur de la terre de Meung, vassal de l'évêque d'Orléans, s'empara du petit château de Meung, dont l'évêque s'était réservé la souveraineté immédiate ; Louis, invoqué par l'évêque, marcha contre le comte rebelle, fut vainqueur et le fit périr.
Ce fut ensuite contre le seigneur du Puiset, en Beauce, qui tyrannisait toute la contrée entre Chartres et Orléans, que l'actif roi de France tourna ses armes. Hugues du Puiset fut battu et perdit sa ville. Mais un fait qui se passa dans cette guerre donne une idée de la turbulence des vassaux : le sire de Beaugency avait. accompagné le roi Louis le Gros ; un engagement eut lieu près du château du Puiset ; le comte abandonna tout à coup l'armée royale et se joignit à ses ennemis ; Louis, vainqueur de Hugues, tira vengeance du sire de Beaugency et le força à payer une forte amende. A l'autre extrémité du département du Loiret, vers l'est, les sires de Courtenay, seigneurs de Montargis, exigeaient un droit de péage de Sens à Orléans et n'en pillaient pas moins les marchands, quand même ils avaient acquitté ce droit.
Le mouvement religieux qui entraîna vers l'Orient un grand nombre de seigneurs délivra la royauté de beaucoup de ses ennemis ; dans les pays qui nous occupent, plusieurs barons se joignirent à Godefroy de Bouillon et prirent part à la première croisade, et presque tous accompagnèrent le roi Louis VII à la seconde, qui eut lieu en 1147. C'est dans cette expédition que quatre des seigneurs de l'Orléanais furent, à ce que raconte une légende, délivrés du plus grand péril par un miracle.
Les sires de Sully, d'Yèvre-le-Châtel, d'Achères et de Rougemont, emportés par leur courage, avaient été entourés par un corps d'armée turque, faits prisonniers, et, le lendemain, au lever du soleil, ils devaient être pendus aux longues gargouilles ou gouttières du château où leurs vainqueurs les avaient enfermés. Dans un si grand péril, ils ne s'abandonnèrent pas au désespoir ; l'un d'entre eux avait déjà eu occasion de recourir à la toute-puissante intervention de Notre-Dame-de-Sainte-Croix ; il engagea ses compagnons à lui adresser comme lui leurs prières, et les quatre chevaliers firent voeu de se consacrer à leur bienfaitrice si elle les délivrait des gouttières du château. Ils s'endormirent ensuite pleins de confiance ; à leur réveil, ils étaient transportés dans l'église d'Orléans. Ce fut l'origine d'une redevance en cire appelée gouttières, qui fut longtemps payée à l'église par les successeurs des quatre barons.
La même époque qui vit les croisades fut aussi témoin de l'affranchissement des communes. L'Orléanais participa peu, dans le principe, aux avantages accordés à un grand nombre de villes situées hors du domaine royal. Les rois intervenaient volontiers chez leurs vassaux, accordaient des chartes aux bourgeois et évitaient soigneusement de faire aucune concession dans leurs propres domaines.
En 1137, les bourgeois d'Orléans voulurent s'ériger en commune malgré les officiers du roi ; il s'ensuivit une répression terrible, et la commune fut supprimée par Louis VII, le Jeune, qui se contenta d'abolir la servitude dans la ville et dans la banlieue la dernière année de son règne (1180). Lorris reçut à cette époque une charte, faveur qui fut sollicitée par beaucoup d'autres villes.
Philippe-Auguste acquit au domaine royal les terres de Montargis (1184) et de Gien (1200) ; ce fut à cette époque que tous les pays de l'Orléanais et de la Champagne furent livrés aux déprédations des pastoureaux, qui parcouraient en grandes troupes les campagnes, y prêchant des doctrines d'égalité entre les pauvres et les riches et de destruction des puissants. Ces bandes dévastatrices furent dispersées. Les dernières années de Philippe-Auguste n'eurent de remarquable en Orléanais que la querelle de ce roi contre l'évêque Manassès, au sujet du service féodal dû par les prélats comme vassaux. Manassès obtint de ne pas conduire en personne ses milices à la guerre.
Sous le règne de saint Louis, la contrée jouit d'un calme qui ne fut troublé que par des mouvements isolés. En 1236, une émeute sanglante éclata entre les bourgeois d'Orléans et le clergé ; plusieurs jeunes nobles qui suivaient les cours de l'Université périrent dans un combat qui eut lieu sur la grande place. A la nouvelle de la mort de leurs proches, les seigneurs entrèrent dans la ville, tuèrent un grand nombre de bourgeois et mirent le feu à leurs maisons ; ces désordres ne cessèrent que par l'intervention du roi.
Pendant la croisade que fit saint Louis en 1248, les pastoureaux se montrèrent de nouveau dans l'Orléanais ; ils avaient pris la croix et annonçaient l'intention d'aller en Égypte au secours du roi prisonnier des musulmans. La régente Blanche, mère de saint Louis, les toléra d'abord dans cet espoir ; mais, au lieu de tenir leur promesse, ils se mirent à ravager tous les pays par lesquels ils passaient ; Orléans fut pillé et un grand nombre de prêtres y périrent égorgés.
Les successeurs de saint Louis continuèrent à agrandir le domaine royal. Philippe le Bel acheta, en 1292, le comté de Beaugency. Les Capétiens avaient plusieurs résidences dans le département du Loiret ; ils affectionnèrent particulièrement les séjours de Gien, Montargis, Châteauneuf-sur-Loire, et la vaste forêt d'Orléans retentit souvent du bruit des fanfares des chasses royales. Philippe-Auguste avait établi à Orléans un bailli, officier chargé de l'administration de la justice, dont la juridiction s'étendait sur Beaugency ; Montargis, Gien et le Gâtinais appartenaient au bailliage de Sens.
Philippe IV de Valois érigea, en 1345, l'Orléanais en duché en faveur de son second fils Philippe, auquel Humbert, dauphin de Viennois, avait cédé le Dauphiné. Le roi de France, pour rattacher plus directement à la couronne cette province éloignée, fit porter le titre de dauphin à son fils aîné Jean. Au duché d'Orléans, qui de la sorte était accordé à Philippe en échange du Dauphiné, il joignit les châtellenies de Beaugency, de Châteauneuf, d'Yèvrele-Châtel, de Vitry, de Neuville-aux-Loges, d'Hyenville, de Château-Renard, de Lorris et de Bois-Commun ; toutes ces seigneuries furent momentanément distraites du domaine royal.
La guerre de Cent ans ramena dans l'Orléanais des désastres que depuis longtemps cette province ne connaissait plus. Plusieurs de ses comtes périrent ou furent pris dans les batailles de Crécy (1346) et de Poitiers (1356). Après cette dernière défaite, des bandes d'aventuriers anglais et navarrais se répandirent autour d'Orléans et mirent toute la contrée à feu et à sang. Les villes de Châteauneuf et Châtillon-sur-Loire tombèrent en leur pouvoir et furent détruites.
Après le traité de Brétigny (1360), ce fut le tour des grandes compagnies de désoler le pays ; la paix leur avait enlevé leurs moyens d'existence ; elles exercèrent autant de ravages qu'en pleine guerre. A la reprise des hostilités (1367), le prince de Galles ravagea le Gâtinais, et, trois ans plus tard, Robert Knolles dévasta l'Orléanais. Beaugency fut emporté d'assaut par une troupe de Gascons. Le prudent Charles V eut soin d'éviter tout engagement sérieux contre les Anglais et se garda bien de compromettre le sort de la France dans une grande bataille comme à Crécy et à Poitiers ; il reprit une à une les villes dont les ennemis s'étaient emparés, mais il abandonna le plat pays, et le territoire dont nous nous occupons fut horriblement dévasté.
Au commencement du règne de Charles VI, l'Orléanais fut réuni à la couronne par la mort de Philippe, duc d'Orléans, qui ne laissait pas d'héritiers. Malgré les sollicitations des bourgeois des vil-les qui demandaient à ne plus être séparés de la France royale, Charles VI donna l'Orléanais en apanage à son frère Louis. Avec ce prince commence une nouvelle période de désastres, la lutte des Armagnacs et des Bourguignons. La démence de Charles VI livre le gouvernement à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et oncle du roi, et à Louis, duc d'Orléans, son frère ; après la mort de Philippe, Jean sans Peur, son fils, hérita de son influence dans la direction des affaires.
Le duc d'Orléans ne cessa d'être en opposition avec les deux ducs de Bourgogne ; deux partis se formèrent dans l'État autour d'eux, mais la lutte ne devint directe qu'après que Jean, sur le soupçon d'une intrigue entre sa femme et le duc d'Orléans, eut fait assassiner celui-ci à Paris, rue Vieille-du-Temple (1407). Cet événement fut le signal des hostilités. Valentine de Milan, épouse de Louis d'Orléans, vint à Paris demander justice du meurtrier ; mais le peuple de Paris s'était prononcé pour Jean sans Peur ; le comte Bernard d'Armagnac, beau-père du jeune Charles d'Orléans, accourut du Midi au secours des jeunes princes d'Orléans ; il eut à Gien une entrevue avec eux pour aviser au moyen de détruire l'influence des Bourguignons (1410), et cinq années se passèrent en combats et en guerres intestines.
L'invasion de la France par les Anglais, qui furent victorieux à Azincourt (1415), n'établit qu'une trêve momentanée entre les partis. Le duc d'Orléans ayant été fait prisonnier dans cette journée désastreuse, le dauphin se chargea de sa querelle. Nous avons raconté ailleurs (Seine-et-Marne, Montereau) l'assassinat du pont de Montereau, qui fut la représaille de celui de la rue Vieille-du-Temple (1419). Les Bourguignons se jetèrent dans le parti des Anglais, y entraînèrent avec eux l'infortuné Charles VI, lui firent déshériter son fils Charles VII au profit du roi d'Angleterre, Henri V (traité de Troyes, 1420), et s'emparèrent si bien de toute la France que deux ans après, à la mort de Charles VI et de Henri V, le dauphin ne put être sacré à Reims, et que, dépouillé de la plupart des villes de son royaume, il était appelé en dérision le roi de Bourges.
La monarchie était à deux doigts de sa ruine quand une jeune fille sauva la France. En 1423, Charles VII avait perdu la bataille de Gravant ; en 1428, Jargeau, Pithiviers, Courtenay lui furent enlevés, et cette même année le siège fut mis devant Orléans. Une chanson populaire, dont on accompagnait le son des cloches sonnant au loin dans les campagnes, ne disait-elle pas :
| A notre Dauphin si gentil, Hélas ! que lui reste-t-il ? Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendosme, Vendosme ! |
Orléans était donc le dernier boulevard de Fraude ; Jeanne D'Arc le délivra. Après avoir sauvé la capitale, Jeanne reprit une à une les villes de l'Orléanais, Jargeau, Beaugency, remporta une victoire complète à Patay et mena sacrer Charles VII à Reims. Après la mort de l'héroïque jeune fille, les Anglais s'emparèrent de nouveau de Montargis ; mais, en 1438 , cette place rentra sous la domination française. L'année suivante eurent lieu, à Orléans, les fameux états généraux où la création d'une armée permanente et l'établissement d'une taille pour son entretien furent décidés. En 1440, Orléans fournit au duc Charles 9 000 écus d'or pour l'aider à payer sa rançon au roi d'Angleterre.
Le successeur de Charles VII, Louis XI, affectionna l'Orléanais ; il se fit admettre chanoine de Saint-Aignan, offrit de riches présents à la cathédrale d'Orléans et reconstruisit l'église de Notre-Dame de Cléry. Mais cette église ayant été en partie détruite par les flammes en 1472, il la fit de nouveau réédifier telle qu'elle existe aujourd'hui. Pendant la régence d'Anne de Beaujeu, le duc d'Orléans, qui plus tard fut Louis XII, se souleva (Guerre folle). Il passa quelques années à Orléans, qu'il fit agrandir de près de moitié ; ce fut de cette ville qu'il partit pour se mettre à la tête de l'armée de Bretagne qui fut dispersée à Saint-Aubin-du-Cormier. Son avènement au trône (1498) réunit pour la seconde fois l'Orléanais à la couronne.
Les rois Louis XII, François Ier et Henri II régularisèrent l'administration de la justice dans notre département. La coutume du bailliage d'Orléans, dressée en 1227, en même temps que celle de Paris, fut publiée en 1510 ; celle de Montargis date de 1531 ; en 1558, Henri II créa une généralité à Orléans, qui auparavant dépendait de la généralité de Bourges. Sous Charles IX, elle fut divisée en douze élections, au nombre desquelles se trouvaient Orléans, Beaugency, Pithiviers, Montargis et Gien. Dans la dernière année du règne de Henri II, un siège présidial fut établi à Orléans, avec ressort sur Montargis, Gien, Beaugency, etc.
Cette même époque vit les guerres de la Réforme ensanglanter les bords de la Loire ; Calvin avait étudié à l'université d'Orléans, alors célèbre. Ses doctrines pénétrèrent dans l'Orléanais vers 1540. Gien les accueillit en 1542, et un des prêtres de cette petite ville fut brûlé à Auxerre en 1545. Les habitants de Châtillon-sur-Loire se distinguèrent parmi les plus fervents calvinistes. A Montargis, la duchesse d'Este se fit la protectrice des réformés.
En 1560, Orléans comptait autant de protestants que de catholiques ; les premiers troubles éclatèrent dans cette ville et à Gien en 1561. Le prince de Condé s'empare d'Orléans après le massacre de Vassy qui fit éclater la guerre civile : Beaugency est pris et pillé en 1502 ; les tombeaux de l'abbaye de Cléry, où avait été enseveli Louis XI, sont profanés ; l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire est saccagée, celle de Fontaine-Jean est incendiée. Le capitaine Noisy, qui commandait ,dans la ville calviniste de Gien, s'empara de Saint-Brisson ; mais le prince de Condé ayant été battu et pris à Dreux, le duc de Guise s'avança dans l'Orléanais, prit Jargeau et vint assiéger Orléans ; il fut assassiné sous les murs de cette ville par Poltrot de Méré.
Orléans ouvrit ses portes à Charles IX après la pacification d'Amboise (1563) ; la faveur que ce roi accorda aux catholiques souleva de nouveau les protestants en 1567. Le capitaine calviniste La Noue s'empara d'Orléans par surprise, Condé prit Beaugency ; en 1569, le duc de Deux-Ponts amena une armée à l'amiral de Coligny jusqu'à Gien. Les succès des protestants ne furent arrêtés que par le terrible massacre de la Saint-Barthélemy ; pendant deux journées entières, les protestants furent égorgés dans tous les quartiers de la ville, et l'on dit qu'il périt plus de 700 personnes. Jargeau et Beaugency furent également le théâtre de scènes sanglantes.
La supériorité des catholiques fut de la sorte établie à Orléans, et cette ville entra dans le parti de la Ligue. Une rencontre eut lieu auprès de Montargis, à Vimory, entre une troupe de reîtres au service du roi de Navarre et les soldats du duc de Guise, qui furent vainqueurs. Dans ces circonstances, le roi de France, Henri III, menacé d'un côté par les Guises qui ne prétendaient à rien moins qu'à le remplacer sur le trône, et de l'autre par les protestants, fit la paix avec ces derniers, s'unit à Henri de Navarre et s'empara d'une partie de l'Orléanais ; Jargeau, Gien, Pithiviers tombèrent en son pouvoir. Il fut assassiné à Saint-Cloud (1589) ; Orléans continua à tenir pour la Ligue et à résister à Henri IV jusqu'à ce que Paris lui eût ouvert ses portes.
La soumission de la capitale (1591) entraîna celle de toutes les villes environnantes. Un fils de Henri IV, Gaston, reçut en apanage l'Orléanais. Louis XIV donna à son frère le duché au même titre, et ce dernier a été la tige de la maison d'Orléans qui arriva au trône en 1830.
Le frère de Louis XIII se mêla à toutes les intrigues et à tous les soulèvements de la noblesse contre le cardinal de Richelieu, puis, sous Mazarin, prit avec sa fille, MIie de Montpensier, la fameuse Mademoiselle, une part active aux troubles de la Fronde. Son duché, l'Orléanais, fut le centre de la plupart des agitations politiques qu'il suscita ; en 1643, Orléans voulut rester neutre entre la Fronde et Mazarin ; mais Mademoiselle pénétra dans la ville et la détermina à prendre le parti des frondeurs. Turenne s'avança à cette nouvelle sur Gien ; mais Condé, à la tête de 12 000 Allemands que lui avait amenés le duc de Nemours, prit l'offensive, s'empara de Montargis et battit à Bléneau une partie de l'armée royale.
Les guerres de religion, de la Ligue, puis de la Fronde avaient tellement appauvri le pays, que les habitants se trouvèrent dans l'impossibilité de payer aucune sorte d'impôt ; en 1655, ceux qui résidaient dans les paroisses de Sully-sur-Loire et de Saint-Benoît se coalisèrent contre les percepteurs des tailles et ne purent être réduits que par un corps de troupes réglées.
En 1789, l'Orléanais adopta avec enthousiasme les principes de la Révolution ; le chef-lieu du Loiret eut cependant sous la Convention à subir la sanglante oppression de ses proconsuls ; Collot d'Herbois et Laplanche s'y signalèrent par leurs fureurs. Pendant les années suivantes, jusqu'en 1800, des bandes de brigands, connues sous le nom de Chauffeurs, ravagèrent les deux départements du Loiret et d'Eure-et-Loir.
Ces désordres cessèrent sous le Consulat ; mais en 1815 et plus tard en 1870, l'Orléanais eut à souffrir de l'invasion étrangère. A la suite du combat d'Artenay, le général Von der Tann , à la tête de 50 000 Bavarois, s'empara, le 11 octobre 1870, d'Orléans, d'où l'armée de la Loire, sous les ordres du général d'Aurelle de Paladines, le délogea, le 10 novembre, par la victoire mémorable de Coulmiers ; mais le 5 décembre, après trois jours de combats, elle dut se retirer devant les forces supérieures de l'ennemi, qui prit de nouveau possession d'Orléans.
Cependant, les 7, 8 et 10 décembre, les 15°, 18° et 20° corps, placés sous les ordres du général Chanzy, soutinrent vaillamment, sur les bords de la Loire, l'attaque des Prussiens ; mais composés pour la plupart de mobiles, c'est-à-dire de soldats improvisés, pleins de bravoure, mais inexpérimentés et mal armés, ils ne pouvaient opposer une longue résistance aux troupes aguerries du prince Frédéric-Charles, et Chanzy dut battre en retraite sur Vendôme, et de là sur Le Mans. Les pertes éprouvées par le département du Loiret, pendant la guerre de 1870-1871, se sont élevées à la somme de 37 886 906 fr. 66.
Les départements et leur histoire - Loire atlantique-44-
Le département de la Loire-Atlantique était occupé dès la plus haute antiquité par un peuple appelé-les Namnètes. Comme il y a eu des historiens qui ont fait descendre les Francs d'un Troyen appelé Francus, on en trouve aussi qui ont fait descendre les Namnètes d'un fils de Noé, appelé Namnès, personnage fort peu historique, comme on s'en doute bien, et qui aurait fondé Nantes.
D'autres, avec aussi peu de certitude, marquent l'année 1620 avant Jésus-Christ pour la date de l'origine de cette ville. Ce sont des fables. Tout ce qu'on peut dire de certain sur ces époques reculées, c'est que le célèbre navigateur marseillais Pythéas, qui vivait vers 280 avant Jésus-Christ, cite Corbilo, un des ports des Namnètes, comme une ville comparable à Marseille ou à Narbonne, d'où l'on peut induire que ce pays prospérait déjà depuis longtemps.
Que les Nantais n'aillent pas chercher plus loin ; ce sont là déjà d'assez beaux titres. La capitale des Namnètes était Contigwic, qui s'élevait au confluent de l'Erdre et de la Loire, à la place qu'occupe aujourd'hui Nantes ; les Romains donnèrent à ce nom une tournure latine, Condivicnum. Les Namnètes formaient une république, comme les autres parties de l'Armorique. Ils furent les alliés des Vénètes (Vannes) dans le combat naval livré à César.
Soumis aux Romains, et compris d'abord dans la Gaule chevelue, puis dans la Ire, enfin dans la IIIe Lyonnaise, ils virent Nantes devenir un des chefs-lieux les plus importants de l'administration romaine. Vers 275, saint Clair vint prêcher l'Évangile dans cette contrée et en fut le premier évêque. Deux jeunes patriciens, Donatien et Rogatien, qui se convertirent des premiers, subirent le martyre (290) à Nantes, où ils sont appelés les enfants nantais.
A la chute de l'empire, Clovis conquit ce pays. Le système de partage qui divisa ses États entre ses fils ayant atteint aussi la Bretagne, elle fut divisée en quatre comtés, dont l'un était celui de Nantes, tributaire des rois francs. Depuis lors, l'histoire du comté de Nantes présente la lutte continuelle des comtes de cette cité et des ducs de Bretagne, ceux-ci s'efforçant de ramener le comté dans leur dépendance, ceux-là de l'en affranchir ; les ducs de Bretagne finirent par l'emporter et résidèrent à Nantes ; mais ce ne fut pas pour une bien longue durée, car les rois de France survinrent avec une puissance irrésistible et englobèrent le tout dans le royaume de France. Le comté de Nantes faisait partie de la haute Bretagne, ainsi que la sirerie de Clisson, la baronnie de Retz, etc.