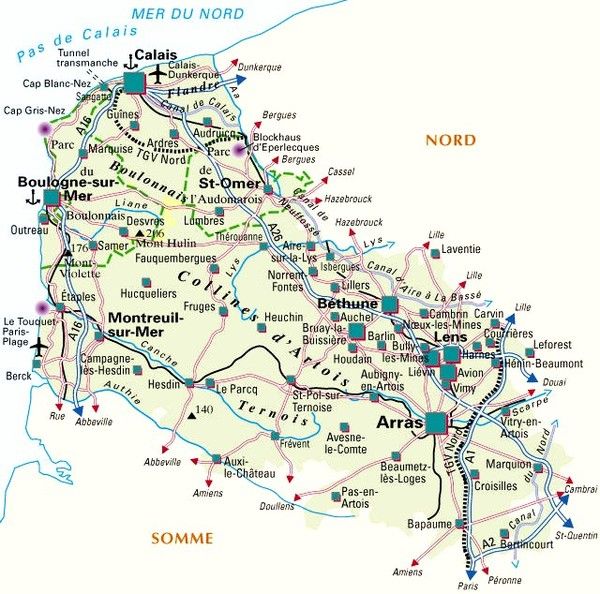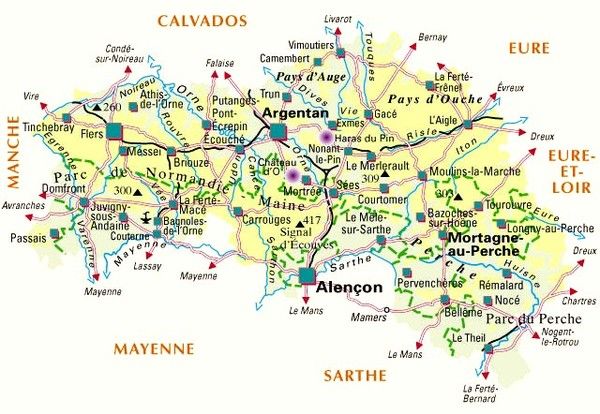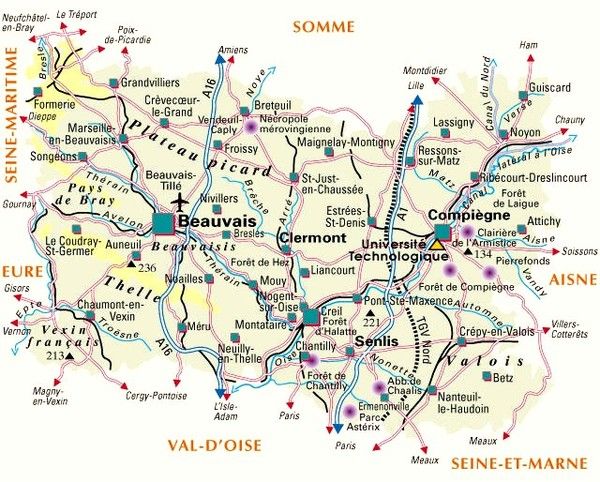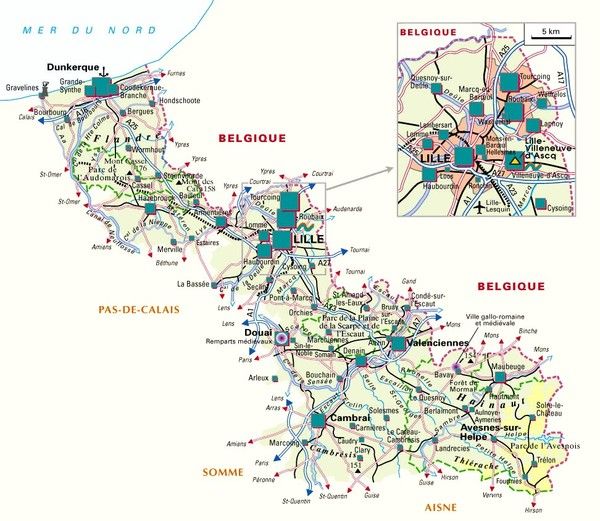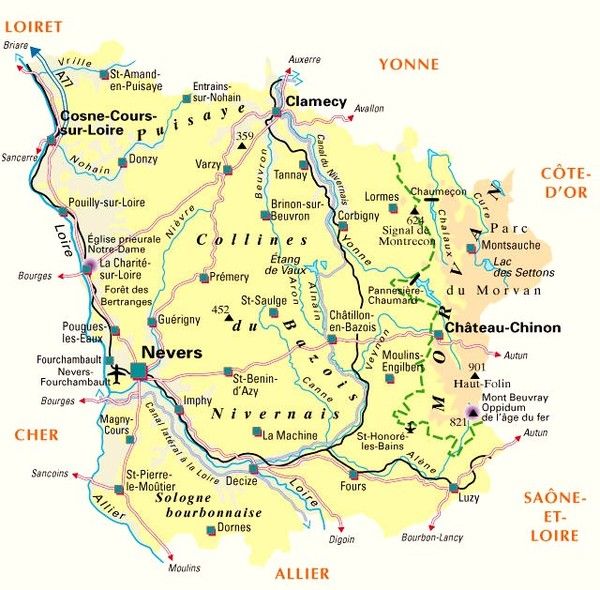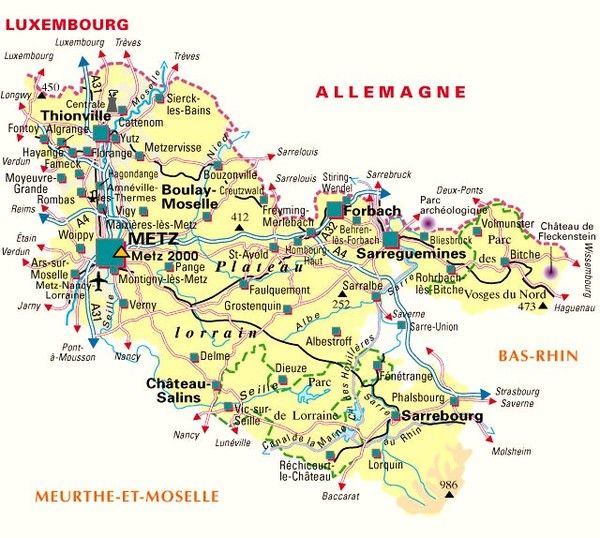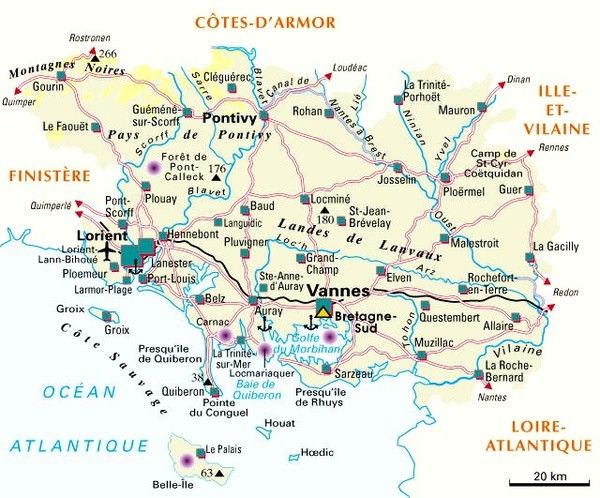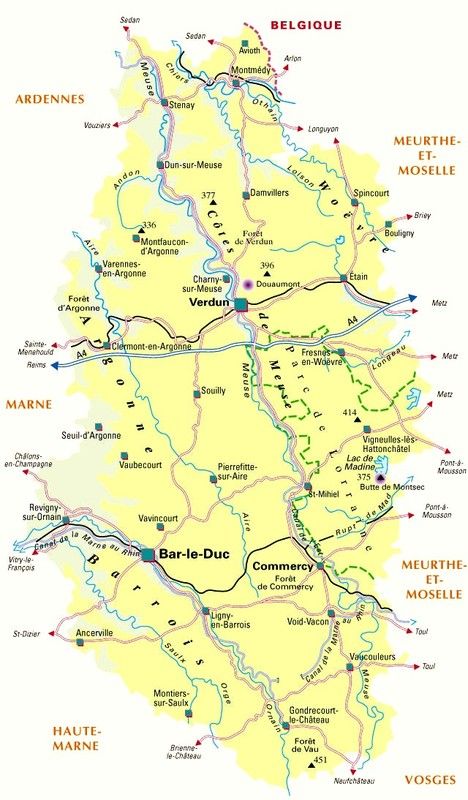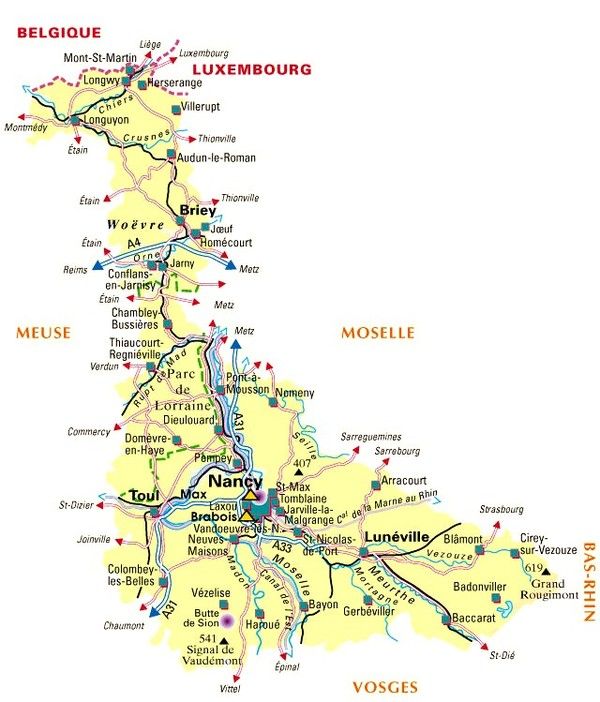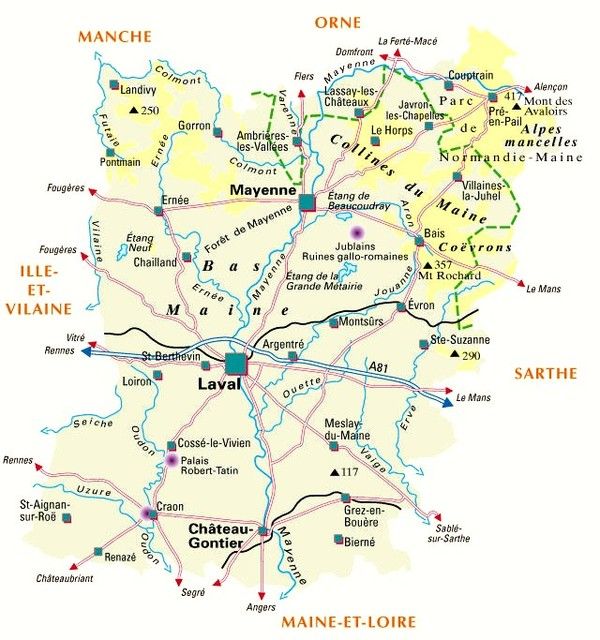Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Les départements-(histoire)-
Les départements et leur histoire -pas de Calais- 62
L'histoire de ce département est toute dans son nom : Pas-de-Calais, passage de Calais ; c'est de là qu'on passe le plus aisément du continent dans cette grande île voisine qui s'allonge, jalouse et fière, en face de nos côtes. Pas de Calais, c'est le nom de ce canal étroit au delà duquel on aperçoit, de notre territoire, le rivage de l'Angleterre. Partout ailleurs, nos côtes se retirent devant elle, excepté pourtant la presqu'île du Cotentin (département de la Manche), qui la menace de Cherbourg. Mais Cherbourg est moins hardie ; elle s'arrête à 25 lieues ; Calais se pose audacieusement jusqu'à 8 lieues de la grande puissance rivale, audace tantôt glorieuse pour notre pays et tantôt fatale.
Ce rivage a porté au-devant de la Grande-Bretagne tous ceux qui ont voulu l'aller chercher chez elle, depuis le conquérant des Gaules, qui, deux fois, descendit chez les Bretons d'autrefois, jusqu'à cet autre conquérant qui avait juré la ruine d'Albion, et qui, moins heureux que César, ne put donner à ses soldats la conquête qu'il leur avait montrée du doigt. Ce même rivage, en des jours de plus triste mémoire, a servi de premier marchepied à ces mêmes ennemis que jamais nous n'avons pu troubler dans le repos de leurs foyers. Trop rapproché d'eux alors, il leur offrait une prise facile, et, pour peu qu'ils étendissent le bras, ils saisissaient Calais, Boulogne et se trouvaient maîtres des poternes de la France.
La première fois qu'une armée franchit le détroit, ce fut sous Jules César. Il venait de rejeter au delà du Rhin les Germains qui menaçaient de lui disputer la Gaule ; il voulut de même refouler dans la Bretagne les secours et les inspirations que les peuples gaulois recevaient de ce foyer de la religion druidique. Il s'embarqua dans le pays des Morins. Les Morins, les Atrebates (d'où Arras), tels étaient les peuples qui occupaient notre département et qui venaient de reconnaître, non sans une glorieuse résistance, l'empire des aigles romaines.
Parti de chez eux, César reparut bientôt, vainqueur des Bretons et pourtant forcé de revenir sur ses pas ; mais déjà, par les soins de Labiénus, une flotte mieux équipée se préparait à Itius portus, qu'on croit être aujourd'hui Wissant, et César, avec ces ressources nouvelles, fut cette fois plus heureux. A Itius portus fut établie une des grandes stations navales de l'empire romain.
Mais les siècles s'écoulent ; Alains, Suèves, Vandales, Burgondes, franchissant le Rhin inférieur, inondent, ravagent les Belgiques et ce pays même des Morins, attribué par Honorius à la Belgique IIe. Ce torrent passe et va, bruyant et dévastateur, se perdre au loin dans les sables de l'Afrique ; cependant notre province respire à peine, que déjà les Francs y pénètrent et en font une de leurs premières conquêtes.
Les Mérovingiens y règnent pendant tout le cours de leur existence ; comprise dans toutes les vicissitudes des partages, elle appartient au royaume de Soissons, quand les fils de Clovis, en 511, font quatre morceaux de la Gaule ; plus tard, quand la division, moins arbitraire et plus réelle, en Neustrie et en Austrasie prévaut dans l'empire des Francs, elle se trouve rattachée à la Neustrie, c'est-à-dire au pays qui deviendra français, et que le cours de l'Escaut sépare de l'Austrasie, destinée à être longtemps germanique.
Alors que la dynastie carlovingienne en décadence voyait les bénéficiers retenir insolemment et transmettre à leurs héritiers des terres que les rois et les empereurs ne leur avaient point données à ces conditions, le pays des Atrebates fut un des derniers à partager le sort des autres parties de la Gaule et à sortir des mains du souverain pour passer dans celles d'un bénéficier ; ce n'est qu'en 863 que Charles le Chauve l'aliéna en autorisant sa fille Judith à le porter en dot au comte de Flandre, qui en fut souverain pendant plusieurs siècles.
Un mariage l'avait donc détaché de la couronne ; un mariage l'y ramena. Les mariages jouaient un grand rôle dans le monde féodal. Ils rassemblaient tour à tour et séparaient les provinces, les fiefs. C'étaient bien plutôt les terres qui s'épousaient que les seigneurs et les nobles dames. Philippe-Auguste épousa (1180) la nièce du comté de Flandre, Isabelle, qui avait en dot le pays d'Artois (Atrebatensis terra). Ce pays n'était pas encore un comté. Il ne reçut ce titre qu'en 1238, et déjà il était séparé de nouveau de la couronne ; il est vrai que c'était à d'autres conditions qu'auparavant : saint Louis venait de le donner en apanage à son frère cadet, Robert, de sorte que l'Artois fut une des premières provinces qui servirent à former cette chose toute nouvelle et pleine de si graves conséquences, les apanages, par lesquels la maison royale trouvait moyen d'établir partout ses propres membres et de former une féodalité nouvelle 'toute dévouée.
Grâce à son titre de frère de saint Louis, le premier comte d'Artois faillit devenir empereur d'Allemagne. Le pape lui offrait cette couronne, qu'il voulait arracher à Frédéric II. Mais les états du royaume de France répondirent « qu'il suffisoit a M. le comte Robert d'être frère du roi de France, qui était le plus grand prince de la terre, » et refusèrent cette offre. Ce n'est pas sur le trône impérial, mais bien tristement, loin de sa patrie, que devait mourir le malheureux Robert. Il accompagna saint Louis dans la septième croisade.
Il était un des plus vaillants et des plus téméraires parmi toute cette chevalerie brillante qui fit connaître sa bravoure aux musulmans des bords du Nil. Depuis un mois, l'armée chrétienne se consumait en vains efforts pour franchir le canal d'Aschmoun, au delà duquel se riaient d'eux les musulmans, lorsqu'on trouva un gué. Robert d'Artois le passa le premier avec trois cents chevaliers seulement, malgré la défense du roi son frère. « Je vous jure sur les saints Évangiles, avait répondu le jeune imprudent, de ne rien entreprendre qu'après votre passage. » Promesse vite oubliée !. A peine vit-il les Sarrasins fuir devant lui que, transporté d'ardeur, il s'attacha à leurs pas et les poursuivit jusque dans Mansourah. Mais une fois dans cette ville, il fut cerné, écrasé sous les poutres et les pierres et succomba (1250).
Aussi brillant, aussi téméraire, aussi malheureux fut Robert II d'Artois. Armé chevalier par saint Louis, il accompagna le pieux roi, son oncle, dans cette funeste croisade de Tunis, où il recueillit son dernier soupir. On le vit ensuite, sous Philippe III et Philippe IV, aller soutenir vaillamment en Navarre, dans les Deux-Siciles, en Flandre, l'influence française, alors portée partout par des princes de la famille royale. Quand Boniface VIII excommunia Philippe le Bel, il osa, lui, déchirer la bulle pontificale, si menaçante pour l'indépendance de la France.
C'est lui encore qui commandait l'armée française dans cette funeste bataille de Coudray, si fatale à la noblesse de notre pays, et qui fut cause de ce grand désastre. Ce fut une seconde édition de la Mansourah. Le sage connétable de Nesle, qui voulait le retenir, se vit accuser de trahison : « Je ne suis pas un traître, répondit froidement le prudent capitaine ; suivez-moi seulement ; je vous mènerai si avant que nous n'en reviendrons ni l'un ni l'autre. » Cette triste prédiction s'accomplit : Robert succomba, percé de trente coups de pique (1302).
Avant cette catastrophe, en récompense des services de Robert, Philippe le Bel, par lettres royaux du mois de septembre 1297, avait érigé en pairie le comté d'Artois. Ce titre de pairie semblait assurer mieux que jamais la succession masculine dans ce comté, quand même il n'eût pas été généralement admis dans le droit féodal de l'époque que les femmes ne succédaient pas.
Pourtant cette grave question fut résolue alors différemment. Robert II avait laissé une fille, Mahaut, et un neveu Robert. Mahaut succéda ; Robert réclama. Il fut débouté de sa demande, en 1309, par un jugement des pairs, et Mahaut non seulement demeura comtesse, mais même siégea dès lors, et plusieurs fois, dans le parlement, comme pairesse (chose toute nouvelle).
Robert ne put se résigner. Il renouvela ses protestations sous les fils de Philippe le Bel, et plus vivement encore sous Philippe de Valois. Il avait eu le tort de fabriquer de fausses lettres par lesquelles Robert II aurait fait cession de son comté à son père Philippe. Le parlement découvrit la fraude, et, à la suite d'un procès scandaleux, une certaine Jeanne Divion, complice du coupable, fut brûlée en 1331.
Pour lui, il refusa de comparaître. Déjà faussaire, il se fit encore sorcier et envoûta le roi, c'est-à-dire qu'il fabriqua une petite image de cire représentant le roi et la perça au coeur avec une aiguille ; un homme envoûté, selon les superstitions du Moyen Age, était un homme perdu. Pourtant Philippe de Valois continua de se porter fort bien, et Robert, craignant les longs bras du parlement, jugea prudent de s'en aller ailleurs. II passa donc d'abord en Flandre, puis en Angleterre et mit le comble à ses crimes en appelant dans son pays le roi d'Angleterre, Édouard III. Ainsi cette famille d'Artois mérite le reproche d'avoir contribué à allumer ce triste incendie de la guerre de Cent ans qui devait dévorer la France.
En 1382, le comté d'Artois fut réuni à celui de Flandre, sous le fameux Louis de Male, et deux ans après, en mourant, il le laissa à Marguerite, sa fille, qui avait épousé le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Quand elle mourut à son tour (1405), elle le transmit à Jean, son fils, qui avait hérité de Philippe le duché de Bourgogne, et depuis lors le comté et le duché demeurèrent réunis jusqu'à la mort de Charles le Téméraire.
A ce moment (1477), où la grande puissance des ducs de Bourgogne se trouva démembrée, l'Artois fut porté, avec la Flandre et la Franche-Comté, dans la maison d'Autriche, par le mariage de Marie de Bourgogne avec l'archiduc Maximilien, mais à la charge de l'hommage envers la France. Bien plus, par le désastreux traité de Cambrai (1529), résultat de la bataille de Pavie, François Ier fut obligé de renoncer à toute suzeraineté sur l'Artois, comme sur la Flandre, et ce ne fut que cent vingt ans après que les victoires du grand Condé le rendirent à la France.
C'est ce que consacra le traité des Pyrénées (1659), confirmé par celui de Nimègue (1678). Depuis lors, ce comté ne fut plus jamais détaché de la monarchie française, et même, depuis 1757, il fut désigné pour servir d'apanage au second frère du roi ; c'est à ce titre que le possédait le roi Charles X avant de monter sur le trône.
Pendant les cent cinquante ans environ qu'il fut soumis à la domination espagnole, l'Artois s'était fait maintenir ou accorder par ses souverains étrangers, fort intéressés à user de ménagement envers un pays aussi important par sa richesse et sa position, des privilèges qu'il conserva après son retour à la couronne de France.
Aussi demeura-t-il pays d'états, ne connaissant ni douanes, ni aides, ni gabelles, et même ayant le droit d'exercer un contrôle nominal sur la levée des deniers royaux. Relativement à ses divisions ecclésiastiques et administratives, il comptait deux évêchés, Arras et Saint-Omer, et se divisait en huit bailliages et une gouvernante, celle d'Arras ; il faisait partie du gouvernement militaire de Picardie et relevait de l'intendance de Flandre pour les finances. Sa population était évaluée à 319 200 habitants. Quant à la langue, l'Artois est remarquable pour avoir été et être encore le théâtre de la lutte du picard et du flamand, en d'autres termes du français et de l'allemand. Le picard a l'avantage à présent et fait des progrès qui refoulent peu à peu son rival.
La province d'Artois a formé, pour la plus grande partie, le département du Pas-de-Calais ; pourtant leurs limites sont loin de coïncider, et ce serait une grave omission dans l'histoire du département que celle des pays, du reste bien moins importants, du Boulonais, du Calaisis, de l'Ardrésis, qui dépendaient anciennement de la basse Picardie.
Comme le Loiret, le Pas-de-Calais, pendant la guerre de 1870-1871, a été témoin d'une victoire remportée par l'armée française sur les Prussiens. C'était le 2 janvier 1871. Commandée par le général Faidherbe, l'armée du Nord, qui déjà, le 23 décembre 1870, avait brillamment soutenu l'effort de l'ennemi à Pont-Noyelles, se trouvait alors divisée en deux corps, le 22e, sous les ordres du général Paulze d'Ivoy, et le 23e, sous les ordres du général Lecointe. « Une division du 2e corps dirigea une attaque vigoureuse sur le village de Béhagnies, qu'elle ne réussit point à enlever ; mais la 1re division du 2e corps (colonel du Bessol) chassa des villages d'Achiet-le-Grand et de Bihucourt les troupes prussiennes commandées par le général de Goeben. Le 3 janvier, toutes les positions ennemies, à Favreuil, Supinies, Avesnes-lès-Bapaume, Ligny, Tilloy, Grévillers, furent enlevées. A six heures du soir, porte la relation officielle, nous avons chassé les Prussiens de tout le champ de bataille, couvert de leurs morts. »
Les pertes éprouvées par le département du Pas-de-Calais pendant la guerre de 1870-1871 ont été évaluées à 2 014 893 francs.
les départements et leur histoire - Orne - 61 -
Le territoire du département de l'Orne faisait partie de la Gaule celtique : les peuples qui l'habitaient portaient le nom générique d'Aulerci. C'était, à ce qu'il semble, à Alençon que se réunissaient les députés des trois tribus dont se composaient leur fédération, et qui étaient les Aulerces Éburons (capitale, Ebroïcum, Évreux), les Aulerces Cénomans (capitale, Subdinum, Le Mans), et enfin les Aulerces Diablintes ; ceux-ci occupaient la plus grande partie du territoire qui a formé le départe-ment de l'Orne.
A l'époque où César vint asservir les Gaules, Crassus, son lieutenant, pénétra dans le pays avec la 7e légion, et le soumit facilement ; mais, plus tard, sous la conduite de Viridovix, ces peuples et leurs voisins se soulevèrent et mirent en péril le lieutenant de César, Titurius Sabinus, qui était entré dans leur pays à la première nouvelle de l'insurrection. César raconte, dans ses Commentaires, que l'armée de Viridovix s'était grossie d'une foule de brigands et d'hommes perdus, venus de tous les points de la Gaule : insulte ordinaire des oppresseurs, qui ne se contentent pas d'écraser ceux qui leur résistent, mais veulent encore les déshonorer.
Quoi qu'il en soit, Sabinus, se trouvant dans une position critique, fut obligé de se retrancher dans un lieu fortifié. Entouré par l'armée de Viridovix, qui lui offrit vainement la bataille, il encouragea à dessein l'audace des assaillants, leur envoya même un des Gaulois qui servaient dans ses troupes pour leur faire un tableau meurtrier du découragement des Romains, et les. engager à en profiter. Les confédérés se décident à attaquer Sabinus dans ses retranchements. « Les Romains, dit César, étaient campés sur une hauteur, d'une pente douce et aisée, d'environ mille pas. Ces barbares la montent en courant de toutes leurs forces, pour ne point leur laisser le temps de se réunir et de s'armer, et arrivent hors d'haleine au pied des retranchements. Sabinus, après avoir par ses discours excité l'ardeur de ses soldats, donne le signal. Pendant que les ennemis étaient embarrassés des fascines qu'ils portaient pour combler les fossés, il ordonne une double sortie par deux portes du camp. L'avantage de la position, l'inexpérience et l'épuisement des barbares, la bravoure de nos soldats et leur habitude de la guerre, furent cause que l'ennemi ne soutint pas même le premier choc, et prit aussitôt la fuite. » Le carnage fut effroyable.
A l'époque de l'insurrection générale des Gaulois excitée par Vercingétorix, nous retrouvons encore dans les Commentaires de César les Aulerces payant bravement leur dette à la patrie commune. Sous la conduite de Camulogène, réunis aux Parisii, ils viennent offrir la bataille à Sabinus, près de Lutèce. L'aile gauche des Gaulois plia ; mais la droite, où se trouvait Camulogène, résista intrépidement : ils se firent tuer jusqu'au dernier.
Les habitants d'Essai étaient seuls restés tranquilles pendant ces insurrections. César les favorisa aux dépens des populations moins patientes et plus patriotiques des environs. Leur puissance grandit rapidement sous la domination romaine ; mais, pendant le ive siècle de l'ère chrétienne, les pirates saxons, après avoir formé divers établissements sur la côte, remontent l'Orne, ravagent et détruisent tout sur le territoire des Essuins, et bâtissent, à deux lieues d'Essai, une nouvelle ville, Saxia ou Sées, qui acquit bientôt une grande importance. Les Saxons ne tardèrent pas à se convertir au christianisme, et, parmi les évêques de Sées, on trouve les noms de Sigisbold, de Sanobod, qui révèlent une origine saxonne.
Pendant l'effroyable désordre auquel les invasions des barbares livrèrent la Gaule, l'Armorique (Bretagne) et les populations dont nous nous occupons formèrent une vaste confédération qui maintint quelque temps son indépendance. Ravagé par les Alains et par une nouvelle invasion des Saxons, le pays se soumit à Clovis.
Pendant la période suivante, l'histoire de cette contrée reste fort obscure : nous trouvons que la plus grande partie de cette région dépend d'un archidiaconat nommé Hiesmois ou Oximisum, dont le chef-lieu était Oximum ou Hiesme, maintenant Exmes, bourg voisin d'Argentan. Pendant cette période, nous voyons grandir la puissance de Sées, à laquelle succédera, vers le Xe siècle, celle d'Alençon.
Mais les Normands ont envahi le pays, et le faible Charles le Simple a été obligé de le céder à Rollon, leur duc. Richard Ier, duc de Normandie, donne, en 943, à Yves de Creil ou de Bellême, dont il veut récompenser les services, l'Alençonnais et une assez grande étendue de territoire. Le nouveau possesseur réunit à ces domaines le Perche (Mortagne, Verneuil et Laigle), et la puissance de sa famille se fonde définitivement sous son fils Guillaume ler de Bellême, qui, le premier, prit le nom de Talvas.
Ce fut lui qui éleva les châteaux de Sées, d'Alençon, de Domfront. Mais Robert duc de Normandie, voulant le punir de s'être déclaré contre lui dans la guerre qu'il avait entreprise contre son frère et son prédécesseur Richard III, vint l'assiéger dans Alençon. Le vieux Talvas fut obligé de capituler et de venir pieds nus, en chemise et une selle sur le dos, demander grâce au duc irrité :
| Son dos offrit à chevaucher, Ne se peut plus humilier. |
dit le Roman de Rou. Au prix de cette humiliation, le vieillard garda ses possessions ; ses quatre fils jurèrent de le venger. Ils s'armèrent, mais ils furent défaits dans la forêt de Blavon. Guillaume eut deux de ses fils tués dans cette guerre ; en recevant la nouvelle de leur mort, déjà malade, il mourut sur-le-champ. L'aîné des deux fils de Guillaume Ier, Robert, lui succéda ; mais, fait prisonnier par le comte du Maine, il fut tué à coups de hache dans sa prison.
Son frère, Guillaume II Talvas, lui succéda. II reçut le surnom de Talvas le Cruel, et le justifia. Il fait étrangler sa femme Hildeburge. Il se remarie et invite à son banquet de noces Guillaume Giroie, chevalier loyal, qui avait eu jadis des différends avec la famille de Tairas.
Malgré Ies représentations de son frère Raoul, Giroie se confie à Talvas le Cruel et se rend à ses noces. Au milieu du festin, Talvas le fait saisir et part pour la chasse. Pendant qu'il se livre au plaisir de la chasse, ses bourreaux ont, par son ordre, crevé les yeux, coupé le nez et les oreilles du malheureux Giroie, qui est jeté en prison. La tour où il fut renfermé, et qui se voyait encore un peu avant la Révolution à l'entrée du château d'Alençon, avait gardé le nom de Tour de Giroie ; mais la vengeance s'appesantit bientôt sur cette horrible famille des Talvas. Le fils de Talvas II, Arnould, chasse son père de ses domaines et est lui-même étranglé dans son lit. Talvas le Cruel mourut à Domfront, en 1052.
Quatre années auparavant, profitant de l'horreur qu'inspirait Talvas, le comte d'Anjou s'était emparé d'Alençon. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, vint lui-même pour reprendre la ville. Quand il s'approcha des murs, les Angevins, qui les défendaient, se mirent à railler le jeune duc, criant à la manière des pelletiers : « A la pel ! à la pel ! » allusion au métier que faisait le grand-père de Guillaume, un pelletier de Falaise dont Robert de Normandie avait séduit la fille. Guillaume le Bâtard jura par la resplendeur de Dieu qu'il se vengerait. Il tint parole. Il fit couper les pieds et les mains aux trente premiers Angevins qu'il put saisir : la ville, effrayée, se rendit.
Mabille de Bellême, fille de Talvas le Cruel et héritière de son duché, avait épousé Robert dé Montgomery ; la famille de Montgomery devait donner cinq seigneurs à Alençon. Robert étant parti pour l'Angleterre, sa femme, atroce comme toute sa famille, régna par le fer et le poison. Elle tenta d'empoisonner Ernauld, le chef de la maison rivale de Giroie. Celui-ci refusa le verre de via qu'on lui présentait. Un de ses compagnons le prit sans défiance . c'était le frère de Montgomery, Gilbert ; il mourut, trois jours après, du poison qui ne lui était pas destiné.
Une autre fois, Mabille fut plus heureuse et réussit à faire empoisonner Ernauld par son chambellan. Mais un jour Mabille avait été visiter le château de Barre-sur-Dives, appartenant à un de ses fils. Elle s'était endormie après avoir pris un bain. On la trouva la tête coupée. L'émotion fut universelle : ou soumit un gentilhomme que l'on soupçonnait, Pantol, à l'épreuve du feu : il la subit victorieusement. On sut depuis que l'auteur du meurtre était Hugues de Sangey, auquel Mabille avait pris un château, et qui, s'étant introduit furtivement dans le château de Barre pendant son sommeil, s'était vengé et était parti aussitôt pour l'Italie, refuge ordinaire, à cette époque, de tous Tes aventuriers normands et de tous ceux qu'un meurtre éloignait de leur pays.
Les Montgomery, en héritant de la seigneurie des Talvas, semblaient avoir hérité de leur cruauté. Nous ne traînerons pas la pensée du lecteur sur cette monotone et sanglante histoire ; ce que nous eu avons dit plus haut suffit pour donner une idée des misères et des crimes de cette époque. Quelques-uns des Montgomery prirent part aux croisades ; leur absence laissa un peu de répit aux malheureux habitants de leur contrée.
Le dernier des comtes d'Alençon de la maison de Montgomery, Robert HI, accompagna Philippe-Auguste en Palestine. Il mourut sans enfants ; Philippe-Auguste, qui. s'était emparé à cette époque de la Normandie, acheta le comté d'Alençon des héritiers de Robert. Le comté fit alors partie du domaine de la couronne. Saint Louis le donna en apanage à son fils Pierre et l'agrandit de quelques villes et territoires voisins. Après la mort de Pierre, le comté revint au roi de France, Philippe le Hardi, qui en disposa en faveur de Charles, son troisième fils. Le fils et le successeur de ce dernier fut ce duc d'Alençon qui, en compromettant l'avant-garde française qu'il commandait à la bataille de Crécy, fut la principale cause de cette défaite et s'y fit tuer.
Parmi les successeurs de ce prince, on remarque son fils Charles III, qui, dégoûté du monde, entra dans l'ordre des dominicains ; Jean Ier, sous lequel le comté d'Alençon fut érigé en duché-pairie et qui périt à la bataille d'Azincourt, expiation bien due par lui à la France dont il avait fomenté les troubles et envenimé les blessures ; son fils, Jean II, pris au combat de Verneuil par les Anglais, qui s'étaient emparé de son duché (Bedford avait pris le titre de duc d'Alençon) ; le duc légitime honora sa captivité par sa constance, par son refus de se soumettre aux conquérants de sa patrie : il ne fut rendu à la liberté qu'après avoir payé une rançon considérable, 300 000 écus d'or (1429).
Il combattit vaillamment pour la délivrance du pays et commanda l'armée française à la bataille de Patay. Ce ne fut qu'en 1449, qu'il rentra en possession de. son duché. Ce prince brillant et chevaleresque, ami du faste, de la musique et de la chasse, fut accusé plus tard, par Charles VII, de connivence avec les Anglais. Condamné à mort en 1458 par la cour des pairs pour crime de haute trahison, il vit sa peine commuée. Délivré par le dauphin, devenu roi sous le nom de Louis XI, et dont l'amitié avait contribué à éveiller envers le duc les défiances de Charles VII, il se jeta néanmoins dans la ligue du Bien public, se lia avec les ennemis du royaume : condamné à mort une seconde fois, sa peine fut encore commuée : il mourut en prison, en 1476.
Son fils René ne reçut du roi, indisposé contre sa race, qu'une partie des domaines de son père ; il fut bientôt, à tort ou à raison, soupçonné d'intrigues contre Louis XI, condamné à une prison perpétuelle et enfermé dans une cage de fer ; il n'en sortit qu'à l'avènement de Charles VIII, qui lui rendit les biens de son père.
Son fils Charles devint l'époux de Marguerite de Valois, soeur du roi François Ier, la Marguerite des Marguerites, comme l'appelait son frère. Il fut une des causes de la défection du connétable de Bourbon aux dépens duquel François Ier avait fait un passe-droit, en le nommant au commandement de l'avant-garde française, et plus tard sa lâche conduite à la bataille de Pavie le couvrit de honte ; il vint mourir à Lyon en 1524.
Sa veuve, Marguerite, séjourna souvent dans ses domaines et épousa en secondes noces Henri II, roi de Navarre, et c'est sous le nom de la reine de Navarre qu'elle est demeurée célèbre dans l'histoire de notre littérature. Elle protégea les poètes, les savants et les protestants. « Ce fut, dit Brantôme, une princesse de très grand esprit et fort habile, tant de son naturel que de son acquisitif : car elle s'adonna fort aux lettres en son jeune âge, et les continua, tant qu'elle véquit, aimant et conversant, du temps de sa grandeur, ordinairement à la cour avec des gens les plus savants du royaume de son frère : aussi tous l'honoroient tellement qu'ils l'appeloient leur Mécénas, et la plupart de leurs livres qui se composoient alors s'adressoient au roi son frère, qui estoit bien savant, ou à elle.... On la soupçonnoit de la religion de Luther ; mais, pour le respect et l'amour qu'elle portoit au roi son frère, qui l'aimoit uniquement et l'appeloit toujours sa mignonne, elle n'en fit jamais aucune profession ni semblant, et, si elle la croyoit, elle la tenoit toujours dans son âme fort secrète, d'autant que le roi la haïssoit fort, disant qu'elle et toute autre nouvelle secte tendoient plus à la destruction des royaumes, des monarchies et dominations qu'à l'édification des âmes. »
Marguerite mourut au château d'Odos, en Bigorre, en 1549. Elle fut la mère de Jeanne d'Albret. Après sa mort, le duché d'Alençon, dont elle n'avait été que l'usufruitière, retourna à la couronne. Charles IX le donna à son frère François, alors âgé de douze ans. Un des seigneurs du pays, Montgomery, qui avait eu le malheur de tuer dans un tournoi le père de Charles IX, Henri II, fut poursuivi avec une haine aveugle parla veuve du roi, Catherine de Médicis.
Protestant et soldat intrépide, il propagea avec ardeur la religion nouvelle dans le pays et devint la terreur des catholiques. Il s'empara d'Alençon, qu'il fut plus tard obligé d'abandonner pour aller rejoindre à La Rochelle le prince de Condé. A l'époque de la Saint-Barthélemy, les catholiques voulurent prendre leur revanche : mais Matignon, lieutenant du roi en basse Normandie, interdit ces représailles et maintint l'ordre dans son gouvernement.
Le duc d'Alençon s'étant échappé de la cour, où il était mal vu à cause de sa modération et de son goût pour les opinions nouvelles, se réfugia à Alençon, et le roi de Navarre, depuis Henri IV, vint l'y trouver. Plus tard, pendant les guerres de la Ligue, le duché devint le théâtre de la guerre. A la mort de Henri III, Henri IV s'empara d'Alençon ; mais, pour acquitter les dettes qu'il avait contractées, il vendit le duché au duc de Wurtemberg, en 1605.
Marie de Médicis, devenue régente, le racheta en 1613. Ce fut là qu'elle se réfugia après s'être brouillée avec son fils Louis XIII, en 1620 ; elle chercha à y rallier ses partisans. Mais le duc de Créqui, à la tête de dix compagnies des gardes, occupa la ville pour le roi. Louis XIII établit une généralité ou intendance à Alençon. En 1646, Gaston, duc d'Orléans, obtint le duché d'Alençon, qui passa après lui successivement entre les mains de sa femme et de sa fille, Madame de Guise. Celle-ci en fit le centre d'une petite cour, assez brillante, qui contribua à la prospérité de la ville.
Après sa mort, le duché retourna au domaine de la couronne, et quand il en fut distrait plus tard pour entrer dans l'apanage d'un des petits-fils de Louis XIV, le duc de Berry, et enfin dans celui du comte de Provence, depuis Louis XVIII, ces princes n'en tirèrent qu'un simple revenu et un titre honorifique : le duché continua à être administré par les gens du roi.
Pendant la Révolution, le pays, après avoir incliné vers les idées nouvelles et s'être attaché un moment au parti girondin, auquel il avait donné un de ses plus énergiques représentants, Valazé, fut dévasté à plusieurs reprises par la chouannerie. Le chef des chouans, M. de Frotté, eut une destinée malheureuse. Après avoir énergiquement soutenu, avec Georges Cadoudal, une. cause désespérée, il fut, en janvier 1800, battu par le général Gardanne, près de La Motte-Fouquet.
Dans son Histoire du Consulat, Thiers écrit qu' « enfin le général Chambarlhac enveloppa dans les environs de Saint-Christophe, non loin d'Alençon, quelques compagnies de chouans, et les fit passer par les armes. Cependant voyant, comme les autres, mais malheureusement trop tard, que toute résistance était impossible devant ces nombreuses colonnes qui avaient assailli le pays, M. de Frotté pensa qu'il était temps de se rendre. Il écrivit, pour demander la paix, au général Hédouville, qui, dans le moment, était à Angers, et, en attendant la réponse, il proposa une suspension d'armes au général Chambarlhac.
« Celui-ci répondit que, n'ayant pas de pouvoirs pour traiter, il allait s'adresser au gouvernement pour en obtenir, mais que, dans l'intervalle, il ne pouvait prendre sur lui de suspendre les hostilités, à moins que M. de Frotté ne consentît à livrer immédiatement les armes de ses soldats. C'était justement ce que M. de Frotté redoutait le plus. Il consentait bien à se soumettre et à signer une pacification momentanée, mais à condition de rester armé, afin de saisir plus tard la première occasion favorable de recommencer la guerre. Il écrivit même à ses lieutenants des lettres dans lesquelles, en leur prescrivant de se rendre, il leur recommandait de garder leurs fusils.
« Pendant ce temps, le premier consul, irrité contre l'obstination de M. de Frotté, avait ordonné de ne lui point accorder de quartier, et de faire sur sa personne un exemple. M. de Frotté, inquiet de ne pas recevoir de réponse à ses propositions, voulut se mettre en communication avec le général Guidai, commandant le département de l'Orne, et fut arrêté avec six des siens, tandis qu'il cherchait à le voir. Les lettres qu'on trouva sur lui, lesquelles contenaient l'ordre à ses gens de se rendre, mais en gardant leurs armes, passèrent pour une trahison. Il fut conduit à Verneuil et livré à une commission militaire.
« La nouvelle de son arrestation étant venue à Paris, une foule de solliciteurs entourèrent le premier consul et obtinrent une suspension de procédure, qui équivalait à une grâce. Mais le courrier qui apportait l'ordre du gouvernement arriva trop tard. La constitution étant suspendue dans les départements insurgés, M. de Frotté avait été jugé sommairement, et, quand le sursis arriva, ce jeune et vaillant chef avait déjà subi la peine de sou obstination. La duplicité de sa conduite, bien que démontrée, n'était cependant point assez condamnable pour qu'on ne dût pas regretter beaucoup une telle exécution, la seule, au reste, qui ensanglanta cette heureuse fin de la guerre civile. Dès ce jour, les départements de l'Ouest furent entièrement pacifiés. »
Pendant la période qui s'écoula de 1815 à 1870, le département de l'Orne puisa dans la sage tranquillité de la paix les précieux aliments d'une prospérité qui fut consacrée aux progrès de son agriculture, de son industrie et de son commerce.
La désastreuse guerre de 1870-1871 vint l'arrêter dans sou essor. S'il n'en supporta pas le poids sanglant, il dut du moins satisfaire à de nombreuses réquisitions qui se chiffrèrent par une dépense de 3 446 234 fr. 45.
Les départements et leur histoire - Oise - 60 -
Le territoire du département de l'Oise fut primitivement habité par les Bellovakes, les Silvanectes et les Veromandues. Ces peuples prirent deux fois part au soulèvement de la Gaule contre César, qui, dans ses Commentaires, vante leur courage et leur habileté. Vaincus sur le territoire des Rèmes, en 57, ils perdirent leur capitale, Bratuspantium (Beauvais ou Breteuil). Cinq ans plus tard, ils se donnèrent pour chef le Bellovake Corrée, dont la mort héroïque rendit les Romains maîtres du pays, qui, subjugué, mais non soumis, pendant longtemps encore résista à leur domination, en l'an 29, avec les Trévires, et plus tard avec les Belges.
Après ces vaines tentatives, Rome introduisit dans le pays définitivement conquis son administration, et, si les sauvages habitants de cette partie de la Gaule-Belgique perdirent quelque chose du courage farouche de leurs ancêtres, ils reçurent en échange les bienfaits de la civilisation. De vastes terrains furent défrichés, les forêts s'éclaircirent, les villes s'élevèrent. Il reste aujourd'hui des traces des immenses travaux entrepris par les Romains dans cette contrée : c'est une voie qui traverse le département et qui porte le nom de chaussée Brunehaut, parce que, dans la suite, elle fut réparée par cette reine d'Austrasie.
Dioclétien comprit le territoire des Bellovakes dans la IIe Belgique. Leur principale ville, qui longtemps avait porté le nom de Caesaromagus et qui était une des plus importantes stations de la voie romaine qui unissait Rothomagus (Rouen), Ambiani (Amiens) et Parisii (Paris), eut le nom de Civitas Bellovacorum, avec le droit de cité.
Par la suite, on la désigna sous le nom de Bellovacum, Beauvais. Le christianisme y fut porté dans le Ier siècle de l'ère chrétienne par saint Lucien, fils, disait-on, d'un sénateur romain du nom de Lucius, que saint Pierre avait converti. Ce premier apôtre du Beauvaisis avait deux compagnons, saint Maxien et saint Julien, qui souffrirent avec lui le martyre.
Il paraît que la foi chrétienne s'établit difficilement dans cette contrée ; car, pendant les trois premiers siècles, un grand nombre de ceux qui s'étaient convertis y subirent de fréquentes persécutions. A cette même époque, le pays des Bellovakes eut beaucoup à souffrir des premières invasions des barbares en Gaule ; Dioclétien avait donné à cette partie de l'empire, pour la gouverner, Constance-Chlore, avec le titre de César.
Les Francs et les Alamans firent des invasions si fréquentes que toute l'ancienne Belgique fut en grande partie dépeuplée (292-305) ; il fallut que ce César, pour repeupler la contrée, autorisât, à l'exemple de l'empereur Probus, des colons germains à s'y établir.
Lorsque survinrent en Gaule les grandes invasions des Francs, cette partie septentrionale fut la première conquise ; elle vit, vers 430, le chef de la tribu Salienne, Clodion le Chevelu, franchir la Somme et promener ses bandes dévastatrices au midi de cette rivière ; mais Clodion fut chassé par le patrice Aétius, et c'était à Clovis qu'il était réservé de s'établir définitivement entre le Rhin et la Seine. Le patrice Syagrius, faible représentant des empereurs en Gaule, fut vaincu à Soissons en 486. Sa défaite entraîna la soumission du pays d'entre Rhin et Seine, et par conséquent de la contrée du Beauvaisis.
Cette partie des États de Clovis passa en héritage à son fils Clotaire, qui fut roi de Soissons en 511 ; celui-ci la laissa à Chilpéric Ier, époux de Frédégonde (561 à 584). Au temps de Clotaire II, la fille de l'un des principaux seigneurs du royaume fonda aux environs de Beauvais, à Oroër (Oratorium), une abbaye qui est devenue célèbre ; Angadresme, fille de Robert, chancelier du roi, était recherchée en mariage par un seigneur du Vexin, Ansbert ; mais elle préféra, à une position brillante, la retraite obscure et pieuse d'Oroër.
Ansbert, de son côté, touché de la grâce divine, se consacra au service du Seigneur et devint par la suite archevêque de Rouen. Angadresme, mise au nombre des saintes, pour sa vie pieuse, est devenue la patronne de Beauvais. Le Beauvaisis se trouvait sur les frontières de la Neustrie et de l'Austrasie ; il fut donc souvent le théâtre de la lutte des Austrasiens et des Neustriens, sous les maires Ébroïn et Pépin d'Héristal.
Sous les règnes de Pépin le Bref et de Charlemagne, plusieurs années de paix et de prospérité vinrent réparer les maux occasionnés par les guerres désastreuses qui avaient, sans interruption, désolé le pays pendant le cours de la première race ; des gouverneurs, placés sous la surveillance des legati et des missi dominici, furent donnés aux diverses parties de l'empire, et le territoire du département de l'Oise fut partagé en différents pagi, qui portèrent les noms de leurs principales villes, et qui étaient administrés par des comtes et des barons.
Ils n'étaient d'abord que simples gouverneurs et représentants de l'autorité impériale ; mais ils se rendirent indépendants sous les faibles successeurs de Charlemagne et reçurent de l'un d'entre eux, Charles le Chauve, en 877, la confirmation de leur usurpation et possédèrent alors ces fiefs à titre héréditaire. En même temps que la féodalité commencent les ravages exercés par les 'pirates normands dans toute la Gaule et en particulier dans le pays des anciens Bellovakes ; au milieu du IXe siècle, Hastings, qui, bien que né en Gaule, s'était joint aux Northmans et était devenu un de leurs chefs les plus célèbres, pénétra dans le Beauvaisis après avoir brûlé, près de Paris, l'abbaye de Saint-Denis, et détruisit les monastères de Saint-Oroër et de Saint-Germer.
A cette période du Moyen Age, l'histoire du département se divise forcément en trois parties ; la première, qui concerne le Beauvaisis, sera suffisamment traitée à l'article consacré spécialement à la ville évêché comté de Beauvais ; des deux autres, l'une comprend le Valois, dont les villes principales étaient Senlis et Crépy, et l'autre la ville de Clermont, qui eut des comtes particuliers.
Le Valois, pagus Vadensis, s'étendit, sous les deux premières races, aux territoires de Senlis, Soissons, Crépy, Meaux et Reims ; sa capitale était Crépy, et il en prit souvent le nom de Comitatus Crispeius, Crispeiensis, Crispeicus ; une partie de ce pays appartient aux départements qui avoisinent l'Oise. Cependant nous donnerons ici le nom de ses principaux comtes, dans l'impossibilité où nous sommes de scinder son histoire et en considération de Crépy, sa capitale.
Un comte du nom de Pépin, frère du puissant comte de Vermandois, Herbert, en reçut l'investiture sous le règne du roi Eudes, successeur du faible Charles le Gros, qui avait été déposé en 887, à la diète de Tribur. Après lui, le Valois passa à une famille étrangère. Le comte Raoul II partagea, vers 1040, ses États entre ses deux fils, Raoul III le Grand et Thibaut III, qui fut comte de Blois. Le vaste château de Crépy fut séparé en deux parties ; Raoul reçut l'habitation avec ses dépendances, et Thibaut le donjon.
Après la mort du roi Henri Ier, Anne de Russie, veuve de ce prince, se retira dans le monastère de Senlis ; Raoul l'y vit et résolut de l'épouser ; Anne y consentit. Raoul était marié ; il fit accuser d'infidélité sa femme Éléonore, divorça et célébra publiquement son nouveau mariage en 1052. Mais l'épouse répudiée recourut au pape, qui fit faire, par les archevêques de Reims et de Rouen, une enquête dont le résultat fut favorable à Éléonore. Sommé de répudier Anne, le comte Raoul s'y refusa ; il fut excommunié et n'en persista pas moins dans sa faute.
Une version généralement accréditée fait retourner Anne de Russie auprès de son père, après la mort du roi, son mari. Celle que nous reproduisons a été adoptée par les savants bénédictins de Saint-Maur et le P. Ménétrier.
Le fils de Raoul, Simon (1074), fut assez puissant pour combattre le roi de France et lui reprendre quelques places que celui-ci lui avait enlevées. Deux années après avoir succédé a son père, le comte Simon fit transporter la dépouille du grand Raoul de la ville de Montdidier au monastère de Saint-Arnould de Crépy. Présent à l'exhumation du cadavre, il fut si vivement frappé de ce spectacle, qu'il résolut de quitter toutes les pompes de la vie et de se consacrer à Dieu.
Vainement ses amis, pour lui faire oublier cette résolution et resserrer les liens qui l'attachaient au monde, lui firent prendre une femme ; il consentit à épouser Judith, fille d'un comte d'Auvergne. Mais la nuit même de leurs noces les deux époux convinrent de se séparer et d'aller vivre tous deux dans la retraite. Simon partit avec trois compagnons, les plus vaillants chevaliers de sa cour, qu'il avait convertis, et se rendit au monastère de Sainte-Claude, puis dans les gorges du Jura, défrichant et fertilisant des terres jusque-là incultes. Simon fit passer le Valois dans la maison de Vermandois ; ce comté y demeura jusqu'à l'époque de sa réunion à la couronne, par Philippe-Auguste, en 1214.
Le roi saint Louis accorda, en 1224, le Valois à la reine Blanche, sa mère. Cette grande princesse étant morte en 1252, à l'abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, le Valois fut réuni de nouveau à la couronne. Mais, deux ans avant sa mort, saint Louis l'aliéna encore en faveur de son quatrième fils, Jean Tristan, comte de Nevers, qui, né à Damiette pendant la première croisade du saint roi son père, mourut, ainsi que celui-ci, en 1270, pendant la seconde.
Le Valois rentra donc de nouveau dans le domaine royal à l'avènement de Philippe le Hardi. Celui-ci le donna en 1285 à Charles, son deuxième fils, qui fut la tige des rois de France de la branche des Valois. Cependant le Valois ne fut pas réuni à la couronne en 1328, à l'avènement de Philippe VI. Ce prince le donna en apanage à son cinquième fils Philippe, qui s'était distingué à la bataille de Poitiers, et qui fut l'un des otages envoyés en Angleterre pour la délivrance du roi Jean.
A sa mort, en 1375, le Valois rentra au domaine royal ; mais le roi Charles VI l'en détacha pour le donner, en 1392, à son jeune frère Louis d'Orléans, en faveur duquel il l'érigea, en 1406, en duché-pairie. Les contrées qui composent le département de l'Oise eurent grandement à souffrir des désordres du malheureux règne de Charles VI. Déjà, sous les rois Philippe VI et Jean le Bon, elles avaient été ravagées par les bandes de paysans soulevés qui prenaient le nom de Jacques.
La jacquerie était sortie, selon une tradition locale, du village de Frocourt-en-Beauvaisis. Les Jacques avaient pillé un grand nombre de villages et la ville de Senlis, lorsqu'ils furent atteints et défaits par le dauphin Charles, depuis Charles V, alors régent pour son père, prisonnier en Angleterre. Le soulèvement se porta plus loin vers le Midi ; mais les misères de toute sorte et les dévastations de la guerre étrangère jointes à la guerre civile dépeuplèrent ce malheureux pays, comme au temps des premières invasions des barbares.
Le duc de Bourgogne entra dans les campagnes de l'Oise et les dévasta, pendant la sanglante rivalité des Armagnacs et des Bourguignons ; puis, après la victoire d'Azincourt (1415), les Anglais s'emparèrent du Beauvaisis et du Valois. Cette partie de la France fut reconquise par Charles VII vers 1430. Jeanne Parc, après avoir fait le siège d'Orléans et remporté la victoire de Patay, poursuivit les Anglais jusqu'au delà de l'Oise, les atteignit à Gerberoy et les battit de nouveau en 1430.
Les Anglais ne renoncèrent cependant pas à leurs tentatives sur le Beauvaisis. Vers 1436, ils se saisirent, dans Beauvais même, par un coup de main habile, du fameux capitaine La Hire, pendant que celui-ci jouait à la paume, et Charles VII fut obligé de leur donner Clermont pour la rançon de son général.
Il est bon, avant de passer à l'histoire des temps modernes, de dire quelques mots des comtes de Clermont. Le premier qui soit connu portait le nom de Renaud ; il fut un des chefs de l'armée conduite en 1054 par Eudes, frère du roi Henri Ier, contre Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. Les Français furent battus, et le comte Renaud ne trouva son salut, dit Orderic Vital, que dans la vitesse de ses pieds. Hugues Ier et Renaud II lui succédèrent. Le fils de ce dernier, Raoul Ier, reçut du roi Louis VII la dignité de connétable de France.
II eut plusieurs démêlés avec le chapitre de Beauvais et fut excommunié deux fois ; mais il racheta ses fautes en accompagnant en Terre sainte, à la troisième croisade, en 1189, les rois Philippe-Auguste et Richard Coeur de Lion. Son petit-fils Thibaut le Jeune mourut sans enfants, et Philippe-Auguste, toujours prêt à mettre à profit les occasions d'agrandissement, réunit le comté de Clermont à la couronne.
Le roi de France disposa de cette acquisition, vers 1218, en faveur d'un fils, Philippe Hurepel, qu'il avait eu d'Agnès de Méranie. Ce dernier, qui fut aussi comte de Boulogne, le laissa à une fille, à la mort de laquelle saint Louis réunit de nouveau Clermont au domaine royal (1258). Mais, en 1269, il s'en défit en faveur de son sixième fils Robert, après lequel le comté de Clermont passa à la maison de Bourbon (1318). Robert de France eut pour bailli dans son comté le célèbre Beaumanoir, qui, en 1283, recueillit et rédigea les Coutumes de Beauvaisis, « le premier, dit Loysel, le plus grand et plus hardy œuvre qui ait été composé sur les coutumes de France. »
Pendant les guerres de Louis XI avec les derniers grands vassaux, le Valois et le Beauvaisis furent envahis par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Il sera question plus loin de l'héroïsme des femmes de Beauvais (1472). Les rois Louis XI et Charles VIII témoignèrent leur reconnaissance aux fidèles sujets du Beauvaisis en leur accordant, à plusieurs reprises, d'importants privilèges.
En 1474, Louis XI donna à Beauvais une somme de 972 livres pour faire construire une chapelle à Notre-Dame. L'année suivante, le chapitre de cette ville reçut 3 000 livres pour acheter le seigneurie de Rotangis ; puis, en 1477, en récompense d'un prêt de 600 écus d'or, les habitants furent investis du droit, qui leur avait été enlevé depuis peu, de nommer leur maire.
La peste sévit dans la contrée qui nous occupe vers cette époque ; mais les ravages qu'elle causa furent peu de chose, en comparaison des misères que les querelles de religion entraînèrent dans le siècle suivant. En 1586, l'état des campagnes était des plus misérables ; une disette cruelle s'était jointe aux oppressions du pouvoir et aux brigandages des gens de guerre ; la population, sans ressources et affamée, se formait par bandes, qui s'en allaient la nuit dans les villages et s'emparaient du peu de blé que possédaient les malheureux paysans.
Après les guerres de religion vinrent celles de la Ligue, à laquelle prirent part les villes, puis vinrent les troubles de la minorité de Louis XIII ; la peste exerça de cruels ravages, en 1629 et 1635, dans toute la contrée qui s'étend d'Amiens à Beauvais. La Fronde causa de nouvelles agitations.
Le XVIIIe siècle ne fut pas exempt de misères : épidémies, disettes, troubles intérieurs. La Révolution survint, et ses premières réformes furent accueillies sans scènes de violence. La classe bourgeoise se montra dévouée à la Constituante, et ce parti modéré exerça dans les villes une grande influence.
La condamnation de Louis XVI jeta la consternation dans Beauvais ; deux commissaires de la Convention, Mauduit et Isoré, furent envoyés dans cette ville et, au moment de l'insurrection de la Vendée, levèrent, dans l'Oise, un bataillon de 800 hommes, qu'ils firent marcher contre le département royaliste. Collot d'Herbois vint à son tour à Beauvais ; de cette ville il se rendit à Senlis, où il promulgua un arrêté contre les parents de nobles et d'émigrés. Cependant la Terreur révolutionnaire ne fit pas, dans le département, beaucoup de victimes.
Pendant l'invasion de 1814, les habitants, animés d'un noble sentiment de patriotisme, prirent les armes et se portèrent à la rencontre de l'ennemi. L'époque impériale, la Restauration et les dix-huit années du gouvernement du roi Louis-Philippe rendirent à l'Oise le calme et la prospérité qui semblaient avoir fui ses laborieux habitants.
Mais, pendant la guerre de 1870-1871, le département fut un des premiers envahis ; il eut beaucoup à souffrir de la présence d'un ennemi implacable ; et lorsque enfin le territoire fut évacué, l'invasion allemande se traduisit pour lui par une perte de 11 567 175 francs 62 centimes.
Les départements et leur histoire - Nord - 59 -
Le département du Nord, formé, en 1790, de la Flandre française, du Cambrésis et de la partie occidentale du Hainaut français, fut peuplé, à une époque dont la date est incertaine, par les Celtes, habitants primitifs du sol gaulois.
Deux siècles environ avant notre ère, quatre grandes tribus d'origine germanique envahirent ce territoire, refoulèrent les anciens habitants et s'établirent : les Ménapiens au nord-est, les Morins au nord-ouest, les Atrébates au sud-ouest (il sera particulièrement question de ceux-ci au département du Pas-de-Calais) et les Nerviens au sud-est. Aucun des principaux établissements fondés par ces peuples n'appartient au département du Nord, et la contrée continua à rester couverte de vastes forêts, de marécages, à présenter un aspect de désolation sous un ciel brumeux, attristé par les plaintes continuelles d'un vent glacé, et au milieu des empiétements et des inondations des eaux de la mer.
Les peuplades conquérantes conservèrent sous cet âpre climat, et par le contact avec les autres Germains, le caractère guerrier de leurs ancêtres ; aussi, lorsque César envahit les Gaules, n'éprouva-t-il nulle part plus de résistance que chez les Belges indomptables, à la taille gigantesque, à l'oeil bleu et farouche, à la chevelure blonde, dont il a vanté le courage dans ses Commentaires.
Par ses ordres, de grands abatis furent pratiqués dans les forêts et quelques villes, entre lesquelles on distingue Cambrai (Cameracum), commencèrent à s'élever ; mais, rebelles à toute tentative civilisatrice, les Morins et les Nerviens conservèrent leurs moeurs sauvages et indépendantes, pendant les cinq siècles de la domination romaine, et ne cédèrent qu'à d'autres barbares, Germains comme eux, les Francs, qui, dans la grande dissolution de l'empire, quittèrent les rives occidentales du Rhin pour s'avancer vers l'Escaut et envahir la Gaule.
Il n'est rien resté dans le pays de la période celtique ; mais les légions romaines ont laissé quelques traces de leur passage : ce sont des routes stratégiques, improprement appelées de nos jours chaussées de Brunehaut, et dont il ne subsiste que des tronçons à peine reconnaissables. Lorsque, en 445, le chef franc Clodion passa le Rhin et la Meuse et pénétra chez les populations belges, le christianisme, apporté pour la première fuis dans ces pays sauvages par trois martyrs, Piat, Chrysole et Eucher, commençait à s'y établir et à se régulariser.
Le chef franc s'empara de Cambrai et de Tournai, et fit massacrer tous ceux qui pratiquaient la religion nouvelle, Gallo-Romains pour la plupart. Après Clodion, Mérovée, l'allié d'Aétius contre les Huns, Childéric, puis son fils Clovis dominèrent sur une partie du territoire, conjointement avec d'autres chefs de tribu, leurs parents, Cararic et Ragnacaire, roi de Cambrai, que Clovis mit à mort pour s'emparer de leurs États, dans les dernières années de son règne (507-511). Ces nouvelles acquisitions du royaume franc firent naturellement partie de l'Austrasie et entrèrent dans le partage de Théodoric à la mort de Clovis, puis dans celui de Sigebert, après Clotaire Ier, en 561.
Dans les premières années du VIIe siècle, sous Clotaire II, vivait au fort de Buc, situé sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui la ville de Lille, un homme riche et considéré dans tout le pays ; on le nommait Lyderic ; il sut gagner la confiance du roi franc, devenu tout-puissant par la mort de Brunehaut, et obtint le titre de comte forestier.
Cette dignité, qui indique que le pays était encore à cette époque couvert de bois, fut, dans l'origine, simplement bénéficiaire, c'est-à-dire à vie. Après ce premier gouverneur, l'histoire en mentionne encore deux autres, Lyderic II d'Harlebeke, sous Pépin, et Ingelram sous Charles le Chauve ; mais il faut aller jusqu'à la seconde partie du règne de ce prince, à l'année 863, pour trouver une suite de comtes certains et héréditaires, dans cette partie de la Flandre.
Balduin ou Baudouin, nom qui en langue teutonique signifie audacieux, succéda à Ingelram, son père, qui d'abord simple missus dominicus dans le pays, c'est-à-dire envoyé par le roi pour surveiller l'administration et la justice, avait fini par s'y établir ; mais son pouvoir était précaire et subordonné au caprice du roi Charles ; le Flamand, dans un séjour à la cour de son maître, séduisit sa fille Judith, l'enleva et obtint avec sa main le titre de marquis, qu'il légua, vers l'an 879, à son fils Baudouin Il le Chauve.
Le premier Baudouin, fondateur de la dynastie des comtes flamands, avait été un guerrier et un chrétien irréprochable ; on l'avait surnommé Bras de fer, et une légende populaire, consacrée par le récit de la chronique, racontait qu'il avait dû ce surnom à une lutte et à une victoire sur le diable. Un jour, assailli par l'esprit malin, qui avait voulu le précipiter dans l'Escaut, il l'avait repoussé par la seule force de son bras.
Les Normands commencèrent, sous Baudouin II, à envahir toute la Gaule, et ses États ne furent pas épargnés ; les incursions de ces pirates redoublèrent. sous son successeur ; ils remontaient l'Escaut et ses affluents à une telle hauteur, que les villes les plus éloignées de l'embouchure du fleuve n'étaient pas toujours à l'abri de leurs ravages.
Baudouin défendit énergiquement la Flandre ; la partie de ce pays qui nous occupe eut peu à souffrir des pirates. Parmi les autres faits de la vie de Baudouin, on signale sa lutte avec Héribert de Vermandois et l'archevêque de Reims, qu'il fit assassiner tous deux. Comme lui, son fils Arnoul le Vieux (919) fut cruel et se débarrassa de ses ennemis par le meurtre ; sous son gouvernement, en 953, une grande invasion hongroise traversa le Hainaut et la ville de Cambrai ; les barbares s'emparèrent de l'église de Saint-Géri, située hors de la ville et défendue par un grand nombre d'habitants, qui furent tous massacrés. Arnoul, pour expier les fautes de sa vie, consacra ses dernières années au Seigneur et entra dans un monastère, laissant le comté de Flandre à son fils Baudouin III.
Quand, peu de temps après cet acte de pénitence, il mourut (964), il y avait un siècle que la dynastie flamande régnait sur le pays. Baudouin III était mort avant son père ; il avait eu pour successeur son fils nommé Arnoul, comme son aïeul, et que, pour distinguer de lui, on a surnommé le Jeune. Ce comte se trouva mêlé aux derniers événements de la dynastie carlovingienne. Lothaire, fils et successeur de Louis d'Outre-mer, pour le punir de ce qu'il lui refusait hommage, envahit ses États, s'empara de Douai et ne se retira qu'avec un butin considérable.
Plus tard, Hugues Capet, après avoir pris le titre de roi des Francs, voulut faire acte de suzeraineté sur la Flandre ; le refus d'Arnoul entraîna une nouvelle guerre, le comté fut envahi et ravagé, et Hugues ne se retira qu'après que le Flamand se fût reconnu son vassal. Arnoul le Jeune, dont le gouvernement n'avait cessé d'être malheureux, laissa à un fils en bas âge, Baudouin Belle-Barbe, des États dépeuplés et appauvris par les invasions successives des Normands, des Madgyars, de Lothaire et de Hugues.
Le règne de ce Baudouin ne fut pas plus heureux que celui de son père ; des troubles agitèrent sa minorité, puis une guerre avec Godefroi, duc de Lorraine, entraîna des hostilités avec l'empire ; enfin la peste, les inondations, la terreur qu'inspira l'apparition d'une comète, la rébellion de son fils Baudouin le Jeune vinrent l'attrister.
La dynastie flamande, malheureuse sous ses deux derniers chefs, se releva avec Baudoin V de Lille, fils et successeur de Baudouin Belle-Barbe (1036). Fils rebelle et turbulent dans sa jeunesse, il devint un prince sage et résolu ; sa fille Mathilde épousa Guillaume le Bâtard, bientôt le Conquérant, duc de Normandie, et son fils consolida sa domination dans le pays par un mariage avec Richilde, comtesse de Hainaut. Ce fut à sa sagesse et à son habilité reconnues que Baudouin dut d'être nommé par Henri Ier, à sa mort, tuteur du jeune roi de France, Philippe (1060). Il profita de l'influence que lui donnait ce choix pour favoriser l'expédition de son gendre en Angleterre, par des secours d'hommes et d'argent. Il mourut quatre ans après, en 1070 ; ses dernières années furent employées en oeuvres pieuses ; il institua dans le bourg de Lille, alors de fondation récente, et encore peu considérable, mais dont il avait fait son séjour de prédilection, un chapitre de chanoines, devenu célèbre sous le nom de chapitre de Saint-Pierre. Il fut enterré à Lille, dans l'église qu'il avait fondée.
Baudouin VI, fils et successeur de Baudouin V, fut surnommé Baudouin de Mons, parce qu'il habitait cette ville de préférence, comme son père avait reçu le nom de Baudouin de Lille pour s'être fixé dans cette ville naissante. Son règne fut de courte durée ; mais les trois années qu'il porta : la couronne comtale furent pour la Flandre, si nous en croyons un chroniqueur contemporain, une époque de complète prospérité. La paix, la concorde, la sécurité étaient universelles ; il n'y avait plus ni voleurs ni assassins, les portes des villes et même des maisons particulières restaient ouvertes, et partout, disent les historiens du temps, se vérifiait cette prophétie : « Ils transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en faux. »
Mais les dissensions et la guerre intestine commencèrent aussitôt après sa mort ; il avait partagé la Flandre entre ses deux fils en bas âge, Arnoul et Baudouin, sous la tutelle de son frère, Robert le Frison ; leur mère, Richilde, s'empara de l'autorité au nom de son fils Arnoul et se rendit odieuse aux Flamands par ses exactions et ses violences ; une partie de la Flandre se déclara pour Robert ; une bataille eut lieu à Cassel.
Philippe, roi de France, avait conduit une armée au secours de Richilde et d'Arnoul ; les Flamands insurgés considéraient Robert le Frison comme leur chef national ; les hommes du roi de France et les partisans de la comtesse furent entièrement défaits ; le jeune Arnoul fut assassiné sur le champ de bataille par un traître de son camp. Richilde, sans se décourager de ce revers, donna son second fils Baudouin pour successeur à son fils aîné, et, bien qu'abandonnée de son allié Philippe, bien que faiblement secourue par Théoduin, évêque de Liège, dont elle avait consenti à se reconnaître vassale, en échange d'un secours d'argent et de soldats, elle reprit les armes ; une seconde bataille eut lieu à Broqueroie ; le combat fut acharné, et le souvenir s'en est perpétué jusqu'à nous par les noms que porte encore le lieu où il fut livré ; on l'appelle les Haies de la Mort ou les Bouniers sanglants.
Robert ravagea tout le pays entre Bouchain et Valenciennes, mit garnison dans le fort de Wavrechin, qui commandait les frontières du Hainaut, et rentra en Flandre où il fut universellement reconnu comte. Pour faire oublier son usurpation, il chercha à s'attacher le clergé et dota de grands biens la plupart des églises flamandes, fonda un monastère à Watten, bâtit une église collégiale à Cassel ; néanmoins, l'évêque de Cambrai, Liébert, se prononça contre lui et le traita ouvertement de rebelle et d'usurpateur.
Robert, pour le punir, vint exercer des ravages dans le Cambrésis et mettre le siège devant la ville ; mais il en fut chassé par l'autorité et les anathèmes du saint prélat. Le pouvoir de Robert, bien qu'appuyé sur deux victoires et sur l'affection des barons flamands, sembla longtemps illégitime aux populations, et on se redisait par toute la Flandre des récits merveilleux, qui promettaient malheur à la postérité du comte.
Il avait envoyé une ambassade à l'empereur pour se le rendre favorable ; ses messagers approchaient de la ville de Cologne, quand une femme, d'apparence surhumaine, s'approcha d'eux et leur demanda qui ils étaient ; ils gardèrent le silence à cette question ; mais, les regardant fixement : « Je sais bien, dit-elle, que vous êtes les envoyés du duc des Flamands, et que vous vous en allez prier l'empereur de garder votre comte en paix ; le but de votre voyage sera rempli, l'empereur lui accordera son pardon, mais l'usurpateur sera châtié dans sa race pour avoir violé le serment qu'il avait prêté à son frère Baudouin, et pris le comté de son neveu Arnoul qui a été assassiné ; son petit-fils mourra sans enfant mâle ; alors deux compétiteurs se disputeront le comté, et il y aura meurtre et sang et carnage de génération en génération jusqu'à l'Antéchrist. »
Puis, l'apparition s'évanouit et jamais depuis on n'entendit plus parler de cette femme qu'on voyait pour la première fuis dans le pays. Robert, inquiet de l'avenir, fit la paix avec son neveu pour fléchir le courroux du ciel, et lui abandonna en toute propriété le Hainaut.
%ais ce prince perdit encore Douai ; il s'était engagé à épouser une fille de Robert, élevée en Hollande, et avait donné cette ville, l'une des plus considérables du comté qui lui restât, en garantie de sa parole ; quand il vit sa cousine, il la trouva tellement difforme que, plutôt que de l'épouser, il préféra abandonner sa ville.
Sur la fin de ses jours, Robert le Frison s'associa son fils, nommé comme lui Robert, et fit un pèlerinage en Palestine pour expier ses fautes ; là encore, selon le récit des chroniqueurs, la colère céleste se manifesta contre lui : en vain voulut-il pénétrer dans la sainte cité de Jérusalem, les portes se fermèrent d'elles-mêmes à son approche, et il ne put s'agenouiller au tombeau du Sauveur, qu'après avoir confessé ses fautes et promis de rendre la Flandre à son légitime héritier.
A son retour du saint tombeau, Robert le Frison, accueilli par l'empereur de Constantinople, lui promit des secours, et il n'est pas sans intérêt, pour l'histoire flamande, de voir, dix années avant le grand mouvement qui a entraîné en Asie les populations de l'Europe, 500 cavaliers envoyés par Robert à la défense de Nicomédie contre les entreprises du sultan de Nicée. Le comte, de retour dans ses États, mourut en 1098, à l'âge de quatre-vingts ans, et fut inhumé dans l'église de Cassel, qu'il avait jadis fondée, après sa première victoire.
Son fils Robert II lui succéda ; compagnon de Godefroy de Bouillon, il prit une part active à la première croisade et fut le dernier des souverains de Flandre qui se qualifia de marquis ; ses successeurs ne prirent plus que le titre de comte. Baudouin, fils de Robert H et son successeur, dut à sa justice sévère le surnom de : à la Hache.
Baudouin à la Hache offrit un asile à Guillaume Cliton, fils de Robert le Hiérosolymitain, que son frère Henri ler d'Angleterre avait dépouillé de son duché de Normandie ; ayant déclaré la guerre au prince anglais, il fut blessé à la tète au siège de la ville d'Eu et mourut en 1119, tant des suites de sa blessure que de celles de son incontinence.
Ainsi que l'avait prédit la femme mystérieuse qui avait jadis apparu aux messagers de son aïeul, la ligne masculine des comtes de Flandre s'interrompit avec lui. Il avait fait reconnaître comme son successeur au comté Charles de Danemark, fils d'une soeur de Robert le Frison. Celui-ci éprouva au début de son règne une grande opposition ; mais il sut par ses qualités, qui lui valurent le nom de Charles le Lion, pacifier la Flandre et rétablir l'ordre.
Sa modestie lui fit refuser la couronne impériale d'Occident et celle de Jérusalem ; mais une conspiration, à la tête de laquelle était le prévôt Bertulphe, s'organisa contre lui et, en 1127, il fut assassiné dans l'église Saint-Donat de Bruges. Le roi de France, Louis VI le Gros, intervint alors dans les affaires du comté et imposa aux Flamands Guillaume Cliton, fils de Robert de Normandie ; mais ce malheureux prince ne put se maintenir en Flandre au delà d'une année.
A sa mort, en 1128, il fut remplacé par Thierry d'Alsace , qui conserva le comté jusqu'en 1168 et, après lui, le laissa à Philippe d'Alsace, qui régna sur les Flamands jusqu'en 1191, époque à laquelle il mourut au siège de Saint-Jean-d'Acre. Ce prince ne laissait pas d'héritier. Le comté de Flandre fut alors dévolu à Baudouin de Hainaut, surnommé le Courageux, descendant direct de Baudouin, comte de Flandre.
Ce dernier étant mort en 1195, il laissa la couronne comtale à son fils, Baudouin IX. Ce fut lui qui fut élevé au trône de Constantinople en 1204, à la suite de la quatrième croisade, et qui périt, en 1205, dans une bataille sanglante contre les Bulgares. Sa fille Jeanne avait épousé Ferrand, fils du roi de Portugal qui, pris à la bataille de Bouvines (1214), fut enfermé par Philippe-Auguste dans la tour du Louvre.
Impérieuse et absolue, Jeanne gouverna le comté après avoir vainement essayé de racheter son mari. Jeanne passait dans le pays pour une mauvaise fille, et beaucoup la disaient parricide ; un vieillard aveugle s'était présenté en Flandre prétendant être le comte Baudouin, échappé aux Bulgares ; elle le fit mettre en croix, et la rumeur populaire disait que c'était son père lui-même que Jeanne avait fait périr de ce supplice infâme.
A la mort de la comtesse qui ne laissait d'enfants ni de Ferrand, ni d'un second mari, Thomas de Savoie, son héritage passa à sa sœur Marguerite, puis au fils de celle-ci, Gui de Dampierre (1280). La guerre, commencée par Jeanne et Ferrand contre la France, s'était continuée sous leurs descendants avec les successeurs de Philippe-Auguste ; les soulèvements intérieurs compliquèrent les difficultés de ce règne ; une partie de la Flandre, Gand, Bruges, Ypres, plus industrieuses que Lille, plus heureuses que Cambrai qui s'était soulevée, mais en vain, pour obtenir les franchises communales, se révoltent. Philippe le Bel envahit le comté avec une armée puissante et s'empare de tous les domaines de Gui qu'il retient lui-même prisonnier.
Le tisserand Keninck et le boucher Breydel soulèvent les Flamands, si jaloux de leur indépendance. Ceux-ci anéantissent à Courtrai une armée française, commandée par Robert d'Artois, cousin du roi de France (1302). Mais ils furent battus deux ans plus tard à Mons-en-Puelle (Mons-en-Pévèle) et laissèrent cette fois 14 000 des leurs sur le champ de bataille. Gui de Dampierre mourut au château de Compiègne. Pour obtenir la liberté, son fils Robert de Béthune s'engagea, par le traité de Paris (1320), à abandonner à la France Lille, Douai et Orchies.
Les communes industrieuses et amies de la liberté se soulevèrent contre le petit-fils de ce comte, Louis de Nevers ou de Crécy, qui appela à son secours Philippe de Valois Philippe fut vainqueur à Cassel, mais cette victoire lui coûta cher. De ce moment commença la haine irréconciliable de la Flandre contre la France, les insurrections sans fin contre les seigneurs que cette dernière prétendait maintenir et l'alliance avec l'Angleterre qui fut d'un si grand poids dans la première moitié de la guerre de Cent ans.
Mais nous n'avons pas à nous arrêter sur cette histoire, qui concerne non la Flandre française et notre département du Nord, mais les Flandres de Belgique, si fières de leurs libertés et de leurs privilèges, et les deux Artevelde et Pierre du Bois et tant d'autres, dont les noms, illustrés par le courage et la persévérance, se perdent dans le grand nombre de noms glorieux des valeureux enfants des Flandres. La partie de son comté que retint Louis de Crécy fut transmise par lui à son fils, Louis de Male, qui donna sa fille en mariage à Philippe le Hardi, dernier fils de Jean le Bon, et le comté de Flandre passa de la sorte dans la maison de Bourgogne, en 1383.
Ainsi, en donnant, si malheureusement, le beau duché de Bourgogne à l'un de ses fils, Jean, roi de France, nuisait deux fois à la couronne : il aliénait l'un des plus riches duchés et empêchait la réunion de la Flandre. Louis XI, bien qu'habile politique, perdit aussi l'occasion de réunir la Flandre, en faisant épouser la princesse Marie, fille de Charles le Téméraire, au dauphin Charles VIII.
La fille du duc de Bourgogne épousa Maximilien, archiduc d'Autriche. Leur fils, Philippe le Beau, marié à Jeanne, infante d'Espagne et héritière de Ferdinand le Catholique et de la reine Isabelle, laissa la Flandre et les Pays-Bas à son fils Charles-Quint, qui porta longtemps le nom de Charles de Luxembourg. La monarchie espagnole, unie à la maison d'Autriche et longtemps ennemie irréconciliable de la France, entourait ainsi sa rivale au nord comme au midi, et la province de Flandre facilitait une invasion sur le territoire français.
François Ier, battu à Pavie, fut contraint par le traité de Madrid (1525) de renoncer à la souveraineté du comté de Flandre. Les Espagnols conservèrent cette province pendant plus d'un siècle, et c'est durant cette longue domination que s'y forma ce mélange singulier, dont on retrouve encore des traces aujourd'hui, des usages espagnols, du caractère et de la physionomie de cette contrée, avec les mœurs des Flamands, et par suite duquel il arrive souvent que, parmi ces blonds enfants du Nord, on rencontre des visages dont le type et la couleur accusent une origine méridionale.
Richelieu comprit l'importance de la possession de la Flandre pour les frontières françaises lorsqu'en 1629 une invasion des Espagnols menaça Paris et fit lever l'armée dite des Portes cochères, six ans après, il conclut avec les Hollandais un traité de partage des Pays-Bas et envoya au secours des protestants une armée de 15 à 20 000 hommes.
Cette armée n'eut aucun succès . mal conduite, elle échoua devant Louvain et périt en partie, dans ses quartiers, de maladie et de misère Plus heureux, Mazarin s'empara d'une partie du Hainaut. Cette province, le Limbourg et le Brabant donnèrent naissance à la guerre dite de Dévolution, par laquelle Louis XIV réclamait, à la mort de Philippe IV, roi d'Espagne, ces contrées du chef de sa femme Marie-Thérèse.
Le traité d'Aix-la-Chapelle (1668) lui en assura une partie. Dans la guerre qui suivit, et que termina le traité de Nimègue, le roi conquit une partie des Pays-Bas et établit un conseil souverain à Tournai. Désirant s'attacher les populations par des privilèges, il érigea ce conseil souverain en parlement, par édit du mois de février 1686 ; mais Tournai ayant été prise par les puissances coalisées contre la France, dans la guerre de la succession d'Espagne, le parlement fut transféré à Cambrai. Au traité d'Utrecht (1713), le siège de ce parlement fut transporté à Douai, et il y resta jusqu'à la Révolution.
Vers la fin de la guerre de la succession d'Espagne, la Flandre était redevenue le théâtre de la guerre. Le 11 juillet 1708, l'armée française avait été mise en déroute à Oudenarde, au passage de l'Escaut. Ce fut, à vrai dire, plutôt une affaire d'avant-garde qu'une bataille ; elle nous avait coûté à peine 1 500 hommes.
Toutefois, malgré l'avis de Vendôme, le duc de Bourgogne, que Louis XIV avait mis à la tète des troupes, ordonna la retraite ; celle-ci commença et fut désastreuse. « Les régiments allaient à l'aventure, dit Victor Duruy, sans ordre, sans chefs ; l'ennemi survint, qui tua ou prit plus de 10 000 hommes. Gand, Bruges se rendirent. Lille même capitula, malgré l'héroïque défense de Boufflers, » qui tint 72 jours dans la ville et qui se défendit encore 47 jours dans la citadelle. Aussi, le prince Eugène, plein d'admiration, lui laissa-t-il rédiger les articles de la capitulation tels qu'il les voulut.
La France était ouverte aux alliés ; un parti de hollandais osa même s'aventurer jusqu'à Versailles et enleva sur le pont de Sèvres le premier écuyer du roi, qu'on prit pour le dauphin. Le terrible hiver de 1709 accrut nos malheurs. Louis XIV demanda la paix et ne put l'obtenir, il fit alors un touchant appel au patriotisme de la nation. Cet appel fut entendu, et, à la bataille de Malplaquet, Villars put opposer aux ennemis, qui comptaient 120 000 hommes, 90 000 combattants et 80 pièces d'artillerie.
Toutefois, notre armée dut reculer entre Le Quesnoy et Valenciennes, et on compta pour une victoire l'honneur de n'avoir perdu que le champ de bataille (1709). La victoire de Villaviciosa, remportée par Vendôme en Espagne, amena le congrès d'Utrecht, auquel l'empereur d'Allemagne refusa de prendre part, ainsi que les délégués de l'Empire. La guerre continua donc de ce côté ; mais la coalition était désagrégée. Le prince Eugène, à la tête de 100 000 hommes, s'était emparé du Quesnoy ; il occupait Bouchain et assiégeait Landrecies. « Il appelait très justement ses lignes, dit un historien, le chemin de Paris ; car, Landrecies tombé, il ne voyait plus de place forte entre Paris et son armée. »
L'alarme se répandit dans le pays. En ce péril extrême, le roi dit à Villars : « La confiance que j'ai en vous est bien marquée, puisque je vous remets les forces et le salut de l'État. Je connais votre zèle et la force de mes troupes ; mais enfin la fortune peut leur être contraire. Si ce malheur arrivait, je compte aller à Péronne et à Saint-Quentin y ramasser tout ce que j'aurai de troupes, faire un dernier effort avec vous et périr ensemble ou sauver l'État. »
Une imprudence du prince Eugène et l'heureuse audace de Villars sauvent la France : les Impériaux sont battus à Denain ; Landrecies est délivré ; Douai Marchiennes, Bouchain, Le Quesnoy sont repris ; nos frontières sont dégagées. Cette mémorable victoire de Denain amena la conclusion du traité d'Utrecht (1713) entre la France, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, la Savoie et le Portugal ; celui de Rastadt (1714), entre la France et l'empereur ; celui de Bade (1714), entre la France et l'Empire. Le traité de Rastadt, en restituant les Pays-Bas à la Hollande, laissa à la France d'une manière définitive l'Artois, la Flandre wallonne et le Hainaut.
Au mois d'avril 1792, lorsque Louis XVI, ou plutôt l'Assemblée législative, eut déclaré la guerre à l'Autriche, les armées françaises se réunirent en Flandre, afin d'exécuter le plan de Dumouriez et de La Fayette, qui consistait, en se portant sur Namur et la Meuse jusqu'à Liège, à se rendre maîtres des Pays-Bas, à révolutionner la Belgique, envoyant ainsi aux souverains la liberté puisqu'ils avaient envoyé la guerre.
Mais les premières opérations, qui eurent en partie pour théâtre la Flandre française, ne furent pas heureuses : le lieutenant général Biron était parti de Valenciennes pour Mons à la tête de 10 000 hommes ; ses troupes, saisies à Quiévrain d'une terreur panique, s'enfuirent et laissèrent prendre par les ennemis le camp et les effets militaires.
En même temps, le général Dillon était massacré à Lille avec quelques-uns de ses officiers par les habitants, qui les accusaient de trahison. Après les événements politiques du 10 août et le départ de La Fayette, les trois corps d'armée formant 30 000 hommes, qui se trouvaient réunis à Maulde, Maubeuge et Lille, eussent été insuffisants pour défendre la frontière septentrionale, si Dumouriez n'eût pris lui-même le commandement de l'armée, abandonné par la La Fayette, et n'eût, par la victoire de Valmy, sauvé la France d'une première invasion.
Bientôt, le duc de Saxe-Teschen vint mettre le siège devant la ville de Lille (octobre 1792) ; mais il fut obligé de se retirer honteusement, après les cruautés d'un bombardement inutile. L'héroïsme que les Lillois avaient déployé en cette occasion fut publié par toute la France, et redoubla l'enthousiasme qu'inspiraient alors les luttes gigantesques d'une seule nation contre toutes pour sa liberté.
Les opérations qui précédèrent la bataille de Jemmapes (6 novembre 1792) se passèrent en Flandre, et cette province ne fut pas en danger d'être envahie, tant que Du-mouriez conduisit la guerre. Mais, après la défection de ce général, les Français perdirent Landrecies, Le Quesnoy, Condé et Valenciennes, qui furent incorporés à la Belgique. Cependant, les Anglais et les Hollandais investirent Dunkerque ; les victoires d'Ypres et d'Hondschoote sauvèrent celte place et rendirent à la France celles qu'elle avait perdues. Pichegru occupa les Flandres et le Brabant, et termina cette glorieuse campagne par l'occupation complète des provinces bataves.
Sous le premier Empire, la Flandre cessa d'être le théâtre de la guerre. Elle avait accueilli avec peu d'empressement les idées révolutionnaires, sans toutefois y opposer une résistance ouverte comme Lyon ou la Vendée ; mais elle avait fourni d'excellents soldats et continua à apporter aux armées de Napoléon un de ses meilleurs contingents en hommes et en officiers.
En 1814, ses places ouvertes furent occupées sans coup férir, et les villes fortes furent assiégées. Aux Cent-Jours, la Flandre vit une partie des préparatifs de la courte guerre dont Waterloo fut le triste dénouement ; pendant que Napoléon Ier, concentrait ses troupes dans la Flandre , les Prussiens et les Anglais formaient des camps dans le Brabant et le Hainaut. La France perdit, au second traité de Paris, quelques districts et forteresses, qui furent réunis au nouveau royaume des Pays-Bas.
De 1815 à 1818, le département du Nord subit l'occupation des armées étrangères. Après une ère de prospérité due à l'active industrie de ses habitants et à ses inépuisables richesses, ses campagnes retentirent de nouveau, en 1870, du clairon des armées allemandes ; le général Bourbaki et après lui le général Faidherbe furent chargés d'organiser la défense dans le Nord. Le général Faidherbe, enfant du département (il est né à Lille), eut bientôt levé, armé, exercé une armée de 20 000 hommes qui, appuyée sur les places fortes de Lille, de Douai, de Valenciennes, etc., put enfin prendre l'offensive.
A la bataille de Pont-Noyelles, cette jeune armée garda victorieusement toutes ses positions ; à la bataille de Bapaume (2 janvier 1871), elle enleva les positions de l'ennemi ; mais, affaiblie par ses succès eux-mêmes, elle dut pour se refaire aller chercher ses cantonnements à 6 kilomètres en arrière.
Pendant ce temps l'ennemi recevait de nombreux renforts ; quoique privé de cavalerie, le général Faidherbe voulut reprendre l'offensive ; cette fois, la fortune des armes trahit sous les murs de Saint-Quentin le courage et le patriotisme de l'armée du Nord et de son général (19 janvier 1871) ; l'armée du général Faidherbe s'était mise en retraite vers Cambrai, Valenciennes, Douai, Arras et Lille ; elle chantait encore dans ses étapes forcées Mourir pour la Patrie ! tandis que d'autres soldats, montrant leurs rangs clairsemés, disaient avec un juste orgueil : Voilà ce qui reste des chasseurs à pied !
Quelques jours après, le département du Nord était envahi, occupé, réquisitionné par les armées allemandes, et cette occupation se soldait pour lui par 1 918 885 fr. 18 c. de pertes. L'armée du Nord et le général Faidherbe avaient bien mérité de la patrie ; leurs efforts avaient réussi à retarder l'occupation du département du Nord et aussi à empêcher l'ennemi de se rendre maître du Havre et d'une partie de la haute Normandie.
Les départements et leur histoire - Nièvre - 58 -
(Région Bourgogne)
L'histoire de ce département n'égale pas en intérêt celle de quelques autres, que leur situation, leur richesse ont mêlés davantage aux grands événements. Ce pays de montagnes, caché au centre de la France, a eu une existence plus modeste et plus obscure. A cheval sur la chaîne des monts du Morvan (Mar, noir ; vand, montagne), qui se détache des montagnes de la Côte-d'Or, possédant à la fois les sources de l'Yonne et une partie de la rive droite de la Loire, son histoire et ses intérêts se trouvent engagés également dans les deux bassins de la Manche et de l'océan Atlantique. Mais son influence ne rayonna bien loin ni d'un côté ni de l'autre.
Au temps des Gaulois, son territoire était occupé, pour la plus grande partie, par les Éduens (&Aeligdui), et, pour la partie nord-ouest, entre Clamecy, Cosne et La Charité, par les Sénonais (Senones). Quelques dolmens ou menhirs encore debout, quelques haches en pierre trouvées dans le sol, voilà tout ce qu'a laissé dans le pays l'époque druidique.
César vint, et deux fois s'en rendit maître. L'administration romaine eut grand souci d'un pays si voisin du centre de partage des eaux de la France, si propre à établir des postes militaires inexpugnables, et enfla situé sur la route d'Autun à Bourges, deux des plus grandes villes de cette époque. Aussi trouve-t-on de nombreux vestiges de voies, de camps romains. Le sommet du mont Beuvray, particulièrement, était un centre où aboutissaient plusieurs routes. Des savants ont prétendu que l'ancienne Bibracte était située sur un plateau élevé de 680 mètres au-dessus de la mer. Une levée de terre circulaire semble indiquer, en effet, ou une ancienne ville gauloise, ou un camp romain.
Le camp est plus probable. Il y en avait un autre à Saint-Sauges, dont les traces sont encore visibles, et Château-Chinon possède les ruines d'un fort bâti par les Romains. Mais les plus curieux débris de ces temps sont les ruines d'une ancienne ville trouvée à Saint-Révérien ; l'amphithéâtre de Bouhy, des fragments de statues, de cippes trouvés à Entrains, et surtout les thermes de Saint-Honoré.
Les eaux thermales et minérales que toute cette région doit à sa nature volcanique, étaient sans doute une des causes les plus actives qui attiraient les Romains. Les thermes de Saint-honoré, dont la découverte s'est complétée en 1821 par des fouilles faites au pied même des montagnes du Morvan, sont remarquables par une salle de bains toute revêtue de marbre, au milieu de laquelle trois réservoirs donnent une eau abondante, et par les nombreuses et brillantes habitations dont les Romains avaient orné cette petite ville.
Ils y fondèrent même un hospice militaire où les bains se prenaient dans dix-neuf bassins aujourd'hui rendus à la lumière. Si l'on en croit Gui Coquille, savant magistrat du pays même, la plupart des noms en y de la province seraient dérivés de noms latins par la transformation suivante : villa Cecilii, Cézilly ; Germanici, Germancy ; Cervini, Corbigny ; Cassii, Chassy ; Sabinii, Savigny ; Ebusii, Bussy, etc. La terminaison fréquente nay viendrait de la terminaison non moins fréquente chez les latins anum : Lucianum, Lucenay ; Casianum, Chassenay ; Appianum, Apponay ; etc.
C'est sous la domination romaine que cette province, comme presque toutes celles de la Gaule, reçut le christianisme prêché par saint Révérien et le prêtre saint Paul, qui furent martyrisés à Nevers en 274. Saint Pèlerin, apôtre de l'Auxerrois, vint presque aussitôt après enseigner l'Évangile aux habitants du district d'Entrains, où il eut à lutter contre les prêtres d'un temple de Jupiter élevé dans ce pays. Pèlerin finit aussi par le martyre ; car, Dioclétien étant devenu empereur, il fut persécuté comme tous les chrétiens, enfermé dans un souterrain et enfin massacré.
La domination des Burgondes, établie sous Honorius dans le sud-est de la Gaule, comprit le Nivernais. Les Francs survinrent, et Clovis, à l'occasion de son mariage avec Clotilde, s'en empara. A sa mort (511), ce fut le roi d'Orléans qui eut le Nivernais. Sous les derniers Mérovingiens, sous les premiers Carlovingiens, la province suit le sort du reste de la Gaule. Louis le Débonnaire la donne ensuite à Pépin, roi d'Aquitaine, dans le partage qu'il fait de ses États en 817, et elle est de nouveau entraînée dans les vicissitudes des grands événements de l'époque ; elle souffre de tous ses maux.
Rien ne donne une plus terrible idée des ravages des Normands, que de voir ces pirates barbares porter la désolation jusque dans le Nivernais, au coeur même de la France. Nevers eut cependant pour comte le fameux Gérard de Roussillon, héros de tant de romans de chevalerie. Mais Gérard se brouilla, en 865, avec Charles le Chauve, qui transféra son comté, avec l'Auxerrois, à Robert le Fort.
Puis, les liens de l'obéissance à l'autorité royale se relâchant de plus en plus, à la fin du même siècle, le Nivernais fit partie des domaines du duc de Bourgogne, qui le donnait à gouverner à des comtes de son choix. L'un de ces comtes, Rathier, suivant une tradition, fut accusé par un certain Alicher d'avoir violé la femme du duc, son suzerain ; le procès se plaida par le combat judiciaire, et déjà Rathier avait enfoncé son épée dans la mâchoire inférieure de son adversaire, quand celui-ci le frappa d'un coup mortel. Le suzerain offensé et vengé était alors Richard le Justicier. Il donna le fief à un certain Séguin.
Henri le Grand en investit ensuite Otto-Guillaume, fils d'Adalbert, roi d'Italie, qui, en 992, le donna en dot à sa fille Mathilde, en la mariant avec Landry, sire de Metz-le-Comte et de Monceaux. C'est de ce moment que date l'existence séparée du Nivernais. Il eut ses comtes distincts, en même temps comtes d'Auxerre. Les autres petits seigneurs du pays, vassaux du comte, se fortifiaient à la même époque dans leurs châteaux et se rendaient presque indépendants, faisant à l'égard des grands vassaux ce que les grands vassaux faisaient à l'égard du roi.
Maintenant nous sommes en pleine vie féodale. Guerres continuelles, de voisinage, à droite, à gauche, principalement avec les ducs de Bourgogne à propos du comté d'Auxerre. Le plus remarquable des comtes de Nevers dans cette période est Guillaume Ier (1040). Le chroniqueur assure qu'on ne trouverait pas, dans toute sa vie, une seule année de paix. Autour de lui, il entretenait sans cesse cinquante chevaliers, et cela ne l'empêchait pas d'avoir toujours 50 000 sous d'argent dans ses coffres, ce qui est assez remarquable pour l'époque. II battit le fils du duc de Bourgogne. Moins heureux lorsqu'il porta secours au roi de France contre le seigneur du Puiset, il fut fait prisonnier au siège de ce château qui tint en échec la faible royauté de ce temps.
Vers la fin de ce siècle, le Tonnerrois fut réuni par héritage au Nivernais et à l'Auxerrois, et Guillaume II porta le titre de comte d'Auxerre, de Nevers et de Tonnerre. Ce Guillaume partit, en 1101, avec 15 000 hommes pour la Palestine, passa par Constantinople, perdit à peu près tout son monde en Asie Mineure, et arriva presque nu à Antioche, d'où il revint en Europe.
Il fut un des fidèles alliés de Louis le Gros. Comme il revenait de combattre le fameux Thomas de Marie, sire de Coucy, il fut fait prisonnier dans une rencontre avec Hugues le Manceau qui le livra au comte de Blois. Celui-ci le tint quatre ans enfermé dans son château avec une opiniâtreté qui résista longtemps aux sollicitations de la plupart des puissances de l'époque. On s'est demandé la cause d'un tel acharnement, et peut-être la trouverait-on dans le mécontentement que devait exciter chez certains seigneurs la persistance des comtes de Nevers à aider les progrès de la royauté.
L'existence des comtes de Nevers fut assez agitée à cette époque. C'est Guillaume III qui accompagne Louis VII en terre sainte et qui va ensuite en pèlerinage en Espagne. C'est Guillaume IV qui voit son comté dévasté par les comtes de Sancerre et de Joigny et qui réussit à les battre à La Marche, entre Nevers et La Charité (1163). Cette guerre lui avait coûté fort cher ; il avait fait des dettes ; comment les payer ? Or, écoutez comment s'y prenait un débiteur féodal pour rétablir ses finances.
La ville de Montferrand passait pour très riche et renfermait, disait-on, un magnifique trésor. Guillaume prend la route de Montferrand, se jette sur la ville, la pille et emmène le seigneur du lieu en disant aux habitants qu'il le leur rendra quand ils auront payé une certaine somme. Un peu plus tard, on le voit marcher sous la bannière du roi Louis le Jeune contre le comte de Châlons.
Puis, pour expier tous ses péchés, il va en terre sainte et meurt à Saint-Jean-d'Acre. Le clergé ne lui sut aucun gré de cette dévotion tardive, et Jean de Salisbury, écrivant à l'évêque de Poitiers, lui fait cette triste oraison funèbre qui pourrait aussi bien s'appliquer à la plupart des seigneurs féodaux de ce temps : « Ce n'est ni par les traits des Parthes ni par l'épée des Syriens qu'il a péri ; une si glorieuse fin consolerait ceux qui le regrettent ; mais ce sont les larmes des veuves qu'il a opprimées, les gémissements des pauvres qu'il a tourmentés, les plaintes des églises qu'il a dépouillées, qui sont cause qu'il a échoué dans son entreprise et qu'il est mort sans bonheur au champ de la gloire. »
De tous ces comtes aventureux, le plus célèbre et le plus malheureux fut Pierre de Courtenay. Il n'était comte de Nevers que par sa femme. En effet, avec Guillaume V s'était éteinte la descendance mâle, et le fief avait fait retour à la couronne. Philippe-Auguste eut la générosité de le rendre à Agnès, soeur de Guillaume V, à laquelle il fit épouser Pierre de Courtenay, petit-fils de Louis le Gros, et, par conséquent, de sang royal.
A la mort d'Agnès, Pierre continua de gouverner le Nivernais, comme chargé de la garde-noble de -ce fief pour sa fille Mahaut, que le roi de France maria plus tard avec Hervé, sire de Gien. A ce moment, Pierre de Courtenay se retira dans ses autres domaines. Quelque temps après, appelé au trône de l'empire latin de Constantinople, il partit pour en prendre possession ; mais un Comnène qui régnait en Épire l'arrêta par trahison, et le tint si bien prisonnier qu'on n'eut plus jamais de nouvelles de son sort.
Les comtes de Nevers et Pierre de Courtenay, le premier de tous, se montrèrent libéraux dans la question communale. Nevers, Clamecy (voyez ces villes) obtinrent des franchises. Des règlements furent publiés, d'accord avec les principaux barons du pays, pour protéger les agriculteurs dans leurs travaux, pour faciliter les mariages des femmes serves avec les hommes des autres seigneurs, sauf toutefois l'autorisation de leur propre seigneur, enfin pour maintenir la paix publique, et le bannissement fut prononcé contre quiconque, ayant détruit ou incendié une maison, refuserait la réparation exigée.
L'intervention de la royauté n'était donc pas fort impérieusement réclamée par l'intérêt des peuples dans ce pays. Mais la royauté, encore plus guidée par l'ambition d'un pouvoir qui sent croître ses forces que par ce beau motif du bonheur des peuples, intervenait partout.
En 1280, un arrêt du parlement interdit aux comtes de Nevers de créer des nobles. C'était le temps de l'impitoyable Philippe le Bel. Par un nouvel arrêt du parlement, le comte de Nevers se voit confisquer ses comtés de Nevers et de Rethel pour avoir refusé de venir se justifier, en cour des pairs, de quelques violences contre le clergé et la noblesse de son fief. Il est vrai que, sous Louis le Hutin, la féodalité regagne du terrain, et ce roi promet, en 1316, par lettres patentes, de ne plus permettre les empiétements de ses officiers sur la juridiction des comtes de Nevers.
Une nouvelle famille de comtes était encore une fois venue s'asseoir sur le siège comtal de Nevers. Yolande, seule héritière (1272), avait épousé Robert de Dampierre, qui fut quelque temps comte de Nevers par sa femme, et, après la naissance de leur fils,. Louis Ier continua de gouverner le fief. Lui-même devint comte de Flandre. Philippe le Bel accusa Louis de Nevers d'avoir soulevé les Flamands, et le fit emprisonner.
Rendu à la liberté, il en usa pour contester à Philippe le Long son droit de succession au trône, de concert avec le duc de Bourgogne, le comte de Joigny, etc. Un arrêt du parlement confisqua toutes ses seigneuries, qui lui furent peu après rendues. Louis II épousa la fille de Philippe le Long, et devint, du chef de son grand-père et de son père, comte de Flandre et de Nivernais (1322). On l'appelle souvent Louis de Crécy, parce qu'il mourut à la bataille de Crécy, en 1346.
Le Nivernais souffrit alors de l'invasion des Anglais. Ils le ravagèrent après la bataille même de Crécy, et, dix ans après, à l'époque du désastre de Poitiers, ils s'emparèrent de La Charité, d'où leurs partis désolèrent la province. En 1359, elle fut obligée de se racheter d'un nouveau pillage, lors du passage de l'armée conduite par Édouard III.
Louis III de Male avait obtenu de Philippe de Valois des lettres patentes qui érigeaient en pairie viagère les comtés de Nevers et de Rethel. Il ne laissa qu'une fille, Marguerite, qui épousa Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et lui porta à la fois la Flandre et le Nivernais. Les deux époux détachèrent le comté de Nevers et le donnèrent à l'aîné de leur fils, Jean (sans Peur) ; et celui-ci le céda à son frère Philippe, qui se fit tuer à Azincourt.
Les fils de ce Philippe moururent aussi, ne laissant qu'une fille, Élisabeth, et les Nivernais virent encore arriver un seigneur étranger ; c'était le duc de Clèves. Son petit-fils, François Ier, se distingua par ses talents militaires et obtint l'érection définitive du Nivernais en duché-pairie (1538).
Les seigneurs de Nevers firent alors exécuter un travail qui était bien dans l'esprit de cette époque de fusion, de centralisation, d'étude, c'est-à-dire la rédaction des coutumes de la province (1534), dont les états provinciaux (1490) avaient jeté les bases. Dans les guerres de religion, les Nivernais se montrèrent d'abord en majorité très catholiques et assez intolérants ; mais à la fin ils changèrent et se rallièrent à Henri IV. Leur pays fut, après Henri IV, le centre de cette nouvelle guerre folle que les seigneurs formèrent contre Marie de Médicis. La mort du maréchal d'Ancre apaisa tout.
La maison de Gonzague possédait alors le Nivernais depuis le mariage de Louis de Gonzague avec Henriette de Clèves, seule héritière (1565). Le cardinal Mazarin acheta le duché (1659), qui, à sa mort, passa à son neveu Philippe-Julien Mazarin, et sa maison l'a possédé jusqu'en 1789. Quelques-uns des derniers ducs de Nivernais se sont distingués au XVIIe et au XVIIIe siècle par leur esprit, leur goût pour la littérature. Le dernier de tous, à la fois auteur de gracieuses poésies légères et ambassadeur à Rome, à Berlin et à Londres, perdit ses biens à la Révolution, et sut vivre en sage, modestement, jusqu'en 1798.
Quant à la province, elle forma à peu près le département de la Nièvre. Auparavant, elle était un des trente-deux gouvernements militaires, et se divisait, pour l'administration ,financière, en quatre élections, dont deux (Nevers et Château-Chinon), faisaient partie de la généralité de Moulins ; la troisième (Clamecy), de la généralité d'Orléans ; la quatrième (La Charité), de la généralité de Bourges.
Pour la justice, elle était comprise dans le ressort du parlement de Paris ; mais elle avait sa coutume écrite, dont on a parlé plus haut, sa chambre des comptes établie au nom du duc de Nivernais ; son hôtel des monnaies, qu'on faisait remonter à Charles le Chauve ; enfin ses Grands-Jours, institués en 1329 par Louis II, tribunal d'appel composé de « trois prud'hommes, un chevalier et deux gradués, pour juger les appeaux de Nivernais, tant des prévosts que des baillis, » avec pouvoir de juger, retenir ou renvoyer. Il y avait trois assises des Grands-Jours avant 1563 ; elles furent alors réduites à deux par un édit royal. Le Nivernais comptait 273 890 habitants.
On ne peut omettre, dans l'histoire du département de la Nièvre, celle du commerce tout spécial qui le fait vivre et l'enrichit, d'autant plus qu'elle présente des incidents assez curieux. Il s'agit du commerce des bois. Les hautes montagnes du Morvan attestent que les volcans ont remué ce sol ; et, en effet, si l'on perce la couche de sable qui le recouvre, on trouve un fond de basalte et de granit. Cette chaude nature du sol a produit de tout temps une riche végétation de forêts.
Si, aujourd'hui qu'on a tant exploité les bois, le département de la Nièvre en possède encore 204 000 hectares sur 6 millions qui existent en France, combien en devait-il être couvert lorsque la France entière, au XVIe siècle, en possédait 30 millions d'hectares ! C'est à cette époque, en effet, que le commerce se développant, les communications s'ouvrant de toutes parts, et Paris, de plus en plus peuplé, manquant de bois, les Nivernais imaginèrent d'expédier le leur à la capitale.
Une compagnie de marchands se forma sous la raison René Arnoult et compagnie, et des lettres patentes lui furent accordées, qui portaient « autorisation de flotter sur les rivières de Cure et d'Yonne, sans qu'il fût donné empêchement par les tenanciers et propriétaires ou autres possesseurs d'aucuns moulins, écluses, ou ayant droit de seigneurie, pêcheries ou autres, et défense au parlement de Dijon de s'immiscer dans les contestations sur le flottage des bois, attribuées spécialement aux prévôts et échevins de la bonne ville de Paris en première instance, et, par appel, au parlement de Paris. »
Le flottage dont il est ici question avait été, dit-on, déjà employé en 1490 sur la rivière d'Andelle ; mais c'est véritablement à Jean Rouvet que l'on attribue (1549) l'invention de ce moyen de transport au profit de la compagnie susdite. Son système consistait à retenir par écluses les eaux au-dessus de Gravant, puis à les lâcher en y jetant Ies bûches à bois perdu, pour les recueillir ensuite au port de Gravant, et les expédier de là, par trains, sur l'Yonne et la Seine jusqu'à Paris.
On retrouve l'usage de ce même procédé au XIXe siècle. Des étangs creusés à la tête de chacun des ruisseaux qui vont former ou grossir l'Yonne amassent l'eau ; dès qu'on lève les pelles, elle s'écoule avec impétuosité, et le torrent emporte les bûches ; les premières, la cataracte franchie, sont jetées à droite et à gauche du ruisseau inférieur et s'y arrêtent : c'est ce qu'on appelle border la rivière ; il ne reste plus alors qu'un goulet étroit, au milieu du cours d'eau, par où les autres sont emportées rapidement. On passe ensuite à l'opération qui s'appelle toucher queue, c'est-à-dire qu'on déborde le ruisseau et qu'on ramène dans le milieu les bûches égarées sur les rives, pour les envoyer rejoindre celles qui ont marché plus vite. Arrivées au port, elles sont toutes arrêtées, tirées de l'eau, triées selon les marques des divers marchands, et empilées jusqu'à la saison d'automne, qui permet d'en former des trains sur la rivière et de les envoyer ainsi à Paris.
Mais les marchands nivernais ne jouirent pas sans conteste des avantages qui leur avaient été accordés. Les propriétaires riverains se plaignaient de la servitude qui leur était imposée, du chômage que souffraient leurs moulins.
D'un autre côté, les marchands de Paris, favorisés par la juridiction parisienne à laquelle avaient été attribuées toutes les contestations en cette matière, se rendirent maîtres des prix ; et, en 1704, ils gagnaient 30 livres sur la corde de 36 livres 10 sols, tandis que, les frais déduits, il ne revenait aux propriétaires que 5 sols par corde. Les propriétaires, les marchands forains se liguèrent contre cette tyrannie et s'entendirent pour flotter à leur gré, quelques-uns même pour conduire des trains jusqu'à Paris.
L'autorité intervint. Le subdélégué de l'hôtel de ville de Paris résidant à Auxerre se rendit sur le port de Clamecy avec une brigade à cheval et se vit entouré d'une foule menaçante de 5 ou 600 personnes, qui s'armèrent de bâtons et de bûches prises dans les piles, qu'ils aiguisaient par le bout.
« Allons , s'écriaient-ils , marchons, allons à la guerre ; mourir aujourd'hui ou mourir demain, cela est égal ; voilà de beaux hommes bien habillés ; il faut les f..... à la rivière. » Le subdélégué leur défendit de toucher aux piles. « Eh ! monsieur, lui dit l'un d'eux, je n'aurais. qu'à rencontrer un chien enragé. » L'exaspération allait croissant, les bâtons étaient levés ; ne se sentant pas en force pour lutter, l'officier public se retira et dressa le procès-verbal où ces détails sont écrits.
Depuis, le flottage fut libre, une rivalité existant cependant entre les marchands nivernais et ceux de Paris , le ministre de l'intérieur ayant dû intervenir en 1850 pour régler le partage des flots de l'Yonne.
Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, l'invasion s'arrêta aux limites mêmes de ce département, et, dans le tableau général des pertes éprouvées par les départements envahis, la Nièvre n'a été comptée que pour la somme insignifiante de 5 618 francs.
Les départements et leur histoire -Moselle- 57 -
Avant l'invasion romaine, le territoire, actuellement occupé par le département de la Moselle, était habité par les Médiomatrices. Cette belliqueuse peuplade ne consentit à subir que l'alliance, et non la domination des envahisseurs. La contrée de ces vaillants gaulois fut comprise dans la première Belgique, et devint une des premières provinces de la Gaule.
Pendant la funeste époque du Bas-Empire, impuissants à conserver ses lointaines conquêtes, les pays messin fut exposé à toutes les invasions des barbares, et les Huns, Attila à leur tête, l'ensanglantèrent et le couvrirent de ruines. Il fut soumis par les Francs, vers la fin du VIe siècle, et resta en leur possession jusqu'au démembrement de l'empire de Charlemagne; il faisait alors partie du royaume d'Austrasie , et fut souvent visité par les rois de la seconde race ; le traité de Verdun le détacha de la France et le donna à Lothaire ler.
Après une tentative de Charles-le-Chauve pour l'adjoindre à ses domaines, le pays messin, sous les menaces du pape, revint à l'empereur d'Allemagne ; cependant, sa situation fut toujours indécise et mixte entre les Allemands et les Francs qui se le disputaient sans cesse.
La véritable autorité du pays fut celle des évêques de Metz qui résistèrent par les armes aux empiétements de tous les princes voisins, ducs de Lorraine, comtes de Bar et de Luxembourg, qui le convoitaient ; cependant, après toute une époque de guerre, après ce siècle funeste où la peste et la maladie connue sous le nom de feu de Saint-Antoine, décimèrent le pays messin vers la fin du XIIe siècle, la ville de Metz, ville impériale, se gouverna par ses propres lois, et la puissance des évêques, purement nominale, dut s'incliner devant le conseil des échevins.
Cette administration fut très éprouvée pendant la guerre de Cent ans par les compagnies qui dévastaient la vallée de la Moselle, pillant et massacrant les populations, puis par les entreprises du duc de Lorraine, Charles III, qui brûla un grand nombre de villages, après avoir échoué devant Metz en 1420. Ce fut alors le principal objectif de la politique lorraine, de s'adjoindre ce riche pays messin qui eût été si précieux pour le duché ; aussi les ducs s'acharnèrent-ils contre lui pendant un siècle et demi, jusqu'en 1552, époque à laquelle un plus redoutable rival, Henri II, roi de France, s'empara de Metz, et occupa la plus grande partie de la contrée.
Vainement Charles-Quint et son successeur Philippe II tentèrent de le conquérir ; malheureusement le traité de Cateau-Cambrésis le fit passer sous la domination du roi d'Espagne.
Pendant les guerres de religion, le pays messin fut souvent ravagé par les catholiques et les Allemands, et il eut beaucoup à souffrir de ces dissensions où la religion était beaucoup moins en jeu que la politique ; enfin, à la paix de Westphalie, les droits de la France sur la ville de Metz furent régulièrement consacrés, et le pays ne fut plus troublé que sous Louis XV, pendant la guerre de la succession d'Autriche, lors de l'invasion des impériaux qui en furent repoussés.
En 1790, à l'époque où la France fut divisée en départements, le département de la Moselle se forma d'une partie des provinces de Lorraine, des Trois-Évêchés et du Barrois.
Les départements et leur histoire - Morbihan - 56 -
Des départements de la Bretagne, le Morbihan est celui qui offre le plus de souvenir de l'époque celtique. Son nom d'abord, qui est demeuré celtique (mor bihan, la petite mer) alors que tous les autres départements prenaient des noms nouveaux en laissant disparaître les anciens ; ensuite les nombreux monuments druidiques, ou. plutôt mégalithiques, dont il est parsemé, et qui semblent attester, selon certains historiens et archéologues, qu'il fut le siège principal du culte des druides.
D'autres pensent que ces monuments de l'âge de pierre, qu'à défaut de données plus précises on appelle aujourd'hui monuments mégalithiques, furent à l'origine répandus avec la même densité sur tout le sol de la France du nord, mais qu'à la suite des invasions, se dirigeant toutes de l'Orient à l'Occident, ils auront disparu avec les premières civilisations, et que leurs débris auront servi à la construction des habitations, des tombeaux mêmes des nouveaux venus : Francs, Suèves, Alains, Bourguignons, Vandales, Gots, Romains, etc. La Bretagne, qui par sa position à l'extrême occident de la France échappa à la plupart de ces envahisseurs, aurait naturellement conservé plus facilement ses monuments de l'âge primitif de l'homme.
A côté de Carnac, qui depuis longtemps jouit d'une réputation colossale en raison du nombre et de la dimension de ses menhirs, on peut citer aussi la lande du Haut-Brambien (lande de Lanvaux), par exemple (commune de Pluherlin). On compte ainsi plus de deux mille menhirs qui dépassent en grosseur ceux de Carnac. Menhirs, peulvan, pierres droites, dolmens, tables de pierres, cromlechs, cercles de pierres, témènes, enceintes consacrées, tumulus, monuments de terre faits de main d'hommes, galgals, monticules formés uniquement de pierres de la grosseur d'un pavé, sans terre ni ciment, et sous lesquels on a souvent trouvé des grottes pleines de squelettes symétriquement disposés, d'armes, de vases de terre, routers, pierres branlantes, pierres percées où les paysans bretons superstitieux vont passer leur tête pour se débarrasser de la migraine, haches de pierre, qu'ils utilisent en les emmanchant dans une branche fendue qui, continuant de pousser et de grossir, se noue autour de la pierre tranchante d'une manière indissoluble ; tels sont les restes celtiques qu'on trouve dans le Morbihan. Nous allions oublier la langue, qui n'est pas le moins curieux de ces restes antiques, et que les paysans du pays parlent à peu près comme leurs ancêtres il y a deux mille ans.
Les Vénètes occupaient le Morbihan à l'époque de l'arrivée des Romains. Ce peuple, après s'être soumis à la première attaque, se repentit ensuite, prit les armes et opposa aux conquérants une des résistances les plus énergiques qu'ils aient rencontrées en Gaule. Il profita fort habilement de la disposition du sol, de cette disposition à laquelle le pays même devait son nom, c'est-à-dire des golfes nombreux par lesquels la mer a déchiré la côte, et qui forment une multitude de presqu'îles.
Les cités des Vénètes s'élevaient à la pointe de toutes ces péninsules dont la marée haute faisait autant d'îles inabordables aux troupes de terre. Lorsque les Romains avaient réussi, après de grandes peines, à s'emparer de quelqu'une de ces villes, ils ne tenaient pas pour cela les habitants, qui s'enfuyaient sur leurs vaisseaux avec tout ce qu'ils possédaient de plus précieux.
Les Vénètes avaient, en effet, une marine nombreuse, au moyen de laquelle ils entretenaient des relations fréquentes avec la Grande-Bretagne. Ils s'étaient rendus maîtres de la plupart des ports de cette côte et avaient imposé un tribut à tous ceux qui naviguaient dans leurs parages. Leurs vaisseaux de chêne, masses énormes, aux flancs épais, à la carène aplatie, à la proue haute comme une forteresse, aux voiles de peau, aux ancres pesantes, bravèrent d'abord les attaques des galères romaines comme elles bravaient le choc des flots dans les tempêtes.
Il fallut à César une tactique toute nouvelle. Il arma ses soldats de faux tranchantes placées au bout de longues perches avec lesquelles ils coupèrent les câbles des vaisseaux Vénètes. Ceux-ci, privés de l'usage de leurs voiles, masses inertes et immobiles, présentèrent un abordage facile et devinrent un champ de bataille où l'on combattit corps à corps. César avait rendu le combat naval semblable au combat de terre, et assuré la victoire aux Romains.
Ainsi se passa la dernière bataille livrée par les Vénètes, et pour laquelle ils avaient réuni dans le port de Dariorig (Dariorigum, que l'on croit être Auray) 220 navires. Les légions romaines sur les hauteurs, et le peuple de la ville sur les murailles, en contemplaient le spectacle. La plupart des Vénètes périrent dans les flots, les anciens de la cité dans les supplices ; le reste fut vendu à l'encan.
Le peuple du Morbihan a cessé depuis lors de former un corps de nation. Soumis aux Romains, il reçut en compensation de la servitude quelques avantages de la civilisation ; il vit son territoire sillonné par ces voies innombrables qui sont un des plus beaux titres de gloire des Romains.
Des recherches consciencieuses ont remis en lumière la plupart des voies romaines du Morbihan. On en trouve de toute grandeur, depuis 15 jusqu'à 70 pieds de large. Les landes, les lieux incultes et les forêts permettent de reconnaître fréquemment des tronçons de ces voies qui, au contraire, dans les lieux cultivés, ont la plupart du temps disparu sous les envahissements des propriétaires.
Ces voies retrouvées suivent en général une direction rectiligne, ce qui était au reste un caractère ordinaire des voies romaines, comme l'ont remarqué la plupart des savants qui se sont livrés à cette étude, comme l'observait déjà, chose curieuse, Beaumanoir dans ses Coutumes de Beauvaisis, au XIIIe siècle. Rencontrait-on une rivière, plutôt que de faire un détour, on construisait un gué artificiel. Ces routes s'offrent pavées de blocs de pierre bordés par d'autres blocs formant accotoirs. Sur les bords, à des distances de neuf ou dix lieues, on rencontre souvent des traces de stations ou mansions, qui marquaient les étapes des soldats romains et où ils trouvaient un abri et des magasins.
C'est ainsi qu'en 1835, un laboureur du village de Lescorno, près du bourg de Surzur, a découvert sur le bord de la voie romaine une pierre monumentale portant cette dédicace : Imperatori Caesari Piavonio Victorino Pio felici Augusto, et tout à l'entour des cendres entassées, des briques brisées, des vases en terre cuite, traces évidentes d'une station romaine. Quant à l'inscription, elle est très curieuse, puisqu'elle atteste la souveraineté d'un des successeurs de Posthumus dans les Gaules. Bien des noms de lieux rappellent la présence des Romains dans le pays : Voie (Via), Estrée, Estrelle, Estrac (Stratum), Les Millières (Milliarium), etc.
Ainsi l'occupation romaine fut aussi forte dans le Morbihan que dans le reste de la Gaule. Le commerce eut aussi quelque prospérité. La petite mer fut de nouveau visitée par les vaisseaux marchands sous son nouveau nom latin de Mare conclusum que lui donne César. On hésite toutefois à prononcer si César a désigné par là simplement le golfe du Morbihan, en avant de Vannes, ou l'espèce de bassin maritime formé par la presqu'île de Quiberon, les îles d'Houat et d'Hoedic, et qui reçoit la Vilaine.
Certains auteurs considèrent comme une colonie des Vénètes du Morbihan les Vénètes plus tard fondateurs de Venise, qui occupèrent le fond de la mer Adriatique. Après l'empire romain, l'histoire du pays qui nous occupe se confond avec celle des comtes de Vannes. Nous renvoyons à cette ville et à celles qui la suivent pour l'histoire ultérieure du département, qui, désormais, n'offre plus guère d'ensemble.
Les départements et leur histoire - Meuse - 55 -
(Région Lorraine)
Au temps de César, deux populations gauloises occupaient le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Meuse, les Leuci au sud, et les Verodunenses au nord. Après la conquête romaine, cette contrée fut comprise dans la Belgique première et eut pour villes principales Verdun (Civitas Verodunensium) et Naix dans la vallée de l'Ornain (Nasium).
A la domination des Romains succéda celle des Francs, et, après la mort de Clovis, les pays baignés par la Meuse firent partie du royaume d'Austrasie. Dans l'organisation de l'empire carlovingien, cette contrée fut partagée en plusieurs comtés ainsi désignés : comitatus Clesensis (cantons de Void et de Gondrecourt) ; comitatus Wavriensis (la Woivre, aujourd'hui la partie nord-est du département) ; comitatus Barrensis (le centre du Barrois) ; et plus au sud comitatus Odornensis (l'Ornois en Barrois).
Le traité de Verdun (843) détacha ce pays du royaume de France et l'adjugea à l'empereur Lothaire Ier ; et, lorsque celui-ci alla ensevelir au fond d'un cloître une ambition si fatale à son père et à lui-même, le second de ses fils, Lothaire II, eut le nord de ses États. Le pays qui forme le département de la Meuse fit partie de ce nouveau royaume, qui reçut le nom de Lotharingie ou Lorraine. Les efforts des rois de France pour reconquérir de ce côté ce que le traité de Verdun avait enlevé à Charles le Chauve n'eurent aucun succès durable ; à partir du Xe siècle, la vallée de la Meuse fit définitivement partie de la Lorraine mosellane.
Il faudra que la dynastie nouvelle qui succédait alors à la race dégénérée de Charlemagne se soit consolidée en France par une existence de plusieurs siècles pour pouvoir tenter de reculer la frontière française au delà de la ligne de démarcation tracée par le traité de Verdun. Cependant ces pays, qui avaient été et qui devaient être encore un objet de litige entre la France et l'empire, étaient livrés à toute l'anarchie féodale.
Il leur manquait une royauté, c'est-à-dire ce qui fut pour les peuples du moyen âge un signe d'indépendance et de nationalité. Ne pas appartenir à la France et ne reconnaître la suzeraineté de l'empire qu'à la condition qu'elle ne fût qu'un vain nom, c'était une situation favorable seulement aux petites puissances féodales. Ainsi s'établirent dans ces contrées la puissance des évêques de Verdun et celle des comtes de Bar.
Ces principautés ne pouvaient conserver leur indépendance qu'à l'une ou l'autre de ces conditions : ou que la France et l'empire restassent faibles et incapables de les conquérir ; ou que leur rivalité même pour la possession de ces contrées les protégeât, et c'est ce qui arriva. Les empereurs accordèrent aux évêques de Verdun des privilèges qui consacraient leur indépendance, afin de les encourager à mieux résister à l'ambition des rois de France. Ils sacrifièrent les droits de l'empire, et, à ce prix, ils obtinrent, pendant plusieurs siècles, que Verdun ne fût pas annexé à la France.
Il n'en fut pas tout à fait de même de la plus considérable de ces principautés temporelles, le comté de Bar. Un comte de Bar, Henri III, gendre du roi d'Angleterre Édouard Ier, prit parti contre Philippe le Bel dans une de ces guerres qui furent comme le prélude de la terrible lutte qui devait armer pendant plus d'un siècle l'une contre l'autre la France et l'Angleterre.
Philippe le Bel lui fit expier chèrement son alliance avec l'Anglais. Fait prisonnier à Bruges, Henri III fut obligé de signer, en 1301, le fameux traité par lequel il se reconnaissait homme lige du roi de France pour la partie de ses États de Barrois située au couchant de la Meuse, vers le royaume de France ; telle est l'origine du Barrois mouvant et du Barrois non mouvant. Depuis cette époque, tout ce que les comtes et ducs de Bar ont possédé sur la rive gauche de la Meuse a été regardé comme relevant de la couronne de France.
A différentes époques, les rois de France essayèrent de convertir en souveraineté réelle la suzeraineté reconnue par le traité de 1301. Les légistes de la couronne déployaient une rare habileté dans les entreprises de ce genre. Mais, lorsque le duché de Bar eut passé à la maison de Lorraine et que, au XVle siècle, des relations d'amitié s'établirent pour quelque temps entre cette maison et les rois de France, ceux-ci crurent devoir ménager des princes qu'ils considéraient comme d'utiles alliés. « En 1552, dit dom Calmet, le bailli de Sens ayant imposé les habitants de Bar-le-Duc, de Gondrecourt, de Châtillon, de La Marche et de Confins, pour contribuer au payement d'une somme de 19 200 livres, et le prince Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, régent de Lorraine sous la minorité de Charles III, ayant fait sur cela ses remontrances que la ville de Bar et les lieux ci-devant nommés étaient fiefs libres de la couronne de France et n'avaient jamais été soumis à de pareilles impositions, le roi Henri II déclara n'avoir jamais entendu que les sujets du duc de Lorraine fussent cotés et sujets à de pareilles impositions.
« Et, en 1553, il les déclara aussi exempts des ban et arrière-ban, et autres impositions faites en France. Enfin, en 1573, le roi Charles IX, en confirmant le traité fait entre lui et le duc de Lorraine, donna sa déclaration par laquelle il termina toutes les difficultés formées au sujet de la mouvance et de la souveraineté du Barrois, et ordonna que le duc Charles III, son beau-frère, jouirait de tous les droits régaliens et de souveraineté sans rien excepter, hors la foi et hommage lige. »
Mais, à la même époque, la France faisait un grand pas vers la conquête de ces contrées par l'occupation de Verdun, faite par Henri II de concert avec le cardinal de Lorraine. Toutefois, le roi de France ne prenait encore à l'égard de Verdun que le titre modeste de protecteur et de vicaire de l'empire.
Le traité de Cateau-Cambrésis, en 1559, laissa à la France l'évêché de Verdun ; on trouvera dans la notice consacrée à cette ville les mesures prises successivement par les rois de France pour annuler, au profit de la couronne, l'autorité temporelle des évènements de Verdun. Le traité de Westphalie (1648) confirma la souveraineté de la France sur cet évêché.
Le duché de Bar fut, comme la Lorraine, envahi par les troupes françaises en 1632, et il suivit toutes les vicissitudes par lesquelles passa la Lorraine pendant le règne orageux de Charles IV. On trouvera, dans la notice consacrée au département de Meurthe-et-Moselle, le récit des guerres de ce prince avec Richelieu et Louis XIV. A sa mort, la Lorraine et le Barrois étaient au pouvoir de la France. Ces deux principautés furent restituées par la paix de Ryswick (1697) au duc Léopold. Enfin le traité de Vienne en 1738, qui donnait la Lorraine et le Barrois à Stanislas Leczinski, en assurait la réversion à la France à la mort de ce prince. C'est ainsi qu'en 1766 le Barrois devint définitivement province française.
Quant à Montmédy, capitale du comté de Chiny, après avoir passé aux ducs de Luxembourg et avoir été ainsi incorporée un instant à la monarchie espagnole, elle fut réunie à la France par le traité des Pyrénées.
Le décret de 1790 créa le département de la Meuse, qui fut composé de l'ancien duché de Bar, d'une partie de la Lorraine, d'une portion des Trois-Évêchés et d'une faible partie de la Champagne. Les habitants de la Meuse ont prouvé, dans les grandes luttes soutenues par la France depuis 1790, qu'ils étaient dignement placés aux frontières de la patrie.
En 1814, les habitants de plusieurs villages voisins de Bar-le-Duc dispersèrent tout un régiment russe et tuèrent le général auquel il servait d'escorte. Le département de la Meuse est un de ceux qui donnent à la France ses meilleurs soldats ; il a produit un grand nombre d'officiers distingués par leur bravoure et leurs talents militaires.
En 1870, presque au début de la guerre franco-allemande, qui fut si désastreuse pour la France, le département de la Meuse fut envahi et comme piétiné par le flot toujours croissant des troupes ennemies. Il suffit, pour s'en rendre compte, de consulter la carte de l'invasion que Charles de Mazade a jointe à son ouvrage intitulé la Guerre de France (1870-1871). On y suit d'un oeil douloureux les progrès et la marche des armées allemandes.
La Ire armée, composée des Ier, VIIe, VIIIe corps, placée d'abord sous les ordres du général Steinmetz, et plus tard sous ceux du général Manteuffel, occupa successivement : Étain, Clermont-en-Argonne, Vaucouleurs et Gondrecourt. La IIe armée, composée des IIe, III°, IVe, IXe, Xe et XIIe corps, sous le commandement du prince Frédéric-Charles, passa à son tour à Bar-le-Duc, Saint-Mihiel et Commercy. La IIIe armée (Ve, VIe, XIe corps prussiens, Ier et IIe corps bavarois), sous les ordres du prince royal Frédéric-Guillaume, séjourna à Vaucouleurs, Ligny, Bar-le-Duc, Nettancourt et Varennes-en-Argonne. Enfin, la IVe armée, dite armée de la Meuse, placée sous les ordres du prince royal de Saxe, occupa Étain, Stenay, Varennes-en-Argonne et Netlancourt. Verdun ne fut occupé qu'en novembre et Montmédy qu'en décembre 1870.
Les places ou les villes que nous venons d'énumérer ne succombèrent pas toutes sans résistance. Citons, en première ligne, Verdun, qui, attaquée une première fois, le 24 août, ne capitula qu'après la reddition de Metz, c'est-à-dire à la fin d'octobre. Montmédy succomba le 14 décembre. A la notice que nous consacrons à Verdun, l'on trouvera de plus amples détails, dont la place n'est pas ici. Les pertes supportées alors par le département de la Meuse se sont élevées à la somme énorme de 26 242 760 fr. 57.
Les départements et leur histoire-Meurthe et Moselle-54-
Le pays qui formait jadis le duché de Lorraine était habité, à l'époque de la conquête romaine, par deux peuples principaux : les Mediomatrici, dont la capitale était Metz, appelé alors Divodorum, et les Leuci, qui avaient pour capitale Toul (Tullum). Ces deux peuples étaient considérés comme faisant partie de la grande nation des Belges, que César appelle les plus braves des Gaulois (Gallorum omnium fortissimi). Quand la Gaule fut divisée en dix-sept provinces, le pays des Médiomatrices et des Leuces ou Leuques fut compris dans la Belgique première, avec Trèves pour métropole, et pour cités Metz, Toul et Verdun.
Dès le IIIe siècle de l'ère chrétienne, ce pays eut a souffrir des invasions allemandes ; plus tard, il fut dévasté par les Vandales et les Suèves. Soumis enfin par les Francs, il fut, sous les successeurs de Clovis, la principale province du royaume d'Austrasie ou France orientale.
Il eut encore plus d'importance sous les princes carlovingiens. Les bords de la Moselle et les forêts des Vosges avaient pour eux un grand attrait, et ils y possédaient une grande quantité de domaines, tels que Marsal, Moyenvic, Vic, Scarpone, Gondreville, Flavigny, Champs, etc. Plus d'une fois Charlemagne célébra à Thionville les deux grandes solennités de Noël et de Pâques, et y tint l'assemblée générale des Francs.
Le traité de Verdun (843) sépara de la France proprement dite les contrées de la Meuse et de la Moselle ; elles furent laissées à l'empereur Lothaire, qui les transmit à son fils Lothaire II C'est alors qu'elles prirent le nom de Lotharingia, d'où nous avons fait Lorraine. Mais ce nom s'étendait à une étendue de pays plus vaste que la Lorraine actuelle ; il embrassait tout le pays compris entre le Rhin, la Meuse et l'Escaut.
Il y eut encore entre les héritiers de Charlemagne bien des luttes avant que la Lotharingie fût définitivement séparée de la France. D'abord à la mort de Lothaire II, dont les dernières années avaient été pleines de troubles et de scandales, grâce à sa passion pour la belle Waldrade, Charles le Chauve et Louis le Germanique se partagèrent ses États. En 880, toute la Lotharingie fut de nouveau réunie à l'Allemagne. Vainement un fils naturel de Lothaire II réclama ; l'empereur Charles le Gros le fit saisir au château de Gondreville, lui fit crever les yeux et le renferma au monastère de Saint-Gall. Quelques années plus tard, le successeur de Charles le Gros fit de la Lotharingie un royaume pour son fils naturel Zwentibold.
Les Lorrains se lassèrent bientôt de la tyrannie cruelle et fantasque de ce personnage, et appelèrent à leur secours le roi de Germanie, frère de Zwentibold ; celui-ci fut vaincu et tué aux bords de la Meuse, et son royaume retourna encore une fois sous l'autorité germanique. Les derniers Carlovingiens de France firent encore quelques efforts pour reconquérir ce pays. Mais ces agressions furent sans succès, et Lothaire, l'avant-dernier roi de la dynastie de Charlemagne, fut réduit, en 980, à renoncer à toute prétention sur la Lotharingie ; ce qui contrista grandement, dit un auteur contemporain, le coeur des seigneurs de France.
Quelques années avant la conclusion du traité de 980, l'empereur Othon Ier avait donné la Lorraine à son frère Brunon, archevêque de Cologne. Ce prélat, comprenant la difficulté de régir par lui-même un pays aussi étendu, le divisa en deux parties, dont l'une fut appelée basse Lorraine et l'autre haute Lorraine ou Mosellane ; c'est cette dernière qui a conservé le nom de Lorraine.
Les trois premiers ducs de la Lorraine mosellane appartiennent à la maison de Bar. Ensuite les ducs de basse Lorraine, Gothelon et Godefroy le Barbu, prétendirent à ce duché ; mais il importait aux empereurs d'Allemagne que la Lorraine restât partagée pour n'être pas redoutable à leur autorité, et l'empereur Henri III donna la Lorraine mosellane à Albert, comte d'Alsace, et, après la mort de ce prince, à Gérard, son neveu (1048).
Des deux fils aînés de Gérard, l'un, Thierry, fut le second duc de Lorraine ; l'autre, Gérard, eut pour apanage le comté de Vaudémont ; sa postérité devait le conserver jusqu'au milieu du XIVe siècle, Henri de Vaudémont étant tué à la bataille de Crécy et ne laissant qu'une fille. Cette héritière du comté de Vaudémont épousa un sire de Joinville ; mais, à la troisième génération, il ne restait également de cette maison qu'une fille, qui épousa un frère du duc Charles le Hardi, lequel commença la seconde maison de Vaudémont.
Ne pouvant suivre en détail l'histoire des ducs de Lorraine, nous nous arrêterons seulement sur quelques époques marquées par d'importants événements. Le XIIIe siècle est une de ces époques ; c'est l'ère de la fondation des libertés bourgeoises et municipales en Lorraine. Nancy, Lunéville, Saint-Nicolas, Frouard, Gerbéviller, etc., reçurent alors la loi de Beaumont, ainsi appelée de la petite ville de Beaumont-en-Argonne, à laquelle un archevêque de Reims avait accordé de grandes franchises pour y attirer des habitants.
Le développement de la liberté fut favorable au développement du commerce ; l'industrie sortit du fond des cloîtres et passa aux mains d'une bourgeoisie laborieuse. « Le numéraire, dit M. Bégin dans son Histoire de Lorraine, plus commun malgré les croisades qui en enlevèrent une quantité considérable, rendit les affaires commerciales plus faciles. Plusieurs riches minerais, tels que celui de Hayange, étaient connus et exploités... Vers le milieu du XIIIe siècle, Henri, comte de Salm, exploita pour la première fois les mines de Framont (Ferratus mons). Les marchands de Lorraine faisaient des échanges avec les provinces rhénanes, la Franche-Comté, la Champagne. ».
Ce fut au XVe siècle qu'eut lieu la réunion des maisons de Bar et de Lorraine, et ce fut à cette époque aussi que la Lorraine fut mêlée d'une manière plus active aux grands événements dont la France était alors le théâtre. C'était le temps de la lutte des Armagnacs et des Bourguignons et de la lutte nationale de la France et de l'Angleterre. La maison de Lorraine était représentée par deux vieillards : le duc de Bar, vieux cardinal, et le duc de Lorraine, Charles le Hardi, qui n'avait qu'une fille.
Charles le Hardi avait été longtemps un violent ennemi de la maison de France. En 1412, irrité d'un arrêt que le Parlement de Paris avait prononcé contre lui, il avait traîné les panonceaux du roi à la queue de son cheval. Mais le parti anglais et bourguignon ne sut pas ménager un allié si important, et Charles finit par donner sa fille en mariage à un prince français, René d'Anjou, à qui le duc de Bar, son oncle, avait déjà assuré son duché. Cependant le parti bourguignon et anglais conservait en Lorraine un allié, le comte de Vaudémont, fils d'un frère de Charles le Hardi.
Vaudémont prétendit que le duché de Lorraine ne pouvait tomber en quenouille et qu'à lui seul appartenait l'héritage en vertu de la loi salique. Vaincu à Bulgnéville (1434) par Vaudémont et les Bourguignons, René d'Anjou fut emmené captif à Dijon. Il consacra les loisirs de sa captivité à la peinture. Le duc de Bourgogne lui rendit la liberté sous caution.
En 1441, la guerre entre les deux prétendants au duché de Lorraine fut terminée par la médiation du roi, qui engagea René à donner sa fille à Ferry de Vaudémont, fils de son rival, en confondant les droits des deux maisons. Quelques années plus tard, René céda le gouvernement de la Lorraine à son fils aîné, Jean, duc de Calabre. Ce prince belliqueux, dont la vie se passa sur les champs de bataille, entra dans la ligue du Bien public contre Louis Xl et eut sa part des libéralités du roi au traité de Saint-Maur, où le bien public, suivant la piquante expression de Comines, fut converti en bien particulier.
En secondant l'ambition du grand adversaire de Louis XI, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Jean de Calabre ne se doutait pas qu'il préparait à la Lorraine de redoutables périls. Charles le Téméraire avait conçu de vastes projets ; il voulait reconstituer l'ancien royaume de Bourgogne, en reliant les États des Pays-Bas à la Bourgogne et à la Franche-Comté ; mais, pour cela, il fallait posséder la Lorraine.
Jean de Calabre était mort en 1470 ; son fils Nicolas ne lui avait survécu que trois ans. L'héritier du duché était alors René II, fils du vainqueur de Bulgnéville et de la fille du roi René. Charles le Téméraire se saisit du jeune duc, et l'obligea d'abord de lui céder quelques places fortes et le libre passage à travers son duché ; mais peu après, pendant que Charles le Téméraire s'obstinait follement au siège de Neuss, près du Rhin, René, excité et encouragé par Louis XI, lui envoya son défi et commença les hostilités.
Charles furieux envahit la Lorraine, et Nancy capitula après une résistance longue et obstinée. Heureusement pour René, le Bourguignon fut défait par les Suisses à Granson et à Morat. Le duc de Lorraine, rentré en possession de son héritage, eut à le défendre contre une dernière attaque ; la bataille de Nancy (1477) fit cheoir, dit Comines, le si grand et somptueux édifice de la puissance bourguignonne, et débarrassa le duc René de son terrible rival.
Louis XI, qui s'était entendu avec le duc de Lorraine tant qu'il avait en face de lui Charles le Téméraire, le traita avec moins de ménagement après la ruine de la maison de Bourgogne, et, en 1440, à la mort du vieux roi René, il se saisit du Barrois, qui ne fut restitué à René II qu'au commencement du règne de Charles VIII. C'est de René II que descend cette famille des Guises à laquelle se rattachent des souvenirs à la fois glorieux et sinistres.
On sait quelles graves conséquences eut pour l'État et pour les derniers Valois l'établissement d'une branche de la maison de Lorraine en France. René II, qui possédait en Champagne, en Picardie, en Flandre et en Normandie des biens allodiaux, les légua au second de ses fils, Claude, duc de Guise, qui se fixa à la cour de France ; il faisait ainsi de la branche cadette de sa maison une famille toute française, entièrement distincte de la branche aînée destinée à gouverner la Lorraine.
Mais l'ambition des Guises fut fatale, non seulement à eux-mêmes, mais à la famille ducale de Lorraine, qu'ils entraînèrent dans leurs projets. Le duc Charles III fut un des soutiens de la Ligue ; il conspira avec Philippe II et avec le pape contre l'indépendance de la France ; il fut l'un des signataires de cet insolent traité de Joinville, par lequel les princes étrangers réglaient le sort de la France. Dès lors commença entre la maison de France et la maison de Lorraine cette antipathie dont les effets devaient éclater sous le règne de Charles IV.
Il y a peu d'exemples d'une existence aussi agitée que celle de ce prince. Dès le début de son règne il se laissa entraîner, par la belle duchesse de Chevreuse, dans les intrigues et les complots dirigés contre l'administration vigoureuse de Richelieu. Quand le duc d'Orléans, qui prêtait aux factieux l'appui de son nom, s'enfuit de France, . le duc Charles lui donne asile à deux reprises et lui fait épouser, secrètement, sa soeur Marguerite. Le Parlement de Paris procède contre lui à raison du rapt commis en la personne du duc d'Orléans, et la Lorraine est deux fois envahie par les armées françaises.
Le duc Charles, réfugié à Mirecourt, abdique en faveur de son frère, le cardinal François. Mais c'était une question de savoir si le duché devait passer aux héritiers mâles par exclusion des femmes. Charles IV n'était pas le fils, mais le gendre du duc précédent, Henri. Si la duchesse Nicole abdiquait, comme son mari, la princesse Claude, soeur de Nicole, pouvait reproduire, en sa personne, la prétention des femmes.
Aussi le nouveau duc jugea-t-il prudent d'épouser sans retard sa cousine, Claude, que Louis Xlll pouvait faire enlever d'un moment à l'autre. Il renvoya au pape son chapeau de cardinal ; et comme les liens de parenté exigeaient des dispenses, il reprit un instant, pour se les accorder, sen caractère de prélat ; puis il reçut d'un prêtre la bénédiction nuptiale et consomma sou mariage.
Cinq jours après, les nouveaux époux sont arrêtés dans leur logis, au nom du roi de France, qui ne veut reconnaître ni le nouveau duc ni son mariage. Ils parviennent à s'échapper, pendant que l'armée française, devançant l'arrêt du Parlement, « qui prioit humblement le roi de se satisfaire sur les biens de son vassal non situés en France, » achève la soumission de la Lorraine.
Cependant le duc Charles, revenant sur son abdication, essaye vainement de rentrer par force dans ses États et finit par demander grâce au roi, qui lui restitua les duchés de Lorraine et de Bar ; mais plusieurs places demeuraient à la France et Nancy restait occupé provisoirement par une garnison française. Le duc promettait de rester attaché aux intérêts de la France et se soumettait à perdre irrévocablement ses États en cas de contravention.
Quelques mois après , il se joignait avec son armée aux Espagnols, ennemis de la France, et la Lorraine était reconquise par l'armée royale. Enfin, après de nouvelles aventures, suspect au roi d'Espagne, qui le tint même quelque temps en prison, abandonné de son armée vagabonde, ex-communié par le pape, pour avoir épousé une maîtresse du vivant de sa femme, le duc Charles obtint de nouveau de Louis XIV et de Mazarin la restitution de ses États (1661). C'était le cinquième traité qu'il contractait avec la France, et on le connaissait assez pour être sûr que ce ne serait pas le dernier.
Il est vrai que Louis XIV, héritier des projets de Richelieu et de Mazarin sur la Lorraine, n'attendait qu'une occasion pour réunir définitivement ce beau pays à la couronne. En 1662, il obtint, moyennant des promesses d'argent, du duc Charles, qui n'avait pas d'enfants légitimes, que ses États seraient après sa mort réunis à la France. Mais le prince Charles, fils de l'ex-cardinal François, protesta contre cet arrangement, et, le duc lui-même revint à de meilleurs sentiments pour son neveu.
Il crut trouver un appui contre l'ambition de la France dans les puissances européennes qu'avaient alarmées les succès de Louis XIV dans la guerre d'Espagne, et il intrigua pour être reçu dans la triple alliance. Aussitôt Louis XIV, se saisit de son duché, et le vieux duc s'enfuit à Cologne. Il combattit encore contre la France dans la guerre de la Hollande et termina en 1675, à Birkenfeld, son aventureuse existence. Il laissait ses droits à son neveu, Charles V, prince doué de talents supérieurs et qui s'illustra à la tête des armées impériales.
Mais il tenta vainement de s'emparer de la Lorraine ; Louis XIV avait fait dévaster systématiquement la partie orientale du duché et démanteler toutes les places secondaires. Il était impossible de s'aventurer avec une armée dans un pays si complètement ruiné. Le duc avait écrit sur ses étendards : Aut nunc aut nunquam (ou maintenant ou jamais). L'alternative ne lui fut pas favorable ; il ne rentra jamais dans ses États. Il est vrai que la paix de Nimègue (1679) les lui restituait, mais en laissant à la France des places de sûreté et entre autres Nancy, sa capitale. Charles refusa de se soumettre à cette humiliation. Il resta à la cour de Vienne, où il épousa une soeur de l'empereur.
A sa mort, Léopold, son fils, prit le titre de duc de Lorraine, et la paix de Ryswick(1697) lui restitua son duché ; Louis XIV ne gardait que Marsal, Sarrelouis et Longwy, avec le droit de passage pour les troupes françaises à travers la Lorraine. Pendant un règne paisible de trente-deux ans, Léopold s'appliqua à faire oublier à ses sujets les longues souffrances qu'avaient attirées sur eux les fautes de son aïeul.
François IV, qui succéda à son père en 1729, ne devait pas jouir longtemps de l'antique patrimoine de sa famille. Le traité de Vienne, qui, en 1735, mit fin à la guerre de la succession de Pologne, stipula que le roi Stanislas, renonçant au trône de Pologne, deviendrait duc de Lorraine et de Bar, et qu'à sa mort, ces deux duchés seraient réunis à la France. François IV était dédommagé par le grand-duché de Toscane et par la main de Marie-Thérèse, fille de l'empereur ; ce mariage lui valut, plus tard, la couronne impériale.
En 1737, Stanislas prit possession de la Lorraine. Des souvenirs honorables et affectueux se rattachent au nom de ce monarque ; mais, malgré les sympathies que méritait la personne de Stanislas, une partie de la population ne vit qu'à regret son établissement sur le trône de Lorraine. Ce règne ne pouvait être et ne fut, en effet, qu'une transition pour préparer l'incorporation définitive de la Lorraine à la France. C'est ainsi que Stanislas consentit à l'incorporation des troupes lorraines dans l'armée française et que le pays fut placé sous le régime financier de la France. Ce furent ces mesures et d'autres du même genre qui soulevèrent la susceptibilité des Lorrains ; et Stanislas eut à soutenir contre la cour souveraine du duché des luttes analogues à celles que, dans le même temps, le gouvernement en France soutenait contre les parlements.
A la mort de Stanislas, en 1766, la Lorraine fut réunie à la France. On conçoit les regrets des Lorrains en passant de l'autorité d'un prince bienfaisant et, malgré ses fautes, ami du bien public, sous le sceptre de l'égoïste Louis XV. Mais ces regrets durent s'adoucir quand éclata la Révolution de 1789. La Lorraine comprit alors que mieux vaut s'associer aux destinées d'une grande nation que de végéter dans la solitude et dans l'humilité d'un petit État.
Le décret de 1790 divisa la Lorraine et le Barrois en quatre départements : la Meurthe, les Vosges, la Moselle et la Meuse. Nous aurons l'occasion de rappeler, dans l'histoire particulière des villes, quelques événements dont la Meurthe et la Moselle furent le théâtre à celte grande et terrible époque.
En 1814, ces départements furent envahis par les alliés. Pendant la campagne de France, les paysans lorrains firent une rude guerre de détail aux envahisseurs. D'autres faits, plus terribles encore, appellent notre attention. Avant de commencer à les exposer, nous devons dire que la notice historique qui précède se rapporte plus particulièrement à notre ancien département de la Meurthe ; un seul arrondissement du département de la Moselle, celui de Briey, a été conservé à la France : il n'est donc plus utile de faire ici l'histoire du pays Messin, que tant de liens pourtant rattachent à la commune patrie.
La tâche douloureuse qui nous reste à remplir est le rapide récit des événements qui nous ont arraché ces territoires et qui, des membres sanglants de la Meurthe et de la Moselle, ne nous ont laissé que le département actuel de Meurthe-et-Moselle, qui en est formé.
Les départements de la Meurthe et de la Moselle ont été, en effet, pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le théâtre d'événements militaires décisifs. Le 19 juillet 1870, notre chargé d'affaires à Berlin remettait, comme on le sait, la déclaration de guerre de la France au gouvernement prussien ; le 20 juillet, chacun de nos corps d'armée se trouvait au poste qui lui avait été assigné, mais quelle énorme disproportion dans le nombre des combattants !
Tandis que l'armée française ne comptait pas plus de 230 000 hommes, l'armée allemande mettait en ligne 450 000 combattants, nombre qui devait s'élever progressivement au chiffre énorme de 1 350 000 hommes. Le 23 juillet, l'empereur partait de Saint-Cloud pour Metz ; le 30, le général Frossard recevait l'ordre de franchir la Sarre et s'emparait de Sarrebrück le 2 août.
On sait quelle fut cette ridicule affaire. Le 3 août, le général Abel Douay était surpris et battu à Wissembourg ; ce combat livrait à l'ennemi l'entrée de l'Alsace et les routes de Strasbourg et de Metz. Le 6 août, malgré des prodiges de valeur, Mac-Mahon était vaincu à Reischshoffen et Frossard à Forbach, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Sarreguemines. Après la défaite de Mac-Mahon et de Frossard, l'empereur ordonna la retraite sous les murs de Metz, où toutes nos troupes se trouvèrent concentrées le 11 août, moins les corps de Mac-Mahon et du général de Failly, qui s'étaient rabattus sur Châlons. Le 10 août, deux divisions détachées de l'armée du prince Frédéric-Charles arrivaient devant Strasbourg et commençaient le siège ; bientôt les troupes allemandes eurent occupé, d'un autre côté, le pays situé au nord-est, à l'est et au sud de Metz, afin de couper la retraite à l'armée française et de bloquer Metz.
La retraite commençait, en effet, le général Steinmetz accourut pour la contrarier et livrait la bataille de Borny. Les Allemands la perdent, mais réussissent à retarder le mouvement de retraite sur Verdun, ce qui permit à l'armée du prince Charles (IIe armée) d'effectuer son mouvement tournant. Le 16 août eut lieu la bataille de Gravelotte ou de Mars-la-Tour, qui fut encore une victoire pour nos soldats. Un effort de plus, et on passait sur Verdun ; c'était le salut de l'armée et le salut de la France.
La totalité de l'armée française fut alors partagée en deux armées : celte dite du Rhin, sous les ordres du maréchal Bazaine (l'empereur avait regagné Châlons dès le 19 août) ; celle dite de Châlons, sous les ordres de Mac-Mahon. Au lieu de marcher sur Verdun, l'armée du Rhin bivouaque sur le champ de bataille de Gravelotte, et, le 18 août, elle se replie sur Metz, après la sanglante bataille de Saint-Privat. Bazaine s'était abstenu de paraître sur le champ de bataille, et « pour la troisième fois, l'armée du Rhin, grâce à son chef, écrit le baron A. Du Casse (la Guerre au jour le jour, 1870-1871), ne se rend pas libre pour rallier l'armée de Châlons. »
Le 19 août, l'armée fut rangée autour de Metz. Le 26, au soir, Bazaine tenta ou feignit d'essayer de rejoindre l'armée de Châlons. La tentative échoua, et l'on rentra à Metz ; le 30, le maréchal Bazaine se décida à recommencer l'opération du 26, mais sans plus de succès. Le 1er septembre, l'armée attristée revenait prendre ses positions autour de la place.
Une phase nouvelle commençait pour l'armée du Rhin. Renonçant à jouer un rôle actif dans la partie suprême engagée en France, son chef attendait des événements politiques ou militaires qui pourraient le ramener sur la scène. Il se laissait engager dans un ordre d'idées où devaient périr son honneur et la force que la patrie avait mise entre ses mains. Nous n'entreprendrons pas de raconter ici les péripéties du blocus de Metz, ni les honteuses démarches qui furent faites pour amener la reddition de la place. Qu'il nous suffise de dire que, le 27 septembre, Bazaine en arrivait à une reddition pure et simple. Il quitta la place, poursuivi par la malédiction des soldats et de la population et fut, avec toute l'armée, interné en Allemagne.
Nous n'avons pas besoin de dire, après ce qui précède, que les principales localités des départements de la Moselle et de la Meurthe tombèrent aux mains des Allemands, dont la Ire, la IIe et la IIIe armées, respectivement sous les ordres des généraux Steinmetz, prince Frédéric-Charles et prince Frédéric-Guillaume de Prusse, envahirent le territoire. Citons notamment : Lunéville, occupé dès le 12 août par la IIIe armée allemande ; Nancy et Vézelise, le 13 août, par des troupes appartenant à la même armée ; Toul, investi le 14 août ; Briey, occupés le 15 août par deux divisions de cavalerie allemande ; Pont-à-Mousson, qui le même jour tombe au pouvoir du prince Charles-Frédéric, etc. Longwy se rendit le 15 janvier 1871 après deux jours de bombardement.
Le 26 février 1871, les préliminaires de la paix étaient signés à Versailles. La France perdait, outre ses deux plus fortes places de l'est, plus de 1 600 000 habitants, répartis dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, des Vosges, de la Meurthe et de la Moselle. Le 7 septembre 1871, une loi régularisa la situation du nouveau département formé de ce qui nous restait de la Meurthe et de la Moselle. Dans les pertes occasionnées par la guerre de 1870-1871, le département de Meurthe-et-Moselle figure pour la somme considérable de 28 611 180 fr. 98.
Les départements et leur histoire-Mayenne-53-
Les diverses populations qui occupaient le territoire dont est formé le département de la Mayenne étaient : les Andes, qui habitaient la partie méridionale du pays, l'arrondissement actuel de Château-Gontier ; les Aulerces Arviens (arrondissement de Laval) ; leur cité était Vagoritum, ville détruite, dont l'emplacement s'appelle encore la Cité, dans la commune de Saint-Pierre-d'Herve ; les Aulerces Diablintes (arrondissement de Mayenne) ; Noiodunum (Jublains) était leur capitale.
Le pays, sous la domination des Romains, fit partie de la troisième Lyonnaise. Plus tard, la partie méridionale du département se trouva comprise dans l'Anjou ; et le pays habité par les Arviens et les Diablintes fit partie du Maine. Ces diverses contrées suivirent la destinée des grandes provinces auxquelles elles appartenaient ; nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à l'histoire des départements de Maine-et-Loire et de la Sarthe, où il trouvera également celle de l'Anjou et du Maine.
Les deux principales subdivisions du pays, au Moyen Age, furent les comtés de Mayenne et de Laval ; on en trouvera plus loin l'histoire dans les notices consacrées à ces deux villes. Pendant la Révolution française, ce pays fut un des plus éprouvés par la guerre civile. L'insurrection, née dans le département de Maine-et-Loire, s'y étendit promptement. Au lieu de disperser l'histoire de la guerre civile dans ce département, en rattachant le récit de chacun des faits à la notice des localités diverses qui en furent le théâtre, nous croyons que, réunis ici, on en saisira mieux la suite, et qu'ils offriront plus d'intérêt.
Après sa défaite à Cholet (17 octobre 1793), l'armée vendéenne passa la Loire, se jeta sur la rive droite, et, sans éprouver de résistance, traversa Château-Gontier et Laval. L'armée républicaine ignorait la direction que les Vendéens avaient pu suivre. Après quelques hésitations entretenues par de faux rapports qui les représentaient comme totalement anéantis, on apprit que la colonne fugitive présentait encore un effectif de trente ou quarante mille hommes en état de tenir tête aux républicains. On se décida alors à s'avancer par Château-Gontier. Westermann et Beaupuy commandaient l'avant-garde, Kléber suivait avec le corps d'armée. Le chef nominal, que son incapacité, sentie par tous et même par lui, tenait en réalité en dehors du commandement, était Séchelles ; il laissait Kléber diriger tous les mouvements.
Le 25 octobre au soir, l'avant-garde républicaine arriva à Château-Gontier ; le gros des forces était à une journée en arrière. Westermann, quoique ses troupes fussent très fatiguées, quoiqu'il fit presque nuit et qu'il restât encore six lieues de chemin à faire pour arriver à Laval, voulut y marcher sur-le-champ. Beaupuy, tout aussi brave, mais plus prudent que Westermann, s'efforça en vain de lui faire sentir le danger d'attaquer la masse vendéenne au milieu de la nuit, fort en avant du corps d'armée et avec des troupes harassées de fatigue.
Beaupuy fut obligé de céder au plus ancien en commandement. On se mit aussitôt en marche. Arrivé à Laval au milieu de la nuit, Westermann envoya un officier reconnaître l'ennemi ; celui-ci, emporté par son ardeur, fit une charge au lieu d'une reconnaissance, et replia rapidement les premiers postes. L'alarme se répandit dans Laval, le tocsin sonna, toute la masse ennemie fut bientôt debout et vint faire tète aux républicains. Beaupuy, se comportant avec sa fermeté ordinaire, soutint courageusement l'effort des Vendéens. Westermann déploya toute sa bravoure, le combat fut des plus opiniâtres, et l'obscurité de la nuit le rendit encore plus sanglant.
L'avant-garde républicaine, quoique très inférieure en nombre, serait néanmoins parvenue à se soutenir jusqu'à la fin ; mais la cavalerie de Westermann, qui n'était pas toujours aussi brave que son chef, se débanda tout à coup, et l'obligea à la retraite. Grâce à Beaupuy, elle se fit sur Château-Gontier avec assez d'ordre. Le corps de bataille y arriva le jour suivant. Toute l'armée s'y trouva donc réunie le 26, l'avant-garde épuisée d'un combat inutile et sanglant, le corps de bataille fatigué d'une route longue, faite sans vivres, sans souliers et à travers les boues de l'automne. Westermann et les représentants voulaient de nouveau se porter en avant. Kléber s'y opposa avec force et fit décider qu'on ne s'avancerait pas au delà de Villiers, moitié chemin de Château-Gontier à Laval.
Il s'agissait de former un plan pour l'attaque de Laval. Cette ville est située sur la Mayenne. Marcher directement sur la rive gauche que l'on occupait était imprudent, comme le fit observer judicieusement un officier très distingué, Savary, qui connaissait parfaitement les lieux. II était facile aux Vendéens d'occuper le pont de Laval et de s'y maintenir contre toutes les attaques ; ils pouvaient ensuite, tandis que l'armée républicaine était inutilement massée sur la rive gauche, marcher le long de la rive droite, passer la Mayenne sur les derrières et l'accabler à l'improviste.
Il proposa donc de diviser l'attaque et de porter une partie de l'armée sur la rive droite. De ce côté, il n'y avait pas de pont à franchir, et l'occupation de Laval ne présentait point d'obstacle. Ce plan, approuvé par les généraux, fut adopté par Séchelles. Le lendemain, cependant, Séchelles, qui sortait quelquefois de sa nullité pour commettre des fautes, envoie l'ordre le plus sot et le plus contradictoire à ce qui avait été convenu la veille. Il prescrit, selon ses expressions accoutumées, de marcher majestueusement et en masse sur Laval, en longeant par la rive gauche. Kléber et tous les généraux sont indignés ; cependant il faut obéir. Beaupuy s'avance le premier, Kléber le suit immédiatement.
Toute l'armée vendéenne était déployée sur les hauteurs d'Entrammes. Beaupuy engage le combat, Kléber se déploie à droite et à gauche de la route, de manière à s'étendre le plus possible. Sentant néanmoins le désavantage de cette position, il fait dire à Séchelles de porter la division Chablos sur le flanc de l'ennemi, mouvement qui devait l'ébranler. Mais celte colonne, composée de ces bataillons formés à Orléans et à Niort, qui avaient fui si souvent, se débande avant de s'être mise en marche.
Séchelles s'échappe le premier à toute bride, une grande moitié de l'armée qui ne se battait pas fuit en toute hâte, ayant Séchelles en tête, et court jusqu'à Château-Gontier, et de Château-Gontier jusqu'à Angers. Les braves Mayençais, qui n'avaient jamais lâché pied, se débandent pour la première fois. La déroute devient alors générale ; Beaupuy, Kléber, Marceau, les représentants Merlin et Turreau, font des efforts incroyables, mais inutiles, pour arrêter les fuyards. Beaupuy reçoit une balle au milieu de la poitrine. Porté dans une cabane, il s'écrie : « Qu'on me laisse ici, et qu'on montre ma chemise sanglante à mes soldats. » Le brave Bloff, qui commandait les grenadiers, et qui était connu par sa bravoure extraordinaire se fait tuer à leur tête. Enfin une partie de l'armée s'arrête au Lion-d'Angers, l'autre fuit jusqu'à Angers même. L'indignation était générale contre le lâche exemple qu'avait donné Séchelles en fuyant le premier. Les soldats murmuraient hautement.
Les représentants du peuple suspendirent Séchelles et proposèrent le commandement à Kléber, qui le refusa, puis à Chablos, le plus vieux général de l'armée, qui l'accepta. Pendant ce temps, les Vendéens arrêtés à Laval, quoique débarrassés de leurs adversaires, ne savaient quel parti prendre. Entre tous ceux qui se présentaient, ils choisirent le plan qui, en les rapprochant de la côte, leur permettait de recevoir des secours des Anglais. Ils se dirigèrent vers le département de la Manche.
Leur armée s'était recrutée d'un grand nombre de combattants à Laval et à Mayenne. « L'esprit public, dit le général Turreau dans ses Mémoires, y était perdu, et, d'ailleurs, le prince de Talmont y avait la plus grande influence. Je me suis assuré sur les lieux qu'a parcourus cette armée des causes dé son accroissement progressif : je les ai trouvées dans le recrutement volontaire et forcé qu'elle a fait depuis Varades, Ancenis, Oudon, et autres points sur le rivage de la Loire, jusqu'à son arrivée à Laval, où le recrutement fut généralement spontané. »
Cependant, quelques jours plus tard, vaincus dans le nord par Kléber, Marceau et Westermann, les Vendéens, diminués des deux tiers, se rabattirent sur le département de la Mayenne, traversèrent de- nouveau Laval sans s'y arrêter ; ils devaient être écrasés au Mans le 23 décembre suivant. Ils s'y étaient abondamment pourvus de tout ce qui leur était nécessaire par un moyen emprunté à la Révolution elle-même, en créant pour neuf cent mille livres tournois de bons hypothéqués sur le trésor royal et remboursables à la paix ; ordre fut intimé aux Lavalois d'accepter ce papier en échange de leurs marchandises. L'armée vendéenne, bien approvisionnée, se mit en marche vers le département de la Manche.
Après ce désastre, le prince de Talmont, irrité de l'ingratitude des siens qui lui refusent le commandement des derniers débris de l'armée, les quitte, et, déguisé en meunier, errant de village en village, il se dirigeait vers Laval, lorsqu'il fut arrêté à Bazouges par une patrouille de la garde nationale. Il mourut sur l'échafaud, à Laval, le 28 janvier 1794.
Cependant la guerre civile se ranima bientôt sous une autre forme. Les quatre frères Cottereau, dits Chouan, du département de la Mayenne, donnèrent leur nom à la chouannerie. « Les chouans, dit M. Thiers, ne formaient pas ; comme les Vendéens, des rassemblements nombreux, capables de tenir la campagne ; ils marchaient en troupes de trente ou quarante, arrêtaient les courriers, les voitures publiques, assassinaient les juges de paix, les maires, les fonctionnaires républicains, et surtout les acquéreurs des biens nationaux.
« Quant à ceux qui étaient non pas acquéreurs, mais fermiers de ces biens, ils se rendaient chez eux, et se faisaient payer le prix du fermage. Ils avaient ordinairement le soin de détruire les ponts, de briser les routes, de couper l'essieu des charrettes, pour empêcher le transport des subsistances dans les villes. Ils faisaient des menaces terribles à ceux qui apportaient leurs denrées dans les marchés, et ils exécutaient ces menaces en pillant et incendiant leurs propriétés. Ne pouvant pas occuper militairement le pays, leur but évident était de le bouleverser, en empêchant les citoyens d'accepter aucune fonction de la République, en punissant l'acquisition des biens nationaux et en affamant les villes. Moins réunis, moins forts que les Vendéens, ils étaient cependant plus redoutables, et méritaient véritablement le nom de brigands. »
Le département de la Mayenne était très bien disposé pour cette guerre de partisans : ce terrain inégal, coupé d'un grand nombre de ruisseaux, de ravins, de haies bordant les chemins, formés d'un talus couvert de buissons et protégé par un fossé, offre un grand nombre d'arbres, chênes, hêtres, châtaigniers, dont on a coupé la tige à une certaine hauteur, et dont le tronc fort gros se creuse par en haut. On les nomme émousse. Les chouans y cachaient leurs armes et leurs provisions, et s'y cachaient souvent eux-mêmes. Dans un des cantons du département, bien des années après la guerre, on découvrit dans un de ces arbres que l'on abattait le squelette d'un chouan qui était venu y mourir. Son fusil était placé à côté de lui, et entre les doigts du squelette se trouvait encore un chapelet.
Aubert-Duhayet, après s'être entendu à Laval avec le général Hoche, se mit à la tête d'une colonne mobile, et par son activité, ses courses incessantes, lassa bientôt les chouans. Le vicomte de Cepeaux, qui commandait une des troupes les plus nombreuses, fut contraint de déposer les armes ; deux mille fusils furent remis et apportés à Laval. Plus tard la chouannerie recommença, et le comte de Beaumont, un des chefs des chouans, battit près de Laval un détachement de troupes de ligne et de garde nationale. Mais, défait par le général Chabot, il fit sa soumission au gouvernement consulaire.
Ce département fut encore agité en 1832, lors de la descente de la duchesse de Berry dans la Vendée. Des rencontres eurent lieu entre les chouans et les soldats sur quelques points du département, entre autres à La Gravelle, près de Laval. Le département fut mis en état de siège, et la tranquillité ne tarda pas à s'y rétablir.
Depuis ces événements le département de la Mayenne avait joui d'une paix profonde quand la guerre de 1870-1871 vint la troubler. L'ennemi n'occupa que momentanément quelques points de son territoire ; il s'arrêta en réalité sur les confins, à Sillé-le-Guillaume, à Saint-Denis-d'Orgues et à Sablé-sur-Sarthe, dans le département de la Sarthe ; mais notre deuxième armée de la Loire, sous les ordres du général Chanzy, s'y rallia, après la bataille du Mans.
Après la perte de la bataille du Mans (11 janvier), il fallut se résigner à la retraite, qui fut favorisée par le brouillard. L'armée française s'était dérobée sans déroute ; mais elle laissait aux mains de l'ennemi 18 000 prisonniers et 20 canons ; la poursuite continua jusqu'à Laval.
Le 17 janvier, après avoir livré, le 14, des combats offensifs heureux aux troupes allemandes, à Saint-Jean-sur-Erve et à Sillé-le-Guillaume, l'armée du général Chanzy continua son mouvement et occupa des positions autour de Laval. Le 16e corps passe la Mayenne sur les ponts de la ville, se reliant avec la droite du 17e corps et protégeant les convois qui filent par la grande route du Mans, se plaçant à cheval sur la route et sur le chemin de fer de Laval à Vitré ; le 17e corps, derrière la rivière, dont il observe le cours jusqu'au pont de Montgiroux ; le 21e, sa gauche à la ville de Mayenne, sa droite à Contest, relié avec le 17e corps par sa cavalerie, le quartier général à Laval, la division de cavalerie du 17e corps en arrière des lignes.
Une fois encore, grâce à l'habile retraite de son chef, l'armée de la Loire était conservée à la France. Les Allemands rétrogradèrent. Toutefois, il fallait au général. Chanzy quelques semaines pour se refaire. L'armistice, conclu le 28 janvier, vint le surprendre et l'arrêter au milieu de sa réorganisation. Les pertes éprouvées par le département de la Mayenne durant cette désastreuse période se sont élevées au chiffre de 645 317 fr. 92.