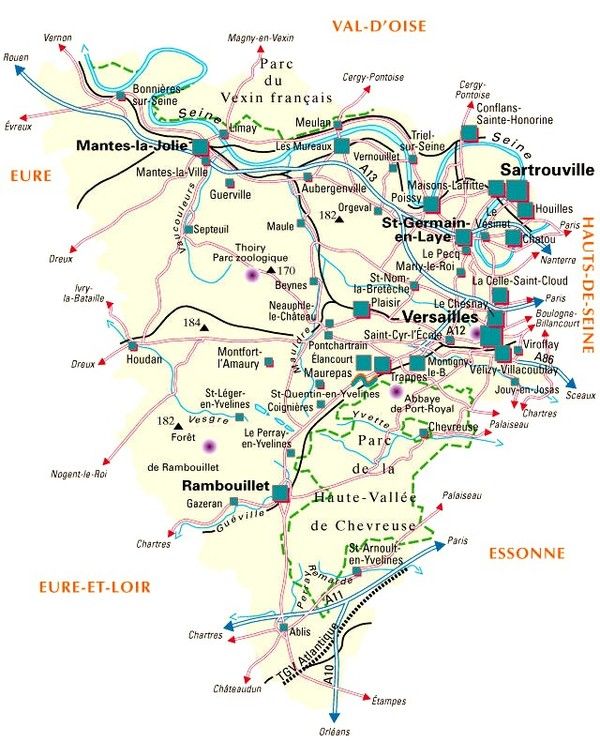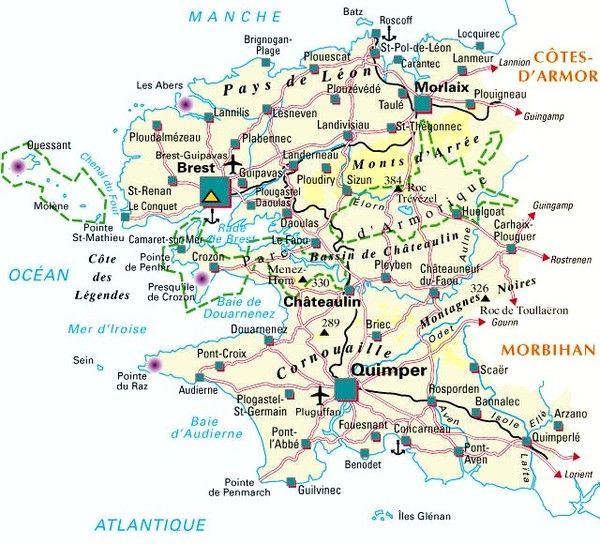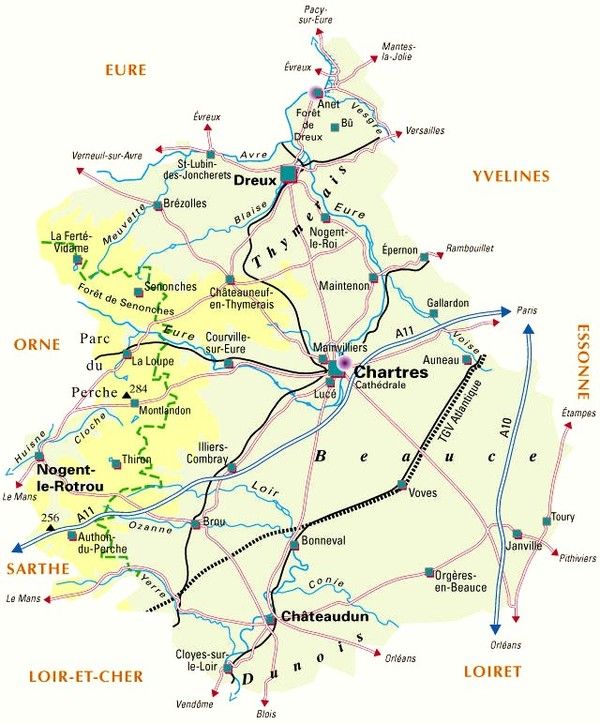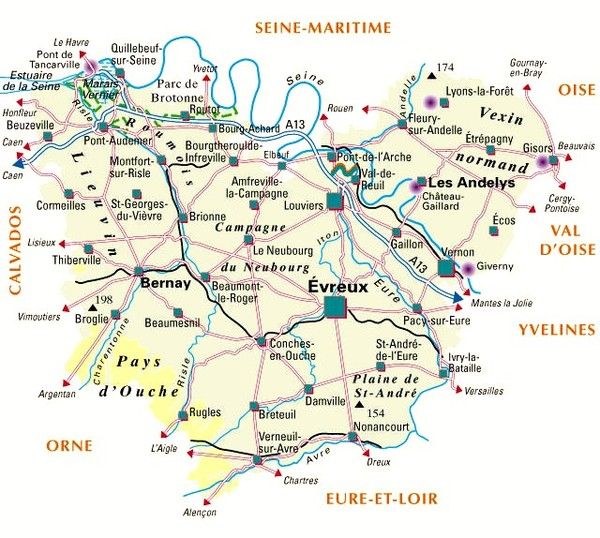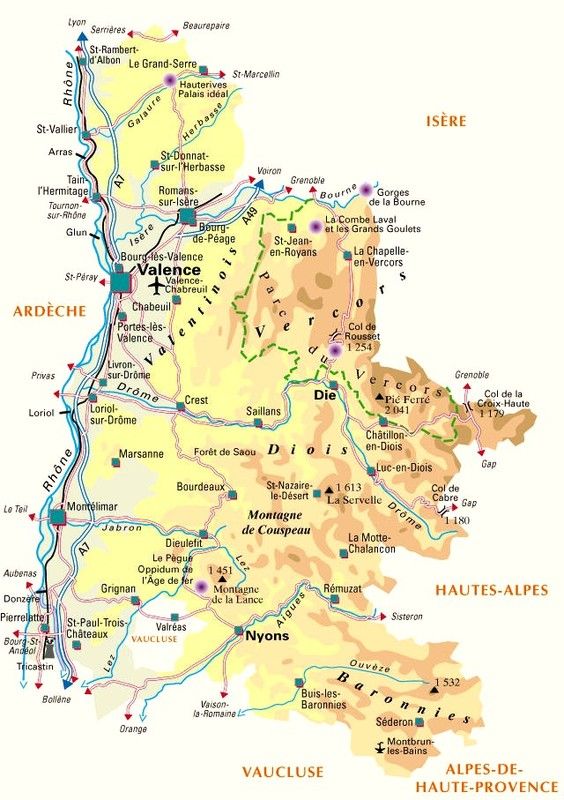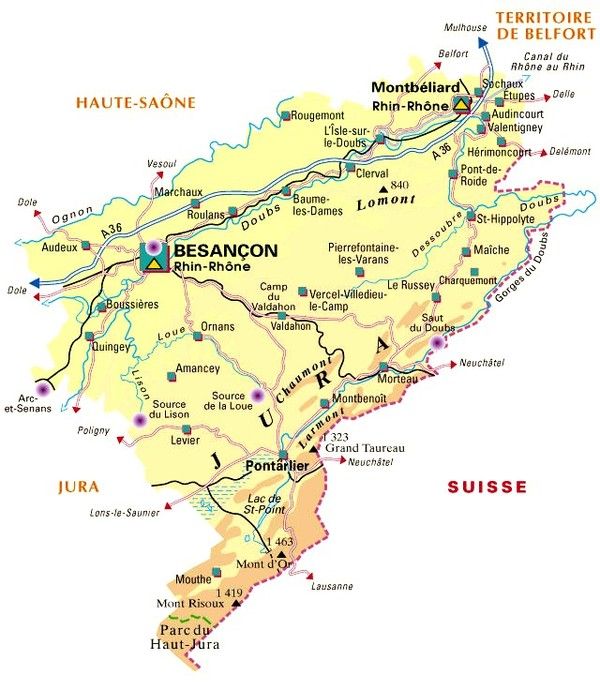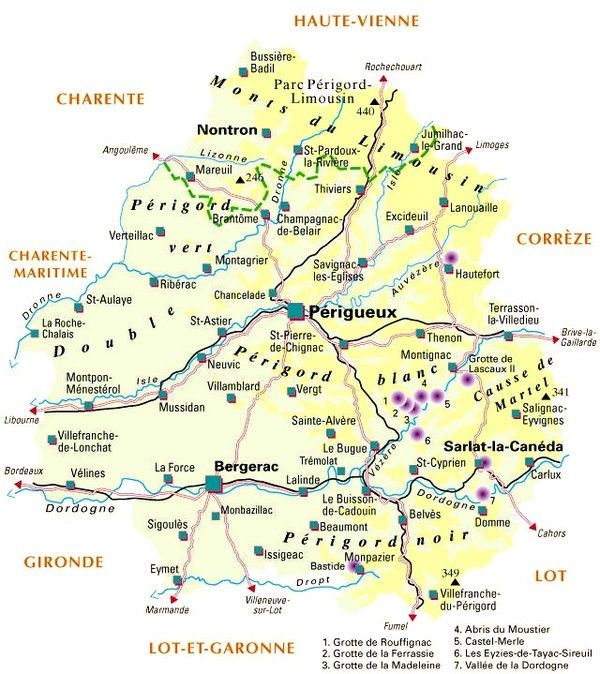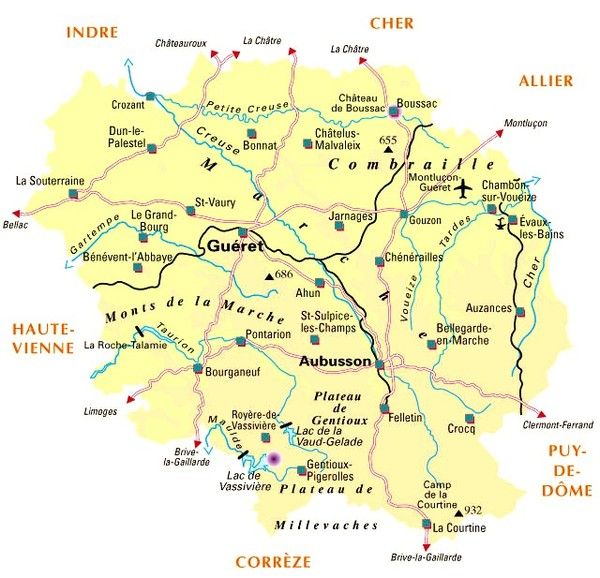Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Les départements-(histoire)-
Les départements-(histoire)-Yvelines - 78 -
Partie 2
Le canton de SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Les règnes suivants devaient être agités par les guerres de la Réforme. Les idées nouvelles pénétrèrent de bonne heure dans l'Ile-de-France ; elles avaient de nombreux adhérents dans le Vexin, où Calvin avait été accueilli par le seigneur d'Hargeville, dans son château situé près de Wy ou Joli-Village ; il y résida quelque temps, y composa une partie de ses ouvrages et prêcha lui-même sa doctrine dans les villages environnants, à Limay, Avernes, Arthies, Jambville et Gadancourt.
Henri Ier, François Il et Charles IX, pendant les premières années de son règne, passèrent alternativement de la rigueur à la tolérance dans leur attitude vis-à-vis des protestants. C'est dans le pays de Seine-et-Oise que se tinrent les premières réunions où les représentants des deux cultes travaillèrent à la pacification des esprits et a la conciliation des consciences ; les états généraux furent d'abord convoqués dans ce but à Saint-Germain ; puis, quelques années plus tard, en 1561, s'ouvrit le colloque de Poissy, fameux par les discussions violentes de Théodore de Bèze ; de nouvelles conférences eurent lieu l'année suivante à Saint-Germain sans amener de meilleurs résultats, et la guerre éclata tout à coup par le massacre de Vassy.
Qui ne se rappelle les sanglants épisodes de ces déplorables guerres, les tristes exploits de Coligny, de Condé et de Montmorency ; ce malheureux département en fut trop souvent le théâtre ; les points stratégiques que les partis ennemis se disputèrent avec le plus d'acharnement furent Corbeil, qui commande le cours de la haute Seine, et Étampes qui domine la ligne de communication entre la capitale et les provinces de l'ouest et du sud.
Cette dernière ville, prise par Condé, resta au pouvoir des protestants jusqu'au traité de paix de Longjumeau ; dans l'intervalle eut lieu la bataille de Dreux, gagnée par Montmorency, commandant l'armée catholique, et la bataille de Saint-Denis, qui amena la petite paix, trêve de six mois rompue par le massacre de la Saint-Barthélemy. Les fanatiques égorgeurs de Paris durent avoir des complices nombreux dans le département de Seine-et-Oise ; mais le rang et le nom des victimes parisiennes ont trop fait oublier les martyrs plus obscurs des campagnes environnantes.
La soif de vengeance que la trahison du Louvre alluma au coeur des huguenots rendit la guerre plus ardente et plus implacable encore. La tiédeur et l'hésitation que les zélés catholiques reprochaient à Henri III avaient grandi l'influence des Guises. L'ambition héréditaire de cette famille n'allait à rien moins qu'à s'emparer de la couronne, dont elle n'était plus séparée que. par un prince maladif et peu populaire, et par Henri de Béarn, chef du parti huguenot. L'assassinat du roi de France, frappé à Saint-Cloud par un jacobin fanatique nommé Jacques Clément, simplifiait encore la question : d'un côté, le droit et la légitimité avec Henri le huguenot ; de l'autre, l'usurpation avec les Guises, forts de leur valeur personnelle, de leur clientèle fanatisée et de la puissante organisation de la Ligue.
A l'exemple de Paris, l'Ile-de-France tenait en grande partie pour les Guises ; aussi fut-elle encore le théâtre des luttes qu'eut à soutenir Henri IV lorsqu'il vint jusque sous les murs de la capitale revendiquer ses droits à l'héritage de Henri III. La conversion du roi acheva l'oeuvre de pacification si glorieusement commencée par la victoire d'Ivry ; la sage administration de Sully, l'esprit de tolérance et d'économie du gouvernement, eurent bientôt cicatrisé les plaies faites par les dernières guerres ; l'Ile-de-France, dont le sol offre tant de ressources, releva toutes ses ruines ; la culture encouragée reprit un rapide essor ; Sully en donnait l'exemple, et, comme, propriétaire du château de Rosny, il fit de nombreuses plantations de mûriers ; Mantes, dont il était le gouverneur, vit s'élever dans ses murs une fabrique de draps ; le château de Saint-Germain fut reconstruit, celui d'Étampes restauré et le duché concédé à la belle Gabrielle d'Estrées.
Les bienfaits de ce règne furent répartis avec tant d'à propos et, d'intelligence, la pacification des esprits fut si complète, qu'à la mort du roi les désordres qui signalèrent la régence de Marie de Médicis n'affectèrent quo d'une façon peu sensible les pays de Seine-et-Oise.
L'administration de Richelieu consolida encore pour eux les bienfaits de celle de Sully. Nous n'avons à citer, sous le règne de Louis XIII, que la naissance à Saint-Germain de Louis XIV, en 1638, et, en 1641, l'assemblée générale que tint le clergé de France dans la ville de Mantes.
La haute noblesse, qui avait été obligée de courber la tête sous la main de fer de Richelieu, voyait à la mort de Louis XIll, dans la perspective d'une longue minorité, une occasion favorable pour revendiquer ses prétendus droits et reconquérir ses privilèges.
La confiance de la reine régente, abandonnée à un autre cardinal dévoué aux idées de Richelieu, son continuateur présumé, à un étranger, à Mazarin, souleva l'indignation des grands et dès princes ; l'opposition des parlements, suscitée par là noblesse, fut le prélude d'hostilités plus sérieuses ; les promesses des meneurs, les épigrammes des beaux diseurs, l'influence du clergé, parvinrent à entraîner les bourgeois de Paris dans cette non-elle Ligue.
Les frondeurs disputaient à la reine mère et au cardinal la personne du jeune roi ; la cour dut quitter Paris et se réfugier à Saint-Germain, sous la protection d'une armée de huit mille hommes ; de leur côté, les rebelles organisèrent leurs forces : le prince de Conti fut nommé généralissime. Les villes de Seine-et-Oise furent, comme toujours, les points qu'on se disputa le plus vivement ; Étampes, Corbeil, Saint-Cloud, Dourdan, dont la Fronde était maîtresse, furent d'abord repris par Condé : une paix de peu de durée fut la conséquence de ces premiers succès de l'armée royale ; une rupture, qui éclata entre la cour et Condé, donna à la lutte un caractère plus sérieux ; Turenne fut opposé par Mazarin à ce redoutable adversaire ; personne n'a oublié les exploits plus affligeants encore que brillants des deux illustres capitaines, ni le fameux combat du faubourg Saint-Antoine, où ils faillirent eux-mêmes en venir aux mains ; cette guerre sans motifs sérieux, et à laquelle devait mettre fin la majorité de Louis XIV, n'en causa pas moins de grands malheurs dans nos pays : Corbeil, Saint-Cloud, Palaiseau, Mantes, furent victimes de l'indiscipline. des soldats des deux armées, qui, manquant de vêtements et de solde, pillaient et rançonnaient les villes et les campagnes. Enfin Paris, éclairé sur le but réel des princes et des organisateurs de la Fronde, se détacha de leur cause et ouvrit ses portes au roi, qui y fit son entrée en 1653.
Les pays de Seine-et-Oise, qui avaient eu une si large part dans tous les revers et toutes les épreuves de la royauté, participèrent plus que toute autre province aux splendeurs du triomphe : le règne de Louis XIV, est raconté par toutes les magnificences des châteaux dont il nous reste à faire l'histoire. La guerre, portée au delà de nos frontières, n'ensanglanta plus les campagnes de l'Ile-de-France ; et Versailles a gardé le glorieux souvenir des années de paix.
Il en est de même pour le règne des princes qui se sont succédé jusqu'à nos jours sur le trône de France ; l'importance des châteaux royaux et des résidences princières rattache désormais à leurs lambris le souvenir des faits principaux qui seuls sont du domaine de cette notice. C'est à Louveciennes et à Marly que nous étudierons Louis XV ; pour son malheureux successeur, Trianon complètera Versailles, Saint-Cloud nous dira le 18 brumaire, et les douloureux mystères de la Malmaison nous conduiront des gloires du premier Empire aux désastres de l'invasion.
Ajoutons que, depuis 1789, l'immense développement de Paris a absorbé toute importance politique, toute originalité saillante dans Seine-et-Oise qui l'entoure ; ce qui nous reste à dire du département n'est plus guère qu'une oeuvre de statistique.
Jusqu'à la Révolution de 1789, il était compris dans le gouvernement de l'lle-de-France ; on y comptait, sous le rapport judiciaire, les prévôtés royales de Poissy, Montlhéry, Corbeil, Arpajon, Gonesse, qui toutes relevaient des prévôté et. vicomté de Paris ; puis venaient : le bailliage et présidial de Mantes, les bailliages simples de Montfort-l'Amaury et d'Étampes, les bailliage et prévôté de Pontoise, etc. Le ressort de ces juridictions était plus ou moins étendu. La coutume de Paris les régissait presque toutes, à l'exception des paroisses du bailliage de Pontoise, qui suivaient les unes la coutume de Senlis et les autres celle du Vexin français.
Sous le rapport financier, le département était de la généralité de Paris, et on y comptait les élections d'Étampes, Mantes, Montfort-l'Amaury et Pontoise. Corbeil, Versailles, Saint-Germain et leurs dépendances étalent de l'élection de Paris. Des gouverneurs royaux commandaient dans les principales villes qui étaient du domaine de la couronne.
Le département, formé en 1790 par l'Assemblée nationale dans un sentiment de défiance contre Paris qu'elle craignait de rendre trop redoutable au reste de la France, fut alors divisé en 9 districts administratifs et judiciaires : Versailles, Montlhéry, Mantes, Pontoise, Dourdan, Montfort-l'Amaury, Étampes, Corbeil et Gonesse. L'organisation impériale de 1804, qui a prévalu jusqu'à nos jours, le partagea en 5 arrondissements : Versailles, chef-lieu ; Corbeil, Étampes, Mantes et Pontoise.
En 1811, Rambouillet fut érigé en 6e arrondissement, pour la formation duquel on prit sur ceux d'Étampes et de Versailles ; ces 6 arrondissements se subdivisent en 36 cantons, comprenant chacun en moyenne 19 communes. Le Concordat de 1801 a établi a Versailles un évêché, qui étend sa juridiction sur tout le département.
Il serait difficile de caractériser la population de Seine-et-Oise ; la diversité de race de ses anciens habitants a été remplacée par la variété des travaux, la différence des positions, l'inégalité des fortunes ; de même que le sol se prête à tous les genres de culture, le génie des habitants s'est plié à toute espèce d'industrie : l'usine y touche à là ferme, la chaumière du vigneron au château du banquier millionnaire.
Seine-et-Oise est à la fois, et le jardin de Paris et là succursale de ses manufactures ; le campagnard ne travaille qu'en vue de Paris, qui consomme et qui achète ; il y a toujours au bout des rêves du Parisien un point des riants paysages de l'Ile-de-France, comme but de sa promenade des dimanches, comme retraite promise aux loisirs de sa vieillesse ; ces rapports étroits, intimes, ce frottement continuel, ont donné au paysan de Seine-et-Oise un caractère qui n'est déjà plus celui du campagnard et qui cependant n'est pas encore celui du citadin ; ce type nouveau, que la rapidité des communications développe de jour en jour, mériterait une étude plus approfondie que ne le comporte le cadre de cet ouvrage ; il nous appartenait seulement d'en signaler l'apparition, qui n'est nulle part plus. sensible que dans cette contrée.
Que nous reste-t-il à dire après tout ce qui a été écrit sur les sites délicieux de ce pays ? Quel est celui de ses bois, de ses coteaux ou de ses vallons qui n'ait eu ses peintres, ses historiens, ses poètes ? A ces tableaux, qui sont encore devant tous les yeux, à ces descriptions qui sont dans toutes les mémoires, nous n'ajouterons qu'un mot, c'est que ni l'inspiration des uns ni l'enthousiasme des autres n'a exagéré les gracieuses merveilles de la réalité; c'est que, malgré tout ce qu'ont pu ajouter aux délices du paysage les fantaisies du luxe, les ressources de l'art, les magnificences des rois, on peut dire que pour lui la nature avait fait plus encore.
Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département de Seine-et-Oise fut, parmi les départements qui subirent alors les douleurs et les hontes de l'invasion, un de ceux qui eurent le plus à souffrir. La situation de son territoire, qui enveloppe Paris de tous les côtés, l'exposait plus que tout autre au danger ; en effet, aussitôt après la lamentable défaite à Sedan, dès le 4 septembre, la capitale de la France devenait l'objectif des Allemands : la IIIe armée, celle du prince royal de Prusse, moins les Bavarois, se mettait en marche dans cette direction.
Le 12 septembre, deux éclaireurs sont aperçus à Ablon, dans le canton de Longjumeau; le 15, des cavaliers se montrent à Draveil; le 16, dès le matin, des troupes de toutes armes, venues de Lagny et de Brie-Comte-Robert, inondent le canton de Boissy-Saint-Léger et se massent dans la plaine de Vigneux. A ce moment, Paris était prêt d'être investi : la IIIe et la IVe armée allemandes sont à deux marches de la capitale, dans la direction du nord-est et du nord-ouest : la 5e et la 6e division de cavalerie, chargées d'éclairer les colonnes, s'avancent vers Pontoise; le même jour, les Prussiens occupent la voie ferrée entre Ablon et Athis, puis ils descendent vers Mongeron.
Le 17, un pont de bateaux est jeté sur la Seine, près de Villeneuve-Saint-Georges, et une avant-garde de 1 000 hommes, appartenant au XIe corps bavarois, se présente dans le faubourg de Corbeil. Le 18 septembre, la 6e division de cavalerie, commandée par le duc de Mecklembourg (IVe armée) marche sur Poissy et y franchit la Seine; la 5e division de cavalerie occupe Pontoise ; le IVe corps atteint Le Mesnil-Amelot, entre Dammartin et Saint-Denis ; la brigade des uhlans de la garde attachée à ce corps marche sur Argenteuil, entre Saint-Denis et Pontoise; la garde se porte sur Thieux, entre Claye et Dammartin. Le XIIe corps (prince de Saxe) s'établit à Claye, en avant de Meaux et de Dammartin, tandis que la 2e division de cavalerie de la IIIe armée, celle du prince royal de Prusse, se dirige sur Sarlay, au sud de Paris, occupe la route qui y mène et se lie par Chevreuse avec la cavalerie du prince de Saxe ; le Ve corps de la même armée passe la Seine a Villeneuve-Saint-Georges (grande route de Melun à Paris) et s'avance jusqu'à Palaiseau ; le IIe corps bavarois marche sur Longjumeau, détachant une brigade à Montlhéry ; le VIe corps occupe Villeneuve-Saint-Georges et Brunoy.
Le quartier général de l'armée de la Meuse (ive armée) est à Saint-Souplet, entre Meaux et Dammartin, près de l'embranchement des routes, sur Paris, de Meaux, Nanteuil et Senlis. Celui de l'armée du prince royal (IIIe armée) s'établit à Saint-Germainlès-Corbeil, a la porte de Corbeil.
Le 19 septembre, le blocus est sur le point d'être complété par les deux armées allemandes; le seul côté moins fortement investi est l'espace compris en avant des forts de l'Est : la 6e division de cavalerie marche sur Chevreuse, la 5e sur Poissy; le IVe corps est à Argenteuil, la garde en avant de Pontoise ; le XIIe corps contourne Saint-Denis ; la 2e division de cavalerie, vers Chevreuse et Saclay, relie la droite de la lVe armée avec la gauche de la IIIe ; le Ve corps est a Versailles même et pousse ses avant-postes jusqu'à Sèvres et Saint-Cloud ; le IIe corps bavarois est près de l'Hay, vers Meudon jusqu'à la Bièvre ; le VIe corps est entre la Seine et la Bièvre, avec une brigade et deux escadrons sur la rive droite du fleuve et de forts avant-postes entre la Marne et la Seine.
Le 21 septembre, l'ennemi complète l'investissement de Paris sur un périmètre extérieur de près de 80 kilomètres ; il établit des communications télégraphiques directes reliant tous les quartiers généraux des divers corps d'armée par un fil électrique qui n'a pas moins de 150 kilomètres de développement.
A la date du 22 septembre, écrit Gustave Desjardins, le département de Seine-et-Oise avait sur son territoire environ 216 bataillons d'infanterie, 244 escadrons de cavalerie avec 774 canons. L'investissement de Paris était fait par 216 bataillons et 140 escadrons. Cet effectif varia peu durant le siège. Le Ier corps bavarois et la 22e division du XIe corps prussien furent détachés, le 6 octobre, et remplacés par le XIe corps prussien envoyé dans les premiers jours de novembre. Le IIe corps marcha vers l'est le 3 janvier ; mais le Ier corps bavarois revint occuper le canton de Boissy-Saint-Léger.
A l'extrême gauche de la Ille armée, la landwehr de la garde prussienne, rendue disponible par la prise de Strasbourg, avait pris position à Chatou, donnant la main à la IVe armée. L'ennemi put prendre ses positions sans rencontrer pour ainsi dire de résistance. Quelques échauffourées eurent lieu çà et là, sans autre résultat que de motiver les pillages et les exécutions sommaires.
On conçoit d'ailleurs qu'une pareille concentration de troupes sur un même point n'ait pu se faire sans un grand dommage et de grandes vexations pour les habitants, auxquels les menaces, les coups, la mort même ne furent pas épargnés. Les villes et les villages furent submergés par ce flot envahisseur qui ne cessait de grossir. Les soldats, dit Gustave Desjardins, pénètrent avec effraction dans les maisons fermées, s'installent par groupes, arrachent les habitants de leur lit.
A Verrières-le-Buisson, ils mettent leurs chevaux dans les boutiques et les rez-de-chaussée, pillent en masse les marchands de comestibles. Corbeil est écrasé : 90 000 hommes y passent en trois jours. Tout est envahi : magasins, maisons, églises ; dans le tribunal s'installe une boucherie.
A Versailles, les Allemands n'osent pas entrer dans les casernes qu'ils supposent minées et occupent les promenades. En un clin d'oeil, la ville du grand roi se transforme en campement de horde germanique. On n'entend plus que le bruit des patrouilles. et les cris rauques des sentinelles. Le 20 septembre, Saint-Germain est menacé de bombardement ; cinq bombes sont même lancées du Pecq sur cette ville.
Les faits militaires ont été peu nombreux dans le département de Seine-et-Oise, et cela se conçoit facilement, puisque l'armée régulière n'existait pas ; les gardes nationales étaient a peine armées et mal instruites ; les francs-tireurs seuls opposèrent de la résistance et quelquefois avec succès. Dans son expédition vers Mantes, la 5e division de cavalerie prussienne rencontre, après avoir brûlé Mézières, des francs-tireurs parisiens. Deux bataillons, sous les ordres du commandant de Faybel, traversent . Mantes, chassent les patrouilles prussiennes ; mais ils sont obligés de se retirer en combattant, par Écquevilly et Mareil-sur-Mauldre, sur Mantes, et de là à Vernon, devant des forces supérieures.
Dans l'arrondissement de Rambouillet, des paysans s'organisent en guérillas. Pour venir à bout de la résistance, le général de la 6e division de cavalerie prussienne ordonna une battue dans ce pays couvert de bois, et ses soldats se livrèrent à d'indignes cruautés contre des habitants inoffensifs.
Le 8 octobre, les Français attaquent les Prussiens et les Bavarois barricadés dans Ablis, près de Dourdan, et font, après une demi-heure de combat, 70 hussards prisonniers. Le lendemain, après le départ des francs-tireurs, une colonne ennemie envahit la commune, brise les portes et les fenêtres et la livre au pillage. A La Montignotte, près de Milly, le 28 septembre, quelques francs-tireurs unis à des gardes nationaux font éprouver des pertes sensibles à une colonne de 800 hommes envoyée de Melun pour châtier Milly.
A Parmain, commune de Jouy-le-Comte, dans le canton de L'Isle-Adam, des volontaires accourus de Pontoise, de Valmondois, de Méry, de Jouy-le-Comte et d'autres localités environnantes, unis à quelques francs-tireurs de la légion Mocquart, se barricadent et s'apprêtent a défendre énergiquement le passage de l'Oise. Le 27 septembre, à 10 heures du matin, quelques centaines de Prussiens, avec quatre pièces d'artillerie, essayent de s'emparer des barricades. Ne pouvant y parvenir, ils s'en prennent à la population de L'Isle-Adam. Le 29, à midi, 4 500 Prussiens sont dirigés sur Parmain, et une partie ayant réussi à passer l'Oise à Mours, tourne le village que les francs-tireurs ont le temps d'évacuer. Le 30, les Prussiens bombardaient Nesles et brûlaient Parmain.
Le chapitre des réquisitions exigées serait interminable, s'il fallait tout relater. Contentons-nous d'un court résumé. Huit jours après leur entrée dans le département, il n'était pas un village qui n'eût reçu la visite des Prussiens. On voyait d'abord paraître trois ou quatre cavaliers, sondant de l'œil tous les recoins du pays ; au premier bruit suspect, ils détalent au galop comme des daims effarouchés. Semble-t-on avoir peur, ils deviennent plus hardis, commencent par briser le télégraphe et intiment avec arrogance aux habitants l'ordre de combler les tranchées pratiquées dans les routes ; si une foule irritée les entoure, ils montrent beaucoup de modération et tâchent de se tirer de ce mauvais pas sans faire usage de leurs armes ; mais ils reviennent un instant après menaçants, soutenus par des forces imposantes. lis savent que leurs chefs veillent sur eux avec sollicitude, leur porteront secours à temps et feront payer cher le moindre attentat envers leurs personnes.
A Dourdan, on s'ameute contre des hussards ; un homme porte la main à la bride du cheval d'un officier. Le lendemain, un parlementaire signifie a la municipalité, que si pareille offense se renouvelle, la ville sera livrée aux flammes et les habitants pendus jusqu'au plus petit enfant, comme dans les guerres bibliques. A Poissy, le général Schmidt fait savoir que si la ville ne lui rend pas deux dragons pris par la garde nationale, elle sera bombardée et frappée d'une contribution de 200 000 francs...
Dans les campagnes, l'ennemi se contente de provisions de bouche ; dans les villes, il demande des couvertures, des matelas, des balais, des gants, des semelles, des fournitures de bureau, des objets de toilette, de l'amidon, du cirage, des bandages herniaires, des peaux de sanglier et de chevreuil, tout ce que sa fantaisie imagine. Le major de Colomb, commandant de place à Corbeil, entendant qualifier de riche en cuirs un paysan dont le langage est orné de liaisons superflues, saute sur une plume et s'empresse de libeller un ordre de livrer 60 peaux pour basaner les culottes de ses dragons : Ab uno disce omnes.
Certains officiers affectent une politesse exagérée, suivie aussitôt d'une menace froide ; d'autres, en arrivant, mettent le revolver au poing et parlent de tout tuer et brûler si l'on n'obéit sur-le-champ. A la plus petite objection, coups de cravache et coups de sabre pleuvent comme grêle... On n'a rien de mieux à faire que d'obéir et de les gorger de vin et d'avoine...
Pour les héros de l'Allemagne moderne, comme pour leurs aïeux les reîtres du XVIe siècle, la guerre est une franche lippée. Le majordome, préparant à Versailles les logements de la cour du roi de Prusse, veut contraindre le maire à violer le domicile d'un absent qui a dans sa cave des vins dignes de la taule de son maître. Dès les premiers jours d'octobre, ils sont entièrement nos maîtres ; la résistance a été partout comprimée avec une sauvage rigueur, et la terreur prussienne règne dans le département. On annonce l'arrivée à Versailles de Guillaume le Victorieux.
On pouvait espérer que l'arrivée du roi de Prusse mettrait fin aux exactions, aux réquisitions et aux vexations. M. de Brauchitsch, nommé préfet prussien de Seine-et-Oise, présenta, en effet, au conseil municipal de Versailles, convoqué pour entendre ses communications, le plus séduisant tableau des intentions de son auguste souverain. Mais ce n'était là qu'une déclaration platonique ; aux exactions et aux violences brutales des soldats allaient succéder des exactions et des violences hypocrites.
Dans son livre intitulé Versailles pendant l'occupation, E. Delérot écrit : « Nous avons pu juger par expérience comment la Prusse contemporaine entendait l'administration civile des pays occupés : le préfet de Brauchitsch est, à ce titre, un échantillon curieux de cupidité à étudier. Ses actes et ceux des subordonnés placés sous ses ordres sont d'autant plus intéressants qu'ils s'accomplissaient sous les yeux du roi, par conséquent avec son assentiment tacite. »
Le préfet prussien essaya d'abord de se servir de l'organisation française ; mais il se heurta au refus ou au mauvais vouloir des anciens employés qui, pour la plupart, ne voulurent pas reprendre leurs fonctions et s'y dérobèrent même par la fuite. Pour avoir des huissiers, le préfet dut les faire empoigner par les gendarmes. Ceci se passait à Versailles et fut d'un salutaire effet pour le reste du département. A Corbeil seulement, il fut possible aux Allemands de réorganiser le personnel de la sous-préfecture.
Devant la mauvaise volonté générale, le préfet prussien du département de Seine-et-Oise réorganisa l'administration sur la base du canton. Le maire du chef-lieu, investi de tous les pouvoirs, était chargé des communications avec l'autorité centrale, de la réparation des chemins, du service de la poste, de la perception des contributions. Le refus absolu était à peu près impossible ; car le préfet terminait son injonction par ces mots, dans le cas de non-acceptation : « Je me verrai obligé, contre mon gré, à en recourir à la force ; ce qui serait toujours regrettable. »
Les exactions, bien entendu, continuèrent de plus belle. Au mois de janvier 1871, M. de Brauchitsch « s'avisa que la perception des contributions indirectes était interrompue et voulut la remplacer. II ajouta à l'impôt foncier un supplément de 950 pour 100 ; mais il n'eut pas le temps d'en poursuivre partout le recouvrement ; toutefois, il extorqua ainsi, dans l'arrondissement de Versailles, près d'un million et demi. En arrivant, les Prussiens avaient frappé le département d'une contribution extraordinaire d'un million. D'autres exigences furent encore présentées ; elles prirent ; celles-la, la forme d'un emprunt forcé qui fournit 1 101 279 fr. »
Nous avons dit que, lors de son installation, le préfet prussien avait promis formellement que les réquisitions cesseraient ou du moins seraient payées. L'armée d'occupation parut ignorer complètement ces engagements, et la population de Seine-et-Oise ne trouva dans la présence de M. de Brauchistch qu'une aggravation à ses maux : elle dut payer l'impôt et fournir les réquisitions.
Les vexations et les réquisitions ne cessèrent même pas durant l'armistice, et le département de Seine-et-Oise ne fut délivré des hordes germaniques que le 12 mars 1871. Les pertes qu'il supporta s'élevèrent à la somme énorme de 146 500 930 fr. 12, la plus considérable après le département de la Seine.
Les départements-(histoire)- Yvelines - 78 -
Partie 1
C'est en 1968 que fut officiellement constitué le département des Yvelines, composé exclusivement de communes appartenant à l'ancien département de la Seine-et-Oise.
Le département de Seine-et-Oise ; compris autrefois dans la province de l'Ile-de-France, n'a jamais eu plus d'unité que nous ne lui en voyons aujourd'hui ; bien avant les développements qu'a pris Paris comme capitale de la France, avant même que l'ancienne Lutèce eût acquis l'importance que lui donna la domination romaine, les habitants des contrées qui nous occupent étaient divisés en nations distinctes et souvent hostiles les unes aux autres.
Les rives de la Seine étaient occupées par les Parisii, peuplade adonnée à la navigation ; les Vellocasses étaient possesseurs de la partie septentrionale du département, qui s'étend entre l'Oise et la Seine, et qui fit plus tard partie du Vexin ; l'ouest appartenait aux Carnutes, dans un espace compris entre l'emplacement actuel de Mantes et le canton de Rambouillet ; enfin, toute la région méridionale, c'est-à-dire le territoire des arrondissements d'Étampes et de Corbeil, avait pour maîtres les Sénonais. Les immenses forêts qui s'étendaient à l'ouest protégeaient les mystères religieux des druides ; aussi leurs principaux collèges étaient-ils dans le pays des Carnutes. César rend hommage au caractère belliqueux de ces habitants de la Gaule celtique ; contre eux, il eut plus souvent recours aux ruses de la politique qu'à la force des armes.
Quand Vercingétorix fit appel au patriotisme gaulois, Carnutes, Sénonais et Parisii furent des plus ardents à se ranger sous ses ordres, et le département de Seine-et-Oise put compter, selon les récits de César lui-même, vingt mille de ses soldats parmi les premiers martyrs de l'indépendance nationale. La victoire définitive des Romains eut pour conséquence l'effacement des nationalités entre lesquelles se partageait le territoire ; de nouvelles délimitations furent tracées, de nouvelles dénominations furent imposées : jusqu'au IVe siècle, Lutèce et tout le territoire actuel de Seine-et-Oise firent partie de la quatrième Lyonnaise ou Sénonie.
Sur ce sol si profondément remué depuis, l'établissement de la domination romaine a laissé peu de traces ; nous savons cependant que des routes furent ouvertes pour le passage des légions ; Paris, que sa position fit adopter par les vainqueurs comme un des centres de leur gouvernement, a pu conserver quelques ruines des monuments de cette époque ; mais, dans le pays environnant, couvert de forêts profondes, habité par des populations aguerries et menaçantes, il convenait peu à la politique romaine d'encourager le développement des anciens bourgs ou l'établissement de villes nouvelles dont l'importance aurait réveillé les souvenirs et les espérances des nationalités vaincues.
Sur un sol aussi remué et fouillé que l'a été celui de Seine-et-Oise, on ne peut guère compter sur la conservation des monuments mégalithiques, celtiques et gallo-romains : Cependant on rencontre encore quelques-uns de ces monuments. On connaît, par exemple, les. dolmens de Meudon, les menhirs de Bruyères-le-Châtel ; le nom du village de Pierrefitte rappelle le souvenir d'un de ces monuments, et, près de Chars-en-Vexin, le docteur Bonnejoy a sauvé de la mise en moellons une autre pierre connue autrefois sous le nom de la Pierre qui tourne.
A Gency, on montre une pierre levée que l'on appelle dans le pays le Palet de Gargantua, la Pierre du Fouet ou la Pierre qui pousse, et, comme à la plupart des monuments de ce genre, la légende ne manque pas. A Jouy-le-Moutier, on en montre une autre. A Bougival et à La Celle-Saint-Cloud, à Marcoussis, sur la lisière du bois des Charmeaux, on a trouvé des débris de poteries et de tuiles de l'époque gallo-romaine.
Aux Mureaux, dans le canton de Meulan, Guégan a retrouvé des traces du séjour des populations préhistoriques. Au Pecq, à Marly, au lieu dit la Tour aux Païens, on a mis au jour des sépultures, des armes en silex, des poteries. Le dragages de la Seine, du Pecq à Conflans-Sainte-Honorine, a aussi fourni son contingent d'antiquités celtiques. A L'Étang-la-Ville, on a mis au jour, en 1878, un dolmen qui renfermait de nombreux ossements : on peut évaluer a cent cinquante le nombre des individus qui y avaient été enterrés.
A Mareil-Marly, dans la tranchée du chemin de fer de Grande-Ceinture, on a trouvé des vestiges romains qui font supposer que ce lieu était un poste de surveillance pour maintenir en respect les populations gauloises. Enfin, en pratiquant une tranchée pour le petit chemin de fer d'intérêt local de Beaumont (Seine-et-Oise) à Neuilly-en-Thelle (Oise), Guégan a trouvé, sur le territoire de la commune de Baines, un cimetière celto-gaulois, gallo-romain et mérovingien.
C'est dans les annales du christianisme qu'il faut chercher les seuls faits importants à recueillir pour l'histoire des quatre premiers siècles de notre ère. Saint Denis fut le premier des apôtres qui pénétra dans le pays des Parisii ; mais la date de son arrivée est incertaine et les détails de son martyre sont plutôt une sainte légende qu'une réalité historique. On cite, après lui, saint Nicaise, mort comme lui victime de son zèle apostolique ; quoique ses prédications datent du commencement du IVe siècle, certains auteurs disent qu'il fut martyrisé à Vadiniacum, aujourd'hui Gasny-sur-Epte ; d'autres assignent, comme théâtre a cet événement, Meulan, qui a choisi ce saint pour patron.
La piété des nouveaux chrétiens nous aurait conservé sans doute de précieux documents sur cette époque de transformation sociale, si l'invasion des barbares eût bouleversé moins profondément cette contrée de Lutèce où les proconsuls romains et l'empereur Julien en personne firent leurs dernières tentatives de résistance. C'est par la nuit et le silence qu'elles ont laissés derrière elles qu'on peut juger les ravages de ces invasions, qui passèrent sur la Gaule celtique comme un torrent.
Quelques points oubliés du territoire étaient encore restés sous la domination des Romains ; Clovis, à la tête des Francs, s'avance du nord sur la Gaule ravagée ; sa conversion à la foi nouvelle achève l'oeuvre de la conquête ; le flot des premiers barbares s'est écoulé ; rien ne subsiste plus de la puissance romaine ; un nouvel empire se fonde entre la Meuse et la Loire. Mais, à la mort du fondateur, déjà le nouvel empire se démembre, et notre département échoit en partie, avec la royauté de Paris, à Childebert, un des quatre fils de Clovis.
C'est de cette époque que commence à dater la notoriété historique de la plupart des villes de l'ancienne Ile-de-France ; mais hélas ! cette gloire fut chèrement payée : les divisions arbitraires des territoires, les rivalités des souverains furent, pendant les temps mérovingiens, la cause de guerres incessantes ; l'Ile-de-France semblait condamnée à être le champ clos où Neustrie et Austrasie venaient vider leurs sanglantes querelles.
Cependant, à côté du spectacle affligeant qu'offraient les déchirements des jeunes monarchies, l'histoire nous montre une puissance nouvelle grandissant dans le silence et la paix, s'enrichissant des présents du vainqueur et des dépouilles du vaincu : c'est la puissance des abbés ; dans leur ferveur de néophytes, les Mérovingiens avaient fondé et enrichi le monastère de Saint-Denis et celui de Saint-Germain-des-Prés ; l'exemple des maîtres avait été suivi par les leudes ou seigneurs ; au vine siècle, l'abbaye de Saint-Germain tenait en sa possession Palaiseau, Verrières, Jouy-en-Josas, La Celle-lès-Bordes, Gagny, Épinay-sur-Orge, La Celle-Saint-Cloud, Villeneuve-Saint-Georges, Mer-sang ; Le Coudray-sur-Seine, Maule et autres domaines de moindre importance ; et l'abbaye de Saint-Denis, maîtresse d'une grande partie du Vexin, était à la veille de voir inféodées ses pacifiques conquêtes, par un édit de Charlemagne, sous le titre de fendum sacrum sancti Dionysii.
Il faut reconnaître que, dans ces temps de barbarie, la domination ecclésiastique fut quelquefois moins dure pour le peuple que celle des leudes et .des rois, prenant à leurs vassaux leur sang dans la guerre, et le fruit de leur travail lorsqu'ils étaient en paix. Ce fut donc un bonheur pour cette époque que le prodigieux accroissement de puissance des abbayes de Saint-Germain et de Saint-Denis ; leurs domaines furent un refuge pour l'artisan des villes ou le laboureur, qui ailleurs ne trouvait pas même le repos dans la servitude.
Aucun document n'est parvenu jusqu'à nous concernant l'organisation administrative, sous les Romains, du pays dont nous retraçons brièvement l'histoire ; ce n'est que sous les Mérovingiens que nous retrouvons, à l'aide des chartes, les principales divisions administratives des pagi ou cantons. Le département de Seine-et-Oise était irrégulièrement composé : 1édeg; du grand pagus de Paris, subdivisé plus tard ; 2° du pagus Castrensis (de Châtres ou Arpajon), qui fut depuis le Hurepoix ; 3° du pagus de Poissy, autrement le Pincerais (Pinciacensis) ; 4° de celui de Madrie (Madriacensis), dont le chef-lieu était probablement Méré, près de Montfort-l'Amaury ; ces deux derniers étaient du diocèse de Chartres ; ajoutons-y le pagus Stampensis ou d'Étampes, au diocèse de Sens. Plusieurs de ces pagi devinrent des comtés au IXe siècle, et leurs possesseurs convertirent leurs dignités en fiefs, comme on le verra plus tard.
La grande époque de Charlemagne fut une ère de paix et de prospérité relative pour le pays de l'Ile-de-France ; l'empereur avait transporté sa capitale sur le Rhin, à Aix-la-Chapelle ; la haute direction des affaires publiques était confiée, dans l'intérieur du pays, à des inspecteurs impériaux, missi dominici ; sous leur surveillance, l'administration de l'Ile-de-France resta aux mains et sous l'influence des deux puissants abbés de Saint-Germain et de Saint-Denis.
La mort de Charlemagne jeta la France dans une période de guerre et d'anarchie que la faiblesse de Louis le Débonnaire et de ses successeurs ne put arrêter. Par suite du partage de l'empire, les pays de Seine-et-Oise furent dévolus à Charles le Chauve. La trêve accordée à ces malheureuses contrées n'avait point été de longue durée ; aux guerres intestines succèdent les invasions des Normands.
En 845, Épine est brûlée ; en 865, Mantes est pillée onze ans plus tard, l'ennemi remonte la Seine jusqu'à Meulan. A chaque invasion nouvelle, il pénètre plus au cœur du pays : Étampes ne doit son salut, en 885, qu'à la valeur du comte Eudes ; Pontoise, moins heureux, est réduit par la famine ; les hostilités ne cessent, en 911, qu'après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, par lequel Charles le Simple abandonne à Rollon, chef des barbares, la Normandie et le Vexin jusqu'à la rivière d'Epte.
Les malheureux successeurs de Charlemagne ne savaient pas mieux défendre leur autorité à l'intérieur que leurs frontières contre l'ennemi. Charles le Chauve, en consacrant en droit, par le capitulaire de Quierzy, en 877, la transmission des bénéfices des mains des possesseurs en celles de leurs héritiers, avait constitué définitivement la féodalité ; les comtes et les autres officiers royaux s'empressèrent de convertir leurs charges en fiefs et propriétés personnelles ; dans le pays de Seine-et-Oise, la transformation féodale fut instantanée et complète.
L'histoire du département offre l'exemple le plus frappant des conséquences qu'entraîna cette grande mesure. Grâce à elle, en moins d'un siècle, l'hérédité des titres et la transmission des fiefs firent des comtes de Paris la souche d'une troisième dynastie. La capitulaire de Charles le Chauve inféodait à leur maison les comtes du Vexin, seigneurs de Pontoise, qui absorbèrent bientôt à leur tour les comtes de Madrie et les comtes de Meulan, les comtes de Corbeil, les barons de Montfort-l'Amaury, de Montlhéry et de Montmorency.
C'est encouragé et aidé par ses puissants vassaux, que Hugues le Grand se fit proclamer roi de France ; mais le prix de leur concours, c'était le partage du pouvoir. Hugues Capet roi, c'était la féodalité couronnée. Les Normands n'avaient rencontré sur leur chemin que des tours en bois construites pour protéger le cours de la Seine ; maintenant que les comtes et barons ont leurs, domaines à défendre, nous verrons les pierres amoncelées s'élever en formidables remparts, les rochers taillés à pic devenir des murailles imprenables, les rivières détournées de leur cours inonder les fossés des châteaux forts.
Nous verrons grandir au nord les colossales assises de Montmorency, et surgir au sud les massifs créneaux de la tour de Montlhéry ; il n'y aura plus de montagne qui n'ait son castel bâti sur sa crête comme un nid de vautour ; plus de vallée qui n'ait à son embouchure son fort menaçant et sombre prêt à disputer et à faire payer le passage. La paix ne pouvait pas sortir de préparatifs aussi peu pacifiques ; la guerre fut donc la vie du XIe siècle. Dans leur indépendance, les grands vassaux refusent obéissance à leurs souverains et s'attachent à la fortune des princes dont ils espèrent meilleure récompense.
En 1015, le trône du roi Robert est menacé par une ligue dont font partie Galeran Ier, comte de Meulan, et Gauthier, comte du Vexin ; ce n'est que par l'intervention de Fulbert, évêque de Chartres, que la guerre est suspendue. Vingt ans plus tard, ce même Galeran s'allie aux comtes de Brie et de Champagne, dans la guerre qu'ils soutiennent contre Henri Ier. En 1102, Houchard IV de Montmorency refuse à Louis le Gros de faire réparation des dommages causés par lui à l'abbaye de Saint-Denis, et se laisse assiéger dans sa forteresse, dont les soldats du roi sont contraints d'abandonner le siège.
Pendant près d'un siècle, la malveillance impunie des sires de Montlhéry entrave les communications de la capitale avec Étampes, demeuré fief de la couronne. En rattachant les souvenirs de ces faits recueillis parmi beaucoup d'autres aux impressions produites par la vue des ruines féodales qui couvrent encore le sol, on pourra se faire une. idée des désordres et de l'anarchie de cette déplorable époque, pendant laquelle les Normands, toujours habiles à profiter de l'affaiblissement du pouvoir central, vinrent ajouter les ravages de leurs excursions aux misères de nos déchirements intérieurs ; en 1060, Meulan avait été encore une fois pris et saccagé par eux ; en 1087, Pontoise et Mantes furent livrés aux flammes.
Dans la lutte devenue inévitable entre les rois et les seigneurs féodaux, la royauté eût probablement succombé sans le mouvement religieux qui entraîna vers les croisades cette noblesse ambitieuse et turbulente ; pendant que le roi Philippe Ier se faisait représenter à la première expédition, en 1083, par Eudes d'Étampes, les plus indociles et les plus redoutables de ses sujets prenaient la croix et s'enrôlaient sous la sainte oriflamme.
Quelques-uns revenaient comme le fameux Simon de Montfort, qui continua si cruellement contre les Albigeois ses exploits de Constantinople et de Palestine ; mais beaucoup d'autres y mouraient ou trouvaient au retour leurs domaines aux mains de nouveaux maîtres.
L'autorité royale n'avait pas seule gagné dans cet amoindrissement de la puissance féodale ; plusieurs seigneurs, pour payer les préparatifs de l'expédition et les frais du voyage, avaient vendu, contre argent, certaines franchises aux bourgeois de leurs villes ; les rois avaient encouragé, de leur pouvoir moins contesté, ces premières tentatives d'émancipation des communes ; pour la royauté d'alors, grandir le peuple, c'était affaiblir d'autant le seigneur intraitable et si souvent menaçant ; c'était créer un antagonisme dont elle se réservait l'arbitrage.
C'est donc de cette époque que sont datées les premières chartes octroyées par les rois de France aux communes. Mantes a les siennes en 1110, Étampes quelques années plus tard, Pontoise en 1188, Meulan en 1189 : un maire et des échevins ou jurés nommés parles bourgeois étaient chargés de l'administration des deniers communaux, de la garde de la ville et de l'exercice plus ou moins étendu de la justice.
L'essor que prirent dès lors les communes, l'importance toujours grandissante de la bourgeoisie assura désormais la soumission des seigneurs contre lesquels la royauté avait partout des alliés reconnaissants. Certes, le trône de France eut encore de rudes assauts à soutenir ; les maisons féodales qui résistèrent à cette première secousse n'en devinrent que plus puissantes et plus redoutables ; c'est à la politique de Louis XI, c'est au génie de Richelieu qu'il était réservé de leur porter les derniers coups ; mais, dans ce pays de Seine-et-Oise, dans l'histoire duquel notre récit doit se circonscrire, la féodalité rebelle, menaçante, rivale parfois de la royauté, cette féodalité ne survécut pas au règne de Philippe-Auguste.
Si l'habile modération qui fut la règle de conduite des puissants abbés de Saint-Germain et de Saint-Denis explique la paisible possession dans laquelle les laissèrent les guerres de la féodalité, la constance de leurs sympathies et de leur fidélité pour les rois de France explique plus naturellement encore la généreuse reconnaissance des monarques pour l'Église. Chaque succès de la royauté est signalé par la fondation de quelque établissement religieux ; Charlemagne et Hugues Capet avaient payé leur tribut après les deux grandes abbayes si souvent citées par nous, celle d'Argenteuil avait été fondée en 665, celle de Chelles en 656, celle de Néauphle-le-Vieux et de Saint-Mellon à Pontoise vers 899, et, quelques années plus tard, celles de Saint-Spire à Corbeil et de Saint-Nicaise à Meulan.
La consolidation définitive de la dynastie capétienne eut pour l'Église de non moins précieux résultats. Elle lui doit, au XIe siècle, la collégiale d'Étampes, le prieuré de Saint-Germaïn-en-Laye, l'abbaye de Morigny, près d'Étampes, le prieuré de Notre-Dame de Longpont ; les abbayes de Saint-Martin de Poissy et de Saint-Martin de Pontoise au XIIe ; l'abbaye de Juziers, de Saint-Corentin-sur-Septeuil, des Vaux-de-Cernay, de Gif, de Port-Royal, et enfin l'abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, en 1236 ; les dominicains de Poissy en 1304 ; les célestins de Limay en 1376, ceux de Marcoussis en 1409.
Toutes ces fondations indiquent une longue période de prospérité et de paix qui nous conduit jusqu'aux premières guerres des Anglais. Sous la conduite du roi Édouard, nous les voyons suivre la même route que les Normands, leurs ancêtres ; ils remontent le cours de la Seine, et jusqu'à Poissy tout est mis à feu et à sang sur leur passage.
La triste histoire du roi Jean, celle de Charles V, la démence de Charles VI, la minorité de Charles VII rappellent les désastres de la patrie, encore présents à toutes les mémoires ; la France entière fut frappée, mais aucune de nos provinces ne le fut aussi cruellement que l'Ile-de-France ; les invasions anglaises étaient périodiques, et quand cette malheureuse contrée avait par hasard échappé aux dévastations de leur arrivée, elle avait à subir leurs exactions ou leur vengeance au retour ; l'histoire de chaque année est la même et peut se résumer dans les mêmes mots : sac, pillage, incendie.
« Après l'invasion de 1360, de Mantes à Paris, dit un chroniqueur contemporain, il n'y avait plus un seul habitant ; » celle de 1370, commandée par le routier Robert Knolles, amena les Anglais jusqu'aux portes de Paris ; de son hôtel Saint-Paul, le roi pouvait voir les flammes allumées par l'ennemi. Un libérateur inespéré, Du Guesclin, sauva cette fois Paris et la France ; la rude leçon que le brave connétable breton avait donnée aux bandes de Robert Knolles les eût peut-être empêchées de songer de longtemps à de nouvelles attaques, si l'Anglais n'eût bientôt retrouvé dans nos discordes un encouragement à de nouvelles tentatives Armagnacs et Bourguignons se disputaient l'héritage de Charles VI vivant encore ; dans sa haine contre le dauphin, la reine Isabeau appela elle-même l'étranger ; le traité de Troyes livra la France à l'Angleterre.
La miraculeuse délivrance de la patrie, les combats, les victoires de Jeanne d'Arc, la vierge inspirée, cette épopée nationale appartient à d'autres pages de notre ouvrage ; nous sommes heureux cependant de pouvoir rattacher à ce grand événement de notre histoire la délivrance du pays de Seine-et-Oise. Charles VII avait été sacra ; à Reims en 1429, Paris avait été repris en 1436, les garnisons anglaises évacuèrent Pontoise en 1441 et Mantes en 1449.
Avant ces miraculeux succès, l'affaiblissement de la monarchie avait réveillé les prétentions des grands vassaux de la couronne ; il ne s'agissait plus des sires de Montmorency ou des comtes de Meulan, mais de ces grandes maisons enrichies par les alliances royales et à la tête desquelles marchaient les ducs de Bourgogne, de Berry et de Bretagne. Louis XI, malgré les ruses de sa politique, n'avait pu dissimuler son projet d'asseoir le trône de France sur la ruine de tous ces grands fiefs, éléments éternels de discorde et d'anarchie ; ses ennemis menacés prirent l'offensive et formèrent une ligue qu'ils appelèrent Ligue du bien public.
Le drame se dénoua encore dans le pays de Seine-et-Oise : le comte de Charolais, à la tête de 15 000 Flamands, rejoignit l'armée des ducs près de Montlhéry ; l'issue de la bataille fut incertaine, chacun des partis s'attribua la victoire ; Louis XI, selon son habitude, parut céder pour attendre une occasion meilleure ; le traité signé à Conflans donna Étampes et Montfort au duc de Bretagne, et au duc de Nemours le gouvernement de Paris et de l'Ile-de-France. Par mariages, alliances, extinctions de races, ou de haute lutte, et par confiscation sous Richelieu et Louis XIV, la monarchie devait bientôt rentrer en possession de ce qu'elle semblait alors abandonner ; nous suivrons, dans l'histoire particulière des villes, les progrès de ces revendications.
Les guerres religieuses du XVIe siècle, les troubles de la Fronde, les prétentions des Guises firent jaillir quelques étincelles des cendres de la féodalité ; mais désormais il n'y avait plus d'incendie sérieux a redouter pour la province de I'Ile-de-France, sur laquelle le roi de France régna sans interruption et sans conteste, même alors que Paris était au pouvoir des rebelles, grâce à quelques surprises qui n'eurent ni résultat ni durée.
Ce n'est point dire que le pays fût désormais à l'abri des agitations dont la France fut troublée ; plus, au contraire, son administration se rattachait directement et étroitement à la couronne, plus il ressentait vivement les secousses dont la royauté était atteinte. Nous constatons seulement son annexion définitive, à une époque où la possession de la plupart de nos provinces était encore incertaine et précaire. Au règne de Charles VIII se rattache le retour à la couronne du comté de Montfort-l'Amaury, qui fut une conséquence du mariage du roi avec Anne de Bretagne.
Les départements-(histoire)- Finistère - 29 -
(Région Bretagne)
Le plus occidental et le plus maritime des départements bretons, celui du Finistère, était habité, dans la haute antiquité, par un peuple dont le nom même était la traduction de sa position géographique : c'étaient les Osismii, qui avaient pour capitale Occismor. Occismor, en langage celtique, veut dire mer de l'Occident (mor, mer ; oc, occident). Ce peuple faisait partie de la confédération armoricaine. Il était allié des Vénètes, et fut avec eux à la tête de la résistance contre l'invasion romaine.
Le pays des Osismiens, aussi bien que celui de Vannes, était le foyer du druidisme, et nulle part la nature ne fut plus en harmonie avec ce culte sombre et terrible. L'horreur règne sur ces côtes, et l'habitant de Léon, pensif et retiré en lui-même, semble méditer sur les villes anéanties, les cultes effacés et la lutte terrible que le granit déchiré de son rivage soutient de toute éternité contre un océan furieux. En lui il y a du vieux druide. Il a remplacé par la veste et le bragow-braz le long manteau de lin blanc ; il ne consomme plus sur les dolmens ensanglantés d'homicides sacrifices, mais il est encore familier avec ses menhirs, ses dolmens, ses pierres branlantes ; il s'assied à leur ombre ; il les consulte comme des oracles, et interroge avec anxiété les mouvements de ces rochers énormes, comme si c'étaient des géants pétrifiés qui auraient la connaissance de ce qui échappe aux hommes.
Qui sait de combien de ménages la pierre branlante de Trégun, près de Concarneau, n'a pas décidé le sort ? Sur son extrémité mobile vient s'asseoir, plein d'inquiétude, le mari soupçonneux, et le branlement de l'étrange machine lui enseigne ce qu'il doit penser de la vertu de sa femme. Avancez-vous dans la presqu'île de Camaret, jusqu'à la pointe de Toulinguet, sur le bord escarpé de la mer : devant vous, sur une pente aride et unie, se dressent 41 colosses alignés sur une longueur de 600 mètres. Perpendiculaires à cette ligne, dirigée de l'est à l'ouest, deux autres s'étendent vers le nord, composées chacune de 12 pierres. Ces masses de granit, inégales et irrégulières, sont hautes de 3 à 5 mètres, et larges de même à la base. Ce monument est, après celui de Carnac, le plus considérable que l'on rencontre en Bretagne.
Plus loin encore, dans l'île d'Ouessant, on voit, presque à ras de terre, la trace d'un édifice considérable que l'on considère dans le pays comme un temple druidique. C'est un carré long, dirigé de nord-est en sud-ouest, et formé de murailles de près de 2 mètres d'épaisseur ; le grand côté a 100 mètres de long, et le petit côté 50.
Lieux effrayants que ces temples et ces enceintes druidiques ; terre arrosée de sang humain, où l'on croit voir encore se débattre, dans une agonie minutieusement étudiée par l'impassible druide, la victime humaine frappée au-dessous du diaphragme avec le couteau de pierre, et expirant au milieu du bruit des voix sauvages et des instruments des bardes. Mais cela appartenait à toute la Gaule. Ce qui était plus particulier à l'Armorique, et surtout aux rivages du Finistère, c'étaient les collèges de druidesses. Ils occupaient les îles qui environnent l'Armorique, principalement l'île d'Ouessant (l'Uxantis des Grecs) et l'île de Batz (la Barsa insula des Latins).
L'immense douleur qui pénétra l'Armorique, quand elle fut contrainte de courber la tête sous le joug de Rome, a laissé des traces tellement profondes chez le peuple grave et peu oublieux de ce pays, que les enfants de la basse Bretagne chantent encore, après dix-neuf siècles, une sorte d'élégie patriotique, douloureux gémissement des vieux Armoricains lorsqu'ils apprirent le massacre des druides de Vannes, qui fut comme l'immolation de leur antique religion.
Un druide enseigne l'histoire à un enfant. L'enfant dit : « Chante-moi le nombre dix, que je l'apprenne aujourd'hui. - LE DRUIDE : Dix vaisseaux pleins d'ennemis ont été vus venant de Nantes, malheur à vous ! malheur à vous, hommes de Vannes !... - L'ENFANT : Chante-moi le nombre onze, que je l'apprenne aujourd'hui. - LE DRUIDE : Onze druides armés viennent de Vannes avec leurs épées brisées et leurs robes ensanglantées et des béquilles de coudrier (le coudrier, dans les traditions celtiques, est le symbole 'de la défaite) ; de trois cents il ne reste que onze. »
Le Finistère fut, avec toute l'Armorique, enclavé, sous Auguste, dans la Lyonnaise ; sous Adrien, dans la troisième Lyonnaise. Mais il est probable que. sa soumission fut fort imparfaite. L'éloignement, la mer, la rigueur du climat, la stérilité du sol furent autant d'obstacles qui s'opposèrent à un établissement bien complet de la domination romaine. Le pays de Léon paraît avoir fait exception, si l'on en croit son nom même (Legio, Legionensis pagus, d'où Léon) et les nombreux débris de constructions romaines qui se remarquent de Morlaix à Brest.
Dès 409, l'Armorique s'affranchit ; et quand le préfet Exsupérantius, en 416, tenta de la ramener sous la domination romaine, il échoua dans ses efforts ; tout ce qu'il put faire, ce fut d'obtenir un traité d'al, liante avec les Armoricains. C'est à titre d'auxiliaires que ceux-ci se joignirent aux soldats d'Aétius pour combattre Attila, et c'est au même titre, selon toutes les probabilités, que des garnisons romaines demeurèrent dans l'Armorique jusqu'aux derniers temps de l'existence de l'empire romain. Ce qui prouve, au reste, combien la civilisation romaine jeta peu de racines dans le dur sol breton, c'est que ce même pays de Léon, où l'occupation paraît avoir été plus complète qu'ailleurs, est aujourd'hui l'un de ceux qui conservent le plus fidèlement le langage et les mœurs celtiques. C'est comme si vous semiez du blé dans ces landes stériles : vous aurez d'abord quelques épis , mais bientôt le granit et les genêts reprendront le dessus.
Le christianisme s'établit dans le Finistère à la même époque que dans le reste de la Bretagne. Mais comment ces populations, opiniâtres dans leurs traditions et dures aux changements, qui avaient repoussé, sans presque en rien conserver, cette puissante civilisation romaine, n'auraient-elles pas opposé aussi quelque résistance à la puissance, il est vrai bien plus grande, de la prédication chrétienne ?
Elles cédèrent, mais ne cédèrent qu'à moitié. Le bas Léon, les îles occidentales du Finistère furent les points de l'Armorique qui résistèrent le plus longtemps au christianisme ; on y trouve encore des paroisses que l'on appelle terre des païens. En plein XVIIe siècle, l'idolâtrie subsistait à Lokrist (Lochrist) et aux îles d'Ouessant ; enfin, même converti, le Breton du Finistère força, en quelque sorte, le christianisme vainqueur à transiger avec le druidisme expirant ; le culte nouveau fut contraint d'hériter de l'ancien et d'en accepter le prestige, pour faire accepter et corroborer le sien : la croix s'éleva, mais sur les menhirs ; les prêtres de Hu et les prêtresses de Koridwen disparurent, mais les fées, ou korrigan, perpétuèrent le souvenir et le nom même de l'antique déesse.
Le gui ne tombe plus, le sixième jour d'une lune d'hiver, au tranchant de la faucille d'or, dans la sale blanche tendue sous le chêne, mais il a conservé dans les mœurs nouvelles son rang vénéré ; c'est l'herbe de la croix (louzaouen ar groaz), et il guérit la fièvre et donne des forces aux lutteurs. Les fontaines, les chênes ont encore un caractère sacré. Les danses et les feux de l'ancienne fête du Soleil se reproduisent à l'occasion de la Saint-Jean. Toutefois c'est le sort des vaincus d'avoir tort ; et quand une époque religieuse finit, les divinités qu'elle adorait deviennent les mauvais génies de l'époque qui succède. Les fées, quelquefois bonnes, souvent méchantes, n'eurent jamais qu'un caractère religieux fort équivoque ; autour des dolmens ne se promènent plus des druides vénérés, mais voltigent des esprits malfaisants.
Après la chute de l'empire romain, le pays qui est actuellement le Finistère devint un petit royaume particulier, le royaume de Cornouaille, dont le premier souverain connu est Gradlon le Grand. Gradlon fut un roi conquérant qui étendit sa domination jusque sur Rennes, et même sur une portion du territoire franc. Il s'intitulait en effet : Grallonus, Dei gratia rex Britonum, nec non ex parte Francorum. Un historien du XIe siècle, Raoul Glaber, appelle Rennes la métropole de la Cornouaille, ce qui donnerait à supposer que les successeurs de Gradlon auraient conservé la même étendue de territoire ; opinion, au reste, fort sujette à controverse.
Ce Gradlon, qui est devenu dans les romans de la Table ronde la fameux Galaor, modèle de valeur et de courtoisie, est représenté par les moines comme un saint et un homme plein de douceur (mitis et agnus), parce qu'il protégea les couvents. C'est sous ses auspices que saint Guignolé fonda le monastère de Landévennec ; saint Guignolé, à qui s'adresse particulièrement la dévotion des femmes stériles. Gradlon avait d'abord pour capitale la ville d'Ys ; après la catastrophe qui fit disparaître cette riche cité, il transporta sa résidence à Kemper, qui devint la capitale de la Cornouaille. Sur le cartulaire du monastère de Landévennec, manuscrit du XIe siècle, on trouve une liste de rois de Cornouaille, parmi lesquels figurent deux autres Gradlon et un Budic, surnommé le Grand.
La plupart de ces petits monarques se signalèrent par leur esprit entreprenant et par l'indomptable énergie avec laquelle ils soutinrent l'indépendance de l'Armorique. Raoul Glaber, que nous avons déjà cité, appelle Rennes la métropole de la Cornouaille, et donne à supposer par là que cette ville était demeurée sous la domination des successeurs de Gradlon. le Grand ; mais cela n'est point vraisemblable, puisqu'on sait que Rennes avait, bien avant cette époque, des souverains particuliers. Ce qui est certain, c'est que les rapports qui unissaient les habitants de la Cornouaille et ceux de Rennes n'étaient rien moins que des rapports d'amitié. Les purs Bretons du fond de la péninsule ne pardonnaient point aux Rennais leur facilité à accueillir les Francs, et les traitaient assez durement. On ne sait à quelle époque ils cessèrent de porter le nom de rois, et l'on suppose que ce fut au temps des invasions carlovingiennes. En effet, Hoël, qui succéda, en 1066, à Conan II comme duc de Bretagne, était simplement comte de Cornouaille. Il réunit ce comté aux domaines des ducs de Bretagne.
La partie septentrionale du Finistère était alors un comté particulier, le comté de Léon. Quand Louis le Débonnaire entreprit de soumettre la Bretagne, le fameux Morvan, comte de Léon, et après lui son fils Guiomarch, furent à la tête de la résistance et déployèrent dans la lutte un courage héroïque. L'indépendance de ce comté alla toujours diminuant, à mesure que les ducs établirent leur autorité sur toute la péninsule.
Le Finistère eut sa part des événements qui agitèrent la Bretagne au moyen âge, et nous rap pellerons plus loin les sièges que ses villes eurent à soutenir. Toutefois, le rôle de ses populations n'eut rien qui le distingue dans l'ensemble de l'histoire. Une seule époque, pour la Cornouaille, tranche sur toutes les autres par l'effrayante accumulation de calamités dont ce pays fut accablé et n'a pu encore se relever : c'est l'époque de la Ligue. Jusque-là, si l'on en croit le chanoine Moreau, la prospérité de cette contrée était merveilleuse ; il avait vu lui-même, chez des bourgeois, un luxe égal à celui des plus grands seigneurs, et dans des ménages de campagnards il avait admiré des hanaps, des plats et des couverts d'argent doré.
La Ligue porta partout les fureurs de la guerre religieuse, et, en ruinant toute l'autorité royale et toute police régulière ; livra toutes les contrées de la France, particulièrement les plus éloignées, aux dévastations de brigands hardis. C'est alors que le seigneur de Fontenelle porta le ravage dans toutes les campagnes de la Cornouaille. On ne vit plus que châteaux détruits, villes et villages incendiés, récoltes en cendres et terres en friche. Pour recueillir un reste de récolte, les populations étaient obligées de se réunir en armes et de garder les moissonneurs comme en un camp.
Des malheureux en haillons grattaient la terre pour y trouver quelques grains échappés aux flammes. « Les pauvres gens, dit le chanoine Moreau, n'avoient pour retraite que les buissons où ils languissoient quelques jours, mangeant de la vinette (oseille sauvage) et autres herbages aigrets ; et même n'avoient moyen, de faire aucun feu, de crainte d'être découverts par l'indice de la fumée ; et ainsi mouroient dans les parcs et les fossés, dans les haies et dans les garennes, par les rues et sur les places, où les loups les trouvant morts s'accoutumoient, comme on va voir, à la chair humaine. Il y en avoit qui soutenoient leurs misérables jours en faisant bouillir des orties dans l'eau de mer ; d'autres mangeoient les dites herbes toutes crues, et d'autres dévoroient de la graine de lin, qui leur donnoit une puanteur qu'on sentoit de huit à dix pas, après quoi ils venoient à enfler et à jaunir par tout le corps, et de cette enflure peu échappoient qui n'en mourussent.
« On ne trouvoit autre chose que trépassés par les chemins, partie ayant encore la vinette ou graine de lin dans la bouche, partie déjà mangés des loups et quelques-uns tout entiers, jusqu'à la nuit qu'ils leur servoient d'aliments, sans qu'ils eussent de sépulture. Les plus misérables agonisants, presque tout nus, fors quelques drapeaux pour couvrir leur honte, sans logement ni couverture que les hangars ou étaux publics, éherchoient du fumier où ils s'enterroient dedans, grelottant la fièvre, et où toutefois ils n'estoient guère de temps qu'ils n'enflassent fort gros avec cette couleur qui les faisoit incontinent mourir... C'estoit un mal de tête et de coeur qui ne produisait aux malades ni aux morts aucune marque extérieure, si ce n'est qu'ils jaunissoient du visage. Le mal jaune emportait son homme en vingt-quatre heures ; et si le malade passoit le troisième jour, il en échappoit. »
Les loups furent le quatrième fléau qui désola la basse Cornouaille après les brigands, après la famine, après la peste. On ne saurait dire tous les maux qu'ils y causèrent. « On les estimeroit des fables, et non des vérités. S'estant habitués à vivre de chair et de sang humain par l'abondance :des cadavres que leur servit d'abord la guerre, ils trouvèrent cette curée si appétissante que dès lors et dans la suite, jusqu'à sept et huit ans, ils attaquèrent les hommes estant même armés et personne n'osoit plus aller seul. Quant aux femmes et enfants, il les faillait bien enfermer dans les maisons ; car si quelqu'un ouvroit la porte, il estoit le plus souvent happé jusque sur le seuil. Et s'est trouvé plusieurs femmes au sortir, tout près de leur de-meure, pour lâcher de l'eau, avoir eu la gorge coupée sans pouvoir crier à leurs maris, à trois pas d'elles, en plein jour !... La paix faite, les portes des villes demeurant ouvertes, les loups s'y promenoient toutes les nuits jusqu'au matin...Ils avaient 'cette finesse de prendre toujours à la gorge, si 'faire se pouvoit, pour empêcher leurs victimes de crier. :. Dès le commencement de leurs furieux ravages, ils ne laissèrent dans les villages aucun chien, comme si par leur instinct naturel ils eussent projeté qu'ayant tué les gardes, qui sont les chiens, ils auroient bon marché des choses gardées." Ces finesses des loups les faisaient prendre par les Bretons pour des soldats trépassés qui ressuscitaient pour affliger les vivants, surtout des soldats de Fontenelle. Aussi le peuple les appelait-il tut-bleiz, c'est-à-dire gens-loups.
Voilà, certes ; un tableau digne de figurer dans les annales des grandes désolations, et qui ne pâlirait point à côté des pestes célèbres d'Athènes, de Florence ou de Marseille. Le Finistère eut bien de la peine à se relever de pareilles calamités, et ce n'est qu'au XIXe siècle, qu'il a conquis, par le travail et l'énergique application de ses habitants , une prospérité qu'il n'avait jamais connue.
Les départements-(histoire)- Eure-et-Loir- 28 -
(Région Centre)
Le département d'Eure-et-Loir, souvent désigné, dans le langage vulgaire, sous le nom de Beauce ou de pays Chartrain, se présente aujourd'hui aux regards du voyageur ou aux souvenirs de ceux qui l'ont parcouru sous un aspect bien différent de celui qu'il eut autrefois.
Dans ces plaines immenses couvertes de riches moissons, dans ces gracieuses vallées parsemées de riantes habitations, sillonnées de routes faciles, étalant les plantureux produits d'une culture intelligente et Variée, il est difficile de reconnaître les épaisses et sombres forêts, les landes incultes et désertes, les marais fangeux inabordables, dont se composait le territoire des anciens Carnutes. Cette tribu de la grande confédération gauloise trouva, tout à la fois, dans la nature du sol qu'elle occupait et dans l'exaltation de ses sentiments religieux, les moyens d'exploiter le culte druidique à son profit.
C'est au fond de grottes ou cavernes cachées dans les profondeurs des bois, sur d'énormes blocs de pierre roulés dans les endroits les plus solitaires, et dont une terreur superstitieuse rendait les abords plus inaccessibles encore, que s'accomplissaient les mystères de Teutatès. Comme les prêtres de l'Inde et de l'Égypte, comme ceux de l'antique Cybèle, les druides de la Gaule trouvèrent bientôt dans l'ignorance et la crédulité populaires les éléments d'une domination souveraine ; près de leurs temples barbares, près de leurs grossiers autels, ils établirent des collèges où les adeptes étaient préparés à l'initiation.
Cette province des Carnutes devint donc le centre religieux du culte druidique, et plus tard le dernier boulevard de la nationalité celtique pendant l'invasion romaine et les premiers envahissements du christianisme. Il existe encore dans le département de nombreux vestiges des monuments de cette période historique. La garenne de Poisvilliers conserve, sur une éminence assez élevée, la trace de fossés larges et profonds qui entouraient ce qu'on nomme encore dans le pays le Vieux-Château, et ce que les archéologues reconnaissent pour l'ancien collège des druides.
On a retrouvé à Dreux et à Fermaincourt les ruines d'anciennes écoles, et dans la forêt d'Ivry les assises d'un vaste édifice qu'on suppose avoir été l'habitation du grand prêtre. Les environs de Chartres et la commune de Lèves sont surtout riches en souvenirs de cette époque : outre les galgals, dolmens et cromlechs, qui sont très nombreux, on cite encore la montagne des Lienes, la caverne qui s'ouvre au levant sur les bords de l'Eure, près d'une fontaine qui passait pour sacrée, la grotte de Chartres, creusée au sommet de la montagne où s'élève la cathédrale actuelle ; enfin, les tumulus de Goindreville et de Morancez, les autels encore debout aux hameaux de Changé et de La Folie, les dolmens si célèbres de Cocherel et de Quinquempoix, attestent à chaque pas le caractère religieux de la contrée et l'importance que la nation des Carnutes avait puisée dans cette espèce de concentration du pouvoir sacerdotal.
L'histoire manque de données positives sur la durée de ce régime ; le bruit des armes romaines trouble pour la première fois le religieux silence de ces mystérieuses forêts. C'est aux clartés de la civilisation qu'apportent avec eux les conquérants, qu'il nous est donné de lire les premières pages de notre histoire nationale. Les mœurs des Carnutes, leur costume, l'aspect du pays, les cérémonies religieuses, ne nous sont révélés que par leurs vainqueurs.
Nous regrettons de ne pouvoir ajouter à notre récit quelques pages sur l'organisation théocratique de cette partie de la Gaule, sur les bardes, sur les prêtresses inspirées, sur les barbares sacrifices inondant de sang humain ces pierres levées, ces autels séculaires, que le lierre et la mousse recouvrent aujourd'hui ; nous voudrions pouvoir évoquer devant nos lecteurs ces poétiques cérémonies, ces processions pompeuses qui, le sixième jour de la lune de décembre, signalaient chez nos ancêtres le retour du nouvel an, alors que, précédé de deux taureaux blancs, entouré des prêtres, des sacrificateurs, des saronides et de leurs élèves, suivi d'un long cortège de députés qu'envoyaient chaque ville et chaque province, le chef des druides, avec ses hérauts vêtus de blanc, une branche de verveine à la main, allait couper le gui sacré avec sa serpette d'or. Une étude de l'âge druidique ne serait nulle part mieux à sa place que dans l'histoire du pays Chartrain ; mais l'espace nous manque, et bien peu de lignes nous restent pour les dix-huit siècles que nous avons encore à résumer.
L'an 56 avant J.-C., César pénètre dans les Gaules, apportant la vengeance de Rome aux descendants de Brennus. Les Carnutes ne se laissèrent point décourager par les premières victoires des légions romaines. La mort de Clodius ayant rappelé César en Italie, une vaste conspiration s'organisa clans le pays Chartrain ; les druides et leurs émissaires se répandirent dans la Gaule, excitant les esprits au nom de la religion et de l'indépendance nationale ; les provinces répondirent à cet appel ; l'Auvergne se signala par l'entraînement de sa population presque entière.
C'est elle qui donna à l'insurrection son chef illustre Vercingétorix ; c'est au pied de ses montagnes que se livrèrent les grandes batailles ; mais le foyer de l'incendie était dans le sanctuaire. druidique, et c'est du fond de leurs inaccessibles retraites d'Eure-et-Loir que les prêtres dirigeaient le mouvement suscité par eux. Leur influence, quoique affaiblie, survécut au triomphe des Romains ; quelques siècles plus tard, nous voyons les superstitions séculaires de la Gaule trouver dans le pays de Chartres leurs derniers défenseurs contre les envahissements du christianisme. :La ténacité aux vieilles croyances, la fidélité au culte du passé, tel est donc le caractère du pays dans cette première période de son histoire ; nous verrons le sol se transformer, les temples du Christ remplacer enfin les sanglants et grossiers autels de Teutatès ; mais nous retrouverons dans les mœurs et dans les annales de la contrée la foi plus pure, mais aussi obstinée, le même fanatisme des traditions se transmettre de génération en génération jusqu'à nos jours.
Le territoire des Carnutes faisait partie de la quatrième Lyonnaise, lorsque les Francs succédèrent à la .domination romaine. Les terres furent partagées entre les chefs vainqueurs et les ministres de la religion qui avaient si puissamment concouru aux succès de Clovis ; l'érection des comtés, l'établissement des évêchés, la fondation des prieurés et des abbayes, sont les faits qui caractérisent le règne des deux premières dynasties.
Comme le reste de l'ancienne Neustrie, les pays dont s'est formé ce département furent ravagés par les Normands ; nous nous contentons ici de mentionner le fait sans entrer dans des détails qui sont toujours et partout les mêmes. La formation des grands fiefs féodaux divisa la contrée en quatre grands comtés du Perche, de Dreux, de Chartres et de Dunois, dont les histoires spéciales constituent l'histoire du département.
Le premier seigneur héréditaire du Perche fut Yves de Bellesme, comte d'Alençon, qui mourut en 926 ; il était issu de la maison de Bellesme qui possédait viagèrement depuis longtemps la petite province du Perche avant de l'obtenir de Charles le Simple à titre héréditaire ; la réunion dans la même famille des comtés du Perche et d'Alençon met une certaine confusion dans les annales de la contrée qui nous intéresse présentement ; nous nous bornerons donc à constater que saint Louis, en donnant en apanage à son frère Pierre le comté d'Alençon, y joignit le comté du Perche, d'où il résulta que les aînés de cette branche royale portèrent souvent le titre de comtes du Perche, comme on peut le remarquer dans le célèbre procès intenté au duc d'Alençon, sous les règnes de Charles VII et de Louis XI. L'ancienne coutume du Perche, qui a régi le pays jusqu'en 1789, avait été rédigée pour la première fois en 1505, par autorité du roi, sous René, duc d'Alençon, comte du Perche, et modifiée en 1558, sous Henri II. La province se subdivisait en trois cantons ; Nogent-le-Rotrou en était la ville la plus importante.
Le Dunois, qui sépare le pays Chartrain de l'Orléanais proprement dit, fut, dès l'origine des temps féodaux, possédé par des seigneurs dont se rendirent indépendants leurs lieutenants, les vicomtes de Châteaudun, capitale de la contrée ; le Dunois fut réuni par les comtes de Blois à leurs domaines, qui passèrent au XIIIe siècle à la maison de Châtillon ; Gui II, le dernier héritier de cette famille, vendit ses deux comtés, vers la fin du XIVe siècle, à Louis de France, duc d'Orléans, frère de Charles VI. Ce prince venait alors de recevoir du roi la vicomté de Châteaudun, confisquée sur Pierre de Craon, assassin du connétable de Clisson.
Louis, devenu ainsi possesseur de tout le Dunois, eut pour héritier Charles d'Orléans, son fils ; celui-ci, fait prisonnier par les Anglais, reçut pendant sa captivité, de son frère naturel, Jean, des services qu'il récompensa par la cession du comté de Dunois et de la vicomté de Châteaudun. Ce nouveau comte Jean est le fameux bâtard de Dunois, qui s'acquit une si glorieuse réputation dans les guerres de Charles VIl contre les Anglais. Il devint la tige de la maison d'Orléans-Longueville, dont onze descendants possédèrent successivement la province de Dunois. La famille s'étant éteinte au commencement du XVIIIe siècle, dans la personne de la duchesse douairière de Nemours, l'héritage échut à un fils naturel du comte de Soissons, oncle de la duchesse ; et la fille unique de l'héritier porta le comté en dot dans la maison de Luynes où il est resté jusqu'à la Révolution. Nous aurons occasion, en racontant l'histoire de Châteaudun, de compléter cette notice sommaire.
Un des barons les plus habiles à exploiter l'agonie de la race carlovingienne fut Thibaut le Tricheur ; ce surnom indique assez de quel esprit rusé, cupide et envahisseur il était animé. Vers l'an 920, ce seigneur, déjà comte de Tours et de Valois, s'empara du comté de Chartres, qui avait été cédé au duc de Normandie par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. La famille resta en possession de ce fief jusqu'en 1286 ; il échut alors à la veuve d'un comte d'Alençon qui le vendit à Philippe le Bel.
Ce prince le donna en apanage à Charles, son frère, comte de Valois, dont le fils, Philippe, étant devenu roi de France, le réunit une seconde fois à la couronne. En 1528, le comté de Chartres fut érigé en duché par François Ier, puis engagé par Louis XII pour 250 000 écus d'or, à l'époque du mariage de sa fille Renée avec Hercule d'Este, duc de Ferrare. En 1623, le duché de Chartres fit encore retour à la couronne, et fut compris dans l'apanage de Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XII ; il fit ensuite partie de celui d'un autre duc d'Orléans, Philippe, frère de Louis XIV, dont la postérité l'a possédé jusqu'à la Révolution.
Quoique dépouillé de ses privilèges les plus essentiels, le titre de duc de Chartres a été religieusement conservé dans la famille d'Orléans ; Louis-Philippe, depuis roi de France, après l'avoir porté jusqu'à la mort de son père, le transmit à son fils aîné qui ne le quitta, à l'avènement du roi son père au trône, que pour le titre de duc d'Orléans, attaché au chef de la famille. Enfin, quoique le titre de duc d'Orléans ait été échangé depuis contre celui de comte de Paris pour l'héritier présomptif de la couronne, le second fils dit prince royal reçut et porte le titre de duc de Chartres.
Le comté de Dreux, formé de l'ancien pays des Durocasses, couvert autrefois de forêts comme le pays Chartrain, a une histoire commune avec cette contrée jusqu'à la séparation des grands fiefs. C'est en 1031 que nous 'rencontrons les premiers documents constatant l'existence d'un comté de Dreux. Ses premiers possesseurs furent les comtes du Perche. En 1378, une dame de cette maison le vendit au roi Charles V. Engagé plusieurs fois, dans les temps difficiles, ravagé ou occupé par les Anglais, il ne rentra dans le domaine royal qu'en 1551. Henri III le donna en apanage à son frère, le duc d'Alençon ; à la mort de celui-ci, il passa à Charles de Bourbon, comte de Soissons, qui le transmit à son fils Louis, tué à la bataille de La Marfée, près de Sedan ; en 1641. Enfin, sauf quelques droits particuliers sur la ville de Dreux, le comté fut définitivement et complètement réuni à la couronne vers la fin du XVIIe siècle.
La longue lutte contre les Anglais, les guerres de religion, quoique se rapportant à l'histoire générale du département, trouveront leur place dans la notice consacrée à chaque ville principale, à propos des épisodes dont elles furent le théâtre.
Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département d'Eure-et-Loir fut un des plus éprouvés par le fléau de l'invasion. La plupart de ses villes et bourgades eurent à subir la présence de l'ennemi, et des combats sanglants furent livrés sur divers points de son territoire, notamment à Châteaudun, aux environs d'Orgères, à Nogent-le-Rotrou et à La Fourche.
L'armée envahissante (3e armée) était commandée par le prince royal Frédéric-Guillaume. Le 18 octobre, la 22e division d'infanterie allemande, la 4e de cavalerie, sous les ordres du général de Wittich, ayant reçu pour mission de rallier l'armée au blocus de Paris, en passant par Chartres et Dreux et en rejetant les 'troupes que l'on pourrait trouver, arrivaient devant Châteaudun, ville défendue par les francs-tireurs de Lipowsli et par les habitants. Un violent combat s'engagea et la ville fut en partie réduite en cendres. A l'article que nous consacrons plus loin à Châteaudun, nous raconterons en détail les péripéties de ce brillant fait d'armes. Le 20 octobre, les troupes allemandes, qui s'étaient emparées de Châteaudun, bombardaient et traversaient Illiers, continuant leur marche sur Chartres, qu'elles occupèrent le 21. Parmi les localités où l'ennemi s'établit, nous nous contenterons de citer : Maintenon, Dreux, Nonancourt, Voves, Brou (25 novembre), Janville, Orgères. (29 novembre), Bonneval et Courville.
Les pertes éprouvées par le département d'Eure-et-Loir, pendant cette triste période de notre histoire, se sont élevées à la somme énorme de 35 499 427 fr. Quoi qu'il en soit, la paix dont a joui. la contrée pendant près de deux siècles a transformé son aspect ;au XIXe siècle, une grande partie de ses bois a été rasée ; le voisinage de l'Ile-de-France et de Paris, ces grands centres de population, offrant aux céréales un débouché assuré et avantageux, le sol défriché s'est couvert de riches moissons ; c'est à juste titré que la Beauce est appelée le grenier de Paris.
Plaines immenses livrées à la grande culture, riantes vallées où chaque paysan a son verger, son marais et sa vigne ; petites villes où se concentre le commerce des campagnes environnantes, telle est la physionomie générale d'Eure-et-Loir au XIXe siècle. Quant au caractère des habitants, il participe, comme partout, de la différence des localités. Les mœurs patriarcales se sont conservées plus pures, plus austères chez les laboureurs, vivant souvent encore d'une vie commune, maîtres et serviteurs, dans leurs grandes termes isolées. L'habitant des vallées, le Percheron surtout, est bien plus accessible aux influences de la civilisation moderne : son vieil esprit gaulois se prête merveilleusement à l'intelligence des affaires ; il est spirituel, fin et quelque peu rusé ; il y a un proverbe qui dit : Il entend à demi-mot, il est de Châteaudun.
Les départements-(histoire)- Eure - 27 -
(Région Haute-Normandie)
Le territoire qui forme aujourd'hui le département de l'Eure était habité, au temps de Jules César, par deux peuples de la Gaule celtique : les Aulerci Eburovices, groupés autour de la ville qui est devenue Évreux, et les Velocasses, répandus dans la contrée appelée depuis Vexin. Le Vexin se trouva divisé en deux parties après la cession, faite par Charles le Simple au chef normand Rollon, de l'ancienne Neustrie, en 911 ; le Vexin normand a été réuni en 1790 au département de l'Eure ; il forme l'arrondissement des Andelys. Les Aulerques (Aulerci) et les Vélocasses (Velocasses) prirent part aux guerres contre César. Clovis, le premier, pénétra jusque dans cette province et la rangea sous sa domination. Parmi ses successeurs, Dagobert et Clotaire III résidèrent quelquefois au château d'Étrépagny.
Pendant la période mérovingienne, la foi chrétienne se développa sur le territoire des Aulerci et des Vélocasses, et les évêques d'Évreux acquirent une grande importance. Au nombre des abbayes fondées à cette époque dans le diocèse d'Évreux, on distingue celle de Saint-Taurin, qui s'éleva probablement vers la fin du Vile siècle, sur le bord du grand chemin, en dehors de la ville, à l'emplacement qu'occupait le tombeau du premier évêque d'Évreux, dont le corps fut levé et déposé dans un reliquaire. Quelques années plus tard s'éleva le monastère de la Croix-Saint-Leufroy.
On rapporte qu'en l'année 674 saint Adrien, évêque de Rouen, étant parti de cette ville pour aller, dit la légende, rendre compte au roi de quelques affaires dont il avait été chargé, passa par le territoire d'Évreux. Alors accablé par l'âge et les infirmités, il ne pouvait plus monter à cheval, et il voyageait dans une litière traînée par deux mulets ; de temps en temps, il s'arrêtait dans les divers pays qu'il parcourait et instruisait les populations accourues pour recevoir sa bénédiction. Il était parvenu près de la rivière d'Eure, dans un village du nom de Nadud, en un lieu où deux chemins se coupaient en forme de croix ; les mulets s'arrêtèrent tout court et refusèrent d'aller plus avant, quoiqu'il n'y eût aucun obstacle et que le chemin fût beau.
Le saint, plein d'étonnement, descendit et pria ; à peine avait-il commencé d'élever ses yeux vers le ciel, qu'il vit une croix toute brillante de lumière et qu'il sentit son esprit éclairé d'une céleste inspiration qui lui apprit que Dieu avait choisi ce lieu pour être la retraite d'un grand nombre de solitaires. Aussitôt il commanda qu'on lui apportât de quoi faire une croix, et, à défaut d'autre bois, il brisa en deux l'aiguillon dont un paysan se servait pour exciter ses bœufs, éleva un tertre de gazon et y plaça la croix avec de saintes reliques. Bientôt le lieu consacré devint le théâtre de prodiges ; pendant la nuit, une colonne de feu y répandait une clarté miraculeuse, et des malades étaient guéris par le contact de la croix plantée par le saint.
Une chapelle fut élevée pour perpétuer la mémoire de ces prodiges, et, quelque temps après, saint Leufroy y fonda un monastère dont il fut le premier supérieur, et qu'il illustra par ses vertus. Ainsi, pieuse et dévouée à l'Église -tomme le reste de la Neustrie, la contrée dont nous nous occupons vivait paisible ; toute son histoire se résumait dans la succession de ses évêques, respectés de tous, et dans les prodiges sans nombre que les, rares monuments de cette époque nous ont légués ; elle avait mérité le nom de nouvelle Thébaïde, quand le calme dont elle jouissait fut troublé par les invasions normandes du Ville et du IXe siècle ; ce furent surtout les parties septentrionales de la Gaule et les villes situées sur le cours des fleuves qui eurent à souffrir des incursions de ces terribles pirates ce' département, que traversent la Seine et l'Eure, fut plus que tout autre maltraité par les barbares.
En l'année 844, Rouen et son diocèse, dont faisaient partie les villes de Gisors, des Andelys, d'Étrépagny et tout ce qui, dans le département de l'Eure, est situé sur la rive droite de la Seine, furent saccagés. Le diocèse d'Évreux ne fut pas épargné non plus par le fléau. Guntbert était alors évêque de cette ville ; il assista avec son métropolitain Gombault, qui prenait pour la première fois le titre 'd'archevêque, à deux conciles tenus à Paris en 847 et 853, pour prévenir le retour des barbares du Nord. Charles le Chauve éleva une forteresse à Pont-de-l'Arche l'année suivante (854) et fit jeter un pont sur la Seine pour barrer le passage à leurs barques.
Cependant ils reparurent en 870, puis en 876. Cette fois, ils étaient conduits par le chef qui établit définitivement dans la Neustrie la domination normande. Le Scandinave' Roll ou Rollon, chassé par un roi danois des États qu'avait possédés son père, se mit à la tête d'une émigration de ses compatriotes, aborda en France en 876, ravagea pendant quelques années les côtes de la Bretagne et de la Neustrie, puis remonta la Seine, pilla sur son passage Jumièges, Rouen, Pont-de-l'Arche, où il battit l'armée du roi Charles le Chauve, commandée par le duc Renault ; puis il vint assiéger Paris.
Ce fut pendant la durée du siège qu'il dirigea vers Évreux une expédition dans laquelle il se rendit maître de cette ville (892). Déjà Rouen était en son pouvoir ; cette ville et son archevêque avaient mieux aimé se soumettre aux Normands et leur payer un tribu t que d'être sans cesse exposés à leurs pillages ; des négociations furent ouvertes, par l'intermédiaire de l'archevêque Francon, entre le chef barbare et le roi Charles le Simple pour traiter de la cession de toute la province. Le Carlovingien ne sacrifiait rien de sa puissance effective en abandonnant une contrée où son autorité avait cessé d'être reconnue, et, en échange de cet abandon, il acquérait un allié et protégeait toute la Gaule contre les invasions de nouveaux Normands, puisque les compagnons de Rollon étaient intéressés à défendre leur conquête. Le chef normand promit d'épouser Giselle, fille du roi de France, se convertit au christianisme et obtint toute la partie de la Neustrie qui s'étend au nord de la Seine, depuis les rivières d'Epte et d'Andelle, et, au midi de ce fleuve, tous les pays situés entre la Bretagne, le Maine et l'Océan.
Ce fut en 911 que ce traité fut signé dans la ville de Saint-Clair-sur-Epte. Le pirate, devenu maître d'une des plus riches provinces de la France, se montra, par sa sagesse, digne de sa fortune ; il releva les cités que lui-même avait détruites avant de devenir maître de la contrée ; Évreux fut de ne nombre ; il se fit sincèrement chrétien et enrichit les églises de donations nombreuses. Cependant il ne put empêcher que ses anciens compagnons qui avaient reçu avec lui le baptême ne s'emparassent des abbayes et des évêchés ; peut-être même favorisa-t-il ce nouveau clergé pour placer toute la Neustrie plus directement sous son influence ; de grands désordres résultèrent de cette nouvelle organisation.
Guillaume Longue-Épée, fils de Rollon, lui succéda. Passionné pour les exercices de la chasse, il fit construire au milieu de la forêt de Lyons un pavillon qui devint, depuis, le château de Lyons et le rendez-vous de chasse du duc de France Hugues le Grand, de Hébert, comte de Senlis ; de Herbert, comte de Vermandois, et de Guillaume, comte de Poitou. Richard, âgé seulement de dix ans, succéda, en 944, à Guillaume Longue-Épée, et, en 947, il eut avec le roi Louis IV une entrevue à Saint-Clair-sur-Epte.
Les deux princes conclurent un traité par lequel le Vexin normand, qui jusqu'alors avait appartenu aux ducs de Normandie comme province séparée, fut réuni au duché. Hugues le Grand ; duc de France, profita de la minorité de Richard pour lui enlever le comté d'Évreux ; Louis d'Outre-Mer voulut à son toué essayer de reconquérir tout le duché de Normandie et commença par s'emparer d'Évreux, sous prétexte de restituer au jeune duc cette portion de ses États ; puis il se saisit de sa personne et le fit transporter à Laon ; le comte de Senlis, vassal de Hugues, enleva Richard. Le duc de France usa de cet avantage pour faire épouser au duc normand sa fille Emma, et ce mariage fut célébré dans la cathédrale de la ville d'Évreux, qui s'était délivrée du joug des Français.
Après Louis IV, son fils Lothaire fit de nouvelles entreprises sur les États normands ; il vint assiéger Évreux, s'en empara et donna cette ville à Thibaud, comte de Chartres, l'un des seigneurs qui lui étaient restés fidèles ; mais Richard ne. tarda pas à la recouvrer. Richard rebâtit Évreux, releva ses églises, qui avaient été détruites dans les précédentes irruptions, et la donna, avec le titre de comté, à son fils naturel Robert, et 989. Ce même Robert obtint de son père l'archevêché de Rouen, en même temps que le comté d'Évreux.
Philippe-Auguste enleva ce comté, en 1193, au comte Amaury III, pour le donner à Jean sans Terre, alors son allié, avec la ville d'Évreux ; ce prince, comptant regagner, par une horrible perfidie, les bonnes grâces des Anglais, invita à un festin les officiers de la garnison française, les fit massacrer et passa au fil de l'épée tous les soldats. Le roi de France, en ce moment occupé au siège de Verneuil, s'empressa d'accourir, reprit la ville et la mit en cendres, puis il conquit presque tout le reste du comté. Amaury fit, en 1200, à Philippe, une cession complète de ses possessions ; le comté d'Évreux fut de la sorte réuni à la couronne.
Il en fut détaché environ un siècle après (1307) par Philippe le Bel en faveur de Louis, fils de Philippe le Hardi. Le nouveau comte servit fidèlement son frère et se distingua dans la guerre contre les Flamands. Plein de sagesse, il pensait qu'un prince n'est grand qu'à la condition de rester soumis à Dieu, au roi et aux lois. Il eut pour successeur, en 1319, son fils Philippe, qui mérita le surnom de Bon ou de Sage. Ce comte avait épousé la princesse Jeanne, fille unique du roi Louis le Hutin et qui prétendait par son père au royaume de Navarre et au comté de Champagne et de Brie. Cette princesse obtint seulement, en 1328, la Navarre, qui passa, en 1349, à son fils, Charles le Mauvais, déjà comte d'Évreux depuis 1343.
La vie agitée de ce prince se passa presque tout entière en dehors de son comté, et la bataille de Cocherel, qu'il perdit le 16 mai 1364, est le seul fait important qui se soit passé sous lui dans le pays d'Évreux. Charles V confisqua, en 1378, les possessions de Charles le Mauvais en Normandie ; mais le roi Charles VI restitua au fils du roi de Navarre, Charles II le Noble, le comté d'Évreux ; ce prince le rétrocéda au roi, en échange d'une rente de 12 000 livres à tenir en duché-pairie avec le titre de Nemours.
Sous ce règne désastreux de Charles VI, les Anglais, victorieux à Azincourt (1415), se répandirent par toute la France et reprirent la Normandie. Après la mort de ce roi, le dauphin Charles VII, dépossédé, en vertu du traité de Troyes, s'efforça inutilement de repousser cette grande invasion anglaise jusqu'au moment où Jeanne d'Arc lui prêta son merveilleux secours ; ses troupes furent battues à Verneuil, par le duc de Bedford, en 1424. Mais lorsque le siège d'Orléans eut été levé, les Français obtinrent des succès presque aussi constants que l'avaient été jusque-là leurs revers.
La Normandie fut cependant l'une des dernières provinces que perdirent les Anglais ; ils ne furent chassés d'Évreux qu'en 1441. La fin du règne de Charles VII et les règnes suivants ramenèrent, avec le calme, un peu de prospérité jusqu'à l'époque de la Ligue. La paix ne fut troublée momentanément que sous Louis XI, par le soulèvement de quelques villes dans la guerre du Bien public. Lorsque la Réforme de Calvin s'introduisit en Normandie, le diocèse d'Évreux dut à la sagesse de ses prélats d'être préservé de l'hérésie.
L'évêque Ambroise Le Veneur visitait souvent, pendant la nuit, les villes et les villages de son diocèse pour voir si l'erreur ne s'y produisait pas. Son successeur, Claude de Saintes, eut la prudence de consentir à réformer le Bréviaire, le Rituel et le Missel d'Évreux, où se trouvaient plusieurs préceptes indignes de la sainteté de la religion. Mais ce pasteur pieux et savant exagéra son zèle religieux au moment où Henri IV fut appelé au trône par la mort de Henri III en 1589 et engagea Évreux dans là ligue contre le roi protestant. Tous les bourgeois s'unirent à' l'évêque ; ils s'armèrent et s'emparèrent du château d'Harcourt en 1590 ; celui de Neubourg fut également emporté, la ville de Conches fut saccagée ; mais Breteuil se défendit courageusement, et le maréchal de Biron vint sommer Évreux de se rendre.
Après quelques pourparlers et un peu d'hésitation, les habitants ouvrirent leurs portes, et l'évêque s'enfuit à Louviers (janvier 1591). Henri IV ne tarda pas à venir en personne dans le comté d'Évreux ; il y gagna sur Mayenne la bataille d'Ivry (1591), s'empara de Louviers, fit prisonnier l'évêque d'Évreux et le transféra au château de Caen, puis à Crèvecoeur, près de Lisieux. Dans les premières années du XVIe siècle, Henri IV visita, avec Marie de Médicis, la plupart des villes de Normandie et, entre autres, Évreux. Le calme se rétablit dans le diocèse, et il ne fut plus troublé que par quelques soulèvements qui eurent lieu en 1649, à l'époque de la Fronde. Le duc de Longueville, gouverneur de Normandie, se révolta et entraîna dans sa rébellion les villes de son gouvernement. François d'Harcourt, marquis de Beuvron, lieutenant général du roi en Normandie, vint mettre le siège devant Évreux ; les bourgeois résistèrent pendant une année environ ; l'emprisonnement des princes de Condé et de Conti et du duc de Longueville (1650) leur fit déposer les armes ; l'évêque, qui s'était déclaré contre la Fronde, rentra dans la ville, et le diocèse jouit d'une longue paix jusqu'en 1789.
Le département de l'Eure, formé en 1790, accueillit avec faveur la Révolution jusqu'au moment où les girondins furent renversés par la Montagne. A ce moment, une armée fédéraliste s'organisa et fut conduite jusqu'à Vernon par le général Wimpfen et le marquis de Puisaye. Le général républicain Schérer eut l'avantage en diverses rencontres ; la guerre se reporta dans la Bretagne et dans la Vendée, et depuis ce temps jusqu'à nos jours la paix ne fut plus troublée dans le département de l'Eure jusqu'à la funeste guerre de 1870-1871.
Lorsque Metz eut succombé et qu'elle eut été livrée plutôt que défendue par le maréchal Bazaine, les troupes du prince Frédéric-Charles, après avoir envahi la Flandre et la Picardie, entrèrent en Normandie ; l'arrondissement des Andelys, situé sur la rive droite de la Seine, fut un des premiers pays normands occupés par les Allemands ; mais ce ne fut pas sans résistance. Le 30 novembre 1870, le général Briand leur livra même un combat heureux et les délogea d'Étrépagny ; mais il fut rappelé sur un autre point par des ordres supérieurs ; l'ennemi revint en force, reprit ses positions et continua sa marche sur Rouen. Évreux fut occupé par l'ennemi, mais il n'eut pas à subir de violences ; et lorsque les Allemands eurent évacué le département, ils lui avaient fait subir une perte de 10 516 053 fr. 90, en réquisitions, impôts, amendes et dommages.
Les départements-(histoire)- La Drome - 26 -
(Région Rhône-Alpes)
Diverses peuplades gauloises habitaient anciennement le territoire dont le département de la Drôme a été formé : les Segalauni, sur la rive gauche du Rhône, depuis la rive droite de l'Isère, jusqu'au Houblon ; les Tricastini, entre le Roubion et l'Aygues, sur les bords du Rhône ; les Vertacomiri, dans les montagnes du Vercors ; les Voconces, sur la pente des Alpes ; les Triulates, dans le Royannais, et les Tricorii, au nord des Voconces.
Toutes ces peuplades avaient chacune ses lois et ses chefs ; mais, divisées en temps de paix, elles se confédéraient dans la guerre. Bellovèse, marchant vers les Alpes, se rendit chez les Tricastini ; de là, il entra sur le territoire des Voconces, et il paraît qu'il entraîna une de leurs peuplades, les Vertacomiri, qui, suivant Pline, fondèrent Novaria (aujourd'hui Novare) en Italie. Annibal traversa le pays des Tricastini et des Tricorii. Sur presque toute la route, les lieux où il s'arrêta s'appellent encore aujourd'hui le camp d'Annibal.
Ravagé par les Cimbres et les Teutons, ce pays fut des premiers conquis par les Romains. Il fit d'abord partie de la Province, puis de la Viennoise. Rome s'efforça de réparer, par de grandes fondations, les maux de la conquête : elle fit participer aux bienfaits de la civilisation les habitants, que le voisinage des Phocéens y avait déjà préparés ; elle polit leurs moeurs, construisit des voies et des aqueducs, éleva des édifices. Il y eut des colonies à Valence, à Die, à Nyons, à Lue, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. La grande voie romaine ou Domitienne traversait la Berre près de Duzera (Donzère), débouchait, par les combes de cette localité, dans les plaines d'Acusio (Montélimar), d'où elle se. dirigeait sur la station de Batiana, aujourd'hui Bance, dans le territoire de Mirmande. Après avoir longé la colline de Livron, au couchant, elle passait à Ambonil (Umbunum), rejoignait la route de Valence à Die sur le territoire d'Étoile, au quartier de Bosse, et passait à Valence, à Châteauneuf, à Tain, Saint-Vallier, Bancel, Roussillon, etc.
Pendant que le génie romain colonisait ce pays, le passage des légions qui se disputaient l'empire, et les fréquentes irruptions des peuples du Nord le couvraient de sang et de ruines. Prétendants et barbares le traitaient en pays conquis ; et quand, vers la fin du ne siècle, il commença à connaître le christianisme, il l'accueillit comme un libérateur. Valence, Die, Saint-Paul-Trois-Châteaux, eurent leurs églises et leurs martyrs.
Après les Wisigoths en 412, les Alains en 430, les Bourguignons vinrent, en 460, se fixer dans le Valentinois et y fondèrent un royaume qui dura jusqu'au milieu du VIIIe siècle ; mais à peine délivré de leur joug par les rois francs, ce pays eut à subir les Sarrasins. Vieillards, femmes, enfants massacrés ou emmenés captifs, villes pillées ou livrées aux flammes, champs ravagés, églises et abbayes renversées, ces terribles conquérants n'épargnaient rien sur leur passage. Partout, dit un historien, l'horreur du désert et l'image de la mort !
Après plusieurs irruptions, ils furent enfin repoussés par Charles Martel. Néanmoins, beaucoup restèrent en Dauphiné et s'y fondirent dans la population indigène. On retrouve encore dans quelques noms de lieux et de rivières des restes de leur langage. C'est ainsi que le petit torrent que traverse la route nationale qui conduit à Nyons, au-dessus du moulin de Vinsobres, a gardé le nom de la Moïe, et ce mot est entièrement arabe (Moïa, eau). Aux Sarrasins succédèrent les pirates normands, en 860, qui pillèrent et ravagèrent la vallée du Rhône.
Cependant, vers la fin du IXe siècle, Valence et le chapitre de Die en vinrent aux mains. Après divers combats et des pertes réciproques, ils firent la paix, mais non pour longtemps. Douze ans après, en effet, ce même évêque ayant voulu lever un subside sur les vassaux de son église, la ville et le chapitre de Die s'en émurent, et la guerre se ralluma. Il fallut, pour l'apaiser, l'intervention du prince d'Orange.
Toutefois, ce n'était là que le prélude de luttes plus longues et plus sanglantes. Les évêques voulaient régner sans partage dans le Valentinois, et la puissance des comtes leur faisait ombrage. De là cette guerre dite des épiscopaux, qui ne finit que par la cession du Valentinois à la couronne de France. Pierre de Chastellux, l'évêque, mit le premier, en 1345, ses troupes en campagne. Battu par celles du comte, il se vengea de sa défaite en mettant à feu et à sang les villages où il passait : Charpey, Alixan, Livron, Barcelone, la vallée de Quint furent la proie des flammes.
C'est le peuple surtout qui souffrit de cette guerre. Les petites armées des comtes et des évêques, également indisciplinées, commandées par des chefs avides de butin et de pillage, ne pourvoyaient à leur subsistance, pendant la campagne, que par la force. Les chevaliers et les soldats étrangers, pour qui le motif de la guerre était indifférent, vendaient leur épée à la fortune de l'évêque ou du comte. Alors, pour les stipendier, il fallait taxer le peuple : bourgeois, artisans, paysans, se voyaient ruinés par des taxes iniques.
Ajoutons encore les ravages de la peste et de la famine : le pain était si rare et si cher, que le peuple était réduit à brouter l'herbe, pendant qu'une fièvre noire le décimait. ON manquait de bras dans les campagnes pour cultiver la terre. Bientôt vinrent les routiers et les aventuriers. Plusieurs de ces compagnies, de retour d'Italie, voulurent traverser le Valentinois ; mais le comte s'y opposa. Alors un combat s'engagea près de Mazene, fatal au troupes du comtes : les routiers s'emparèrent de Châteauneuf et firent prisonniers l'évêque de Valence, le prince d'Orange et le comte de Valentinois lui-même. Aimery de Sévérac, chef des routiers, mit le pays à rançon, et obtint le libre passage.
Jusqu'à la fin du XIIe siècle, le Diois, dont la ville de Die était la capitale, avait eu ses souverains comme le Valentinois : leur héritière avait épousé Guillaume, comte de Forcalquier, qui laissa le Diois à son fils Pons, dont la postérité le posséda pendant trois générations ; mais en 1176, Isoard II, le dernier comte, étant mort sans enfants, l'empereur Frédéric Ier, regardant le Diois comme un fief vacant de l'Empire et du royaume d'Arles, en investit Aymar de Poitiers, comte de Valentinois. Ainsi les deux comtés furent réunis.
Le Valentinois resta longtemps sans faire partie du Dauphiné. D'abord comté, il s'étendait depuis l'Isère jusqu'à la Drôme ; puis duché, depuis l'Isère jusqu'au comtat Venaissin. De 950 à 1419, il fut possédé par les comtes ; mais le dernier, par haine pour sa famille, et accablé de dettes, le vendit au dauphin Charles, depuis Charles VII, à cette condition qu'il ferait partie du Dauphiné. Charles VII n'ayant pas rempli ses engagements vis-à-vis du comte, le duc de Savoie, qui lui était subrogé dans la donation, se mit en possession du comté et du duché de Valentinois, qu'il céda, en 1446, au dauphin, fils de Charles VII.
Ainsi réuni au Dauphiné, le Valentinois le fut à la France. Plus tard, en 1498, Louis XII l'érigea en duché-pairie, et le donna à César Borgia, pour se rendre le pape Alexandre VI favorable ; mais il ne tarda pas à se repentir de sa donation : César Borgia ayant embrassé le parti espagnol contre la France, le roi le déclara coupable de félonie, et lui retira son duché, qui revint à la couronne. Depuis, François Ier en fit don à Diane de Poitiers, pour en jouir pendant sa vie ; mais, en 1642, le Valentinois passa aux princes de Monaco, qui l'ont conservé jusqu'à la Révolution.
Le Valentinois ne reconnaissait le roi que comme dauphin ; l'impôt y était levé non comme une contribution, mais comme un don gratuit. Rien ne s'y faisait sans la sanction du parlement. Bien que la noblesse y fût nombreuse, il y avait des terres sans seigneurs. C'était là que les dauphins venaient se préparer à régner. On sait le long séjour qu'y fit le prince qui devait s'appeler Louis XI.
On cite encore les châteaux qu'il habita et ceux où il marqua son passage par des parties de chasse et de plaisir. Il s'y essaya à cette politique qui devait caractériser son règne ; il y supprima les coutumes et les règlements que les évêques et les seigneurs avaient établis dans leurs terres, autant de petits tyrans qui s'y étaient élevés sur les ruines de l'ancien royaume de Bourgogne, et qu'il abaissa. A l'avènement de Louis XI, ils s'armèrent pour recouvrer leurs privilèges ; ils firent de l'Étoile le centre de la révolte ; mais le gouverneur de la province ayant fait appel aux communes voisines, les révoltés se soumirent, et la puissance féodale ne se releva plus dans ce pays.
A peine sorti des guerres civiles, le Valentinois se vit agité par les guerres religieuses. Déjà, dans la croisade contre les Albigeois, il avait été désigné comme le lieu du rendez-vous. Raymond, comte de Toulouse, passait pour protéger les hérétiques : il fut ajourné à comparaître en personne devant un 'concile à Valence. Il s'y rendit, fit et promit ce . qu'on voulut dans l'intérêt de la paix ; mais les croisés ne voulurent point poser les armes. On sait ce qui arriva. Cependant le Valentinois et le Diois, où Raymond avait des intelligences et des amis, s'agitaient. Simon de Montfort accourut ; mais le comte Aymar, qui commandait les révoltés, lui résista vigoureusement et le contraignit à se retirer.
Plus tard, quand vint la Réforme, elle trouva ce pays déjà préparé par les Vaudois et les Albigeois à la recevoir. Sur plusieurs points, le feu qui couvait éclata. A Valence, à Montélimar, à Romans, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, les protestants prirent les armes et s'emparèrent des églises. Après le massacre de Vassy, la révolte devint générale. D'abord l'ennemi des calvinistes, le baron des Adrets s'était fait leur chef. A son appel, tout ce qu'il y avait de jeunes hommes dans le pays vint se rallier à lui. Non moins redoutable aux catholiques qu'il l'avait été pour les protestants, il soumit tout sur son passage ; mais, comme il faisait la guerre pour la guerre, il devint suspect à son parti, qu'il compromettait par ses cruautés, ce qui le fit arrêter à Valence en janvier 1563.
Catherine de Médicis, dont la politique était de souffler à la fois la paix et la guerre, vint en Dauphiné : elle visita Valence, Étoile, Montélimar et Suze-la-Rousse, promettant partout aux huguenots protection et amitié ; mais la journée de la Saint-Barthélemy leur fit payer cher leur confiance : ainsi qu'à Paris, le sang coula à Valence, à Romans, à Montélimar. Dans cette dernière ville, les magistrats essayèrent, mais en vain, de les sauver en les renfermant dans la citadelle ; on en força les portes, et tous furent égorgés. Alors la guerre recommença, mais cette fois à outrance. Conduits par deux braves chefs, Montbrun et Lesdiguières, les protestants s'emparent de plusieurs places dans le Valentinois et le Diois. Assiégés dans Livron par Bellegarde, chef de l'armée catholique, ils s'y défendent vaillamment et le forcent à la retraite.
Après des alternatives de paix et de guerre, calmés, non satisfaits par l'édit de Nantes, à l'avènement de Louis XIII, ils reprennent les armes. Un fils du célèbre Montbrun les commande : ils assiègent Le Buis, prennent les châteaux de Mollans, de Roilhanette et de Puygiron. Tout le Diois est en leur pouvoir ; mais le prince de Condé le reprend en 1627, les protestants sont désarmés et les forts de Nyons, de Livron, de Die, de Crest, de Soyans et de Moras détruits. Déjà ceux des Saillans, de Pontaix, de Vinsobres, de Tulettes, de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de Loriol, de Puy-Saint-Martin et de Grane avaient été rasés.
Avec la guerre et tous les malheurs qui l'accompagnent, la peste, la famine et d'autres fléaux calamiteux ravagèrent ce pays. Après une invasion de sauterelles en 873, une invasion de chenilles en 1586, à la suite de pluies torrentielles qui avaient corrompu l'air. Ces chenilles étaient en si grand nombre, disent les mémoires du temps, qu'elles infestaient les habitations, les chemins, les arbres, les haies. Beaucoup parmi les superstitieux s'en prirent aux huguenots, mais le plus grand nombre au diable.
Comme le cas était grave, on avisa. Après d'inutiles efforts pour chasser ces nouveaux ennemis, le grand vicaire de Valence les cita à comparaître devant lui et leur nomma un procureur d'office, qui défendit solennellement leur cause : l'avocat fut éloquent, mais malheureux, et ses clientes furent condamnées à « vider les lieux » sous peine de forfaiture et d'excommunication. On leur signifia leur jugement avec défense d'en appeler. Chenilles de ne se mouvoir. Alors, comme on les en avait menacées, on lança contre elles les foudres de l'anathème ; mais, avant de recourir au bras séculier, on voulut essayer des voies de la conciliation. Sur l'avis de deux savants jurisconsultes et de deux théologiens ; qu'il serait plus sage, en pareille matière, de ne se servir que des armes spirituelles, et d'user d'un peu de tolérance envers les chenilles, on se contenta de les adjurer et de les asperger d'eau bénite. O puissance de l'exorcisme ! les chenilles disparurent, longtemps après, il est vrai ; mais qu'importe ? on n'en cria pas moins au miracle.
Après tant d'agitations, protestants et catholiques vivaient en paix dans ce pays, quand la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, vint de nouveau tout diviser. Dans plusieurs communes, notamment à Bourdeaux, à Bezaudun et à Chantemerle, les protestants coururent aux armes. On ne les soumit point, on les persécuta. Rien n'était épargné, ni l'âge ni le sexe. A Poët-Laval, trois jeunes filles eurent la tête tranchée ; une quatrième, fut pendue à un peuplier. A Die, le pasteur Ranc fut décapité, et sa tète exposée sur un poteau à la porte d'un cabaret. Sur la fin de 1745, les prisons de Crest, de Montélimar de Valence et de Die étaient remplies de protestants ; condamnés à mort, ils marchaient avec joie au martyre, comme les premiers chrétiens. Cette persécution dura jusqu'au règne de Louis XVI.
Si le Dauphiné donna le premier, à Vizille, le signal de la Révolution, le premier il se leva pour la défendre : douze mille citoyens armés se rassemblèrent, en 1789, dans la vallée du Rhône, et jurèrent « de rester à jamais unis, de se donner mutuellement toute assistance, et de voler au secours de Paris et de toute autre ville de France qui serait en danger pour la cause de la liberté. » Ce serment, les habitants de la Drôme surent le tenir en envoyant, en 1792, les premiers volontaires aux frontières.
C'est avec eux que furent formées en grande partie la 4° demi-brigade légère, la 57e de ligne, qu'on surnomma la Terrible ; la 18e, à qui Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, adressa ces paroles, en lui donnant l'ordre d'attaquer à la bataille de Rivoli : « Brave dix-huitième, je vous connais ; l'ennemi ne tiendra pas devant vous ! » et enfin cette 32e demi-brigade, qui se couvrit de gloire à Arcole : « J'étais tranquille, lui dit Napoléon, la 32e était là ! »
Ce département fut ravagé, en 1795, par les compagnies de Jéhu et du Soleil, et par la réaction royaliste, en 1815. Il avait salué le retour de Napoléon et pris une part active aux Cent-Jours, en s'opposant à la marche du duc d'Angoulême sur Paris. « Après avoir remonté la vallée du Rhône jusqu'à Valence, il (ce prince) se vit arrêté devant Romans par les troupes impériales. Alors, il rétrograda sur Pont-Saint-Esprit. Repoussé de cette ville, il se retira sur La Palud. Cependant les troupes impériales n'avaient pas cessé de le poursuivre. Arrivées à Montélimar, et leur avant-garde occupant Donzère, elles se disposaient à l'attaquer ; mais déjà le duc, effrayé du mouvement des gardes nationales qui le pressaient de toutes parts, avait conclu avec le général Gilly une capitulation qui l'obligeait à poser les armes et à s'embarquer au port de Cette. » (Ferrand et Lamarque, Histoire de la Révolution française de 1789 à 1830.)
Après le coup d'État du 2 décembre, il y eut, sur plusieurs points du département, des rassemblements armés qui ne tardèrent pas à être dispersés, non sans coûter la liberté à quelques insurgés faits prisonniers ; mais à ces jours orageux succéda une ère plus calme, à la faveur de laquelle le département vit renaître son industrie agricole et son commerce.
Si le département de la Drôme n'a pas eu à souffrir de la guerre 1870-1871, il a pris une large part à la défense nationale en envoyant à l'armée de la Loire son contingent de mobiles dont plus d'un s'est signalé dans les divers combats qui furent livrés contre les Prussiens.
Il y a au XIXe siècle, dans les mœurs, dans le langage, dans le caractère et dans le costume des habitants de la Drôme, quelque chose des vieux Celtes, leurs ancêtres : ils portent la braye comme eux, et comme eux encore ils sont gais, vifs, vaillants, hospitaliers, actifs et laborieux. Cependant, si le citadin se ressent davantage des rapports de ce pays avec le Midi, qui l'avoisine, le paysan et le montagnard, par une bonhomie qui n'exclut pas la finesse et la ruse, semblent se rapprocher des Normands. Ainsi que la Normandie, en effet, le Dauphiné est le pays des procès.
Les départements-(histoire)- Le Doubs - 25
(2ème partie)
Vers 1076, un des plus riches comtes du royaume de France, Simon de Crépy en Valois, fut touché de la grâce divine ; préférant à l'éclat de la gloire une pieuse obscurité, il abandonna ses dignités et ses richesses et vint s'enfermer dans un monastère de la Franche-Comté. Bientôt, peu satisfait des mortifications et des pénitences qu'il s'imposait à Saint-Claude, Simon résolut de rendre utile sa retraite du monde, et, suivi de quelques compagnons, il pénétra, une hache à la main, dans les solitudes du Jura et s'ouvrit un passage à travers les forêts jusqu'aux sources du Doubs.
Là, les pieux cénobites s'appliquèrent à défricher un sol infertile et malsain, hérissé de broussailles, au milieu des précipices, parmi les rochers âpres et nus ; dans une région déserte, dont les échos, pour la première fois, retentissaient des cris de l'homme, Simon et ses rares compagnons firent tomber sous la cognée les arbres séculaires, frayèrent des chemins là où l'homme n'en connaissait pas avant eux ; ils fertilisèrent un sol longtemps rebelle a la charrue, et après bien des périls, bien des fatigues et des privations journalières, ils eurent conquis sur cette terre Inhospitalière la contrée qu'on a longtemps appelée les Hautes-Joux et les Noirs-Monts.
Le prieuré qu'avait fondé le puissant comte devenu pauvre solitaire, et qui fut habité après lui par ses disciples, prit le nom de Motta (maison des bois) et il a été l'origine de ce joli village si pittoresque de Mouthe, dans l'arrondissement de Pontarlier, et qui aujourd'hui s'enorgueillit de ses riches pâturages. A Rainaud II succéda Guillaume II, dit l'Allemand, qui fut, selon toute vraisemblance, assassiné par ses barons. Ce comte s'écarta de l'esprit de piété de ses prédécesseurs ; il ne craignit pas de porter une main téméraire sur les richesses que l'abbaye de Cluny tenait de leur dévotion. Son crime ne resta pas sans châtiment.
L'abbé Pierre le Vénérable nous apprend qu'un jour qu'il revenait d'exercer de nouvelles spoliations dans le saint lieu, méprisant les conseils des hommes sages et les prières des moines, il chevauchait orgueilleusement, et répondait à ceux qui lui demandaient s'il ne craignait pas d'attirer sur lui le courroux du ciel : « Quand mon or sera épuisé, j'en irai prendre d'autre au bon trésor de Cluny. » Tout à coup, à l'entrée d'un sentier étroit, un cavalier monté sur un cheval noir s'arrêta devant lui. « Comte de Bourgogne, dit-il en le fixant de son farouche regard, comte de Bourgogne, il te faut m'accompagner. - Qui donc es-tu et de quelle race pour regarder si fièrement le maître de tout ce pays ? » repartit Guillaume. "Tu vas le savoir » répondit le cavalier ; puis il saisit le comte, l'assit sur son cheval, et ceux qui l'accompagnaient voient avec une surprise mêlée de terreur deux vastes ailes s'ouvrir aux flancs du coursier ; le cavalier mystérieux et le comte furent emportés dans les airs, et bientôt l'œil ne put plus les suivre. Il se répandit une grande odeur de soufre et de fumée, et on dit que c'était le démon lui-même qui était venu chercher le comte impie.
Des historiens peu crédules ont prétendu que Guillaume fut assassiné par ses barons, qui, pour détourner les soupçons, imaginèrent cette fable. Vinrent ensuite Guillaume III l'Enfant et Rainaud III, qui mourut en 1148 laissant ses États à sa fille, la jeune Béatrix. Celle-ci épousa en 1156 l'empereur Frédéric Ier. L'année suivante, ce souverain tint une diète à Besançon, dans laquelle il reçut le serment de fidélité des prélats et des seigneurs de la contrée. Sa femme mourut en 1185 ; il se déposséda alors de la Comté en faveur de son troisième fils Othon et ne retint que Besançon, qui devint ville impériale et resta dans cet état jusqu'en 1656, époque à laquelle elle fut rachetée par l'Espagne. La fille d'Othon, Béatrix, qui lui succéda en 1200, porta la Comté dans une famille étrangère par son mariage avec Othon, duc de Méranie (Moravie), marquis d'Istrie et prince de Dalmatie. Après. Béatrix, Othon III (1234-1248), Alix de Méranie (1248-1279), sa sœur et Othon IV, dit Ottenin (1279-1303) régnèrent. Ce dernier fut un fidèle allié des rois Philippe le Hardi et Philippe le Bel. II changea les armoiries des comtes de Bourgogne ; jusque-là elles étaient : de gueules, à l'aigle éployée d'argent ; il y substitua, vers 1280, l'écu semé de billettes d'or, au lion de même.
Ce fut dans les dernières années d'Othon ou dans les premières de son successeur, Robert l'Enfant (1303-1315), que le roi Philippe le Bel érigea en parlement le conseil des comtes de Bourgogne. Le parlement de Besançon fut l'un de ceux qui eurent les pouvoirs les plus étendus : outre les affaires contentieuses, il connaissait encore, pendant la paix, de toutes les affaires concernant les fortifications, les finances, les monnaies, la police, les chemins, les domaines et les fiefs. Pendant la guerre, il réglait la levée des troupes, leurs quartiers, leurs passages, les étapes, subsistances, payements et revues.
Ces pouvoirs étendus et presque royaux ne lui furent pas conférés de prime abord, mais par des ordonnances successives de 1508, 1510, 1530, 1533 et 1534. Jeanne Ire, qui épousa le roi Philippe le Long, succéda à Robert l'Enfant (1315-1330) et laissa la possession de la province à sa fille Jeanne II, qui, en 1318, avait épousé Eudes IV, duc de Bourgogne. Leur petit-fils, Philippe de Rouvres, fut en même temps duc et comté, et, pour la première fois depuis Boson, les deux Bourgognes se trouvèrent réunies (1350-1461).
A sa mort, tandis que le duché rentrait dans la possession des rois de France, la Comté passa en héritage à Marguerite, fille de Philippe le Long et de la reine Jeanne ; cette princesse eut pour successeur Louis de Male, comte de Flandre (1382). Tous les États de ce comte passèrent à Philippe le Hardi, fils de Jean le Bon et le premier de cette race capétienne de Bourgogne qui, jusqu'à Louis XI, contrebalança l'autorité royale. L'an 1386, la ville de Besançon renouvela, avec le duc Philippe, le traité qu'elle avait signé avec les anciens comtes.
La même année, Philippe exigea le droit féodal qu'on appelait relevamentum, la reprise des fiefs ou renouvellement d'hommage de ses vassaux de Franche-Comté, accoutumés depuis longtemps, par l'absence de leurs suzerains, à, vivre dans l'indépendance. La partie de la Franche-Comté dont nous nous occupons, éloignée du théâtre des guerres des Anglais, des Armagnacs et des Bourguignons, eut moins à souffrir dans toute cette période que tout le reste de la France ; cependant elle ne fut pas épargnée par la peste noire en 1348 et 1350. Les routiers vinrent aussi « y querir victuaille et aventures, » et, à l'histoire du Jura, nous les retrouverons à Salins ; mais ces maux, quoique grands, étaient peu de chose comparés à l'affreuse dévastation, à la misère profonde de tant d'autres provinces ; d'ailleurs, dans la Franche-Comté même, le territoire qui a formé le Doubs dut à sa position extrême d'être moins atteint par les brigandages.
Les villes avaient acquis une existence particulière : nous retrouverons à leur histoire spéciale leurs chartes communales. Le règne de Philippe le Bon fut marqué par des troubles dont il sera fait mention quand nous nous occuperons de Besançon. A la mort de Charles le Téméraire (1477), la Franche-Comté ne passa pas, avec le duché de Bourgogne, au roi Louis XI ; la princesse Marie porta cette province dans la maison d'Autriche par son mariage avec Maximilien, aïeul et prédécesseur de Charles-Quint. En 1482, Marguerite succéda à sa mère ; son frère Philippe le Beau gouverna quelques années, de 1493 à 1506. Enfin, à sa mort (1530), la province passa sous la domination de son puissant neveu Charles-Quint, roi d'Espagne et empereur d'Allemagne.
Le règne de Charles-Quint fut pour la Franche-Comté un temps de prospérité ; il aimait cette province et accorda des privilèges à un grand nombre de ses villes ; Besançon eut les siens ; le commerce et l'industrie firent des progrès rapides sous cette administration bienfaisante et ne s'arrêta que lorsque le voisinage de la Suisse eut introduit la Réforme dans la Comté. Besançon eut ses religionnaires, ses luttes intestines, un tribunal de l'inquisition et des persécutions violentes. Guillaume Farel avait prêché la Réforme à Montbéliard dès 1524 ; après lui, Théodore de Bèze et d'autres missionnaires semèrent en Franche-Comté les nouvelles doctrines. Une confrérie, sous l'invocation de sainte Barbe, réunit les membres les plus considérables du parti protestant.
En 1572, il y eut dans Besançon une lutte sérieuse entre les partis catholique et protestant. Après les guerres de religion vinrent les guerres de la conquête française. Henri IV, devenu roi de France malgré la Ligue et l'Espagne, envahit la province espagnole de Franche-Comté après sa victoire de Fontainebleau en 1595. Pendant la guerre de Trente ans, la Franche-Comté fut menacée de nouveau, et la ville de Pontarlier fut assiégée par le duc de Saxe-Weimar, commandant des forces suédoises.
Mais la grande invasion, celle qui eut pour résultat de rendre française cette province, appartient au règne de Louis XIV. Ce prince réclama la Franche-Comté au nom des droits qu'il prétendait tenir de sa femme, Marie-Thérèse ; la guerre de dévolution, terminée par le traité d'Aix-la-Chapelle (1668), la lui livra. Mais, cette même année, la province fut restituée par la France à l'Espagne, en échange de l'abandon de tous droits sur les conquêtes faites par Louis XIV dans la Flandre. La guerre se renouvela en 1672. Besançon tomba au pouvoir des Français, toutes les villes de la province furent prises une à une, et le traité glorieux de Nimègue rendit définitive cette seconde conquête (1678). Louis XIV s'empressa de donner une nouvelle organisation à la province devenue française. La bourgeoisie franc-comtoise perdit la plupart de ses privilèges ; Besançon fut définitivement capitale de la Franche-Comté et siège du parlement et de l'université, qui avaient été transférés à diverses époques à Dôle.
A la convocation des états généraux, la Franche-Comté, comprise dans le nombre des provinces étrangères et États conquis et surchargée d'impôts, accueillit avec empressement les idées nouvelles, et, lorsque la patrie fut déclarée en danger, les trois départements fournirent chacun leur bataillon de volontaires. Pendant la Terreur, Robespierre le jeune fut envoyé en mission dans le Doubs ; cependant les excès furent modérés, et le 9 thermidor y mit entièrement fin.
En décembre 1813 et janvier 1814, ce département vit un corps d'armée autrichien assiéger Besançon, qui se défendit vainement avec courage. Depuis cette époque jusqu'à la guerre franco-allemande (1870-1871), le Doubs a subi les révolutions qui se sont faites en France bien plus qu'il ne s'y est mêlé ; au milieu du calme et de la paix, il a vu se développer sa prospérité ; il peut s'enorgueillir des hommes illustres qu'il a donnés à notre siècle, et aujourd'hui il est l'un des premiers départements de la France, comme la Franche-Comté en était une des premières provinces. Cette prospérité devait être troublée.
Durant la guerre franco-allemande (1870-1871), le département du Doubs eut à subir les douleurs de l'invasion. A l'exception de Besançon, le département tout entier fut occupé par les Allemands, notamment les localités suivantes : Ancey, L'Isle-sur-le-Doubs, Clairval, Baume-les-Dames, Doris, Montbéliard, Blamont, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Morteau, par les troupes du XIVe corps de la IVe armée, sous les ordres du général de Werder ; Quingey, Villeneuve, Levier, Sombacourt, Chaffois, Pontarlier, La Cluse, par l'armée du général Manteuffel. Le Doubs fut alors le théâtre de la désastreuse retraite de l'armée de l'Est, presque comparable à la retraite de Rassie en 1812. Nous allons en retracer aussi brièvement que possible les douloureuses péripéties.
Après la reprise d'Orléans par les Allemands et la défaite des armées de la Loire, le gouvernement de la défense conçut, le 20 décembre 1870, le plan d'opérer une diversion dans l'Est et de débloquer Belfort assiégé. Le général Bourbaki accepta cette tâche difficile. Le 11 janvier, il livrait à Villersexel (Haute-Saône) un sanglant combat et s'emparait de cette ville ; le 14, il arrivait sur les hauteurs de la rive droite de la Lisaine, et le 15 il établissait son quartier général à Trémoins. Alors commençaient ces rudes batailles entre Montbéliard et Belfort, qui ont pris le nom de bataille d'Héricourt (Haute-Saône). Le 15 au soir, notre armée entrait dans Montbéliard ; l'ennemi s'était retiré dans le château. Le 16, les lignes allemandes furent attaquées avec acharnement. La droite de l'armée ennemie seule céda ; Cremer délogea le général Degenfeld de Chenebrier et le repoussa jusqu'à Frahier.
Dans la nuit, un mouvement sur Béthencourt est repoussé ; une autre attaque, tentée sur Héricourt, a le même sort. La garnison de Belfort n'avait pu intervenir dans la lutte. L'armée française s'était épuisée sans parvenir à rompre les lignes allemandes. Il fallait renoncer à faire lever le siège ; il fallait reculer pour vivre ; le temps était terrible, le thermomètre marquait 18 degrés au-dessous de zéro. Comment continuer, avec des soldats exténués par la misère et par la fatigue, une lutte' où l'on s'acharnait inutilement depuis trois jours ? Le général Bourbaki prit, le soir du troisième jour, le parti de se retirer vers le sud. Nos troupes quittaient les bords de la Lisaine le 18 janvier et arrivaient le 22 autour de Besançon, où le général en chef comptait pouvoir mettre son armée à l'abri et la réorganiser ; mais cela était devenu impossible ; en effet, Manteuffel, parti le 12 de Châtillon, ayant évité Dijon, occupé par Garibaldi, et masqué ses mouvements, traversait, par une marche aussi audacieuse qu'elle pré-sentait de danger, les montagnes de la Côte-d'Or ; le 22, il tenait les deux rives du Doubs ; le 28, il arrivait à Quingey, se jetant sur les routes d'Arbois et de Poligny, coupant la ligne directe de Besançon à Lyon.
En même temps, de Werder descendait vers le sud, en sorte que Bourbaki, en arrivant sous Besançon, se trouvait dans la position la plus critique. Pour comble de malheur, un convoi de deux cent trente wagons chargés de vivres, de fourrages et d'équipements, avait été surpris par l'ennemi à Dôle. D'heure en heure se rétrécissait autour de nous le réseau qui menaçait de nous étouffer. La situation était poignante. Que faire ? Battre encore en retraite. Mais de quel côté se diriger, par où se frayer un passage ?
Affolé de désespoir, craignant de passer pour un traître, entre cinq et six heures du soir, le 26 janvier, Bourbaki, retiré dans une maison particulière, à Besançon, se tira au front un coup de pistolet. « La mort, une fois de plus bravée, dit M. Claretie, ne voulut pas de lui. Le général Clinchant prit le commandement des troupes. La tâche qui lui incombait était lourde. Comment échapper, comment sauver cette armée débandée, perdue, incapable de résister aux coups de l'ennemi ? Il fallait reculer, battre en retraite - chaque minute était un siècle - et toujours mourant, toujours souffrant, toujours glacé, essayer de gagner Lyon ou la Suisse. Le général Clinchant n'avait pas le choix ; il ne pouvait que presser et diriger la retraite sur Pontarlier. Il arrivait le 28 autour de cette ville. Dès le 29, les Allemands arrivaient, après un combat où ils firent 4 000 prisonniers du 15e corps, à Levier, à Sombacourt, à Chaffois, à 4 kilomètres de Pontarlier, sur la route de Salins.
« A ce moment, dit un historien de la guerre franco-allemande, parvenait aux deux camps la nouvelle de l'armistice conclu à Paris le 28 ; mais les Allemands étaient avertis, par M. de Moltke, que l'armée du Sud devait continuer ses opérations, jusqu'à ce qu'elle eût obtenu un résultat définitif ; en sorte que la chute de Paris excitait son ardeur, tandis que le général Clinchant, ignorant la fatale exception contenue dans le traité, laissait tomber ses armes et faisait cesser le combat. Le 30, quand on dut les reprendre, la marche continuée des Allemands aggravait la situation. Ils enlevaient Frasne, sur le chemin de fer, et 1 500 prisonniers. Cremer était à Saint-Laurent, séparé de l'armée et à peu près sauvé par cela même... Le 1er février, toute l'armée allemande aborde Pontarlier, qui est enlevée presque sans résistance. Cependant le 18e corps est encore à la croisée des routes de Mouthe et de Rochejeau, appuyé sur le fort de Joux, près de La Cluse, à 15 kilomètres au sud de Pontarlier. Là, un dernier combat s'engage avec le IIe corps prussien, qui, repoussé tout le jour, s'attacha seulement à achever de couper les routes du sud jusqu'à la frontière. Il n'y parvint qu'imparfaitement, et une partie du 18° corps put regagner la route de Lyon. »
Le général Clinchant, on le conçoit, n'avait plus alors qu'une préoccupation, celle de dérober à l'ennemi les soldats qui lui restaient, ses armes, son matériel, fût-ce en allant chercher un refuge au delà de la frontière. Pendant la nuit du 31 janvier au 1er février, il signait aux Verrières, avec le général suisse Herzog, une convention qui réglait le passage de l'armée française en Suisse. Cette armée, exténuée, y entrait au nombre de 80 000 hommes. « C'était, depuis six mois, dit Charles de Mazade, la quatrième armée française disparaissant d'un seul coup, après celles de Sedan et de Metz, qui étaient encore captives en Allemagne, et celle de Paris, qui restait prisonnière dans nos murs. »
Dans cette immense douleur, dans cet épouvantable désastre, nous eûmes, du moins, la consolation de voir nos malheureux soldats accueillis par la généreuse république helvétique avec une touchante humanité. « Pauvre armée en lambeaux, écrit Claretie, pauvres soldats en haillons ! Lorsque les Suisses les virent, pâles, exténués, mourants, tous pleurèrent. Une immense pitié s'empara de ces cantons, qui se saignèrent pour fournir vivres, argent, vêtements aux vaincus et aux exilés. » La France a contracté en cette lamentable circonstance une dette qu'elle n'oubliera pas. L'invasion allemande avait coûté au Doubs 5 517 370 francs.
Les départements-(histoire)- Le Doubs - 25 -
1ère partie
(Région Franche-Comté)
Le département du Doubs fut, dans la période gauloise, habité par une partie de la nation puissante des Séquanais. On ignore à quelle époque ce peuple envahit la Gaule ; mais il paraît certain qu'il fut parmi les Celtes un des premiers qui s'y fixèrent. La tradition disait qu'ils étaient venus des bords du Pont-Euxin. Lorsque les neveux, du roi Ambigat, Bellovèse et Sigovèse, franchirent les Alpes 600 ans avant Jésus-Christ, les Séquanais furent au nombre des barbares qui portèrent pour la première fois en Italie les armes gauloises.
Ce fut à l'époque où la domination romaine commença à s'étendre par delà les hautes montagnes qui séparent l'Italie de la Gaule que les Séquanais acquirent une grande importance historique. On sait que Rome accordait sa protection aux Éduens : cette vaste confédération mit à profit la suprématie qu'elle devait au titre de « soeur et alliée du peuple romain » pour tyranniser ses voisins les Arvernes et les Séquanais. Jaloux de cette puissance, les Séquanais cherchèrent à leur tour des alliés au dehors ; ils attirèrent en Gaule, par l'appât d'une forte solde, 15 000 mercenaires germains conduits par Arioviste, le chef le plus renommé des Suèves, vaste confédération teutonique qui dominait dans la Germanie.
Grâce à ce secours, les Séquanais furent vainqueurs et les Éduens se reconnurent leurs clients ; mais bientôt ils furent plus malheureux que les vaincus ; Arioviste, qu'était venue rejoindre une multitude de barbares, exigea des Séquanais un tiers de leur territoire ; il prit la partie la plus rapprochée de la Germanie, celle qui aujourd'hui forme le département du Doubs ; puis, jugeant ce lot insuffisant, il exigea un autre tiers. Les Séquanais, indignés, se réconcilièrent alors avec les Éduens ; il y eut une grande bataille où l'armée gauloise fut taillée en pièces. Nous parlerons, dans la notice sur la Haute-Saône, de cette sanglante défaite de Magetobriga. Arioviste fut alors maître de tout ce pays, « le meilleur de la Gaule », dit César au livre Ier de ses Commentaires.
Mais la conquête du chef suève avait encouragé d'autres barbares à envahir les Gaules ; on connaît ce grand mouvement des Helvètes qui détermina l'intervention de Rome et de Jules César. L'an 58, le proconsul, après avoir fait alliance avec Arioviste, quitta la province, marcha sur Genève avec une seule légion, coupa le pont du Rhône, retourna à Rome chercher son armée et revint, par une de ces marches rapides qui lui frirent depuis familières, accabler les Helvètes. Vainqueur de ces premiers ennemis, César se tourna contre Arioviste et lui enjoignit de quitter le pays des Éduens et des Séquanais. « Que César vienne contre moi, répondit le Suève, il apprendra ce que peuvent d'invincibles Germains qui depuis quatorze ans n'ont pas couché sous un toit. » Le Proconsul entra aussitôt en Séquanaise, gagna son ennemi de vitesse et s'empara de la capitale du pays, Vesontio, où il établit sa place d'armes et ses magasins.
La bataille, dans laquelle la discipline romaine triompha du nombre et de l'impétuosité des barbares, se livra à trois journées de Besançon, vers le nord-est. Les Séquanais furent délivrés de leurs oppresseurs germains ; mais' ils ne firent que changer de maîtres : les Romains occupèrent militairement leur pays, y envoyèrent des administrateurs et des agents ; la domination romaine savante, policée et durable s'établit au mi-lieu d'eux. Ceux des Séquanais qui regrettaient les temps de l'indépendance gauloise quittèrent leur patrie et remontèrent vers le nord, afin d'exciter contre leurs oppresseurs les peuples belges ; ces Gaulois intrépides et sauvages se prêtèrent facile-ment à ce dessein ; leurs attaques furent pour César l'occasion et le prétexte de la conquête des Gaules ; il était à Besançon quand commencèrent les hostilités.
L'indépendance de toute la Gaule, et en particulier celle des Séquanais, fut perdue sans retour par la soumission de Vercingétorix. A partir de ce moment, ils restèrent fidèles aux traités et servirent avec loyauté dans les armées romaines. Lucain fait un grand éloge de la cavalerie séquanaise et nous représente la légion vésontine marchant au combat avec sa vieille enseigne : un globe d'or dans un cercle rouge. Auguste avait compris la Gaule transalpine dans les provinces impériales et classé la Séquanaise dans la Belgique (28 ans av. J.-C.) ; cette province prit le nom de Maxima Sequanorum à l'époque de la division administrative de Dioclétien et eut pour capitale Besançon (292).
Au IIe et au IIIe siècle, une, grande partie de la Séquanaise était chrétienne. De Lyon, la foi nouvelle remonta, vers le nord de la Gaule ; en 180, deux jeunes Athéniens, disciples de l'évêque Irénée, Ferréol et Ferjeux, portèrent la foi évangélique chez les Séquanais ; ils firent un si grand nombre de prosélytes, que Besançon ne tarda pas à devenir le siège d'une nouvelle église dont Ferréol fut le premier évêque. Mais les deux disciples de saint Irénée payèrent de leur sang leur généreuse propagande : ils firent mis à mort en 211. Saint Lin, saint Germain et les autres successeurs de saint Ferréol étendirent la foi chrétienne malgré les persécutions, et, au temps de Dioclétien, la Séquanaise entière était convertie au christianisme.
A cette époque, les provinces de la Gaule qui confinaient à la Germanie n'avaient pas de repos ; elles étaient sans cesse menacées par les barbares. Avant les invasions définitives des Burgondes et des Francs, les habitants de la Séquanaise eurent à souffrir d'un grand nombre d'incursions passagères. Lorsque Julien, alors césar, se rendit à Besançon, après ses victoires sur les Francs et les Allemands. dans les années 358 et 359, il trouva toute la province dont cette ville est la capitale ravagée et, à Besançon même, il ne vit que des traces de dévastation : « Cette petite ville, écrit-il au philosophe Maxime, maintenant renversée, était autrefois étendue et superbe, ornée. de temples magnifiques et entourée de murailles très fortes, ainsi que la rivière du Doubs qui lui sert de défense. Elle est semblable à un rocher élevé qu'on voit dans la mer et presque inaccessible aux oiseaux mêmes, si ce n'est dans les endroits qui servent de rivage au Doubs. »
Avant de se jeter sur l'Espagne, les Vandales laissèrent aussi en Séquanaise des traces de leur passage. Ce fut enfin en 410 que l'une des invasions définitives qui se fixèrent sur le sol et lui donnèrent pendant longtemps son nom, celle des Burgondes, se répandit dans la Séquanaise. Les nouveaux maîtres, de mœurs paisibles et douces, ne furent pas des oppresseurs ; ils se contentèrent de s'approprier une partie du sol sans établir des impôts onéreux et vexatoires ; ils laissèrent à leurs sujets leurs lois romaines, leur administration municipale et vécurent avec eux dans une égalité parfaite, chacun selon ses lois. Le patrice Aétius chassa momentanément les Burgondes de la Séquanaise, de 435 à 443 environ. Aux ravages occasionnés par cette guerre s'en ajoutèrent de bien plus terribles. Attila, battu à Châlons-sur-Marne (451), fit sa retraite par l'orient de la Gaule, et Besançon fut tellement ruinée par les Huns que pendant cinquante ans elle resta déserte.
L'établissement définitif des Bourguignons dans les pays éduen et séquanais, qui devinrent les deux Bourgognes, date de l'année 456. Le Suève Ricimer, héritier des dignités d'Aétius qui venait d'être mis à mort par Valentinien III, partagea ces pays entre les chefs burgondes Hilpéric et Gondioc, avec lesquels il avait formé une alliance de famille. Gondioc laissa en mourant le territoire de Besançon et cette ville à l'un de ses quatre fils, Godeghisel, uni à Gondebaud et devenu maître de toute la Séquanaise par le meurtre de deux de ses frères. Godeghisel fit secrètement alliance avec le roi des Francs Clovis et abandonna son frère dans la bataille qui eut lieu sur les bords de l'Ouche en 500. Gondebaud tira vengeance de cette trahison : lorsqu'il eut obtenu la paix de Clovis, il tourna ses armes contre son frère, le battit et le fit massacrer. Gondebaud fut alors maître du territoire séquanais et y imposa son code, la célèbre loi Gombette, jusqu'au moment où les fils de Clovis prirent aux enfants de Gondebaud tout leur héritage et s'emparèrent de la Bourgogne (534).
Lorsque la monarchie franque fut partagée entre les quatre fils de Clotaire Ier, le pays dont nous nous occupons échut avec toute la Bourgogne à Gontran (561-593). Grâce à son éloignement des champs de bataille, il traversa sans trop de vicissitudes cette période de la domination des Francs. Ses nouveaux maîtres étaient cependant de mœurs moins douces que les paisibles Bourguignons ; Besançon commençait à se relever des ruines et des désastres des invasions précédentes, quand survinrent les Sarrasins. En 722, les hordes d'Abd-el-Rhaman passent la Loire, remontent la Saône, se divisent vers Autun en deux bandes : l'une se dirige vers l'ouest, tandis que la seconde livre aux flammes Besançon et tout le pagus de Warasch ou Varasque, qui se composait alors du territoire aujourd'hui compris dans le département du Doubs. Tandis que la Bourgogne citérieure ou en deçà de la Saône commençait à former ses divisions féodales et à se diviser en comtés, la Bourgogne ultérieure ou Franche-Comté conservait les divisions barbares qui avaient pris naissance avec les Burgondes et s'appelaient pagi.
Pépin le Bref laissa à sa mort (768) les deux Bourgognes à son fils Carloman ; on sait que ce prince n'en jouit pas longtemps ; se retirant dans un monastère, il laissa ses États à des enfants en bas âge qui furent dépossédés par leur oncle Charlemagne. L'histoire du département du Doubs se confond avec celle du vaste empire du héros germain ; on sait seulement que les Bourgognes profitèrent de la réforme administrative à laquelle il soumit tous ses États ; mais ce ne fut pas pour longtemps ; les troubles du règne de Louis le Débonnaire survinrent, puis les discordes de ses fils lui survécurent.
Après la bataille de Fontanet (841) et le traité de Verdun (843), les deux Bourgognes furent séparées pour la première fois. La Bourgogne éduenne échut à Charles le Chauve et la Bourgogne séquanaise à Lothaire. Cet empereur mourut en 855. La haute Bourgogne ou Bourgogne cisjurane entra dans la part du plus jeune de ses trois fils, Charles, roi de Provence. A la mort de ce prince (863), ses frères Louis II et Lothaire II firent deux parts de son royaume ; la haute Bourgogne fut scindée, la plus grande partie du territoire qui forme le département du Doubs échut avec Besançon à Lothaire II.
Lothaire ne survécut que de six ans à son frère Charles. Le roi de France, Charles le Chauve, profita des embarras et des guerres dans lesquels son neveu, Louis II, était engagé en Italie pour se saisir des États de Lothaire II ; il se fit proclamer roi de Lorraine à Metz ; mais Louis II protesta, et un nouveau partage plus bizarre que tous les précédents eut lieu. La haute Bourgogne fut complètement démembrée, le pagus de Varasque, qui. avait pris le nom de Comté, échut à Louis, depuis Besançon jusqu'à Pontarlier, tandis que Besançon même était concédée à Charles le Chauve par un traité conclu au mois d'août 870.
Pour se reconnaître dans cette multiplicité de partages où l'historien lui-même, s'il veut ne pas se perdre, a besoin d'apporter une attention soutenue, il faut bien songer que les noms de haute Bourgogne, Bourgogne ultérieure et Bourgogne cisjurane s'appliquent tous également à cet ancien pays des Séquanais que nous n'avons pas encore le droit d'appeler du nom de Franche-Comté. Tant de dislocations et de changements nuisaient aux relations et aux intérêts des localités et faisaient périr tous les éléments d'unité et de pouvoir. La partie de la haute Bourgogne qui échut a Charles le Chauve protesta contre le partage de 870 ; Gérard de Roussillon, ce héros du premier temps féodal, gouverneur de Provence et de Bourgogne, s'opposa par les armes à son exécution ; ce fut aux environs de Pontarlier que se livra la bataille qui décida en faveur du roi de France :
Entre le Doubs et le Drugeon
Périt Gérard de Roussillon
dit une vieille tradition. Gérard ne périt pas, mais fut chassé et cessa de contester à Charles l'occupation du pays. Nous retrouvons deux fois le prince à Besançon ; la première à la suite de sa victoire,, la seconde lorsque, après la mort de son neveu Lothaire II (875), il descendit en Italie pour s'y faire couronner empereur. On sait que, l'année même de sa mort (877), Charles le Chauve ratifia, par le fameux capitulaire de Kiersy-sur-Oise, les usurpations de la féodalité.
Le gouverneur des Bourgognes et de la Provence, Boson, n'avait pas attendu la sanction royale pour se rendre indépendant dans les pays qui lui étaient confiés ; mais ce fut seulement en 879, à la mort de Louis le Bègue, qu'il tint à Mantaille une diète générale où, entre autres personnages influents, nous voyons figurer l'archevêque de Besançon. Il se fit donner le titre de roi de Bourgogne. L'année qui suivit sa mort (888), les Normands ravagèrent la haute Bourgogne ; son successeur, en bas âge, Louis, était incapable de défendre les États de son père ; il fut dépossédé du comté de Bourgogne ou Bourgogne cisjurane par son oncle Rodolphe, qui avait séduit Thierry Ier, archevêque de Besançon, en lui offrant le titre de grand chancelier de Bourgogne.
Ce ne fut cependant pas sans opposition de la part d'Arnoul, que les Germains s'étaient donné pour roi après avoir déposé le lâche empereur Charles le Gros à la diète de Tribur (887), et de la part du jeune Louis de Provence, héritier légitime de cette contrée. Mais Arnoul céda devant la résistance obstinée de Rodolphe, Louis fut vaincu et le prince usurpateur régna paisiblement jusqu'à sa mort, arrivée en 911.
Cette période de guerres et de ravages fut pour la comté de Bourgogne l'une des plus malheureuses qu'elle vit jamais ; les brigandages, tous les excès impunis, dix pestes, treize famines ravagèrent toute cette contrée : c'était le prélude du Xe siècle, « le siècle de fer. » Sous le règne de Rodolphe II, qui succéda sans opposition à son père, en 937, un nouveau fléau apparut dans la contrée : les Hongrois, plus féroces encore que les Normands, s'y précipitèrent, mettant tout à feu et à sang sur leur passage ; devant eux les populations fuyaient épouvantées vers les montagnes et dans les lieux fortifiés ; les barbares s'abattirent sur Besançon. La ville ne put pas résister à leur fureur et fut prise d'assaut, pillée, réduite en cendres. L'église Saint-Étienne s'écroula dans les flammes. Le feu, poussé par un vent violent, gagna le sommet du mont Calius et dévora tout, églises, édifices et demeures.
C'était pour la quatrième fois depuis la conquête romaine que l'antique capitale des Séquanais passait par de semblables épreuves. Rodolphe II mourut, l'année même de ce désastre, laissant un jeune fils, Conrad, qui, sans jamais exercer la royauté, porta pendant un demi-siècle le titre de roi. Les véritables maîtres de la Bourgogne cisjurane et transjurane furent l'empereur d'Allemagne Othon, qui s'empara du jeune Conrad et exerça une grande influence dans ses États, et le premier comte propriétaire de ce pays, selon le savant dom Plancher, Hugues le Noir, deuxième fils de Richard le Justicier. Vers cette époque apparut sur les bords de la Saône un étranger qui fit dans le pays de Bourgogne une rapide fortune. Albéric de Narbonne s'enrichit par l'exploitation des salines, puis il gagna la confiance du roi Conrad, qui le combla de bienfaits.
A sa mort (945), il était comte de Mâcon, baron de Scodingue et du Varasque ; la fortune de sa famille ne périt pas avec lui ; de ses deux fils, l'un, Albéric, comme son père, commença la série des sires de Salins que nous verrons à l'histoire du département du Jura ; l'autre, Letalde, fut la tige des comtes héréditaires de Bourgogne. Il hérita de ce comté à la mort de Gislebert, successeur, dans ce titre, de lingues le Noir, mort en 951 sans postérité. Letalde, à l'exemple de Hugues le Noir, prit le titre d'archicomte. Sa race directe s'éteignit en 995, et la partie de la Bourgogne qu'il avait possédée revint à Othe Guillaume, qui fut le premier comte héréditaire de cette province.
Fils du roi lombard Adalbert, l'un des seigneurs les plus renommés des deux Bourgognes, audacieux et entreprenant, Othe Guillaume fut un véritable souverain. Irrité de l'influence qu'exerçaient dans le pays les abbés, l'évêque et les vassaux intermédiaires, il s'arrogea le droit de nommer les uns et supprima les autres. Ce fut ainsi que disparurent les anciens comtés de Varasque, Scodingue, Besançon, etc. Sur ces entrefaites, la monarchie carlovingienne avait été renversée par les ducs de France, qui avaient usurpé le titre de roi.
Robert, fils de Hugues Capet, héritait du duché de Bourgogne à la mort de Henri Ier (1002). Othe osa élever des prétentions contraires et disputer cette province au roi de France ; il ne réussit pas à joindre à ses États cette vaste possession ; mais, par le traité de 1016, il acquit les comtés de Mâcon et de Dijon. Le comte de Bourgogne mourut dans cette dernière ville en 1027. Son fils Rainaud Ier lui succéda ; il refusa d'abord de reconnaître la suzeraineté de l'empereur de Germanie, Henri III, fils de Conrad. prenant part à la première croisade. On sait que la fin du XIe siècle fut l'un des moments où l'esprit de foi et de piété anima le plus le moyen âge. Pendant que des seigneurs allaient en pèlerinage au tombeau de Jésus-Christ, d'autres enrichissaient les monastères et les comblaient des marques de leur munificence.
Les départements-(histoire)-Dordogne - 24 -
(Région Aquitaine)
Antérieurement à la division territoriale de 1790, le département actuel de la Dordogne formait l'ancienne province du Périgord. Ce nom lui venait, à travers les modifications apportées par le temps et les variations du langage, des Petrocorii ou Pétrocoriens, tribu gauloise qui habitait la contrée quand les Romains y pénétrèrent.
Ici, comme ailleurs, les documents sur cette première période de notre histoire nationale sont rares et confus. L'origine celtique de ces ancêtres, l'exercice du culte druidique dans le pays, l'influence de ses ministres et l'existence d'une florissante capitale appelée Vesunna sont les principaux faits authentiques, incontestables, qui soient parvenus jusqu'à nous. Malgré le caractère essentiellement belliqueux des Gaulois en général, certains indices tendent à prouver que les Pétrocoriens n'étaient étrangers ni à l'industrie ni au commerce. Les scories qu'on rencontre assez fréquemment sur divers points du département permettent de supposer que les mines de fer, dont le sol est abondamment pourvu, étaient dès lors exploitées et leur produit travaillé dans des forges locales ; une inscription, trouvée sur le tombeau d'un certain Popilius, negotiator artis prosariae, nous révèle que l'art du tissage était connu et pratiqué ; on sait enfin que les Phocéens de Marseille venaient échanger les marchandises du Levant contre des fers, des lins et des étoffes en poil de chèvre.
La domination romaine fut établie dans le Périgord 63 ans avant l'arrivée de Jules César, et sans que cette conquête soit signalée dans l'histoire par aucune lutte sérieuse. C'est seulement après la défaite de Vercingétorix qu'un lieutenant de César est envoyé dans cette province pour y comprimer les élans patriotiques que la lutte héroïque des Arvernes avait réveillés, et à laquelle 5 000 Pétrocoriens avaient pris part. Le pays des Pétrocoriens était alors compris dans la Gaule celtique. Vers la fin du IVe siècle, il fut incorporé dans la seconde Aquitaine.
La révolte de Julius Vindex, dont la famille habitait le Périgord, révolte à laquelle les Pétrocoriens s'associèrent, est le fait capital qui se rattache le plus spécialement aux annales de la contrée. Le gouvernement romain y suivit ses différentes phases sans incidents notables. Dans les premiers temps, respect scrupuleux de la religion, des coutumes et du langage des vaincus ; envahissements successifs du paganisme et de la civilisation romaine pendant le IIe siècle ; apparition du christianisme, apporté, dit-on, dans le Périgord par saint Front, un des disciples du Christ ; dissolution des forces morales et matérielles de l'empire pendant les deux siècles suivants, et enfin au Ve révélation de son impuissance en face des invasions des barbares.
Le Périgord était compris dans les territoires dont les Wisigoths obtinrent l'occupation du faible Honorius.. On sait que ce prétendu accommodement, sur la valeur duquel cherchait à se faire illusion la vanité romaine, cachait une véritable prise de possession. Ce mensonge des mots tomba vite devant la réalité des choses, et l'empire wisigoth fut constitué. Les destinées du Périgord furent liées aux siennes jusqu'à la bataille de Vouillé, qui recula jusqu'aux Pyrénées les limites du royaume des Francs. L'espace était trop vaste, les races trop peu fondues, pour que la France de Clovis pût se constituer d'une façon durable. Ces partages de l'héritage royal, qui amenèrent de si déplorables déchirements, et contre lesquels se soulèvent les raisonnements de la critique moderne, étaient alors une nécessité des temps.
Sous le nom d'Aquitaine, l'empire wisigoth, qui avait ses limites naturelles et une espèce d'unité, cherchait fatalement à se reformer. La création des royaumes de Neustrie et d'Austrasie n'était qu'une satisfaction donnée à ces impérieux instincts ; et quand l'ambition des maires du palais voulut reprendre l'oeuvre de Clovis, la révolte des antipathies de race éclata dans la lutte acharnée que soutinrent les Aquitains pour leurs ducs héréditaires. Cette page de notre histoire appartenant plus spécialement aux annales des deux capitales de l'Aquitaine, Toulouse et Bordeaux, nous nous bornerons ici à en rappeler le souvenir, en constatant que le Périgord fit alors partie intégrante de ce grand-duché et fut mêlé à toutes les vicissitudes qui l'agitèrent.
L'invasion des Sarrasins, dont se compliquèrent les désastres de cette époque, a laissé dans le pays des traces sinistres que le temps n'a pas encore effacées. De nombreuses localités ont gardé des noms qui attestent le passage et la domination de ces farouches étrangers ; telles sont les communes des Sarrazis, de Maurens, de La Maure, de Montmoreau, de Fonmoure, de Mauriac, de Sarrasac et le puits du château de Beynac, désigné encore aujourd'hui sous le nom de puits des Sarrasins. La défaite des infidèles, la reconnaissance des populations et les sympathies du clergé furent les principaux titres qui valurent aux Carlovingiens la couronne de France.
Le héros de cette dynastie, Charlemagne, traversa le Périgord et y laissa des témoignages de son habile administration. Il fonda le prieuré de Trémolat et lui fit présent de la chemise de l'Enfant Jésus ; il dota le monastère de Sarlat d'un morceau de la vraie croix ; il y autorisa, en outre, la translation des reliques de saint Pardoux et de saint Sacerdos ; enfin plusieurs historiens lui attribuent la construction de l'église de Brantôme, gratifiée par lui, entre autres pieux trésors, des restes vénérés de saint Sicaire. Le Périgord fut alors gouverné, comme la plupart de nos provinces, par des comtes qui, dans la pensée de Charlemagne, devaient être des fonctionnaires amovibles, mais qui, sous ses successeurs, se rendirent indépendants et héréditaires.
Le premier fut Widbald ; il administra la contrée de 778 à 838. C'est sous le second de ses successeurs et pendant la durée du règne de Charles le Chauve que l'autorité des comtes se transforma en fief héréditaire. L'apparition des Normands, qui date aussi du milieu du XIe siècle, contribua beaucoup à l'établissement des grandes maisons féodales. C'est comme défenseur du pays que Wulgrin, déjà comte d'Angoulême, s'imposa au Périgord. C'était un vaillant guerrier, qui avait mérité le surnom de Taillefer pour avoir pourfendu d'un seul coup de son épée le casque et la cuirasse d'un chef normand.
Au milieu de l'enfantement de la société féodale, dans le chaos du Moyen Age où la force est le droit, Guillaume Wulgrin est un type assez complet de ces fondateurs de dynastie, rudes figures qui surgissent dans l'histoire bardées de fer, lance au poing et se taillant de petits États dans les dépouilles de la monarchie agonisante. A sa mort, ses deux fils se partagèrent ses domaines ; Guillaume, le cadet, eut le Périgord ; la ligne masculine de cette branche s'éteignit à la seconde génération, en 975, dans la personne d'Arnaud dit Bouratien, dont la soeur et unique héritière épousa le comte de la Marche (Hélie Ier) et apporta le Périgord en dot à son époux. Ce seigneur, souche de la seconde dynastie des comtes de Périgord, prit et laissa à ses descendants le surnom de Talleyrand, qu'illustra pendant quatre siècles cette puissante maison de Périgord. Son indépendance était presque absolue ; elle battait monnaie. C'est un Adalbert de Talleyrand-Périgord qui fit cette réponse devenue fameuse, et dans laquelle se résumait si bien la fierté féodale : « Qui t'a fait comte ? » lui demandait un jour Hugues Capet. « Qui t'a fait roi ? » lui répondit Adalbert. La seule puissance contre laquelle les comtes eussent parfois à lutter était celle des évêques. Ces démêlés se rattachant à l'histoire des villes épiscopales et n'ayant point eu d'ailleurs de sérieuse influence sur les destinées de la province, nous n'avons pas à nous en occuper ici.
Lorsque le mariage de Henri II avec Éléonore de Guyenne plaça le Périgord sous la domination anglaise comme relevant de l'ancien duché d'Aquitaine, les comtes de Périgord s'associèrent à tous les efforts qui furent alors tentés pour arracher le sol français au joug de l'étranger. La fortune ne favorisa point leur honorable résistance ; le pays fut occupé militairement, des garnisons ennemies furent placées dans les forteresses et châteaux, de nouvelles citadelles furent élevées ; mais le patriotisme périgourdin ne se découragea pas, et pendant cette longue et triste période, qui dura depuis Louis le Jeune jusqu'à Charles VII, si trop souvent le pays fut obligé de souffrir le pouvoir de l'Anglais, on peut dire à sa gloire qu'il ne l'accepta jamais.
L'historique des guerres de l'Angleterre et de la France n'entre pas dans le cadre de notre récit ; nous déterminerons seulement par quelques dates l'influence qu'elles exercèrent sur le sort de notre province. Le Périgord, conquis par Henri II Plantagenet, revint à la France en 1224, fut rendu à l'Angleterre en 1258, puis confisqué en 1294 par Philippe le Bel, restitué de nouveau à l'Angleterre en 1303, reconquis par Philippe de Valois, cédé encore une fois par le traité de Brétigny, repris par Charles V, remis sous l'autorité anglaise vers la fin du règne de Charles VI, et enfin acquis définitivement, réuni pour toujours à la couronne de France en 1454.
Dans l'intervalle de ces orages, nous avons à citer un voyage de saint Louis dans le Périgord. Ce prince, avant de partir pour sa seconde croisade, voulut aller s'agenouiller devant le suaire du Christ, précieuse relique sur l'authenticité de laquelle nous nous garderons bien de nous prononcer, conservée dans un monastère de bernardins à Cadouin. Saint Louis traversa le pays, accompagné des seigneurs de sa cour, et, voulant éviter Sarlat, à cause de la mésintelligence qui existait entre l'abbé et les consuls de la ville, il s'arrêta au château de Pelvezis. A la même époque se rattache une certaine extension des franchises municipales, signe précurseur de la chute de la féodalité.
L'état de la France s'était bien modifié sous le coup des dernières crises qu'elle venait de traverser. C'est à la monarchie surtout qu'avait profité cette lutte de deux siècles contre l'étranger, lutte pendant laquelle elle avait si souvent paru près de succomber. L'intelligence de Cette situation nouvelle semble avoir échappé aux comtes de Périgord, qui, se croyant encore au temps des Wulgrin et des Boson, affectaient envers la couronne une indépendance qui n'était plus de saison.
Archambaud V, dit le Vieux, qui vivait dans les dernières années du XIVe siècle, contesta au roi certains droits que la couronne revendiquait sur Périgueux et essaya .de soutenir ses prétentions par les armes ; un premier arrangement arrêta les hostilités ; mais quelque temps après le comte intraitable recommença la guerre. Il fut vaincu ; un arrêt de mort contre le coupable et de confiscation pour le comté avait été rendu ; le roi fit au seigneur rebelle grâce de la vie, ne conserva que Périgueux comme gage de sa victoire et abandonna au fils d'Archambaud tout le reste des domaines paternels.
Mais le fils se montra moins sage encore que son père. Il réclama avec menaces la ville dont il se croyait injustement dépouillé. Cette fois, il n'y eut même plus besoin d'une expédition militaire pour réduire l'incorrigible. Une tentative de rapt sur la fille d'un .bourgeois de Périgueux fit de lui un criminel vulgaire ; on instruisit son procès, et un arrêt du parlement, à la date du 19 juin 1399, le condamna au bannissement et à la confiscation de tous ses biens. En lui s'éteignit la puissance de cette antique famille, qui possédait le Périgord depuis l'an 866, et qui, de Wulgrin à Archambaud VI, comptait une succession de vingt-sept comtes.
Le roi Charles VI donna le comté de Périgord au duc d'Orléans, son oncle. Celui-ci le laissa à Charles, son fils, qui, étant prisonnier en Angleterre, le vendit en 1437 pour seize mille réaux d'or à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. Ce dernier eut pour héritier Guillaume, son frère, qui ne laissa que trois filles. L'aînée épousa Alain, sire d'Albret, dont le fils fut roi de Navarre, et la petite-fille de celui-ci apporta en dot le Périgord, avec ses autres États, à Antoine de Bourbon, qu'elle épousa et qui fut père de Henri IV. Le Périgord faisait donc partie des domaines de ce monarque lorsqu'il monta sur le trône, et il fut alors réuni à la couronne.
L'influence qu'exerçait dans la province la maison d'Albret y facilita les progrès de la réforme religieuse, surtout lorsque la reine Jeanne eut embrassé avec tant d'ardeur la foi nouvelle ; le Périgord devint un des théâtres de l'affreuse guerre qui déchira la patrie à cette époque. Peu de contrées furent éprouvées aussi cruellement. Sanctuaires violés, églises détruites, villes prises d'assaut, partout le sac, le pillage, l'incendie, les massacres, telle est l'oeuvre du fanatisme, tel est le tableau que nous ont laissé les historiens contemporains de cette lamentable période.
La paix eut beaucoup à faire pour cicatriser de pareilles blessures, elle fut, grâce au ciel, rarement troublée pendant les temps qui suivirent ; mais le repos donné par le despotisme ne régénère pas les populations ; l'espèce de sommeil léthargique dans lequel nous voyons le Périgord s'endormir de Henri IV à Louis XV, le silence qui se fait autour de la province pendant la durée de deux siècles ne sont point des indices de prospérité ; le salut devait venir d'ailleurs. Quelque indispensables, cependant, que fussent devenues des réformes réclamées par la monarchie elle-même, ce n'est pas sans une sorte de protestation qu'elles se firent jour sur ce vieux sol de la féodalité. Le Périgord avait do longue date ses états particuliers ou provinciaux ; c'était le sénéchal qui les convoquait en vertu de lettres patentes ; le comte et plus tard le gouverneur y occupaient le premier rang ; les quatre barons du Périgord, qui avaient le privilège de porter le nouvel évêque de Périgueux à son entrée dans la ville, Bourdeilles, Beynac Biron et Mareuil, prenaient place après l'ordre du clergé les maires et consuls marchaient à la tête du tiers état.
Lors de la convocation des derniers états, en mars 1788, M. de Flamarens, évêque de Périgueux, refusa de prêter le serment exigé, et le clergé fut obligé de se nommer un autre président. Cette inoffensive boutade n'entrava pas la marche des événements, et lorsque éclata la Révolution, le Périgord fut l'un des premiers à y adhérer. Il envoya à la Convention nationale les représentants du peuple Romme et Lakanal, mais, si les agitations politiques le troublèrent un moment, il dut à sa position, loin des frontières, d'être préservé des invasions que les fatales années de 1814, dé 1815, de 1870 et de 1871 déchaînèrent sur la France. Aussi ce département n'a-t-il cessé, depuis, de prospérer.
Les départements-(histoire)- La Creuse - 23 -
(Région Limousin)
Le département de la Creuse, formé d'une grande partie de l'ancienne province de la Marche et de quelques petits pays du Limousin, du Berry et de l'Auvergne, dépendait, avant la conquête romaine, du pays des Lemovices, et il dut à sa position sur les frontières du pays occupé par ce peuple le nom de Marchia Lemovicina. Plus lard, la Marche s'agrandit du pays de Combraille (pays des Cambiovicenses, Combraliae pagus). Elle fit partie de l'Aquitaine première, et passa sous la domination des Wisigoths, lorsqu'ils fondèrent le royaume de Toulouse (419). Elle suivit la fortune du Limousin et reconnut l'autorité des Francs après la victoire de Clovis à Vouillé (507).
En 571, les habitants furent, comme ceux de l'Auvergne, décimés par une horrible contagion dont Grégoire de Tours signal e les ravages. Desiderius, duc de Toulouse, et Bladaste, duc de Bordeaux, dans leur expédition contre le Berry, suivirent la grande voie romaine qui conduisait de Limoges à Bourges. Ils traversèrent la Marche et s'arrêtèrent peut-être dans les murs d'Ahun (583). Pendant la lutte de Pépin contre l'Aquitaine, Remistan ravagea toute la contrée et s'avança jusque dans le bas Berry, en 767.
Dans le démembrement de l'empire carlovingien, la Marche, à l'exemple de toutes les provinces de France, se morcela en un grand nombre de seigneuries. Elle ne put échapper aux ravages des Sarrasins et des Normands. En 846, ils dévastèrent le Limousin et s'avancèrent jusqu'aux limites du Berry et de l'Auvergne. En 930, ils reparurent ; mais, cette fois, ils furent battus et repoussés par le roi Raoul. Les Hongrois vinrent achever la ruine des provinces françaises. Ils pénétrèrent, en 937, jusqu'aux frontières de la Marche, et revinrent, en 951, désoler toute l'Aquitaine.
La France n'avait plus de gouvernement, plus d'armée ; elle était tombée dans la plus désastreuse anarchie. C'est au milieu de cette société en dissolution et dans l'effort tenté pour la reconstituer sous la forme féodale que se fonda, vers 968, le comté de la Marche. Les grands fiefs étaient autant de souverainetés indépendantes, et leurs possesseurs reconnaissaient à peine la suprématie nominale du roi. C'est ainsi que, malgré les menaces de Hugues Capet, Adalbert Talleyrand, comte de la Marche et de Périgord, s'allie avec Foulques Nerra, duc d'Anjou, contre Conan, comte de Rennes.
Tandis que Foulques s'empare de Nantes, Adalbert assiège la ville de Tours. Le roi marche au secours de cette place (992) . Il somme son vassal de se retirer. « Qui t'a fait comte ? » lui dit-il. Adalbert répond : « Qui t'a fait roi ? » Ce mot célèbre du comte de la Marche caractérise bien la politique féodale au Xe siècle. L'autorité royale baissa encore sous les successeurs de Hugues Capet. Un moment resserrée dans Paris par la féodalité, elle ne fut presque plus qu'une ombre. On trouve, en effet, en 1095, avant les croisades, plus de quatre-vingts grands fiefs qui avaient des souverains héréditaires et une véritable indépendance.
C'étaient quatre-vingts rois qu'il y avait en France, et parmi eux on compte plusieurs des anciens vassaux du duc de France qui ne lui obéissaient plus. Philippe Ier ne possédait réellement que les comtés de Paris, d'Étampes, de Melun, d'Orléans, de Dreux et de Sens, et, en montrant à son fils le château du seigneur de Montlhéry aux portes de Paris, il lui disait : « Beau fils Louis, garde bien cette tour qui tant de fois m'a travaillé, et en qui combattre et assaillir je me suis presque tout enseveli, et par la déloyauté de laquelle je ne puis avoir bonne paix ni bonne sûreté ; en tout le royaume n'étoient maux faits ni trahisons sans leur assent et sans leur aide, et si grande confusion étoit entre ceux de Paris et ceux d'Orléans que l'on ne pouvoit aller en terre de l'autre pour marchandise ni pour autre chose sans la volonté à ces traîtres, si ce n'étoit de grandes forces de gens » (Chroniques de Saint-Denys).
Au XIe siècle, l'ombre même d'un gouvernement central, d'une nation générale semble avoir disparu. « Comment se fait-il, dit M. Guizot, que la civilisation et l'histoire vraiment française commencent précisément au moment où il est presque impossible de découvrir une France ? C'est que, dans la vie du peuple, l'unité extérieure, visible, l'unité de nom et de gouvernement, bien qu'importante, n'est pas la première, la plus réelle, celle qui constitue vraiment une nation. Il y a une unité plus profonde, plus puissante : c'est celle qui résulte, non pas de l'identité de gouvernement et de destinée, mais de la similitude des éléments sociaux, de la similitude des institutions, des moeurs, des idées, des sentiments, des langues ; l'unité qui réside dans les hommes mêmes que la société réunit, et non dans les formes de leur rapprochement ; l'unité morale enfin, très supérieure à l'unité, politique et qui peut seule la fonder solidement. A la fin du Xe siècle et au commencement du XIe, il n'y a point d'unité politique pareille à celle de Charlemagne ; mais les races commencent à s'amalgamer ; la diversité des lois, selon l'origine, n'est plus le principe de toute la législation. Les situations sociales ont acquis quelque fixité ; des institutions, non pas les mêmes, mais partout analogues, les institutions féodales ont prévalu, ou à peu près, sur tout le territoire. Au lieu de la diversité radicale, impérissable, de la langue latine et des langues germaniques, deux langues commencent à se former, la langue romane du Midi et la langue romane du Nord, différentes sans doute, cependant de même origine, de même caractère, et destinées à s'amalgamer un jour. Dans l'âme des hommes, dans leur existence morale, la diversité commence aussi à s'effacer.
« Le Germain est moins adonné à ses traditions, à ses habitudes germaniques ; il se détache peu à peu de son passé pour appartenir à sa situation présente. Il en arrive autant du Romain ; il se souvient moins de l'ancien. empire et de sa chute, et des sentiments qui en naissaient pour lui. Sur les vainqueurs et sur les vaincus, les faits nouveaux, actuels, qui leur sont communs, exercent chaque jour plus d'empire. En un mot, l'unité politique est à peu près nulle, la diversité réelle encore très grande ; cependant il y a au fond plus d'unité véritable qu'il n'y en a eu depuis cinq siècles. On commence à entrevoir les éléments d'une nation ; et la preuve c'est que, depuis cette époque, la tendance de tous ces éléments sociaux à se rapprocher, à s'assimiler, à se former en grandes masses, c'est-à-dire la tendance vers l'unité nationale, et par là vers l'unité politique, devient le caractère dominant de l'histoire de la civilisation française. »
Dès le règne de Philippe le Gros commence, contre la féodalité, la guerre qui, par l'alliance de la royauté et des communes, doit aboutir au triomphe du principe moderne de la centralisation. Le fils de Philippe Ier ne reste pas, comme son père, emprisonné dans le domaine des ducs de France. Il cherche à étendre au loin son influence et son action. En 1121, nous le voyons s'avancer jusqu'aux confins de la Marche et diriger une expédition contre le comte d'Auvergne. Cinq ans plus tard, il intervient de nouveau en faveur de l'évêque de Clermont et force le comte à se soumettre au jugement -de la cour du roi (1126). Le comté de la Marche passa, vers ce temps, à la famille des Montgomery, dont un des membres, Adalbert IV, partant pour la terre sainte en 1177, vendit son domaine, pour cinq mille mires d'argent. à Henri II, roi d'Angleterre. Cette vente fut annulée sur la demande des seigneurs de Lusignan, qui, depuis longtemps, avaient des prétentions sur la Marche. Henri Il rendit ce comté à Hugues de Lusignan.
Vers la fin du XIe siècle, des bandes de routiers se levèrent dans le Berry et mirent toute la contrée au pillage. Ils prenaient le nom de Cottereaux. Les seigneurs des pays voisins, de la Marche, de l'Auvergne, formèrent contre eux l'association des Capuchons, et les taillèrent en pièces dans plusieurs rencontres (1184). Pendant les guerres de Philippe-Auguste et de Jean sans Terre, le comté de la Marche, situé à la limite des possessions anglaises et françaises, se trouva exposé aux ravages des gens d'armes.
Le comte Hugues le Brun suivit le parti du roi de France. Il était animé contre le roi d'Angleterre par des griefs personnels. Jean lui avait enlevé quelques châteaux et sa fiancée, fille du comte d'Angoulême (1201). En 1206, les deux rois signèrent une trêve de deux ans ; Hugues le Brun fut un des garants de Philippe-Auguste (Chroniques de Rigord). Philippe, poursuivant l'oeuvre de Louis le Gros et prenant au sérieux son titre de roi, était pour les grands vassaux un maître incommode. Hugues de Lusignan ne lui resta pas longtemps fidèle. Il se ligua en 1213 avec Jean sans Terre, son ancien ennemi. Mais la paix fut bientôt rétablie. On nomma des arbitres pour les infractions commises dans le Berry, l'Auvergne, le comté de la Marche et le Limousin ; ils se réunirent entre Aigurande et Cuzon, châteaux du comté de la Marche.
Pendant la minorité de Louis IX, la maison de Lusignan s'associa à la réaction féodale tentée contre la régente, Blanche de Castille. Le comte de la Marche prit les armes comme le duc de Bretagne et le comte de Champagne ; mais, comme eux, il fut obligé de se soumettre (1227). Ses successeurs régnèrent sans éclat jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En 1308, Gui de Lusignan, mourant sans enfants, légua le comté de la Marche à Philippe le Bel.
Le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Creuse fut alors presque tout entier réuni au domaine royal, sauf la terre de Combraille, qui appartenait à la maison d'Auvergne. Le comté de la Marche fut érigé en pairie par lettres patentes données à Paris, au mois de mars 1316, en faveur de Charles de France, comte de la Marche. Charles succéda à son frère Philippe le Long (1322), et ainsi cette pairie fut éteinte. Mais, comme le même roi donna le comté de la Marche à Louis de Bourbon en échange du comté de Clermont en Beauvoisis, il fut érigé de nouveau en pairie par lettres patentes du mois de décembre 1327.
Il passa dans la maison d'Armagnac par le mariage d'Éléonore, fille de Jacques de Bourbon, avec Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac et de Castres. Leur fils, Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, comte de la Marche, de Pardiac, de Castres et de Beaufort, vi-comte de Murat, seigneur de Leuze, de Condé et de Montagne-en-Combraille, fut l'ennemi et la victime de Louis XI. Il périt par la main du bourreau (août 1477). Le roi confisqua ses biens, et donna le comté de la Marche à Pierre II de Bourbon, sire de Beaujeu, qui avait épousé Anne de France. Suzanne de Bourbon, leur fille, porta ce domaine en dot au connétable Charles de Bourbon. Celui-ci était déjà comte de Montpensier et dauphin d'Auvergne, duc de Bourbon, d'Auvergne et de Châtellerault, comte de Clermont en Beauvoisis, de Forez, de Gien vicomte de Carlat et de murat, seigneur de Beaujolais, de Combraille, de Mercoeur, d'Annonay, de La Roche-en-Régnier et de Bourbon-Lancy.
La trahison du connétable anéantit cette puissance redoutable de la maison de Bourbon. Ses biens furent confisqués en 1523. Le comté de la Marche passa à Louise de Savoie, mère de François Ier ; après la mort de cette princesse, il rentra dans le domaine de la couronne. François Ier le donna, par lettres du 12 juin 1540, à son troisième fils, Charles de France, pour le tenir en pairie ; mais ce prince mourut le 9 septembre 1545. Depuis lors, la Marche ne fut plus détachée de l'unité nationale. La féodalité s'était transformée en noblesse. Au XVIIIe siècle, le comté de la Marche fut le titre des fils aînés des princes de Conti.
L'histoire de la province n'est pas riche en détails intéressants. Durant les désastres de la guerre de Cent ans, les villes et les seigneurs ne trahirent pas la cause de la France. Le sire de Boussac, chambellan de Charles VII, le servit jusqu'au crime. Lorsque la guerre civile vint se mêler à la guerre étrangère, et que le dauphin souleva la Praguerie, Charles VII traversa la Marche en poursuivant son fils rebelle (1440). On a retrouvé au British Museum (m. 11, 542) des lettres royales du 4 décembre 1545, par lesquelles sont institués, dans la sénéchaussée de la Marche, cinq commissaires, à l'effet de percevoir, d'après un nouveau mode, un aide pour la solde des gens d'armes. Ce sont « nos amis et féaulx conseillers et chambellans, le sire de Culant, maître Jehau Tudert, maistre des requêtes ordinaires de notre hôtel, les sénéchal et chancelier de la Marche, et Pyon de Bar, notre valet de chambre. »
Il existe au cabinet des titres de la Bibliothèque nationale des quittances de ce Pyon de Bar. Le 1er décembre 1445, il avait reçu de Jacques de la Ville la somme de 100 livres à titre de commissaire ordonné pour asseoir au comté de la Marche la portion à l'aide de 300 000 francs, mis sus par le roi sur les pays de Languedoc au mois de janvier précédent. « Vous mandons et commettons que les gens d'armes qui sont du pays et ressort de la comté de la Marche soient dorénavant payés, selon l'ordonnance que nous avons de présent faite, à commencer le premier jour de janvier prochain venant. C'est assavoir : en argent 21 livres tournois par lance fournie de six personnes et six chevaux ; plus pour 10 livres tournois en nature. Et voulons toutes manières de gens être à ce contribuables, excepté gens d'Église, nobles vivant noblement, et autres qui, par nos dernières ordonnances, en étoient exemptés. » (Lettres du 3 août 1445, Ordonn. des rois de France, tome XIII, page 442 et pass.) « Et avec ce... mettez sus, audit pays et ressort de la Marche, avec les frais raisonnables ci-après déclarés, et outre le fait et payement desdits gens d'armes, la somme de 5 000 livres tournois, 500 livres tournois pour les frais. Laquelle somme est pour et au lieu de l'aide de 200 000 livres tournois que de nécessité étions contraint mettre sus en notre pays comme l'année passée. Mais, considéré la pauvreté de notredit peuple et la charge qu'ils ont desdits gens d'armes, nous avons modéré ledit, pays, pour sa portion dudit aide, à ladite somme de 5,000 livres tournois, et 500 livres tournois pour les frais. » (Biblioth. de l'école des Chartes, déc. 1846.)
Sous Louis XI, les états de la haute et basse Marche demandèrent à se réunir pour une imposition commune, et le roi les y autorisa (1478). Les états de cette province cessèrent de s'assembler au XVIIe siècle, après la victoire de Mazarin sur la Fronde et le triomphe de l'absolutisme. En 1531, la province fut affligée par les inondations et par la famine. La Creuse et la Gartempe débordèrent. « Estoit en ladite saison grand'cherté de blés et de vins ; car le setier de froment se vendoit 50 sols, le setier de seigle 40 sols et plus, etc. » C'est l'année où le comté de la Marche fut réuni à la couronne. Bientôt après se tinrent à Poitiers les Grands-Jours, « qui jugèrent deux cents causes en deux mois et condamnèrent un grand nombre de gentilshommes d'Anjou, Touraine, Maine, Aunis, Angoumois et Marche. »
En 1553, « les droits que les habitants prennent sur le sel furent vendus par le roi Henri II aux habitants du pays de Poitou, Saintonge, ville et -gouvernement de La Rochelle, Angoulême haut et bas Limousin, haute et basse Marche, qu'on appelle à cause de cela pays de franc-salé. » Sous le règne de Henri III, la Réforme pénétra dans la Marche, mais elle n'y fit pas de progrès. Pendant les guerres religieuses, « le sieur de Saint Marc était commandant pour l'Union au pays de la Marche. » (Palma Cayet.) Il périt en allant au secours de Randan, chef des ligueurs en Auvergne (1590). Les paysans de la Marche prirent part à la révolte des Croquants, en 1594.
Aux états de 1484 avaient paru les députés du comté de la Marche. Il n'en vint aucun à ceux de 1593. En 1614, la sénéchaussée de la haute Marche envoya aux états généraux Georges de La Roche-Aymon, sieur de Saint-Maixent ; Gabriel, sieur de Malité, et Jean Vallenet, lieutenant particulier à Guéret.
Les Grands-Jours, tenus à Limoges en 1605, n'avaient pas plus épargné les nobles brigands de la Marche que ceux du Limousin ; mais l'esprit féodal n'était pas encore détruit dans ces provinces presque sauvages. La royauté devait longtemps encore y rencontrer des ennemis. « Le 17 mars 1617, dit le Mercure françois le prince de Joinville partit de Paris pour aller en son gouvernement d'Auvergne, y lever des troupes et avoir l'œil sur les pratiques qui se faisoient au pays de la Marche, bas Limousin et provinces voisines, par M. de Bouillon, qui sollicitoit une assemblée générale de ceux de la religion réformée pour les exciter à se soulever et prendre les armes. » Vingt ans après reparaissent les Croquants. « On dit qu'en Limousin, la Marche, l'Auvergne et le Poitou, sont élevées plusieurs troupes de gens, sous le nom de Croquants, lesquels font une guerre aux partisans, et qu'on parle en deçà d'envoyer vers eux pour les apaiser. » (Lettre de Gui Patin, 26 mai 1637.)
Au commencement de la guerre de la Fronde, le marquis d'Effiat était gouverneur de la haute et basse Marche (1649). Aubusson et Guéret figurent dans la liste générale des villes où furent envoyées, le 2 août 1652, les lettres circulaires de la ville de Paris invoquant l'appui des autres cités du royaume. Aubusson et Guéret ne répondirent pas. La Marche était alors un pays perdu au milieu de la France. Qu'on en juge par les impressions de voyage du célèbre comte de Forbin, qui la traversa en 1684. « Comme le service du roi ne demandoit pas ma présence à Rochefort, car la saison étoit déjà fort avancée, mon oncle me conseilla d'aller en Provence, pour régler quelques affaires que j'y avois ; il m'ordonna en même temps de passer par Lyon et de parler à un homme qui lui devoit quelque argent. La route que j'avois à suivre étoit par le Périgord, le Limousin et l'Auvergne. La quantité de neige dont le pays étoit couvert le rendoit impraticable à un homme qui n'en avoit d'ailleurs aucune connoissance. Pour obvier à cet iriconvénient, je me joignis aux muletiers qui partent deux fois la semaine de Limoges pour Clermont. Leur marche étoit si lente et si ennuyeuse que je me trouvois bien malheureux d'être obligé de m'y conformer. Après les avoir ainsi suivis pendant quatre jours, nous arrivâmes à un cabaret en rase campagne. J'étois auprès du feu à causer avec l'hôtesse, lorsque je vis entrer six hommes qui ressembloient bien mieux à des bandits qu'à toute autre chose. Je demandai quels hommes c'étoient : Ce sont, me répondit la maîtresse du logis, des marchands de Saint-Étienne en Forez, qui reviennent de la foire de Bordeaux ; nous les voyons repasser ici toutes les années. Ravi de cette nouvelle, je leur fis civilité ; nous soupâmes ensemble et je m'associai avec eux pour tout le reste du voyage. Il tomba dans la nuit une si grande quantité de neige que les chemins en furent entièrement couverts. Mais ces marchands les avoient si fort pratiqués que, se conduisant d'un arbre à l'autre, ils ne s'égarèrent jamais. Comme nous marchions, un geai vint se percher devant nous à la portée d'un fusil. Un de mes compagnons de voyage qui avoit un bâton, ou quelque chose qui paroissait tel, fit arrêter la troupe ; et ayant ajouté à ce prétendu bâton quelques ressorts qu'il renfermoit sans qu'il y parût, il en fit un fusil complet, tira sur l'oiseau et le tua... Nous devions nous séparer à Thiers, etc. » (Mémoires du comte de Forbin, p. 302.)
Dans cette contrée presque sauvage, une seule ville, par son industrie et son commerce, méritait d'arrêter l'attention du voyageur. Aubusson comptait environ 12,000 habitants, presque le double de sa population actuelle. La fabrication de ses tapis, déjà célèbres, occupait un très grand nombre (Louvriers. La plupart étaient protestants. La révocation de l'édit de Nantes (1685) les força de s'expatrier. ils émigrèrent en Suisse et en Allemagne.
Ainsi la Marche subit, comme les provinces de l'Ouest, les effets désastreux de l'intolérance. Colbert n'était plus ; Louvois dominait dans les conseils de Louis XIV ; et le travail national, un moment ranimé sous l'administration d'un homme d'État qui comprenait les vrais intérêts de la France, allait être sacrifié désormais aux fantaisies de l'ambition et de l'orgueil. La France n'a guère traversé de périodes plus douloureuses que la fin du règne de Louis le Grand. Elle perdit même, pendant la guerre de la succession d'Espagne, les consolations de la gloire ; et, la fortune épuisant contre nous toutes ses rigueurs, le froid et la famine se coalisant avec l'Europe, la nation expia cruellement les prétentions de son maître à la monarchie universelle. La Marche ne put échapper aux adversités de la patrie ; mais, du moins, grâce à sa position centrale, elle ne fut pas atteinte par le fléau de l'invasion. Grâce au caractère de ses habitants, elle évita les maux de la guerre civile ; les fils des Croquants ne suivirent point l'exemple des Camisards.
La haute Marche faisait partie, ainsi que le pays de Combraille, de la généralité de Moulins, mais elle n'en partageait point toutes les charges ; plus heureuse que le Bourbonnais et le Nivernais, provinces de grandes gabelles, elle était comprise dans le pays rédimé de l'impôt du sel. Le pays rédimé ne payait qu'un droit modique perçu sous les noms de convoi, de traite, de charente, etc., sur tous les sels extraits des marais salants pour l'approvisionnement des habitants. « Le commerce du sel étant libre dans cette partie de la France, on ne petit pas, dit Necker, en connaître la consommation avec autant de certitude que dans les parties du royaume où le privilège exclusif du débit est entre les mains du roi. Il y a lieu de l'évaluer à environ 830 000 quintaux ; et cette quantité, rapportée à une population de 4 025 000 âmes, ferait environ dix-huit livres pesant par tête d'habitant de tout sexe et de tout âge. La valeur courante varie depuis six jusqu'à dix et douze francs. »
Necker les portait, pour les provinces de grandes gabelles, à 62 livres par quintal ; pour celles de petites gabelles, à 33 livres 10 sous. La Marche, voisine du Berry et du Bourbonnais, leur fournissait en contrebande des quantités considérables de sel, et ses faux sauniers faisaient une rude guerre aux gens du roi. Enfin, la Révolution de 1789 abolit les douanes intérieures et répartit également les charges publiques entre tous les départements de la France. Les contrebandiers, abandonnant les provinces du centre, durent renoncer à leur commerce ou changer le théâtre de leurs exploits. Ils n'avaient plus rien à faire dans la Marche.
Pendant la période révolutionnaire, le département de la Creuse n'eut pas à souffrir des tourmentes politiques. La Terreur n'y fit point couler le sang. Les nobles, peu nombreux, émigrèrent ou se soumirent ; la vente des biens du clergé eut lieu sans scandales et sans bruit, et la guerre civile ne trouva point d'armée sur cette terre qui ne porte point le fanatisme. La Creuse ne fournit de soldats que pour combattre les ennemis de la France. Ses volontaires servirent avec honneur sous les drapeaux de la République. Un de leurs bataillons (Joullieton atteste ce fait dans son Histoire de la Marche) reconnut les petits-fils des proscrits de 1685 dans un village des bords du Rhin où s'était conservé le patois marchais.