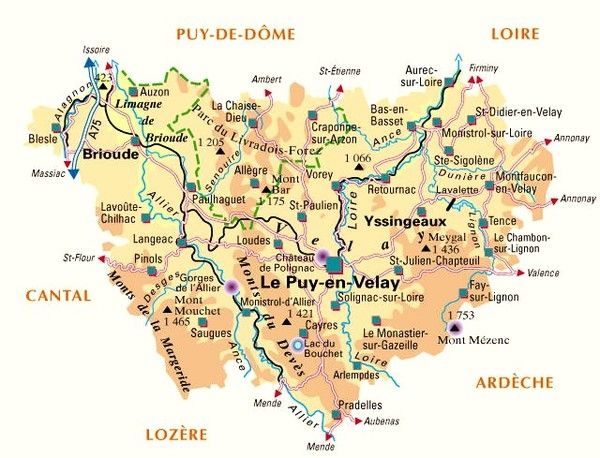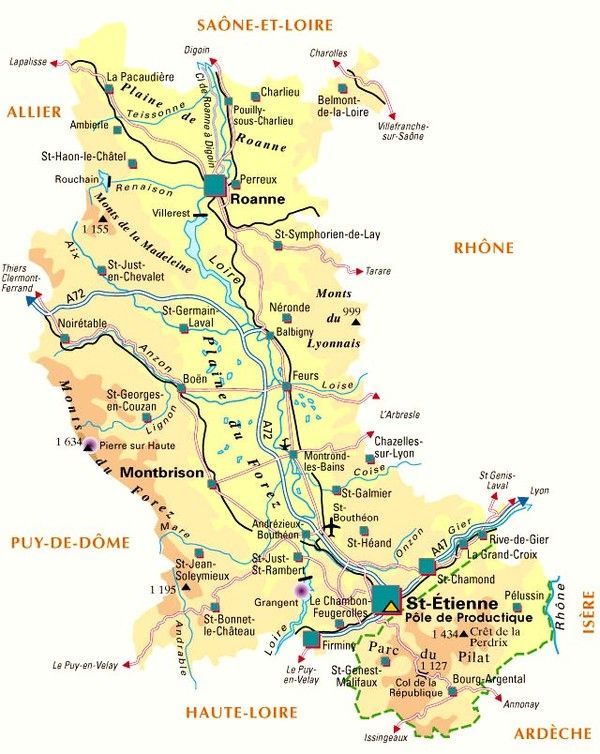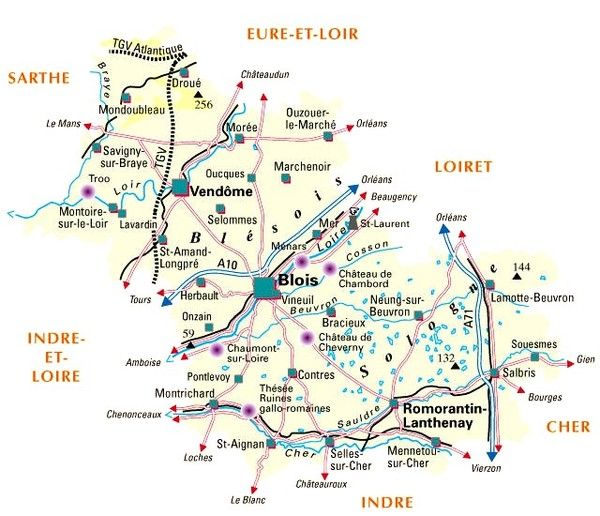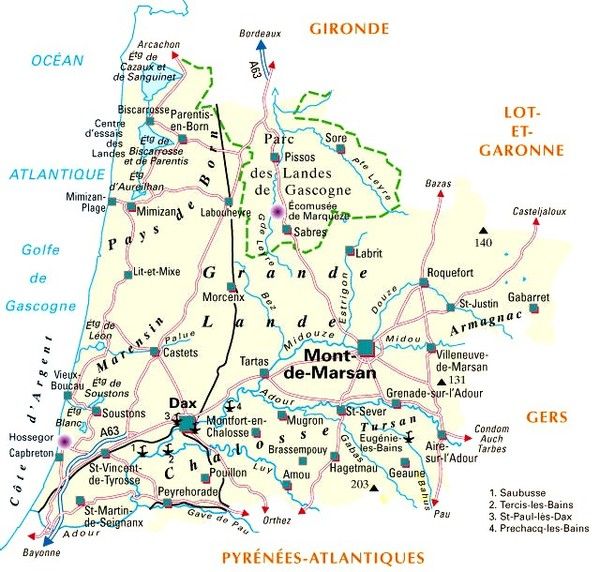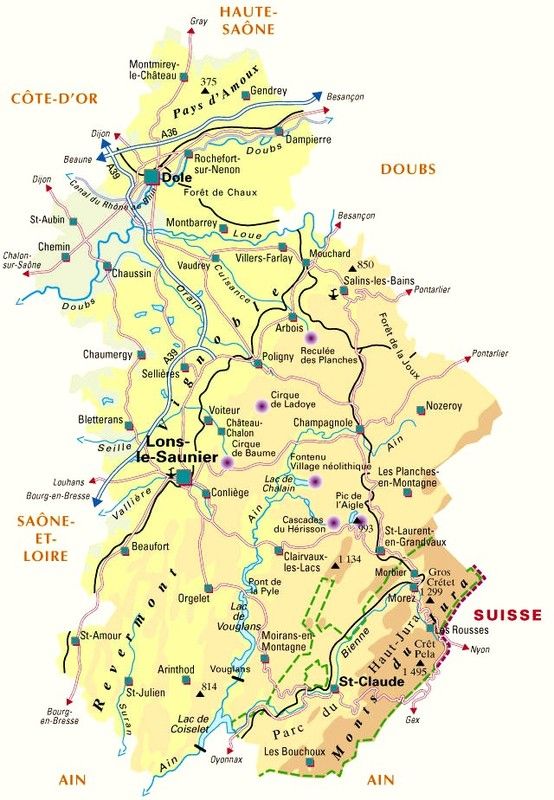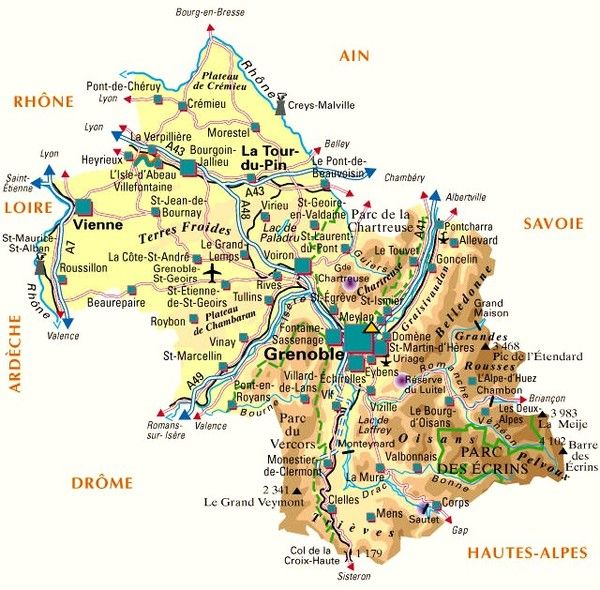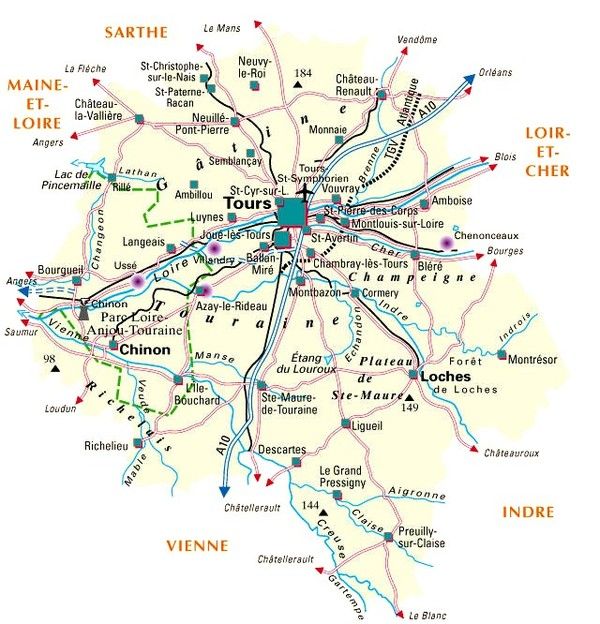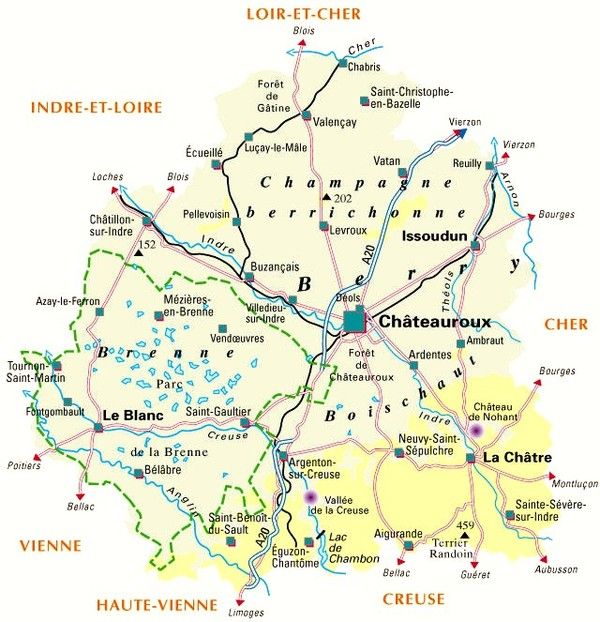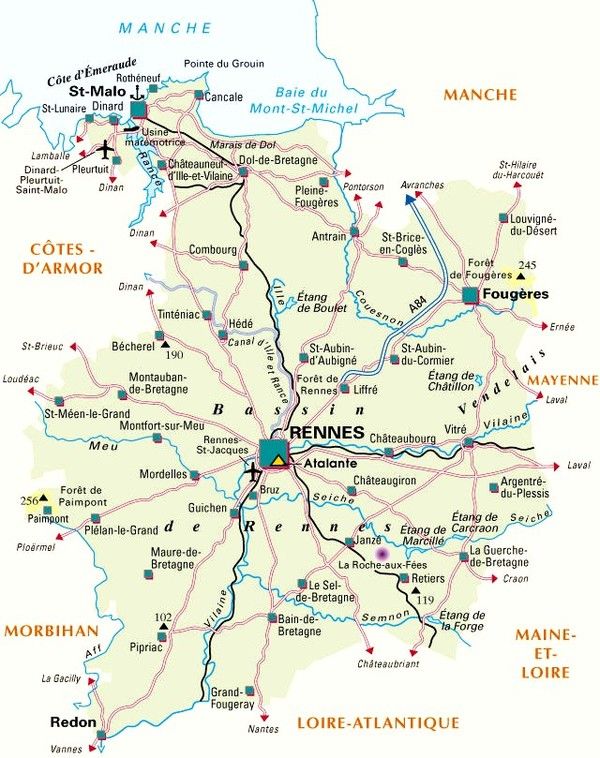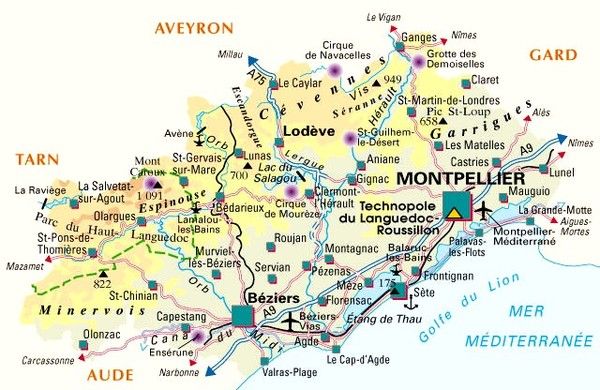Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Les départements-(histoire)-
Les départements et leur histoire - Haute-loire - 43 -
Sur les limites de l'Auvergne et du Languedoc s'élève un groupe de froides et rudes montagnes. Rien de sauvage et de grandiose comme l'aspect de cette contrée, où le voyageur rencontre, à chaque pas, des traces des révolutions physiques qui l'ont violemment agitée dans les temps anciens. Ce ne sont que rochers à pics basaltiques, aux flancs déchirés et dont les cimes, à défaut de végétation, sont hérissées de ruines, tristes et derniers restes d'antiques forteresses, qui semblent avoir été construites par une race de géants. C'est là, sur le versant occidental des Cévennes, qu'habitaient les Velauni, Vellavi ou Vellaviens, c'est-à-dire, en langue celtique, montagnards. Voisins des Arvernes, ils en étaient, suivant César, les clients : Velauni qui sub imperio Arvernorum esse consueverant.
Avant l'arrivée des Massaliotes, qui les premiers y pénétrèrent, on ne voyait point de routes dans ce pays, mais seulement quelques étroits sentiers perdus dans les rochers ou dans les ravins. Borné au nord par le pays des Arvernes ; au midi, par celui des Helviens et des Volces Arécomices ; à l'est, par celui des Ségusiens et des Allobroges ; à l'ouest, par le territoire des Gabales, le pays des Vellaviens n'avait pas moins, dit-on, de cent soixante-cinq lieues carrées. Ruessio, aujourd'hui Saint-Paulien, en était la capitale.
Comme tous les peuples primitifs, les Vellaviens vivaient de la chasse ou de la garde des troupeaux. Dans plusieurs communes du Velay, notamment au Puy, à Vals, à Saint-Julien, à Pradelles, à La Roche-Aubert, à La Terrasse, au Monastier, à Tarsac, etc., on voit encore des vestiges de leurs habitations. « Rien, dit l'auteur de l'Ancien Velay, rien ne saurait donner une idée plus exacte d'un vicus et de certains oppida dont parle César que la vue de ces roches disséminées dans les campagnes du Velay, et qui, jadis citadelles, servaient d'asile à des populations entières. »
Auguste affranchit les Vellaviens des liens qui les unissaient aux Arvernes. Alors, compris dans la première Aquitaine, ils formaient, suivant Strabon, une cité particulière. Peu à peu la civilisation romaine tempéra l'âpreté et la rudesse de ce peuple à demi sauvage. Ruessio, Icidmagus, Condate, Aquis Segete, où elle avait fondé des colonies, devinrent des cités florissantes. A ces sombres grottes, à ces rustiques huttes couvertes de chaume, enduites d'argile, et au fond desquelles les Vellaviens vivaient pêle-mêle avec leurs boeufs et leurs chèvres, succédèrent des palais, des villas, des temples, des cirques, des prétoires, des aqueducs. Des voies romaines s'ouvrirent dans tous les sens : la principale conduisait de Ruessio à Lugdunum, et, par un embranchement, à Mediolanum (Moingt, près de Montbrison). On l'appelait la via Bolena.
Bien que d'un abord difficile, ce pays n'en fut pas moins visité par les barbares. Après les Burgondes, qui prirent et pillèrent Brivas (Brioude), vinrent les Wisigoths, puis les Francs. On croit que les Sarrasins y pénétrèrent en 725. Après avoir ravagé l'Aquitaine, les Normands, en 863, envahirent le Velay, réduisirent en cendres Ruessio et en dispersèrent les habitants.
Dans les divers partages qui eurent lieu entre les rois francs et leurs héritiers, le Velay échut successivement à Sigebert, puis, en 506, à Théodebert II, et, plus tard, à Sigebert III. Sous Charlemagne, il eut pour gouverneur le comte Bullas.
S'il faut en croire la tradition, saint Georges l'un des soixante-douze disciples de Jésus-Christ et envoyé dans le Velay par saint Pierre, y aurait le premier prêché l'Évangile. « Pour lors, dit le père Eudes de Gissey, notre saint n'épargna rien contre le paganisme, baptisant à troupes les gentils, brisant les idoles, abattant les temples. » Dans un pré de Chaumel, sur les bords du ruisseau de Chalan, s'élève, sur une pierre renversée et entaillée, un fût de colonne : c'était, dit-on, un autel païen avant l'arrivée du glorieux saint Georges.
Quand l'apôtre eut converti les Vellaviens à la foi chrétienne, sa première oeuvre fut de renverser la pierre maudite ; il le fit même avec une telle colère, ajoutent les gens du pays, qu'on voit encore, sur la pierre, les marques de sa crosse et celles de ses pieds. A saint Georges succéda saint Macaire, puis saint Marcellin, qui rendait, dit-on, la parole aux muets, l'ouïe aux sourds, la vue aux aveugles, et chassait le malin esprit du corps des possédés. Au IXe siècle, l'église du Velay était puissante et renommée ; ses évêques, grâce aux libéralités des rois et des empereurs, jouissaient de grands privilèges. Sur les ruines des temples païens s'élevaient de riches abbayes ou des chapelles, célèbres par les miracles qui s'y opéraient. Notre-Dame-du-Haut-Solier, dans la Civitas Vetula, et l'Oratoire des Anges , sur le mont Anis, attiraient de nombreux pèlerins.
C'est dans le Velay que devait se tenir le concile convoqué par le pape Urbain II au sujet de la première croisade ; mais le pape ayant changé d'avis, le concile s'assembla à Clermont (1095). Néanmoins, le Velay prit une grande part à la sainte entreprise. On sait que Raymond, comte de .Toulouse, et Aymar de Monteil, évêque du Puy, en furent les chefs. Homme d'église et homme d'épée, fils d'un seigneur dauphinois, élevé dans le métier des armes, Aymar fut choisi par le pape pour le représenter. Il partit à la tète de quatre cents enfants de sa ville épiscopale. C'est lui qui, après la prise d'Antioche, en juin 1098, releva le courage des croisés, lorsque le sultan de Mossoul, Kerbogha, vint les assiéger dans leur nouvelle conquête, accompagné de Kilidje-Arselan, sultan des Turcs Seldjoucides, avec une armée de 200 000 combattants.
On prétend que ce fut un prêtre du Velay, du nom de Pierre Barthélemy, qui découvrit, après une révélation divine, la sainte lance qui avait jadis percé le sein de Jésus-Christ, et dont la vue ne contribua pas peu à relever le moral de l'armée, déjà décimée par la désertion, la disette et les maladies. Lés Turcs furent défaits sous les murs d'Antioche, ce qui augmenta la ferveur des gens de la langue d'oc ; mais ceux de la langue d'oil niaient le miracle de la sainte lance.
Aymar, évêque du Puy, qui semblait partager leur avis, mourut alors, et l'on ne manqua pas d'attribuer cette catastrophe, que rendaient toute naturelle la disette et l'épidémie, à une juste punition du ciel. Il mourut, dit un chroniqueur, et moult fut pleuré ; mais ruai lui avait pris de douter de la sainte lance, car la nuit de sa mort il apparut à Pierre Barthélemy et lui dit qu'il avait été conduit en enfer. « Là, ajoutait-il, j'ai été flagellé très rudement, et mes cheveux et ma barbe ont été brûlés. » Tel fut, suivant la légende, le châtiment d'Aymar.
Cependant, de grands débats s'étant élevés à cette occasion, et ceux de la langue d'oil persistant à méconnaître le miracle, Pierre Barthélemy s'offrit pour subir l'épreuve du feu ; il en mourut, disent les historiens français de la croisade, et la sainte lance demeura fort discréditée. Les Provençaux soutiennent, au contraire, qu'il triompha de cette terrible épreuve, et que les spectateurs enthousiasmés, le regardant comme un saint, se précipitèrent à l'envi sur lui pour toucher ses vêtements ; si bien qu'il fut renversé à terre, foulé aux pieds, et qu'il eût péri sans l'assistance d'un chevalier.
Après les croisades vinrent les guerres féodales. Chaque montagne du Velay avait son château crénelé, redoutable retraite d'où le châtelain envoyait ses hommes d'armes piller et ravager le pays. Au commencement du XIIIe siècle, Armand de Polignac et ses deux fils, Héracle et Pons, avaient fait bâtir aux abords des principales routes des tours d'observation, où des archers veillaient nuit et jour, prélevant sur tout ce qui passait un droit de péage. Voyageurs, pèlerins, marchands, nul ne pouvait s'y soustraire.
A l'exemple des sires de Polignac, les autres seigneurs du Velay se retranchèrent sur plusieurs points, et prirent à leur solde des compagnies armées. La terreur fut grande dans le pays ; le citadin n'osait sortir de ses murailles, le paysan de sa chaumière ; l'étranger ne s'aventurait qu'en tremblant à travers les montagnes. Un coupe-gorge, voilà ce que les seigneurs avaient fait du Velay au moyen âge Pierre III, évêque du Puy, fit un appel à ses vassaux et réprima les brigandages des châtelains. Héracle et Pons de Polignac s'engagèrent à livrer trente chevaliers comme otages ; mais, loin de. tenir leurs promesses, ils recommencèrent leurs spoliations. Cette fois, l'évêque en appela au roi Louis VII qui vint en personne châtier les tyrans du Velay.
A la mort de Pierre III, nouveaux troubles. Plus accommodant que son prédécesseur, Pierre IV, après avoir anathématisé le sire de Polignac, se réconcilia tout à coup avec lui. Cette paix n'était qu'un piège. Adalbert, évêque de Mende, s'en plaignit au roi : « Paix a été faite entre l'église du Puy et le vicomte de Polignac, lui écrivait-il ; mais cette paix, qui n'en est pas une, est un dangereux exemple, qui met en péril l'Église de Dieu. L'évêque du Puy, comme la dignité et la justice l'exigeaient, avait d'abord excommunié le vicomte, à cause de ses exactions sur les voies publiques ; cependant, à cette heure, l'église ancienne et le vicomte de Polignac se sont réunis et ont conclu entre eux une ombre de paix, en vertu de laquelle ils partagent les produits des péages et des rapines, de telle sorte que l'église participe aux spoliations pour lesquelles elle avait excommunié le vicomte, et qu'un secret amour du gain lui a fait approuver à son profit ce qu'elle avait condamné quand elle n'y avait pas d'intérêt... Ils veulent changer l'ordre des choses, ajoutait le digne prélat, et faire du temple de la mère de Dieu, qui doit être l'asile des affligés, une caverne de voleurs. Ceux qui ont été établis pour pleurer sur les souffrances du peuple, ceux qui lui remettent ses fautes, se sont préparés à se réjouir de ses larmes et à remplir leur bourse des produits du vol ; mais la justice de notre seigneur le roi s'étend sur tous ces hommes ; plaise au ciel qu'ils reconnaissent la vanité de leurs projets ! »
Alors le roi se trouvait à Souvigny : il y manda le vicomte et l'évêque. Tous deux protestèrent qu'ils n'avaient eu en vue, dans cette paix, que le bien de l'Église. Mais comme il avait trompé l'évêque, Héracle trompa le roi. A peine de retour dans ses montagnes, en effet, il reprend les armes. Non moins violent que son frère, Pons se joint à lui. « Saisis d'un instinct diabolique, dit un chroniqueur contemporain, ils faisaient du pillage à main armée l'emploi ordinaire de leur misérable vie. » Ils allaient, en effet, détroussant les voyageurs, ravageant les villes et les campagnes, dévastant les églises et les abbayes. Selon eux, « c'estoit un abus insupportable que des gens si inutiles à l'État que festoient les moines égalassent les princes en richesses ; » et, pour y remédier, ils les volaient.
Alexandre III en écrivit au roi Louis VII, l'invitant à mettre un terme à tant d'excès. « Le très pieux roi, ému de compassion et de colère, ajoute le chroniqueur, rassembla aussitôt son armée ; et comme il estoit prompt à saisir la verge du châtiment, il se hâta d'aller combattre ces grands coupables. Il les atteignit sur le théâtre de leurs méfaits, les attaqua avec vigueur, en véritable prince qu'il estoit, et leur fit sentir la pointe de son épée. Les ayant vaincus, il les prit, les emmena avec lui, et les garda prisonniers jusqu'à ce qu'ils eussent juré et promis sous les plus fortes garanties de renoncer désormais et à toujours à inquiéter les églises, les pauvres et les voyageurs (1163-1165). »
Comme toujours, les sires de Polignac jurèrent et promirent ; mais se parjurer n'était pas ce qui leur coûtait le plus, et le Velay souffrit encore de leurs exactions. Après avoir ravagé les terres de l'abbaye de la Chaise-Dieu, ils se disposaient à en faire le siège, quand le retour de Louis VII dans le Velay les força de se retirer. Vainement ils se retranchèrent dans le château de Nonnette ; ne pouvant résister, ils se rendirent, « jurant, sur le salut de leur âme, qu'ils se soumettoient par avance à tout ce que le roi ordonneroit. » Le roi les ramena prisonniers à Paris.
Après trois ans de captivité, Héracle et Pons redevinrent libres ; mais Armand, leur père, qui les avait poussés à la révolte, fut condamné, par sentence arbitrale, à réparer tous les dommages qu'il avait causés à l'église du Puy, à restituer toutes les sommes que lui ou les siens, ses gens ou ses chevaliers avaient imposées sur les routes aux voyageurs, aux pèlerins et aux marchands. Ses fiefs furent confisqués au profit de la couronne, et sa personne déclarée prisonnière jusqu'à l'entière exécution de la sentence. Ces conditions étaient dures ; néanmoins le vieux châtelain s'y soumit et fut rendu à la liberté.
Après sa mort, ses fils, ne pouvant se résoudre à les exécuter, demandèrent et obtinrent qu'elles fussent modifiées. Pons, par un traité signé en 1173, eut : 1° la moitié de la leude et des autres produits de la ville du Puy ; 2° deux des quatre châteaux Ceyssac, Aynac, Saint-Quentin et Seneulh. On lui rendit les deux autres. Après avoir fait amende honorable à la ville et à l'église de Brioude et légué son château de Casse à l'abbaye, Héracle partit pour la terre sainte et y mourut. De son côté , Pons fit hommage de sa vicomté à I'évêque du Puy, et se retira dans une abbaye de l'ordre de Citeaux. Ainsi finirent ces terribles chefs de routiers.
Plus tard, en 1380, le Velay eut à souffrir du passage des grandes compagnies ; elles s'emparèrent de plusieurs châteaux. Bertrand du Guesclin, l'intrépide guerrier, vint leur faire la chasse. Les consuls du Puy lui envoyèrent « beaucoup de vaillantes gens tant à cheval qu'à pied, artilleurs, archiers, arbalestriers, et eu oultre force artillerie, traits, canons, pouldre, arcs, arbalestes, engins et telles autres munitions belliqueuses ; force pain, vin, victuailles, desquelles choses ledit connétable se tint très content. » On sait comment il mourut. On lui fit les funérailles d'un roi ; il fut enseveli à Saint-Denis. Son cœur fut donné à la Bretagne, sa patrie, et ses entrailles furent religieusement transportées au Puy, qui lui éleva un tombeau.
Au XVe siècle, dans la guerre des Bourguignons et des Armagnacs, le Velay resta fidèle au roi. Bien qu'elle eût fort à souffrir, la ville du Puy envoya « vers monseigneur le Dauphin dix notables pour lui offrir toute obéissance de corps et de biens jusqu'à la mort. » Cependant, les Bourguignons, ayant à leur tète le sire de Rochebaron, voulurent se rendre maîtres du Velay. Ils s'emparèrent de plusieurs points importants et s'avancèrent jusque sous les murs du Puy ; mais les seigneurs du Velay l'avaient mis à l'abri de toute surprise. Après un long siège, « voyant que guière ne pouvoient profiter, vu que la ville estoit moult bien garnie de gens de défense pour leur résister, ils (les Bourguignons) s'en retournèrent à honte et à confusion, et allèrent parmi le pays faisant maux indicibles. »
Sous la domination des Wisigoths ariens, le Velay était resté catholique ; il persévéra dans sa foi pendant les longues et sanglantes guerres du XVIe siècle : Vainement Blacons, lieutenant du baron des Adrets, vint mettre le siège devant Le Puy ; il y trouva l'élite de la noblesse du Velay prête à défendre la ville. Ne pouvant pénétrer dans la place, les assiégeants vont s'emparer du château d'Espaly, dans le voisinage ; puis, se rapprochant de la ville, ils essayent de la prendre de vive force ; mais, repoussés vigoureusement, ils sont contraints de lever le siège.
Plus tard, en 1621, Blacons revint dans le Velay et y surprit Yssingeaux ; mais le curé, vieillard septuagénaire, se mit à la tète de ses paroissiens et chassa de la ville Blacons et ses bandes. Ces résistances vigoureuses arrêtèrent le progrès des idées nouvelles dans le Velay. Depuis plus d'un siècle, ce pays jouissait du plus grand calme, lorsque Mandrin y parut en 1754. Après avoir rançonné les campagnes, il entre au Puy, pille la maison du capitaine général des fermes, force les prisons, enlève plusieurs détenus, et se retire chargé de butin. Bientôt il tente une seconde expédition dans le Velay. Attaqué, cette fois, par cent hommes de cavalerie, il parvient à leur échapper à la faveur de la nuit, et se réfugie en Savoie.
Pendant la guerre de 1870-1871, ce pays a envoyé son contingent de mobiles à l'armée de la Loire.
Les départements et leur histoire - Loire - 42 -
L'auteur de l'Astrée décrit ainsi le pays anciennement habité par les Ségusiens : « Auprès de l'ancienne ville de Lyon, du costé du soleil couchant, il y a un pays nommé Forests ; qui, en sa petitesse, contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules ; car, estant divisé en plaines et en montagnes, les unes et les autres sont si fertiles et situées en un air si tempéré, que la terre y est capable de tout ce que peut désirer le laboureur.
« Au coeur du pays est le plus beau de la plaine, ceinte, comme d'une forte muraille, de monts assez voisins, et arrousée du fleuve de Loire, qui, prenant sa source assez près de là, passe presque par le milieu, non point encore enflé et orgueilleux, mais doux et paisible. Plusieurs. autres ruisseaux en divers lieux la vont baignant de leurs claires ondes ; mais l'un des plus beaux est Lignon, qui, vagabond en son cours aussi bien que douteux en sa source, va serpentant par cette plaine depuis les hautes montagnes de Cervières et de Chalmazel, jusques à Peurs, où Loire le recevant et lui faisant perdre son nom propre l'emporte pour tribut à l'Océan. » Alliés, sous Vercingétorix, des Éduens (Autunois) leurs voisins, et placés entre le Rhône et les Arvernes, les Ségusiens avaient pour cité Forum, aujourd'hui Feurs, d'où le Forez paraît avoir tiré son nom.
César et Ptolémée font mention des Ségusiens, peuple libre, suivant Pline, Segusiani liberi. On croit qu'ils se livraient au commerce. Ils prirent une part active à la guerre de l'indépendance par l'envoi d'un contingent de 10 000 hommes à l'armée nationale. On dit même que c'est près de Saint-Haon-le-Vieux que César défit complètement Vercingétorix. Au milieu d'une prairie s'élève un rocher sur lequel sont sculptées de grandes clefs en relief, en mémoire, racontent les habitants du pays, de la victoire de César.
Après la conquête romaine, cette contrée, comprise dans la Lyonnaise, devint une colonie florissante : Des temples et des palais s'élevèrent ; des voies romaines et des aqueducs sillonnèrent le pays dans tous les sens. Pendant près de cinq siècles, les Romains y dominèrent. On y voit encore plus d'une trace de leur long séjour. Comme dans la plupart des cités gallo-romaines, le christianisme naissant y eut ses persécuteurs et ses martyrs. Conquis par les Bourguignons en 478, puis par les Francs en 534, le Pagus forensis fut compris dans le partage que firent entre eux les enfants de Clovis, en 534. Plus tard, en 727, les Sarrasins le ravagèrent. Après un assez long déclin, il refleurit sous Charlemagne. Il faisait alors partie du comté du Lyonnais, dont le gouvernement était confié à des comtes amovibles.
Sous le règne de Charles le Chauve, l'un de ces comtes, appelé Guillaume, parvint à rendre son pouvoir héréditaire. Il se qualifiait de comte par la grâce de Dieu (900). Après lui, Artaud Ier son fils, régna sur les Forésiens, avec le titre de comes Forensium. A ce comte succéda Artaud II. Burchard, archevêque de Lyon , s'étant permis, dans cette ville, des actes d'autorité qui blessaient les droits de ce prince, celui-ci entra à main armée sur les terres de l'Église lyonnaise et les ravagea (999). Artaud III contribua à chasser les Maures du Dauphiné.
Son frère, Giraud II, qui lui succéda, réunit au comté de Lyon son apanage particulier, le comté de Forez, et continua contre les archevêques de Lyon la lutte commencée par Artaud II ; mais il fut chassé de cette ville par les troupes de Conrad le Salique.
Ce comte avait une fille qui s'appelait Prêve. Celle-ci, désirant se retirer du monde, fit part de son dessein à son père et à sa mère, qui lui assignèrent comme retraite le château de Pommiers. Prêve était jeune et belle. Un jeune seigneur s'en éprit et la rechercha en mariage ; mais elle rejeta ses propositions , disant qu'elle avait fait choix de son époux. « Soit erreur, dit la chronique (Histoire du Forez, par A. Bernard), sur le sens de ces paroles, soit que son amour-propre fût blessé de ce refus, ce jeune seigneur vint dire aux frères de Prêve, qui étaient ses amis et l'avaient même encouragé dans sa demande, que leur soeur s'était déshonorée et qu'elle vivait en concubinage. Les deux plus jeunes, sans chercher à s'assurer du fait, croyant en avoir assez appris par ce seul refus de mariage, viennent la trouver dans son château de Pommiers, et, l'ayant engagée à une promenade, lui coupèrent la tête et la jetèrent avec le cadavre dans un puits, qui est celui qui encore aujourd'hui sert à l'usage du public du bourg. »
Après Giraud II régna Guillaume III, dont Guillaume de Tyr parle avec éloge. Poussé, dit-on, par des chagrins domestiques, il fut l'un des premiers à se croiser. Quoi qu'il en soit, réputé pour ses vertus et pour ses talents militaires, il périt au siège de Nicée, laissant son héritage à Guillaume IV, son fils, qui mourut sans postérité. Ainsi finit, après deux siècles d'existence, la première race des comtes de Forez (1107).
Alors, par le mariage d'Yde-Raymonde , fille d'Artaud IV, avec Gui-Raymond d'Albon, dauphin de Viennois, le comté passa dans une autre maison, et la seconde race des comtes de Forez commença. Gui Ier laissa trois fils : l'un se fit chartreux, le second succéda à son père, et le troisième, Raymondin, épousa la fameuse Mélusine dont il est si souvent parlé dans les anciens romans de chevalerie et surtout dans l'Astrée.
Armé chevalier par le roi lui-même, Gui II eut à défendre le Forez contre les entreprises de Guillaume, comte de Nevers. Saint Bernard intervint dans la querelle des deux comtes. « Il trouva dans le comte de Forez, dit Jean l'Hermite, toute la docilité qu'il pouvait désirer ; mais celui de Nevers protesta qu'il n'accorderait ni paix ni trêve à son ennemi qu'il ne l'eût chassé de ses terres ; et aussitôt, ayant rassemblé ses troupes, il entra dans le Forez. Le comte Gui, ne pouvant éviter le combat, se recommanda aux prières du saint homme, qui lui promit la victoire, et l'événement justifia la promesse ; car Gui, plein de foi, s'étant jeté comme un lion furieux sur les troupes de son ennemi, les tailla en pièces, de telle sorte qu'à peine deux ou trois de ses gens purent échapper au carnage et que le comte de Nevers lui-même fut fait prisonnier. »
Cependant les archevêques de Lyon n'avaient point renoncé à ce qu'ils appelaient leurs droits sur cette ville, dont les comtes de Forez se disaient possesseurs de temps immémorial. Héracle en occupait alors le siège. Il voulut faire valoir ses prétentions. Alors Gui II entra dans le comté avec une armée, prit Lyon, y maltraita les partisans d'Héracle, surtout les clercs, dont les maisons furent pillées, et força le prélat lui-même à se retirer dans le Bugey. Il y eut des pourparlers, mais qui n'aboutirent qu'après de longues disputes dont le roi et le pape durent se mêler. Les deux prétendants se partagèrent la ville (1157).
Plus tard, cependant, en 1173, Gui céda à l'archevêque le comté de Lyonnais, en échange de plusieurs domaines que celui-ci possédait dans le Forez, et moyennant. onze cents marcs d'argent. Philippe-Auguste et le pape ratifièrent ce traité, en 1180. C'est de cette époque que les chanoines de Saint-Jean, à Lyon, furent appelés comtes de Lyon, comme ayant succédé aux droits des comtes de Forez.
Après Gui II, Gui III gouverna le comté. Il partit avec Renaud de Dampierre pour la croisade, en 1096, et mourut, en 1202, sous les murs de Tyr, regretté de toute l'armée. Son fils, Gui IV, eut en 1214 des démêlés avec le sire de Beaujeu, son voisin. Philippe-Auguste intervint et tout s'arrangea par arbitrage. Ce même Gui s'opposa, en 1215, au passage du Bugre d'Avignon, qui voulait traverser le Forez pour aller rejoindre son neveu, Ferdinand de Portugal. Ayant rassemblé une forte armée, le comte alla à la rencontre du Bugre, lui livra bataille le même jour que Philippe-Auguste livrait celle de Bouvines, et, l'ayant battu et fait prisonnier, « il le mena triomphant à Paris. »
Huit ans après, en 1223, il octroya une charte d'affranchissement aux habitants de Montbrison. C'est le premier comte de Forez qui. ait fait cet octroi à ses serfs. Son exemple fut suivi par les autres petits seigneurs ses vassaux. Outre Montbrison, Saint-Rambert, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Bonnet, Cornillon, Valleret obtinrent le droit de s'ériger en communes.
Dans la guerre des Anglais, les comtes de Forez se signalèrent par leur dévouement à la cause nationale ; l'un d'eux, Gui III, contribua puissamment à la reprise de Miremont et de Villefranche sur l'ennemi (1345). Deux ans après, il se trouva dans l'armée du roi, « marchant, dit Froissart, à l'encontre de l'Anglois. » Cependant le Forez eut sa large part de malheurs dans cette guerre. Montbrison tomba au pouvoir de l'ennemi qui la livra aux flammes.
Après les Anglais vinrent les mange-lard, puis les croquants, les redonteurs, et enfin les tard-venus, tous bandits ou voleurs qui se mirent à ravager le pays sous des chefs hardis et expérimentés qu'ils se choisissaient eux-mêmes. Déjà ils avaient jeté un camp volant jusqu'à la ville de Charlieu, d'où ils menaçaient de se ruer sur le Forez, quand Jacques de Bourbon, comte de la Marche, ayant reçu mission du roi Jean d'aller donner la chasse à ces pillards, passa par ce pays. Il prit avec lui ses deux neveux de la maison de Forez, savoir : le comte Louis et Jean son frère, que leur oncle Renaud, seigneur de Malleval, voulut accompagner (1362).
« Ce prince, dit un vieux chroniqueur, se rend donc à Lyon avec ces trois seigneurs, qui composoient alors toute la maison de Forez, et, ayant tenu son conseil de guerre avec les principaux officiers de son armée, il fut délibéré, pour ne donner temps à ces bandits de s'approcher davantage de la ville de Lyon, ou de s'épancher davantage dans le pays voisin et spécialement dans celui de Forez qui estoit cher à ce prince, à cause de ses neveux, de les aller combattre. Ce prince donc, avec le comte d'Uzcz et Renaud de Forez, seigneur de Malleval, et quelques autres seigneurs de l'armée, choisissent des coureurs pour aller reconnoître les ennemis, qui, se prévalant de la commodité d'une montagne voisine de Briguais, ne firent paroître sur l'éminence qui regardoit Lyon qu'environ cinq mille hommes, le reste, par ruse de guerre, s'estant caché derrière la montagne, qui avoit encore pour eux cet avantage qu'elle estoit pierreuse et leur fournissoit des cailloux à commodité pour en accabler ceux qui les y viendroient attaquer.
« Ces coureurs ayant fait rapport du petit nombre qu'ils avoient aperçu, et n'ayant pas remarqué les amas de pierres qui estoient sur cette montagne, le prince, croyant avoir l'avantage de son costé et pour le nombre d'hommes et pour le courage des combattants, mit son armée en bataille pour aller à eux, et dans cette marche fit plusieurs grands seigneurs chevaliers, qui levèrent bannière, selon les formes et coutumes de ce temps-là. » Parmi ces chevaliers était « ce Louis, comte de Forez, son neveu, lequel, en effet, avant ce grade de chevalerie, et pour ne l'avoir pas encore, estoit qualifié, avant qu'il fust comte, de simple nom de damoiseau, nobilis vir Ludovicus de Foresio, domicellus, comme on le voit en la bulle de dispense de son mariage avec Jeanne de Turenne. »
A la vue de cette armée, dont l'avant-garde comptait seize cents combattants, les tard-venus, « qui avoient paru dessus leur montagne, attendirent de pied ferme qu'on les y vînt attaquer, et sitôt qu'ils virent l'armée assez près d'eux pour la combattre, ils jetèrent d'en haut de toutes parts une telle grêle de cailloux qu'ayant d'abord enfoncé et mis en déroute l'avant-garde, ils mirent aussi en désarroi le corps de bataille, dans lequel, après les bannières ou enseignes du prince commandant et de son fils marquées des armes de Bourbon, paroissent celles de ses neveux, le comte de Forez et son frère. Ils renversèrent à force de pierres les meilleurs bataillons de ce corps d'armée ; après quoi leurs autres troupes, qui estoient cachées derrière la montagne, serrant leurs files et courant en diligence, vienrent donner à dos sur l'arrière-garde, dont s'ensuivit une mêlée entre les deux armées où il y eut un grand carnage de part et d'autre ; mais, enfin, la victoire s'inclinant du côté des tard-venus, le champ de bataille leur demeura, et ce qui resta de l'armée des princes se retira en grande confusion. » Telle fut cette bataille de Brignais, « bataille, dit Froissart, qui fit si grand profit aux compaignons et porta un coup funeste au Forez et à la seconde race de ses comtes. »
Louis, en effet, y périt, et Renaud, son oncle, y fut fait prisonnier. Seul, Jean de Forez, frère du comte et qui lui succéda, en revint sain et sauf ; mais il ne tarda pas de ressentir les effets de ce grand désastre : « Il tomba en un délire qui lui causa une faiblesse et imbécillité d'esprit qui lui demeura le reste de sa vie, et obligea la princesse sa mère et ses autres parents de lui nommer pour curateur son oncle Renaud de Forez, sitôt qu'il fut sorti de prison ; » mais celui-ci vendit le Forez à Louis de France, second fils du roi Jean, et dès lors ce comté passa dans l'immense apanage des ducs de Bourbon.
Sous ces ducs, le Forez, souvent visité par eux, jouit d'une longue prospérité. Ils y régnèrent jusqu'à la mort de Suzanne de Bourbon, arrivée en 1521. Louise de Savoie, mère de François Ier, hérita de ce comté, qui fut réuni à la couronne en 1531.
Après les comtes de Forez et les ducs de Bourbon, les d'Urfé ou d'Ulphé (Ulphiacum) ont laissé le plus de souvenirs dans ce pays. Si les premiers en furent les maîtres, ceux-ci en furent les pères et les bienfaiteurs. Ainsi que toutes les grandes familles, les d'Urfé ont leur légende. On croit qu'ils sont originaires d'Allemagne. Un comte Welphe, que les chroniques des Pays-Bas appellent duc de Bavière, et qui vivait au Moyen Age, serait, suivant l'opinion générale, leur premier ancêtre connu.
De ce duc naquit Welphe, dit le Robuste, célèbre dans les croisades. Son fils, Welphe le Vaillant, vint à la cour du roi Louis le Gros et le suivit dans son expédition contre les sires de Polignac dans le Velay. Comme il revenait du Puy avec ce prince, en passant dans le pays de Forez, il fut si fort épris de la beauté d'une parente de Gui Ier, comte de Forez, appelée Aymée, qu'il demanda et obtint sa main. Il se fixa dans le pays et y fit bâtir, sur l'un des plus hauts lieux, un château auquel il donna son nom, Welphe ou Ulphe, qui se modifia plus tard en celui d'Urphé ou Urfé.
Telle est l'origine de cette famille célèbre. Sa fortune fut rapide. Déjà puissants sous la seconde race des comtes, les d'Urfé représentèrent la troisième et plus tard lui succédèrent. Héritiers des comtes, presque étrangers au pays, les ducs de Bourbon sentant la nécessité d'y avoir un représentant, Guichard d'Urfé, qui était déjà l'ami et le confident du duc Louis II, fut par lui pourvu de la charge de bailli de Forez, qui resta depuis presque toujours dans sa famille. A ce titre, la faveur des princes attacha, dans la suite, de grands et nombreux privilèges dont les d'Urfé jouirent jusqu'au règne de Louis XIV.
Alors l'esprit centralisateur « vint, dit un biographe des d'Urfé, étouffer les provinces et leurs patrons, et la maison de d'Urfé, qui n'avait tiré toute son illustration que de son pays, alla quelque temps végéter à Paris, puis s'y éteignit presque sans gloire dans le XVIIIe siècle. »
Cependant les sages efforts des d'Urfé ne parvinrent pas toujours à préserver ce pays. C'est ainsi qu'à peine sorti des guerres féodales et étrangères il eut à souffrir des guerres de religion. Plusieurs « ministres et prédicants qui s'estoient perchez ez villes de Feurs, Saint-Galmier et Saint-Bonnet-le-Chastel » ayant été arrêtés et conduits dans les prisons de Montbrison (1562), les protestants. armèrent en diligence.
Bientôt le baron des Adrets parut dans le Forez. Après avoir pris Feurs, le 3 juillet, il marcha sûr Montbrison à la tête de quatre mille hommes et s'en empara. De Montbrison, il alla droit au château de Montrond, où le gouverneur du Forez s'était renfermé. Il y entra le lendemain ; puis, y laissant Quintel, un de ses lieutenants, il se retira à Lyon, non sans avoir laissé derrière lui de nombreuses traces de sang. On dit qu'à Mont rond il pilla l'église ; et parce qu'ils étaient trop lents à lui apporter les vases sacrés, il fit, ajoute la chronique, jeter en bas du clocher le curé et le marguillier.
Ainsi maîtres de la principale place du Forez, les calvinistes faisaient chaque jour des expéditions contre les villes voisines qui n'étaient nullement en état de défense, et que Saint-Aubin nomme les villottes du Forez ; ils envoyèrent à Saint-Bonnet-le-Château une compagnie d'archers, qui revint après avoir brûlé tous les papiers de l'église. Boën, Saint-Galmier, Saint-Germain se souviennent encore de leur terrible. visite. De pareils excès étaient loin de concilier aux huguenots les habitants du Forez ; les catholiques prirent les armes, et, sous la conduite de Saint-Chamond, de Saint-Hérand et de Saint-Vidal, firent la chasse aux soldats de des Adrets.
Après son expédition contre Saint-Étienne, Sarras, capitaine huguenot, s'en revenait, avec les siens, chargé d'armes et de butin. Saint-Chamond, qui avait environ quinze cents hommes, dont sept à huit cents arquebusiers, le surprit, et, l'ayant battu, il vint mettre le siège devant Annonay, alors ville forésienne et qui tenait pour le parti protestant. Cette ville capitula ; mais, contre la foi des traités, Saint-Chamond fit passer au fil de l'épée tous ceux qui furent pris les armes à la main et précipiter en bas ceux qui étaient dans les tours. Puis, apprenant que des Adrets marchait au secours de cette ville, « avec quatre cents argoulets, il lui accourcit le chemin et l'affronta à Beaurepaire, si rudement, que des Adrets, voyant ses gens taillez en pièces, se retira de la meslée et gaigna Lyon à la course (1562). »
Après la bataille de Moncontour, des bandes de l'armée protestante se jetèrent dans ce pays, disant qu'elles voulaient plumer les oizons du Forez ; elles y séjournèrent près d'un mois, pendant lequel elles « firent de grands bruslements et saccagements ; tellement que du donjon de Montbrison de jour à autre on voyoit le feu allumé en divers lieux (1569). » Au fléau de la guerre civile vinrent se joindre la peste, la famine et le débordement de la Loire. Jamais le Forez n'avait plus souffert : la tradition rapporte qu'il ne resta que vingt-cinq habitants à Bourg-Argentai. A Montbrison, l'herbe croissait dans les rues. Dans la seule année 1589, Saint-Étienne compta 7 000 morts.
« Henri III estoit mort, dit un vieux chroniqueur du Forez ; messire Anne d'Urfé, gouverneur de ce pays pour la Ligue, fit lever la main à tous ceux qui vouloient suivre ce party en l'assemblée générale du pays qui fut faicte à Montbrison. Plusieurs y firent serment de fidélité à la Ligue ; mais pour-tant il fut remarqué que plusieurs habitants de Montbrison tenoient le party du roy. C'est pourquoy le marquis d'Urfé ayant en ladicte ville sa compagnie de gens d'armes dict qu'il leur feroit affront s'ils ne changeoient de party ; et, en effet, le 15 août 1589, ils se mirent à battre ceux de Montbrison qui ne tenoient pour la Ligue et en blessèrent plusieurs. » Cependant, en 1595, Montbrison se rendit au roi ; mais son château fut rasé ainsi que ceux de Bourg-Argentai, de Donzy et autres.
Compris, en 1790, dans le département de Rhône-et-Loire, le Forez paya largement son tribut à la Révolution par le pillage de ses châteaux et de ses églises et par un grand nombre de victimes envoyées à l'échafaud. Depuis ce temps, à part la grève de Ricamarie, en 1869, sa répression sanglante et l'émeute de Saint-Étienne, pendant la Commune, en 1871, ce pays s'est livré tout entier au commerce et à l'industrie.
Jusque-là l'exploitation des mines de plomb, d'étain, de cuivre, d'or, d'argent et autres métaux, dont un bourgeois de Lyon avait obtenu le privilège, en 1405, s'était peu développée ; grâce à des temps plus calmes, elle prit une grande extension. Mais on songeait peu alors aux mines de houille qui ont fait plus tard la fortune de ce pays. Depuis 1572, on parlait de rendre la Loire navigable. Ce projet tant de fois ajourné reçut enfin un commencement d'exécution. On fit plus : on tenta, au moyen d'un canal de jonction entre le Rhône et la Loire, d'ouvrir sur les deux mers un débouché à l'industrie de cette contrée. Cette entreprise gigantesque n'a pu être achevée, et le canal ne vient encore que du Rhône à Givors ; mais les chemins de fer y ont suppléé.
C'est surtout à partir de 1820 que ce pays s'est successivement élevé au degré de prospérité industrielle qu'on y remarque, et qu'il doit à l'abondance de ses combustibles minéraux, à ses nombreux établissements métallurgiques et à ses nouvelles voies de communication. Au XIXe siècle, son industrie minérale et sa fabrication de rubans y contribuent, il est vrai, d'une manière inégale, la première en créant une valeur beaucoup au-dessous de celle que produit la seconde. Néanmoins, elles se fécondent l'une par l'autre. De là une source intarissable de travail pour une population qui peut s'accroître en conservant un grand bien-être.
Les départements et leur histoire - Loir-et-Cher -41
Le Blaisois, le Vendômois et une partie de la Sologne, trois contrées comprises dans l'ancien Orléanais, ont formé, en 1790, le département de Loir-et-Cher. Avant la conquête romaine, ce pays était occupé par les Carnutes, sauf quelques parcelles au sud et à l'ouest, qui confinaient au territoire des Bituriges et des Turones.
Grégoire de Tours est le premier historien qui désigne sous un nom particulier, Blesenses, les habitants de Blois et des environs. Nous avons eu si souvent occasion de raconter l'énergique résistance que les Carnutes opposèrent à César et à ses successeurs, l'histoire de ce département aux époques postérieures est d'ailleurs si importante, que nous consacrerons quelques lignes seulement à la période gallo-romaine.
D'immenses forêts, un sol bas et marécageux, la difficulté des communications protégeaient, au milieu de ces contrées, les mystères du culte druidique et y assuraient l'influence sacerdotale dont le centre était, comme on sait, dans le pays Chartrain. Le fanatisme religieux vint donc en aide à l'esprit national dans sa lutte contre l'étranger. Le christianisme, qui y pénétra de bonne heure, dut s'y faire accueillir comme une protestation contre le paganisme des maîtres ; son avènement semblait d'ailleurs préparé par les dispositions mystiques qu'entretenaient les druides et par certaines assimilations religieuses, la glorification de la Vierge, entre autres, dont les premiers apôtres profitèrent avec beaucoup d'habileté. Puis vinrent les Francs, et cette partie du territoire des Carnutes fut incorporée dans le royaume de Clovis, avec la quatrième Lyonnaise, dans laquelle elle était comprise depuis le règne d'Honorius.
Sous les Mérovingiens, le pays dont nous avons à nous occuper suivit la fortune de l'Orléanais, qui tantôt constituait le centre d'un État particulier dans les partages de l'empire, tantôt rentrait dans l'unité territoriale de la monarchie franque ; ces provinces étaient gouvernées, au nom du roi, par des seigneurs qui, n'ayant point encore de pouvoir héréditaire, n'ont laissé de leur passage aucun souvenir qui mérite d'être conservé.
C'est seulement au commencement du IXe siècle que nous voyons surgir cette maison de lillois, destinée, sous ses diverses dynasties, à tant de puissance et à tant de gloire. Le premier comte de Blois est un frère d'Eudes, comte d'Orléans, nommé Guillaume. Son fils ou son neveu, qui s'appelait Eudes, lui succéda en 837 et eut pour successeur Robert le Fort, tige des princes de la troisième race.
Malgré notre désir de circonscrire notre récit dans l'histoire de la province, les annales du Blaisois deviennent ici l'histoire de France. Robert le Fort avait laissé deux fils : Eudes, comte de Paris, et Robert, comte de Blois. Le premier fut revêtu de la puissance royale par les seigneurs et les évêques réunis à Compiègne, la race déchue des descendants de Charlemagne devenant impuissante à protéger la patrie contre les Normands, dont les armes menaçaient jusqu'aux murs de Paris. Après avoir régné dix ans, Eudes ne put, en mourant, assurer la couronne à son frère Robert ; telle était cependant la puissance de cette famille que Robert put se faire sacrer roi à Reims, et que, sans la perte de la bataille de Soissons, où il fut tué, peut-être est-ce de lui qu'eût daté la troisième dynastie de nos rois.
Pendant que s'éteint la race carlovingienne, la descendance de Robert le Fort ne cesse de grandir, et lorsque la branche des comtes de Paris usurpe la couronne dans la personne de Hugues Capet, la branche des comtes de Blois, représentée par Thibaut le Tricheur, son cousin germain et comme lui arrière-petit-fils de Robert le Fort, réunit au Blaisois la Touraine, le comté de Champagne et le pays Chartrain.
Nous avons insisté sur cette généalogie, quelque peu aride, pour bien constater la haute position qu'occupaient des lors les comtes de Blois dans la féodalité française. Si Thibaut mérita son surnom par des traits de déloyauté et de fourberie que la morale si peu scrupuleuse de son temps n'a cependant pas craint de flétrir, il faut aussi reconnaître que, en véritable descendant de Robert le Fort, il lutta obstinément contre l'étranger ; il perdit son fils aîné dans une bataille livrée à Richard, duc de Normandie ; ce fut son second fils, Odon ou Eudes, qui lui succéda, et, après la mort de celui-ci, sa femme, Berthe, fille de Conrad, roi de Bourgogne, épousa en secondes noces Robert, fils de Hugues Capet.
Eudes II, successeur d'Odon, ajouta à ses titres héréditaires celui de comte palatin ou premier comte du palais ; son crédit à la cour du roi Robert était immense, ses richesses fort considérables ; les revenus de la célèbre abbaye de Marmoutier lui appartenaient presque en totalité ; le nom des adversaires auxquels il fit la guerre suffirait à prouver quelle devait être sa puissance : sans parler des comtes de Vermandois, auxquels il enleva la dignité de palatin, citons Henri Ier d'Angleterre, Raoul, roi de Bourgogne, son oncle, et Conrad, roi d'Italie, qui fut depuis empereur. Ce guerroyeur infatigable périt enfin dans une bataille qu'il livra à Gosselin, duc de Lorraine et de Bar.
Son fils Thibaut, mort en 1088, perdit le comté de Tours, que lui enleva Geoffroy-Martel, comte d'Anjou ; malgré cet amoindrissement, il laissa de si vastes domaines à son successeur, Étienne ou Henri-Étienne, que ce seigneur était appelé communément le grand comte de France, et qu'un vieux dicton recueilli par les chroniqueurs contemporains lui attribuait la possession d'autant de châteaux qu'il y a de jours dans l'année.
Après s'être signalé dans un premier voyage en terre sainte par l'éclat de ses exploits et la sagesse de ses conseils, Étienne, dans une seconde expédition, fut tué à la bataille de Rama, laissant huit enfants, dont cinq fils. On fit passer rainé pour atteint de folie : il se faisait appeler, dit-on, seigneur du soleil ; pour ce motif ou sous ce prétexte, il fut dépouillé de la plus grande partie de l'héritage paternel. Le second, nommé Thibaut, comme son père, fut comte de Blois et de Champagne. Le quatrième devint roi d'Angleterre par son union avec Mahaut de Boulogne, héritière de la couronne. C'est sous le nom d'Étienne de Blois qu'il figure dans la liste des monarques anglais. Les deux autres frères n'ont laissé aucun souvenir historique ; on suppose qu'ils furent évêques ou n'eurent dans la succession qu'une part peu importante.
Ce Thibaut, substitué aux droits de son aîné, eut aussi plusieurs enfants, entre lesquels fut partagée aussi sa succession. Le comté de Blois échut au second de ses fils, qui s'appelait Thibaut comme lui. Celui-là épousa une fille du roi Louis le Jeune, fut sénéchal de France et périt au siège de Saint-Jean-d'Acre, en Palestine. Nous avons ici un exemple frappant des coups que portèrent les croisades à la féodalité française, si profondément enracinée dans le pays, obstacle qui arrêtait depuis si longtemps le développement de la prospérité nationale.
Louis, fils de Thibaut, part aussi pour la croisade et meurt à la bataille d'Andrinople. De cette nombreuse et florissante famille, un seul fils reste, Thibaut, qui meurt sans enfants, et le comté de Blois passe à sa cousine Marie d'Avesnes, qui le porte dans la maison de son époux, Hugues de Châtillon. Sans doute les nouveaux comtes de Blois étaient encore d'une famille illustre et puissante ; mais combien nous sommes loin déjà de Robert le Fort et de Thibaut le Tricheur !
La dynastie des Châtillon régna sur le Blaisois de 1230 à 1391. Dans cette période commencent à poindre les premiers germes de franchises municipales ; la monnaie locale que battaient les comtes de Blois subit une dépréciation proportionnée à l'extension des relations commerciales ; Gui Ier est obligé de vendre son droit de monnayage à. Philippe de Valois, sa monnaie de pouvant plus soutenir la concurrence avec la monnaie royale.
Tout révèle que la France est invinciblement entraînée vers la constitution de son unité ; cette oeuvre ne s'accomplira pas sans de grands efforts ni sans de pénibles déchirements, mais les croisades préparent l'émancipation par l'épuisement de la féodalité, et, dans l'histoire particulière du Blaisois, c'est des Châtillon que date cette phase nouvelle.
Enfin, en 1591, Louis de Châtillon, unique héritier de Gui Ier et désespérant lui-même d'avoir des enfants, se laissa entraîner par les conseils du sire de Coucy, habile diplomate, dirait-on aujourd'hui, grand contracteur, selon la ici les faits d'un intérêt plus général. L'époux de Valentine fut assassiné, comme on le sait, par les ordres du duc de Bourgogne.
Charles, son fils, pour venger la mort de son père, appela l'étranger à son aide ; il expia ce crime par une captivité de vingt-cinq ans ; fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, il confia l'administration du comté d'abord à son frère, comte des Vertus, puis à Dunois, bâtard d'Orléans. Il ne recouvra la liberté qu'en 1440, et c'est encore vingt-deux ans plus tard, en 1462, qu'il eut de sa troisième femme, Marie de Clèves, un fils qui fut le roi Louis XII.
Cet espace de près d'un siècle fut rempli par les événements les plus calamiteux. A la guerre des Armagnacs succéda la guerre contre les Anglais. Le Blaisois fut traversé et ravagé souvent par les troupes de tous les partis. C'est dans cette contrée que Jeanne Parc rassembla. la petite armée à la tête de laquelle elle partit pour faire lever le siège d'Orléans.
Quand la paix était rétablie partout ailleurs, le Blaisois fut encore le théâtre de la sédition connue sous le nom de Praguerie ou de guerre des écorcheurs. Charles VII, vainqueur des Anglais et comprenant la nécessité de donner à l'armée une organisation régulière, voulut procéder au licenciement des compagnies franches dont les habitudes de violence et de pillage rendaient la paix presque aussi désastreuse que la guerre aux habitants des pays que ces bandes traversaient.
Les capitaines, jaloux de conserver la sauvage indépendance dans laquelle ils vivaient, surent intéresser à leur cause les seigneurs, les princes du sang qui avaient été leurs compagnons d'armes ; le dauphin lui-même, celui qui devait être Louis XI, consentit à être le chef des mécontents, et c'est dans le Blaisois que s'organisa cette révolte dont les conséquences pouvaient être si funestes, si l'habileté énergique du roi n'était parvenue à la comprimer dès le début.
Les guerres de religion qui agitèrent le siècle suivant n'épargnèrent pas davantage le pays ; mais nous en réservons le récit pour notre notice sur la ville de Blois, dont le nom seul rappelle les épisodes les plus importants de ce drame. Depuis l'avènement au trône de Louis XII, le Blaisois avait été réuni au domaine royal. Depuis Louis XIII jusqu'à nos jours, les événements qui s'y sont passés appartiennent aux chroniques locales ou rentrent dans l'histoire générale de la France, que nous n'avons ni la mission ni l'ambition de traiter ici.
Il nous reste seulement quelques lignes à ajouter sur le Vendômois et la Sologne, dont les territoires, comme nous l'avons dit en commençant, sont entrés aussi dans la constitution du département de Loir-et-Cher. Le Vendômois (Vindocensis ou Vidocinensis ager) reste confondu jusqu'au Xe siècle dans cette immense contrée couverte de bois qui formait primitivement le pays des Carnutes. C'est sous Charles le Chauve qu'il prend une existence politique distincte et devient comté héréditaire.
On pourrait s'étonner de voir ce petit fief conserver son indépendance dans le voisinage si périlleux des domaines de Robert le Fort et de Thibaut le Tricheur ; l'histoire nous donne l'explication de ce fait. Bouchard, comte de Vendômois à cette époque, jouissait de la plus haute considération auprès des Capets ; il fut le général et le premier ministre de Hugues.
Peut-être encore crut-il devoir consolider son crédit par le prestige d'un certain caractère religieux ; car, quoique :marié et père de deux enfants, nous le voyons se retirer du monde avec le consentement de sa femme et se faire moine en 1007 dans l'abbaye de Saint-Maur-les-Fossés, près de Paris. Son fils Renaud, évêque de Paris, hérita de sa faveur auprès de Hugues Capet dont il fut chancelier. Sa nièce, Adèle, apporta en dot le Vendômois à Bodon de Nevers, dont le second fils, Foulques, surnommé l'Oison, eut le comté maternel pour sa part d'héritage. La fille unique de ce dernier, Euphrosine, fit passer par son mariage le Vendômois dans la maison de Preuilly, où il demeura cent ans environ.
La famille de Montoire le conserva pendant les deux. siècles qui suivirent. C'est en 1362 qu'une Catherine de Vendôme, unique héritière de cette famille, épousa Jean de Bourbon, comte de La Marche. En 1514, le comté de Vendôme fut érigé en duché-pairie par Louis XII en faveur de Charles de Bourbon, aïeul de Henri IV. Ce prince étant devenu roi réunit le Vendômois à la couronne, puis, en 1598, il le donna en apanage à César, fils naturel qu'il avait eu de la belle Gabrielle d'Estrées. Louis-Joseph, arrière-petit-fils de César, reconnu duc de Vendôme en 1669, mourut sans enfants en 1712, et son duché fut définitivement réuni à la couronne.
La Sologne, partie du Blaisois comprise entre la Loire et le Cher, nommée dans les vieux historiens Segalonia, de socal ou segale, qui en langue celtique signifiait, dit-on, seigle, dut aux limites naturelles qui la circonscrivent et à l'importance de Romorantin, sa capitale, le Privilège de constituer une seigneurie distincte, quoique dépendante du Blaisois, et qui fut presque toujours l'apanage des cadets des différentes familles qui possédèrent le comté de Blois.
Il en fut ainsi pour les maisons de Champagne, de Châtillon et d'Orléans. Les ducs de ce nom l'abandonnèrent à leurs frères puînés, qui portaient le titre de comtes d'Angoulême ; c'est ainsi que Charles d'Angoulême transmit la seigneurie de Sologne à François d'Angoulême, depuis roi de France sous le nom de François Ier, qui la réunit à son domaine royal.
La Sologne, moins favorisée sous beaucoup de rapports que les autres contrées du département, est la partie où le caractère national a conservé le plus d'originalité ; les habitants cachent sous les apparences d'une simplicité naïve et presque niaise une finesse proverbiale : C'est un niais de Sologne, disait-on jadis et pourrait-on dire encore, qui prend des sous pour des liards. Ce penchant vers la ruse, dernière ressource du faible contre le fort, s'explique par l'infériorité relative où la nature place l'habitant de la Sologne.
Au milieu des territoires les plus riants, les plus fertiles de France, entre la Touraine et le Blaisois, le contraste des caractères est une image de la dissemblance du sol. Joyeux et fortunés habitants des riches vallées de la Loire , soyez indulgents et compatissants pour le colon pauvre et fiévreux de la mélancolique Sologne.
Durant la guerre de 1870-1871, le département de Loir-et-Cher fut envahi par les armées allemandes, notamment par les troupes commandées par le grand-duc de Mecklembourg et par le prince Frédéric-Charles ; il fut le théâtre principal de la retraite de la seconde armée de la Loire dirigée avec une grande énergie par le général Chanzy. Des combats sanglants furent livrés dans la forêt de Marchenoir, à Josnes, à Morée, en avant de Vendôme, etc.
A la suite d'événements militaires, la jeune armée de la Loire, sous les ordres du général d'Aurelle de Paladines, fut forcée d'évacuer Orléans, le 4 décembre 1870, pour opérer sa retraite : la première armée de la Loire, mise le lendemain de l'évacuation d'Orléans sous les ordres du général Bourbaki, tout à fait désorganisée, se retirait sur Salbris, Vierzon et Bourges ; la seconde, sur Le Mans.
Nous ne pouvons raconter ici en détail cette pénible marche, par un temps horrible, à travers des chemins le plus souvent défoncés. Contentons-nous d'une rapide esquisse, et disons tout d'abord que le général Chanzy se montra à la hauteur des circonstances douloureuses dans lesquelles il se trouvait placé ; il déploya une activité, une ténacité dignes des plus grands éloges et qui plus d'une fois étonnèrent l'ennemi. Grâce à lui, la retraite ne fut pas un désastre, et nos jeunes soldats, dans les combats qu'ils eurent à soutenir, montrèrent ce qu'ils eussent pu faire si, au lieu d'être des recrues à peine exercées et mal équipées, elles eussent été des troupes sérieusement organisées.
Quoi qu'il en soit, dès le lendemain de la reprise d'Orléans par les Allemands, le prince Frédéric-Charles lançait le grand-duc de Mecklembourg à la poursuite de l'aile droite et du centre de notre armée. Le 7 et le 8 décembre, des combats heureux pour nos armes étaient livrés dans les défilés de la forêt de Marchenoir, à Josnes, à Cravant, à Beaumont, à Villorceau et à Messas ; mais l'abandon de Beaugency forçait le général en chef à se retirer à Travers. L'occupation du parc et du château de Chambord par les Allemands (9 décembre), sur la rive gauche de la Loire, rendait impossible une diversion de la part du général Bourbaki, qui n'était pas, du reste, en mesure d'y songer et auquel un « mois » était nécessaire pour se réorganiser.
La crainte bien légitime d'être coupé ne permettait donc pas au général de conserver les positions sur lesquelles il s'était arrêté, et il dut abandonner la Loire et ramener son armée au nord-ouest, derrière le Loir. La retraite, rendue pénible par un temps affreux, s'effectua pourtant sans trop de difficultés, l'armée du grand-duc étant hors d'état de faire un nouvel effort. Le 14, Chanzy occupait Vendôme et la ligne du Loir et repoussait les attaques du grand-duc ; mais le prince Frédéric-Charles arrivait avec des forces écrasantes et notre armée se désorganisait. Il fallait reculer, reculer encore. Le 16, au matin, on évacua Vendôme ; la retraite se poursuivit vers Le Mans, où nos troupes, en partie débandées, espéraient trouver un refuge et un repos de quelques jours ; elles ne furent d'ailleurs pas sérieusement inquiétées et il n'y eut que quelques combats soutenus par l'élite de nos soldats, à Azay et à Épuisay.
Par le court récit qui précède, il est facile de comprendre que le plus grand nombre des localités de Loir-et-Cher, importantes soit par leur population, soit plutôt comme points stratégiques, furent occupées par les Allemands ; citons : Mer, Blois, Chambord, Villemorain, Coulommiers, Marchenoir, Oucques, Vendôme, Villiers, Montoire, Sougé, Poncé, Ouzouer-le-Marché, Morée, Azay, Épuisay, Sargé, Mondoubleau, etc.
Cette occupation ne put se faire sans causer de grands dommages à la malheureuse population ; aussi les pertes éprouvées par le département de Loir-et-Cher se sont-elles élevées à 25 522 693 fr. 34 centimes.
Les départements et leur histoire - Landes - 40
Le territoire. qui forme aujourd'hui le département des Landes était occupé, avant la conquête romaine, par plusieurs peuplades d'origine ibérienne : au sud et à l'est, dans les bassins de l'Adour et de la Midouze, les Tarbelli, pays de Dax ; les Tarusates, pays de Tartas ; une partie des Élusates et des Sotiates, dont les principaux établissements se trouvaient sur le territoire des départements du Gers et de Lot-et-Garonne ; à l'ouest et le long de la mer, dans la région qu'on appelle aujourd'hui les grandes Landes, les Aquitani proprement dits. Tous ces peuples étaient compris dans la Gaule aquitanique.
On serait fort embarrassé de donner sur l'existence de ces peuples des détails spéciaux. Sans doute, leurs moeurs étaient celles des peuples environnants modifiées par l'influence de leur malheureux pays, de ces sables accumulés il y a des milliers d'années par la mer, et par lesquels elle semble avoir voulu resserrer elle-même son empire.
Dès cette époque, de vastes forêts couvraient le pays et servaient d'asile à des hommes presque aussi sauvages que les bêtes qui leur en disputaient la possession. Pourtant quelques. éléments de civilisation y pénétrèrent. Les Celtes y portèrent leur culte, et l'on voit sur la route d'Hagetmau à Saint-Sever un peulven qui atteste leur passage en ces lieux. Il est probable aussi que, lorsque les Grecs établirent leur ligne de comptoirs le long de la Garonne et de l'Adour, les habitants des Landes ressentirent l'influence de ce commerce voisin.
U avait-il déjà quelque port sur la côte entre ceux de Bayonne (Lapurdum) et de La Teste-de-Buch (Boïes), qui appartiennent aux deux départements voisins ? On sait que les Boïens, qui occupaient le dernier de ces deux ports, avaient, dans les mêmes régions, une autre ville appelée Lasseaba. Était-elle située dans la partie septentrionale du département des Landes ou en dehors de ses limites ? On l'ignore. Mais si les habitants des côtes et des landes proprement dites avaient peu d'établissements, on ne peut douter que ceux qui occupaient les rives de l'Adour et de la Midouze n'en aient eu de plus ou moins considérables. Dax, Tartas existaient déjà chez les Tarbelliens et les Tarusates.
Ces peuples subirent la domination romaine sans avoir pris une grande part à la résistance ; à cause de leur position excentrique. On connaît l'énergie déployée par les Sotiates contre Crassus dans leur forteresse située sur le territoire du département de Lot-et-Garonne. Quand Rome eut pris possession de cette extrémité sud-ouest de la Gaule, elle y marqua sa présence par ces voies de communication qu'elle ouvrait partout, et qui assuraient le maintien de sa puissance en même temps qu'elles sauvaient la civilisation.
Les voies romaines étaient comme la trace des légions ; partout où celles-ci pénétraient, elles apparaissaient. Les sables et les forêts n'y mettaient pas plus d'obstacle que les montagnes et les fleuves. Une voie romaine longea la côte depuis Boïos jusqu'à Lapurdum. Les Landais l'appellent Camin Roumiou. Une autre, partant de Bordeaux, aboutit également à Lapurdum en passant par Dax. On en voit encore aujourd'hui des restes. On remarque aussi des vestiges de camps romains, entre autres celui qui se trouve entre Gamarde et Saint-Geours-d'Auribat. On verra plus loin que Saint-Sever prétend aussi prendre pour son point de départ un camp de César.
A l'ouest de Soustons, arrondissement de Dax, auprès de la côte, s'élève un mamelon artificiel, qu'on suppose avoir formé l'extrémité d'un vaste camp retranché opposé aux pirates. Quant aux monuments ils sont rares. Outre le temple de Mars, dont Mont-de-Marsan tire son nom, on a découvert en 1736, dans la paroisse de Saint-Michel-de-Jouarare, les restes d'un édifice qui fut, dit-on, un temple de Jupiter (Jovis ara) ; on y a trouvé un grand nombre d'urnes cinéraires, de lacrymatoires, de vases, de lampes, de tronçons d'armes, de pièces de monnaie et de médailles ; ailleurs, des tombeaux, des autels votifs. Néanmoins , on peut dire que les monuments romains sont rares dans le département.
Les Landes, d'abord comprises par les Romains dans l'Aquitaine, firent partie de l'Aquitaine troisième ou Novempopulanie, lorsque la Gaule fut partagée en dix-sept provinces, et le christianisme y pénétra au IIIe siècle.
Les barbares, qui, à partir de l'an 406, traversèrent la Gaule et s'enfoncèrent dans l'Espagne, effleurèrent dans leur invasion le pays qui nous occupe. Les Wisigoths y établirent leur domination, que celle des francs remplaça après la bataille de Vouillé. Celle-ci, assez mal établie dans une contrée si lointaine, fut à son tour ébranlée, à la fin du VIe siècle, par l'invasion des Vascons ou Gascons. Ces montagnards, remontant la vallée de l'Adour, s'y établirent et de là se répandirent dans toute l'Aquitaine.
Depuis ce temps, les Landes appartinrent aux dues de Gascogne, et sous ces ducs à un certain nombre de seigneurs leurs vassaux. Après la terrible invasion des Arabes, dont ce pays eut à souffrir et que Charles Martel dispersa en 732, l'empire carlovingien enveloppa cette partie de la Gaule, comme toutes les autres, dans son unité. Quand de ses ruines sortit le régime féodal, le principal fief qui s'éleva dans les Landes fut la vicomté d'Albret. Plus loin, nous parlerons de la modeste bourgade d'où sortit cette brillante et glorieuse famille. Le premier vicomte d'Albret dont le nom soit connu est un certain Amanjeu, qui vivait au XIe siècle. Ce nom, au reste, fut porté par un grand nombre de ses descendants et successeurs. Parmi lesquels on rencontre aussi plusieurs Bernard.
Après le mariage d'Éléonore de Guyenne avec Henri II, roi d'Angleterre, le pays des Landes passa à la maison de Plantagenet. Pendant longtemps, les rois anglais y dominèrent, grâce à leur habile politique ; mais tous les seigneurs ne s'accommodèrent pas de cette domination, notamment les d'Albret, qui, après avoir porté le titre de vicomte, l'échangèrent contre celui de sire, plus modeste, mais' qui ne servait qu'à déguiser une ambition toujours croissante. Ils agissaient en cela comme les sires de Coucy, qui, n'osant prendre le titre de prince et dédaignant tous ceux qui venaient ensuite , se mettaient en quelque sorte hors de la hiérarchie féodale par une orgueilleuse humilité.
L'Albret ne tarda pas à envelopper la plus grande partie du département actuel des Landes en même temps qu'il s'étendait sur les pays circonvoisins. En 1401, Charles Ier, fils d'une princesse de la maison de Bourbon, s'attacha à la cour de France, imitant les Armagnacs et reconnaissant comme eux que la royauté était désormais l'astre d'où émanait tout éclat et toute puissance. Il obtint l'honneur d'écarteler les armes de France avec celles de sa maison, qui étaient d'or plein, et devint connétable de France.
Mais il ne fit pas un usage heureux de. l'épée fleurdelisée qui lui avait été confiée, car c'est lui qui perdit la bataille d'Azincourt. Au reste, il y fut tué et, par sa mort, expia sa défaite. Charles II, son fils, proche parent des Armagnacs, suivit leur parti dans les guerres du XVe siècle. Il eut trois fils : l'aîné lui succéda ; le deuxième fut décapité ; le troisième forma la branche des seigneurs de Miossens et de Pons, qui s'éteignit en 1676 et dont les biens passèrent dans une branche de la Lorraine-Armagnac.
Jean, son arrière-petit-fils par son fils aîné, épousa Catherine de Foix, soeur et héritière de Gaston-Phoebus, et devint roi de Navarre (1494). Il fut dépouillé d'une partie de ses nouveaux États. Mais sa famille se releva, d'a-bord par l'érection de l'Albret en duché-pairie sous François Ier, beau-frère de Henri d'Albret, puis par le mariage de Jeanne, fille de Henri, avec Antoine de Bourbon. De ce mariage naquit Henri IV, qui réunit ses domaines à la couronne de France. Plus tard (1652), Louis XIV rétablit la pairie d'Albret en faveur de la maison de Bouillon.
A peine sorti de la guerre de Cent ans, le pays des Landes fut agité par les luttes religieuses du XVIe sicle les protestants, grâce à la protection de Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV, s'y organisèrent militairement ; mais les catholiques leur opposèrent Montluc, et, de part et d'autre, il se commit les plus grands excès, jusqu'à la pacification générale, amenée par l'édit de Nantes.
Depuis ce temps, à part un moment d'agitation sous la Fronde, l'histoire de ce pays se confond avec celle de la France. Sous la domination anglaise, les Landes dépendaient judiciairement du grand sénéchal qui présidait à Bordeaux la cour du roi. Du reste, les villes, comme autant de petites républiques, administraient elles-mêmes leurs finances, leur police intérieure, leur milice particulière et, dans plusieurs cas, la justice civile et criminelle.
Les rois de France respectèrent d'abord ces privilèges, mais ensuite ils les supprimèrent peu à peu et transportèrent à leurs officiers la plupart des droits dont les villes avaient joui auparavant. Ces officiers étaient, dans l'origine, des commissaires aussi nombreux qu'il y avait de parties dans l'administration.
Henri II, en 1551, réunit ces diverses attributions dans les mains des commissaires départis, qui prirent, sous Louis XIII, le nom d'intendants du ministère, de la justice et de la police. L'intendant veillait à l'égale répartition de l'impôt, à la culture des terres, à la prospérité du commerce, à l'entretien des chemins, à la réparation des édifices publics, à l'emploi des revenus des villes et des communautés, à la distribution des troupes dans la province, à l'approvisionnement des magasins du roi, à la levée des milices. C'est de lui que le ministère recevait tous les renseignements sur l'état de la province, ses ressources, ses charges, ses pertes, ses débouchés, etc.
Comprises, avant la Révolution, dans le gouvernement de la Guyenne, comme toute la Gascogne, les Landes formèrent, en 1790, un département dont la circonscription embrassa les pays désignés alors et encore aujourd'hui sous les noms de haute et basse Chalosse (Saint-Sever), de Marsan (Mont-de-Marsan), de Tursan (Aire), de Gabardan (Gabarret), du Maransin (Saint-Michel), d'Albret ou des petites Landes (Albret), enfin des grandes Landes, dans la partie occidentale, le long de la mer.
Triste est l'aspect des Landes encore au XIXe siècle, au moins dans la plus grande partie du département. La Chalosse, les vallées de l'Adour et de la Midouze, enfin toute la zone qui borde les Pyrénées sont, à la vérité, très fertiles et réjouissent l'œil par d'agréables et verts coteaux ; mais, quand on s'avance vers la mer' et la Garonne, ce ne sont plus que des dunes onduleuses, stériles, envahissantes quand le vent les roule de l'ouest à l'est, dangereuses pour le voyageur quand, oubliant de suivre les sommités du terrain et descendant imprudemment dans les lèses ou vallons, il se laisse glisser dans les blouses, ces lacs perfides dont les eaux se cachent sous le sable.
Que n'a-t-on accepté, au XVIe siècle, l'offre des Maures chassés d'Espagne, lorsqu'ils demandèrent la permission de s'établir dans nos Landes ! Cette industrieuse nation eût peut-être fait de ce désert une fertile province. Ce n'est que de nos jours que l'homme s'est trouvé de force à lutter contre la nature. Un inspecteur général des ponts et chaussées, M. Brémontier, a trouvé le secret d'arrêter les envahissements des sables. Le littoral s'est partout couvert de belles plantations dont l'humidité favorise le développement.
Au XIXe siècle, on se disait qu'il faudrait bien du temps avant que la lande rase ait cessé d'offrir au regard attristé, pendant l'été, la nudité des déserts d'Afrique, pendant l'hiver l'humide et froide surface des marais de la Sibérie ; avant que l'industrie ait réuni et multiplié par ses travaux, par la canalisation, par l'appropriation des cours d'eau, les cultures isolées que le voyageur rencontre à de longues distances comme autant de fécondes oasis. On affirmait qu'il faudrait aussi du temps avant que le Landais ait changé son genre de vie grossier et ce caractère mélancolique et triste, reflet de son triste pays.
On ne parlait ni du propriétaire qui vit de ses revenus dans l'aisance, ni du colon propriétaire, sorte de classe intermédiaire, mais du simple colon, formant la masse de la population, de cet être malingre couchant sur la paille ou dans sa charrette, se nourrissant d'un pain noir de seigle ou de maïs assaisonné de quelques sardines de Galice, et que cette vie malheureuse, aidée quelquefois par l'abus des spiritueux, condamnait à ne point vieillir. On disait que les Landais tenaient peu à la vie, cependant qu'ils accompagnaient les funérailles par des cris et des démonstrations exagérés. Usage singulier : les parents allaient à l'église, non au cimetière, et jadis hommes et femmes allaient se coucher pendant la sépulture, sans doute pour témoigner un excessif abattement.
L'anniversaire de la mort ou cap de l'an était célébré par un repas funèbre. Superstitieux, ils se signaient quand le vent gémissait dans ta bruyère ; car c'était le soupir d'une âme en peine. Ils croyaient aux fantômes courant la nuit dans les bois, au cri de l'orfraie passant sur leur tête, présage de mort pour un membre de la famille ; aux fées qui remplissaient d'or le vase qu'on dépose au pied du chêne sous lequel elles vont danser la nuit, et quand l'orage se préparait, ils disaient : « Voici le roi Arthur qui passe avec sa meute. »
Les départements et leur histoire - Jura - 39 -
Le département du Jura est un des trois départements formés en 1790 avec la Franche-Comté; il occupe la partie sud-ouest du territoire de cette ancienne province. Les Romains le trouvèrent habité par les Séquanais. Dans les sections consacrées à l'histoire du Doubs et de la Côte-d'Or, nous racontons la lutte et les rivalités de ce peuple avec les Éduens, l'intervention et la conquête romaine, l'invasion et l'établissement des Burgondes ; nous ne recommencerons donc pas ici l'histoire détaillée de cette première période.
Nous allons seulement essayer de compléter en nous attachant plus particulièrement aux épisodes ressortant des annales du Jura ou intéressant la nationalité franc-comtoise. Les deux capitales des -Séquanais étaient deux villes de la Franche-Comté : Dôle d'abord, puis Vesuntio (Besançon) fondée par les Romains. L'invasion et le triomphe des Burgondes réunirent sous une même dénomination et en un seul royaume la Bourgogne et la Franche-Comté.
C'est pendant le règne des monarques de la seconde dynastie bourguignonne que furent constitués des comtes amovibles d'abord pour l'administration du territoire correspondant à la province qui nous occupe. Le premier seigneur revêtu de cette dignité fut, dit-on, Léotalde, auquel succéda Albéric, son fils, dans la première partie du r siècle ; mais le domaine de ces premiers comtes n'était pas encore ce qui devait être plus tard la Franche-Comté.
C'est seulement lors du démembrement du vaste royaume de Bourgogne, héritage que se disputaient tour à tour Rodolphe d'Allemagne, Robert de France et Othe-Guillaume, que fut concédé à ce dernier, en compensation de ses autres prétentions repoussées et vaincues, un comté de Bourgogne, indépendant du duché et du royaume de ce nom, dont la délimitation n'était point alors celle plus tard notre province, mais auquel cependant remontent toutes les traditions franc-comtoises.
Les descendants de Guillaume conservèrent l'héritage paternel pendant plus d'un siècle, jusqu'à la mort de Renaud III, en 1148. C'est une des plus glorieuses périodes de la Comté : ses frontières 's'étendent au delà des monts, l'influence de ses princes est respectée en Allemagne comme en France, et, à la mort de l'empereur Lothaire, Renaud III, brisant les liens de vassalité qui le rattachaient à la couronne impériale, mérite le surnom de franc-comte dont héritera plus tard la contrée qu'il gouverne.
C'est vers le même temps que saint Simon de Crépy dirige les premiers efforts des moines de Saint-Claude vers le défrichement des hautes pentes du Jura. Vient ensuite une phase allemande dans l'histoire de la Comté, et c'est un épisode romanesque qui lui sert d'introduction. Renaud III n'avait laissé après lui qu'une fille, Béatrice Son oncle, Guillaume de Mâcon, l'avait fait enfermer dans un château fort et s'était emparé de ses États. Quelques années après, Frédéric Barberousse était appelé au trône impérial par les barons de Germanie et de Lorraine.
Les malheurs de l'orpheline touchèrent le coeur du jeune et chevaleresque Hohenstauffen, peut-être aussi la perspective d'une dot si riche et si bien placée éveilla-t-elle son ambition; il attaqua et vainquit le tuteur dénaturé, délivra la prisonnière et l'épousa. La Comté devint donc un fief possédé par des princes allemands ; Othon Ier le quatrième fils de Béatrice et de Frédéric, ayant eu cette province en partage, ajouta le titre de palatin à celui de comte de Bourgogne.
Ce prince et ses successeurs vécurent presque constamment en Allemagne, abandonnant le gouvernement de leurs domaines aux comtes de Champagne ou aux ducs de Bourgogne. Leur dynastie s'éteignit en 1248 dans la personne d'Othon III, et, à défaut de descendance directe, l'héritage fut recueilli par la maison de Châlon, branche cadette de celle des ducs de Bourgogne. Le fondateur de cette nouvelle dynastie, Jean de Châlon, surnommé l'Antique ou le Sage, et un des hommes les plus remarquables de son siècle, contribua plus qu'aucun de ses prédécesseurs à constituer la Franche-Comté sur les bases qui lui ont donné une vitalité si durable.
Au moyen d'échanges de territoires avec le duc de Bourgogne, il arrondit les frontières de cette province et en forma un corps plus compact et plus homogène. Il donna aux villes une existence nouvelle en leur concédant des chartes d'affranchissement qui y attiraient les populations et y encourageaient le commerce et l'industrie ; il y créa en quelque sorte cette vigoureuse et patriotique bourgeoisie qui, pendant près de quatre siècles, sut défendre les privilèges et l'indépendance du pays contre ses souverains les plus puissants, contre ses voisins les plus redoutables.
Dans ces temps de convoitises princières et de luttes continuelles, plus une .province était riche et prospère, plus elle était menacée par ceux qui en enviaient la possession; c'est ainsi que la Franche-Comté voyait ses destinées remises en question chaque fois qu'un bras fort manquait à son gouvernement, chaque fois que les droits de ses comtes n'étaient pas incontestables. Après une rude et longue guerre contre l'empereur d'Allemagne, la Comté passa quelques instants aux mains d'un prince français, Philippe le Long, qui avait épousé Jeanne, héritière d'Othon IV et de Mahaut d'Artois; mais la princesse ayant survécu à son époux recouvra comme douaire le comté de Bourgogne, qu'elle laissa par testament à sa fille aînée, Jeanne III, mariée dès 1318 au duc de Bourgogne, Eudes IV, et c'est ainsi que furent réunies sous une même domination les deux Bourgognes, séparées depuis cinq cents ans.
Cette réunion, quoique de courte durée, fut féconde en événements dramatiques. La noblesse voyait avec peine la concentration d'une si grande puissance entre les mains de son suzerain immédiat. Eudes, de son côté, autant par politique que par esprit libéral, cherchait un appui dans la bourgeoisie des villes, dont il fortifiait l'indépendance. Il avait divisé la province en deux ressorts principaux, Amont et Aval, et les avait soumis l'un et l'autre à un bailli particulier.
Dans les premiers mois de l'année 1333, il était venu en personne installer à Dôle un parlement. Peu de temps après, l'orage éclata. Le premier cri de guerre fut poussé par Jean de Châlon-Arlay II, qu'il ne faut pas confondre avec le sage et bienfaisant comte du même nom ; les principaux seigneurs de la province y répondirent et se lièrent entre eux par les serments les plus solennels ; un poète du temps dit à propos de cette révolte :
Sont deux grands barons de la terre
Qui sont : Jean, dit de Chaalon,
Et le sire de Montfaucon.
Plusieurs barons de la Comté,
Ou de fait ou de volonté,
A ces deux barons joints estoient
Mais aucuns bien dissimuloient :
Dieu sait si c'estoit par amour
Ou par la force du seignour
Pendant plus de dix ans, le pays demeura en proie à toutes les calamités d'une lutte acharnée, qui prit le nom de son instigateur et qu'on a appelée la Petite guerre de Châlon. Eudes y usa son énergie et ses forces ; il fut emporté par la terrible épidémie de 1348, la peste noire, laissant ses États déchirés par les dissensions qu'il n'avait pu comprimer, et pour héritier un enfant, son petit-fils, Philippe de Rouvre, dont la mère, Jeanne de Boulogne, prit la tutelle.
On sait que ce jeune prince mourut au moment où il atteignait sa majorité, en 1361. En lui finit la première race des ducs de Bourgogne, descendants de Hugues Capet, et, ce qui intéresse plus spécialement notre notice, sa mort détermina une nouvelle séparation du comté et du duché de Bourgogne. Le roi Jean réunit à sa couronne le duché, qui était la première pairie du royaume; mais, pour la Comté, il reconnut et respecta les droits de Marguerite de France, fille de Philippe le Long et héritière naturelle par sa mère Jeanne.
Deux autres princesses, du nom de Marguerite comme leur aïeule, possédèrent la Comté pendant cette période de sa séparation avec le duché. La première, Marguerite de Brabant, avait épousé Louis de Mâle, fils de Marguerite de France et du comte de Flandre. L'autre, tille unique de Louis de Mâle et de Marguerite de Brabant, épousa le troisième fils du roi Jean, Philippe le Hardi, auquel Charles V, son frère, donna en apanage le duché de Bourgogne, et qui réunit une fois encore sous la même domination les deux provinces.
Cette période est une des plus tristes de notre histoire. Aux anciens éléments de discorde vient se joindre l'intervention étrangère; l'Anglais, maître d'une si grande partie de la France, se montre aussi dans la Comté; l'empereur d'Allemagne suscite des compétiteurs aux souverains de sang français; la noblesse accepte comme instruments de ses vengeances ou comme auxiliaires de ses convoitises ces hordes de brigands indisciplinés, les routiers, les grandes compagnies, qui parcourent le pays, rançonnant les villes, pillant et dévastant les campagnes.
L'avènement de la dynastie des quatre grands ducs de Bourgogne fut donc un bonheur pour la Comté. Son histoire, depuis Philippe le hardi jusqu'à Charles le Téméraire, est trop étroitement unie à celle de Bourgogne pour que nous ne devions pas la supprimer dans ce rapide aperçu; nous constaterons seulement que, malgré leur puissance, les ducs respectèrent avec un soin scrupuleux les privilèges et l'indépendance de la Comté, qu'ils regardaient comme un des plus précieux fleurons de leur couronne.
Les souvenirs que laissa leur administration n'ont pas peu contribué à entretenir la fidélité héroïque que gardèrent les Francs-Comtois à la maison de Bourgogne. Lorsqu'on sut que Marie, héritière du dernier duc, n'épousait pas le fils du roi de France, Dôle, Salins et les autres villes de la Comté chassèrent les garnisons que Louis XI avait pu y placer comme tuteur de la jeune princesse. Son mariage avec Maximilien d'Autriche livra cette province à l'étranger. Charles-Quint, qui recueillit cette riche succession, la donna en douaire à sa tante Marguerite de Savoie, déjà en possession de la Bresse.
Les vertus, la bonté de cette princesse ne firent que rendre plus vif et plus profond l'éloignement des Comtois pour la domination française. Cette conquête était pourtant d'une indispensable nécessité pour la constitution territoriale du royaume. Dès que la monarchie, forte au dedans, cessa d'être menacée par les ennemis du dehors, les regards des gouvernants se fixèrent sur cette province faisant pointe dans notre territoire en deçà des hautes montagnes que la nature semblait lui assigner pour frontières.
Richelieu entama des négociations, fit des tentatives qui échouèrent ; Louis XIV reprit son oeuvre. Nous voudrions pouvoir oublier à quel prix il a réussi. Son triomphe était de nature à retarder pour de longues années la fusion des races, l'union des cœurs; sous Louis XV encore on pouvait dire qu'il n'y avait en Comté que la noblesse de France. La Révolution de 1789 vint enfin, et les Comtois purent entrevoir ce que l'avenir de la France avait à leur offrir en échange des souvenirs si chers de leur passé.
De ce jour la conquête de la Franche-Comté fut accomplie. Le département du Jura fournit un contingent dévoué de volontaires qui concoururent à la défense de la patrie, et depuis lors, à travers les grands événements qui ont agité ce siècle, la France n'a trouvé nulle part une population plus sympathique, plus intelligente, plus étroitement attachée à ses destinées.
Elle l'a bien prouvé au cours des terribles événements de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Le département du Jura, en effet, eut ainsi que tant d'autres à subir les douleurs de l'invasion. La ne armée prussienne, commandée par le prince Frédéric-Charles, après s'être emparée de Gray et de Pesme, dans la Haute-Saône, atteignit le Jura, occupa Montmirey-le-Château et Pôle et s'avança jusqu'à Poligny et Champagnole. Pendant ce temps, la 1re armée, sous les ordres du général de Manteuffel, venant de Châtillon-sur-Seine, dans la Côte-d'Or, et se dirigeant vers Pontarlier (Doubs) à la poursuite de l'armée de Bourbaki en retraite vers la Suisse, ne faisait qu'effleurer le territoire du Jura où elle occupait seulement Dampierre, dans l'arrondissement de Dôle. Les pertes éprouvées par le Jura, durant cette triste période, s'élevèrent à 8 761 525 fr. 70.
Les habitants du Jura sont, au XIXe siècle, en général froids et posés, sans être pour cela nonchalants. Leurs passions sont peu impétueuses, ou plutôt ils trouvent en eux-mêmes la force de les modérer. Ils montrent de l'esprit, de la prudence et une grande perspicacité; ils sont bons et hospitaliers, religieux sans fanatisme et tolérants sans ostentation. Ils ont un goût prononcé pour les agréments de la société, la vie douce et les plaisirs tranquilles.
Les femmes, plus occupées dés soins du ménage que du désir de briller, sont pour la plupart douces, aimantes et spirituelles ; les hommes ont une haute opinion de la dignité humaine et croient surtout à la supériorité du sexe masculin. Sans avoir la passion des armes, ils font d'excellents soldats; leur caractère réfléchi n'exclut pas les actes de la plus audacieuse bravoure; leur taille est généralement au-dessus de la moyenne et leur constitution vigoureuse et saine.
Les departements et leur histoire - LIsère - 38 -
Avant la conquête romaine, deux nations puissantes et nombreuses ayant toutes les deux même langage, mêmes mœurs et une commune origine, les Allobroges et les Voconces, habitaient le pays qui forme aujourd'hui le département de l'Isère : les Allobroges, entre le Rhône et l'Isère jusqu'aux Alpes ; les Voconces, dans Ies montagnes, du côté de Die. Vienna (Vienne) était la capitale des premiers ; Dea (Die), celle des seconds.
Pline, Strabon, Ptolémée et tous lés anciens géographes qui en ont parlé, rangent les Allobroges et les Voconces parmi les peuples-les plus anciens et les plus célèbres de la Gaule ; et le peu que les Romains en ont dit suffit pour nous faire connaître qu'ils n'étaient pas sans agriculture, ni sans industrie, ni sans quelque connaissance des arts. Tranquilles possesseurs de leur territoire, il s'établit entre eux et les Phocéens des rapports commerciaux, politiques et religieux, qui propagèrent la civilisation dans ces contrées.
A l'exemple de leurs voisins, les Allobroges créèrent des écoles où l'on enseignait l'éloquence et la poésie. Renommés par leur courage, d'où leur surnom de Jessates (vaillants), ils firent partie de l'expédition de Bellovèse au delà des Alpes. Plus tard, ils grossirent l'armée de Brennus. Recherchés par les rois et les conquérants à cause de leur valeur, ils prirent part à toutes les grandes guerres et à toutes les batailles célèbres de l'antiquité : Annibal passa par leur pays. Alors, divisés en plusieurs petites peuplades, ils avaient des cités florissantes, et l'on y voyait des campagnes cultivées, signes d'une ancienne civilisation ; ce que Tite-Live semble confirmer lorsque, parlant des Allobroges, il dit qu'ils ne le cédaient à aucune autre nation en richesse et en renommée. Ils disputèrent à Annibal le passage de leur territoire.
Plus tard, cependant, ils le servirent contre les Romains, dont ils commençaient à craindre le voisinage. Après les guerres puniques, ceux-ci, voulant faire expier aux Allobroges le secours qu'ils avaient prêté à leur implacable ennemi, passèrent les Alpes : les Allobroges allèrent à la rencontre des Romains à Vindalium, mais ils furent vaincus. Alors, rassemblant de nouvelles forces, ils se joignent aux Arverni et aux Ruteni, et livrent bataille aux Romains dans les plaines de Tegna (Tain), au confluent du Rhône et de l'Isère ; mais que pouvaient-ils contre une armée disciplinée et commandée par un chef éprouvé ?
Après une action très vive de part et d'autre, le désordre se mit dans les rangs des Allobroges, trop nombreux pour ne pas être embarrassés ; et Q. Fabius Maximus, qui les battit, en reçut le nom d'Allobrogique. Cette victoire eut lieu l'an 121 avant Jésus-Christ.
Pour la première fois alors, les Allobroges connurent la servitude. Vaincus cependant et non domptés, ils s'unissent à Catilina, dans la conspiration contre le sénat ; puis aux Cimbres et aux Teutons, qui envahissent la Province romaine. Deux fois les Romains essayent de les repousser, mais sans succès. Battus enfin par Marius, ils expient leur révolte.
Ce général ravage leur territoire ; il veut même le partager à ses soldats ; mais le sénat s'y oppose. Bientôt, cependant, il se ravise : il les prive, par un décret, de leurs villes et de leurs propriétés. Rome, enfin, ne laissa aux Allobroges que leur nom et la vie : elle sentait si bien que c'étaient là ses véritables ennemis, qu'elle n'usa point de rigueurs pareilles à l'égard des autres peuples gaulois dont elle avait fait la conquête. A la vérité, elle établit de nombreuses colonies dans le pays des Allobroges et des Voconces ; mais l'avarice et la cruauté des préteurs n'inspirèrent aux vaincus que la vengeance et le désir de s'affranchir.
Déjà, par ses tyrannies, Fonteius les avait réduits à l'extrémité. Ils s'en plaignirent au sénat. Voyant qu'il n'y avait rien à espérer des Romains, ils courent aux armes et se déclarent indépendants : Pontinus envoie contre eux deux de ses lieutenants : ils sont repoussés. Alors il s'avance lui-même avec de nouvelles forces. De son côté, Catugnat, chef des Allobroges, se retranche dans Solonium, le long de l'Isère ; la population tout entière s'est jointe à lui : c'est la guerre nationale ; chacun sent qu'il y va du sort de la patrie.
Après un combat sanglant, Pontinus s'empare de la ville ; mais Catugnat, par un effort héroïque, la reprend. Cependant, pressé par la famine et par l'ennemi, il laisse au peuple la liberté de traiter et se retire ; mais les Romains n'écoutent aucune proposition : la ville est saccagée, et ses défenseurs sont passés par les armes. Telle fut l'issue de cette guerre : le dernier rempart des Gaules du côté des Alpes venait de tomber. César n'avait plus qu'à marcher pour les conquérir.
Cependant, sous Auguste, ce pays obtint plusieurs franchises et jouit de quelque repos. Compris dans cette étendue des conquêtes romaines appelée Provinéia Romana ou simplement Provincia, d'où est resté le nom de Provence à une partie de cette contrée, il fit, après la division de la Gaule en quatre provinces, partie de la Narbonnaise. Vienne resta la capitale du pays des Allobroges et devint, dans la suite, celle de la province viennoise, enfin la métropole de toutes les Gaules.
Au commencement du Ve siècle, les Bourguignons s'emparèrent de la province viennoise, après en avoir chassé les Huns et les Goths, et fondèrent le premier royaume de Bourgogne, qui s'étendait jusqu'à Langres, au nord, Bâle à l'est, et Nevers à l'occident. Le pays des Allobroges et celui des Voconces s'y trouvèrent compris.
Plus tard, Clovis voulut en disputer la possession à Gondebaud ; mais celui-ci ne parut un moment y renoncer que pour mieux les reprendre. Il rentra dans Vienne, sa capitale, plus fort et plus puissant que jamais. Prince guerrier et législateur, il mit à profit la paix qu'il venait de conquérir, en travaillant à ces lois connues sous le nom de lois gombettes, en grande partie extraites des lois romaines, mais qui, dans ces temps barbares, n'en marquaient pas moins un progrès de civilisation.
Après huit ans de luttes, les fils de Clovis parvinrent à affranchir le pays des Allobroges de la domination des Bourguignons (534). Ils le possédèrent pendant près de trois siècles. Cependant les Sarrasins, ayant fini par s'en emparer, s'y fixèrent ; mais, vaincus par Charles-Martel, ils furent chassés sans retour par Charlemagne.
A la mort de Louis le Débonnaire, en 845, ce pays échut en partage à l'un de ses fils, Lothaire, et successivement à Charles et à Lothaire II. Ces princes étant morts sans postérité, Charles le Chauve, leur oncle, s'en empara et le transmit à Louis le Bègue. C'est sous ces derniers règnes que l'anarchie féodale commença. Seigneurs ; comtes ou gouverneurs de provinces, s'érigèrent en souverains indépendants, grâce à la pusillanimité de Charles le Chauve. Boson, qui avait épousé sa soeur, ne voulut pas même devoir sa puissance à ses fils : il se fit nommer, en 879, roi de Bourgogne par un concile tenu à Mantaille, château situé sur la rive gauche du Rhône, entre Vienne et Valence, et auquel assistèrent les principaux évêques et seigneurs du Dauphiné.
Alors cette province fit partie du nouveau royaume de Bourgogne. Bientôt, dépouillé de ses États par Carloman, fils de Louis le Bègue, Boson y fut rétabli à charge d'hommage par Charles le Gros, qui réunit un instant sous son autorité les vastes États dont avait été composé l'empire de Charlemagne.
Ce que les comtes avaient fait sous les descendants de Pépin, les petits seigneurs le firent sous les comtes : ils s'affranchirent peu à peu de leur vasselage et s'érigèrent en souverains, déclarant leurs biens héréditaires. De là, dit-on, l'origine des fiefs. Alors parurent les comtes d'Albon, les barons de Sassenage, ceux de La Tour-du-Pin, etc. Les rois dans ce pays n'eurent plus qu'un vain titre. Après un siècle et demi, privés de toute puissance, ils finirent par transmettre aux empereurs d'Allemagne l'ombre vaine qui leur en restait.
Déjà, vers la fin du IXe siècle, un certain Gui ou Guigues s'était établi dans ce pays sous le titre de comte d'Albon. Il devint le chef d'une famille puissante. Il avait assisté à l'assemblée de Varennes, où le fils de Boson Ier fut proclamé roi. A la mort de Rodolphe III ; n'ayant pas voulu reconnaître son successeur, Conrad le Salique, il s'ensuivit une guerre qui se termina à l'avantage de Conrad ; mais, en même temps, ce prince fut obligé de renouveler un traité conclu antérieurement entre Rodolphe III, Henri II et les seigneurs bourguignons, et par lequel l'empereur et le roi avaient fait à ces seigneurs des cessions considérables.
Jusqu'à Gui VIII, les comtes d'Albon vécurent tranquilles dans leurs terres ou à l'ombre des cloîtres : Gui VIII rendit sa maison illustre par les armes. On connaît ses guerres avec le comte de Savoie. Blessé dans un combat près de Montmélian, il mourut des suites de sa blessure, en 1149. Il fut, dit-on, le premier qui porta le nom de dauphin, qui lui fut donné à cause du cimier de son casque qui figurait un dauphin. Jusque-là, les armes des comtes d'Albon avaient été indifféremment une ou plusieurs tours, ou bien un château.
Après Gui VIII, la figure du dauphin commença à s'introduire dans leurs armoiries, et, comme ce signe marquait leur nouvelle puissance, ils' perdirent insensiblement le titre de comtes d'Albon pour prendre celui de dauphins. Tel est le sentiment de Boulainvilliers, et cette opinion, ajoute Expilly, est très probable. Quoi qu'il en soit, Gui IX, fils et successeur de Gui VIII, épousa Béatrix de Montferrat, nièce de l'empereur Frédéric Barberousse, qui, en considération de cette alliance, investit le comte d'Albon de tous les privilèges de la souveraineté, tels que ceux de lever l'impôt, d'armer des troupes, de frapper monnaie, etc.
Vers ce temps-là, Berthold IV, qui possédait les comtés de Bourgogne et de Vienne, céda à Gui IX ses droits sur ce dernier comté ; l'empereur, présent à cette cession, la confirma, et Gui IX prit le titre de dauphin de Viennois. Il mourut en 1167, ne laissant qu'une fille, Béatrix, qui épousa Hugues III, duc de Bourgogne, et dont la postérité masculine s'éteignit en la personne de Gui Xl, mort en 1269.
Anne, sa fille unique et seule héritière, se vit disputer le Dauphiné par Robert II, duc de Bourgogne ; mais le roi Philippe le Bel, ayant été choisi pour arbitre, en 1295, adjugea cette province à Anne, qui avait épousé Humbert Ier, seigneur de La Tour-du-Pin. Jean II, son fils, s'unit à Béatrix d'Anjou, fille de Charles, roi de Hongrie, et de Clémence, reine de France, et Gui XII, à la princesse Isabelle, fille du roi Philippe V. Il mourut sans enfants. Humbert II, son frère, lui succéda. Ce prince, trop faible pour résister au duc de Savoie, qui harcelait ses frontières, et se voyant sans enfants par la mort de son fils André, céda le Dauphiné à la France moyennant, dit-on, 120 000 florins d'or.
Cette cession, renouvelée à Lyon dans une assemblée solennelle, il la confirma par un acte passé à Romans en 1349. « Celui qui sera daulphin, y disait-il, et ses hoirs et successeurs au Dauphiné, se appelleront et soient tonus de faire soy appeler daulphin de Viennois, et porteront les armes dudit Daulphiné, esquartellées avec les armes de France, et ne laisseront et ne pourront laisser le nom de daulphin, ne lesdites armes ; et ne sera et ne pourra être uni ne adjouté ledit Daulphiné au royaume de France, fors tant comme l'empire y serait uni. »
Après avoir remis à Charles, petit-fils de Philippe de Valois, « l'espée ancienne du Daulphiné et la bannière Saint-Georges, qui sont anciennes des daulphin de Viennois, et un ceptre et un anel », Humbert se fit moine à Lyon dans le couvent des Frères prêcheurs, et finit dans le cloître une vie passée à pleurer son fils et à regretter son Daulphiné. « C'est mal à propos, dit le président Hénault, qu'on a cru qu'une des conditions du traité avait été que le titre de dauphin seroit porté par le fils aîné de nos rois. Il arriva, au contraire, que le premier dauphin nommé par Humbert au premier traité de 1343 fut le second fils de Philippe de Valois ; mais il est vrai que cela n'eut plus lieu, et que ce titre a toujours été porté depuis par le fils aîné du roi. »
Alors le Dauphiné devint pays d'états. Humbert, avant de le céder, l'avait affranchi et constitué par un statut delphinal, qui forma le droit protecteur de la province. Après avoir octroyé à ses sujets divers privilèges et fait des lois contre l'usure, il défendit aux seigneurs de s'emparer des biens de ceux qui mouraient sans enfants. Déjà, en 1337, il avait établi à Grenoble un conseil delphinal pour prendre connaissance en souverain des causes litigieuses d'entre ses sujets : il le composa de sept conseillers, d'un auditeur des comptes et d'un trésorier ; il ordonna que quatre des sept conseillers enseigneraient le droit dans l'université de Grenoble. Ce conseil delphinal fut érigé par Louis XI en parlement, en 1453, lorsque ce prince, n'étant encore que dauphin, se retira dans cette province pour s'y former à la royauté, ou plutôt pour y conspirer contre son père. Charles VII chassa son fils du Dauphiné, mais il ne toucha point au parlement qu'il avait établi.
Pressentant qu'ils allaient tomber sous le joug d'un maître, les seigneurs dauphinois virent avec regret cette cession. Sous les derniers rois de Bourgogne, ils avaient usurpé le droit de guerre ; ils le conservèrent sous le sceptre tolérant des dauphins, et même longtemps après la réunion du Dauphiné à la France. Alors la province fut déchirée par les guerres qu'ils se firent entre eux. Rien ne peut mieux donner une idée de la multiplicité de ces petites guerres et de l'anarchie qu'elles produisirent, que le grand nombre de châteaux forts qui leur servaient de retraite, comparé au peu d'étendue du territoire où ils étaient situés. Il y en avait neuf cent cinquante en 1339. Certes, il ne fallut rien moins que la puissance de Louis XI pour mettre fin à cette anarchie.
Successivement visité, en 1434, par Henri II, roi de Navarre et comte de Provence ; puis par le prince d'Orange, le duc de Savoie, le Dauphiné se vit un moment menacé par les impériaux ; mais Bayard, avec 2 000 fantassins et quelques chevaux, sut défendre les avenues de sa terre natale. II détruisit, en outre, une bande de 1 500 brigands qui ravageaient le Viennois.
Aux guerres féodales succédèrent, dans cette province, les guerres religieuses. C'est dans ses montagnes que la secte des Vaudois avait pris naissance. « On voulut, dit Chorier, contraindre les chefs de famille de déférer aux inquisiteurs leurs femmes et leurs enfants, et ceux-ci leurs mères et leurs pères. La peine des obstinés dans leur erreur fut le feu. Dans l'espace d'une seule année (1393), deux cents périrent sur les bûchers. »
Au XVIe siècle, les protestants, sous les ordres du baron des Adrets, y firent leurs premières armes. Ils s'emparèrent de Grenoble en 1563. Plus tard, Mont-brun et Lesdisguières ayant pris le commandement de la province, la guerre s'y ralluma avec des alternatives de succès et de revers. Plusieurs places du Valentinois et du Diois tombèrent au pouvoir des protestants ; mais, dans le haut Dauphiné, Grenoble, repris par le parti catholique, leur résista. Henri III revenait de Pologne pour remplacer sur le trône de France Charles IX, son frère.
Arrivé au pont de Beauvoisin, il se vit disputer le passage par Montbrun. Celui-ci tomba sur le roi et sur le gros de sa suite. « Avez-vous donc oublié que vous êtes né sujet ? » lui dit quelqu'un. « Les armes et le jeu, répondit Montbrun, rendent les hommes égaux. » Henri III lui écrivit pour lui reprocher son action. « Quoi ! s'écria Montbrun, il m'écrit comme si je devais le reconnaître pour roi ; cela serait bon en temps de paix, mais en temps de guerre, lorsqu'on a le bras armé et le cul sur la selle, tout le monde est compagnon. »
Henri en garda un vif ressentiment. Après le siège de Châtillon, Montbrun, poursuivi par de Gordes, chef des catholiques, se retourne contre lui près de Molières, et, la lance à la main, le force à rétrograder. De Gordes opère sa retraite sur Die ; mais, secouru au pont de Mirabel par d'Ourches et Lestang, qui lui amènent des renforts, il repousse l'attaque de Montbrun et de Lesdiguières. Cette journée fut fatale aux protestants. Après des prodiges de valeur, Montbrun, couvert de sang et de poussière, en franchissant un mur, tombe avec son cheval. Il est fait prisonnier, pendant que Lesdiguières parvient à se retirer en bon ordre sur Pontaix. Montbrun est transporté à Grenoble ; le parlement lui fait son procès.
On connaît sa fin tragique. Henri III, supplié par la famille de Montbrun, par la noblesse protestante du Dauphiné et par le prince de Condé lui-même, ne voulut pas faire grâce ; et celui que ses amis et ses ennemis avaient surnommé le Brave périt de la main du bourreau. Cependant, avec la paix de 1576, les protestants obtinrent la réhabilitation de Montbrun et le libre exercice de leur culte ; mais cette paix ne fut pas de longue durée. Contre le voeu des députés du Dauphiné, les états généraux assemblés à Blois déclarèrent qu'il n'y aurait désormais qu'une religion en France. C'était la guerre : les protestants dauphinois prirent pour la sixième fois les armes et sous Lesdiguières, digne de succéder à Montbrun, ils firent contre la Ligue cette campagne qui ne se termina qu'à l'édit de Nantes, en 1598.
Jusqu'en 1789, la province fut régie comme toutes les autres, à l'exception de plusieurs usages particuliers. Ainsi l'on n'y recevait pas la maxime nulle terre sans seigneur, admise dans le reste du royaume ; l'adultère n'y était puni que d'une amende de cent sols. Il y avait, en Dauphiné, un parlement, une chambre des comptes, un présidial, sept bailliages, trois sénéchaussées, quatre judicatures royales et autant de justices qu'il y avait de terres seigneuriales. Pays d'états et de droit écrit, il jouissait de grands privilèges en vertu de l'acte de cession de 1349. Composés des députés de la noblesse, du clergé et du tiers, les états avaient le droit d'accorder ou de refuser l'impôt. Ils se réunissaient presque annuellement.
Dans les états généraux du royaume, on considérait ceux de Dauphiné comme un corps particulier ; il était répondu à leurs cahiers séparément ; mais, dans ces petits états comme dans les grands, la noblesse et la clergé s'entendaient contre le tiers, qui n'en sortait le plus souvent qu'humilié et taillé à merci et miséricorde. Cependant la Révolution approchait. Depuis Louis XIII, qui les avait sus- pendus, les états de Dauphiné ne s'étaient point assemblés. De toutes parts, on criait contre les abus. Aux remontrances des parlements, la cour répondait par des coups d'État ; la fortune et la liberté des citoyens étaient livrées au caprice du pouvoir. Alors, convoqués par les consuls de Grenoble, les états de Dauphiné s'assemblèrent à Vizille, le 21 juillet 1788. Après avoir proclamé les principes du droit public de la province, ils protestèrent contre la suppression des parlements et demandèrent la convocation des états généraux. On sait ce qui arriva. Barnave et Mounier avaient été l'âme de cette assemblée ; quand, le 5 mai 1789, ils parurent aux états généraux, le tiers, d'un mouvement spontané, se leva pour leur rendre hommage.
Par sa position sur la frontière, le Dauphiné eut à souffrir des invasions : le roi de Navarre, en 1426 ; quelque temps après, le prince d'Orange ; plus tard, les impériaux ; en 1691, le duc de Savoie ; enfin, les armées alliées, en 1814 et en 1815, violèrent successivement son territoire. Mais le pays des Allobroges, de Bayard et de Lesdiguières, trouva dans ses enfants de vaillants soldats pour combattre l'étranger.
C'est le coeur et le bras de la France. Comme leurs frères de la Drôme, en effet, les habitants de l'Isère du XIXe siècle ont conservé les vertus de leurs ancêtres. Probes, désintéressés, laborieux, économes, hospitaliers, patients dans le malheur, courageux dans le péril, passionnés pour la liberté et l'indépendance, ils tiennent, par leur caractère et leurs habitudes, encore plus du montagnard que du citadin. Ajoutons qu'au XIXe siècle, les Dauphinois pratiquent cette grande loi de la nature qui consiste à s'entre aider. A cet amour du prochain, ils joignent au plus haut degré l'amour de la patrie et du sol natal. Si loin qu'ils soient de leur pays, ils ne soupirent qu'après le retour. Et comment ne seraient-ils pas attachés à leurs montagnes ? Beau ciel, heureux climat, sol fertile, sites charmants, la nature n'a-t-elle pas tout fait pour leur en rendre le séjour agréable ?
Les departements et leur histoire - L'indre et Loire - 37 -
Le département d'Indre-et-Loire comprend les quatre cinquièmes de l'ancienne Touraine, dont la capitale est devenue son chef-lieu. Ce beau pays n'a pas eu, comme quelques autres plus énergiques et plus rudes, une histoire intérieure fort agitée ; si sa tranquillité a été troublée, c'est en général par le contrecoup des secousses qui remuaient les pays voisins ou même toute la France.
Le caractère de ses habitants est plus propre au repos qu'à la guerre ; une certaine indolence se remarque aujourd'hui chez eux, et les témoignages de tous les temps s'accordent sur ce point : Turoni imbelles, dit Tacite ; mais les Tourangeaux réclament et demandent qu'on lise rebelles. Una nuper cohors rebellem Turonium (profligavit), dit Silius Italicus. Rebellem ! s'écrient les Tourangeaux avec fierté. Oui, mais una cohors, une seule cohorte les a vaincus. Bella timentes Turones, dit Sidoine Apollinaire. « Mais ceci, répond Stanislas Bellanger (de Tours), n'est point une preuve irréfutable. » Enfin, le Tasse, énumérant les peuples accourus à la croisade, écrit sur les guerriers de Tours et de Blois ces vers charmants :
| Non è gente robusta o faticosa... La terra molle, e lieta, e dilettosa, Simili a se gli abitator produce. |
« Ce n'est pas un peuple robuste et fait pour supporter les fatigues ;... cette terre, qui respire la mollesse, la joie et les délices, donne le jour à des habitants qui lui ressemblent. »
Que les Tourangeaux sachent se borner ; qu'ils se contentent de la réputation d'esprits fins, caustiques, prenant la vie par le bon côté, et parlant notre langue avec plus de pureté qu'aucune autre province de France, ce qu'on attribue, à tort ou à raison, au long séjour de la cour dans leur pays.
Dans le temps qu'on se faisait grand honneur d'une antique origine, les Tourangeaux ont eu, comme bien d'autres peuples du reste, la manie de se rattacher aux temps héroïques de la Grèce. Turnus aurait été le père des Turoni, et, au XVIe siècle, on montrait encore près d'une des portes de Tours une grosse pierre carrée qu'on disait être son tombeau. D'autres voulaient qu'une troupe de Gaulois fût allée au secours de Troie et, la trouvant déjà conquise, en eût ramené des Troyens qui se seraient fixés aux bords de la Loire.
Il en est qui font venir Turoni du grec fils du ciel. Une étymologie moins flatteuse est celle qui fait dériver leur nom du celtique tur, turon, qui tourne, qui change, épithète qui désignerait l'instabilité de leur caractère. Les Turoni, à parler sérieusement, étaient des Celtes et tenaient leur place dans la confédération des Andes, des Carnutes, des Sénones, des Lingons, des Vénètes. Ils formaient une des civitates si nombreuses que César trouva en Gaule. Ils étaient gouvernés de même, avaient la même religion, les mêmes lois, les mêmes armes.
Plusieurs dolmens encore debout et quelques débris d'armes trouvés dans le département, une pointe de lance et des haches en bronze, un fragment d'une hache en silex, un casse-tête, un caillou tranchant pour dépouiller les animaux, des pointes de flèche en silex, des fragments d'armure en bronze, en témoignent suffisamment. Sur des médailles ornées de figures du sanglier symbolique des Gaulois ou d'autres animaux bizarres qu'on suppose être l'urus ou auroch, on lit, outre la légende Turonos, les noms de Cantocix et de Triccos, qu'on croit avoir été deux chefs du pays à une époque inconnue.
Les Turoni ne se firent que faiblement remarquer dans les grandes expéditions des Gaulois hors de leur pays et dans la résistance nationale aux armes de César. Soumis avec toute la Gaule, ils fournirent de la cavalerie au conquérant et furent compris dans la Celtique qui, sous Auguste, reçut le nom de Gaule Lyonnaise.
Un peu plus tard, leur pays fut démembré, et sa partie méridionale fut attribuée à l'Aquitaine. Quand il y eut quatre Lyonnaises, ils firent partie de la troisième, qui comprenait la Touraine, la Bretagne, l'Anjou et le Maine. Dans la décadence de l'empire, lorsque déjà les Wisigoths occupaient le sud de la Loire, les Bretons, les Andécaves (Anjou) et les Turones formèrent la ligue armoricaine dans le but de ressaisir leur antique indépendance. Mais Aétius les vainquit et établit chez eux les Alains mercenaires qui, de la rive droite de la Loire, où ils se fixèrent, ne cessèrent d'aller ravager la rive gauche et la Touraine méridionale. Ils ne s'arrêtèrent que devant les armes des Wisigoths, qui ne voulaient pas les laisser empiéter sur leur royaume d'Aquitaine.
Ce fut, depuis lors, le sort de la Touraine d'être cruellement disputée par ces ennemis acharnés. Entre la Seine et la Loire, et par conséquent en partie chez les Turones, subsistait le dernier débris de l'empire romain en Gaule. L'un des plus habiles et des derniers chefs de ce petit État romain perdu au milieu de l'invasion barbare fut AEidius, qui refoula les Wisigoths. Mais il mourut empoisonné après sa victoire (464), et les Wisigoths, après la chute de l'empire (476), se précipitèrent sur la Touraine, qu'ils réunirent à leur royaume au sud de la Loire. Ainsi finit en ce pays la domination romaine après y avoir subsisté 535 ans.
Pendant cette longue période de civilisation, le christianisme y avait été introduit vers la fin du IIIe siècle par saint Gatien, premier évêque et patron de Tours, mort en 304. Saint Martin acheva son oeuvre. Quand les Wisigoths eurent conquis la Touraine, ils voulurent y établir leur religion, l'arianisme, en même temps que leur domination, et ce fut ce qui leur fit perdre cette province. Les habitants, persécutés par Alaric II, accueillirent favorablement les Francs, qui, après avoir fait une première incursion dans le pays en 473, y reparurent, convertis et orthodoxes, avec Clovis à leur tête, en 504.
Par l'entremise du roi des Ostrogoths, le grand Théodoric, les deux rivaux, Clovis et Alaric, eurent une entrevue amicale au milieu de la Loire, dans l'île d'Or, aujourd'hui île Saint-Jean, en face d'Amboise, tous deux se touchèrent la barbe et se jurèrent amitié ; à l'occasion de quoi furent frappées des médailles. On prétend aussi voir des monuments commémoratifs de cette réconciliation dans les deux énormes tumulus de Sublaines, entre Loches et Amboise, qui sont plus vraisemblablement les tombeaux de quelques anciens chefs gaulois.
Cette réconciliation fut bien éphémère ; car, bientôt après, s'engageait près de Poitiers la bataille de Vouillé, qui chassa les Wisigoths de la Gaule et livra à Clovis la Touraine, l'Aquitaine, etc. Après sa mort, la Touraine fit partie du royaume d'Orléans et fut un objet de querelles pour les quatre rois frères.
Lors de l'invasion du midi de la France par les Sarrasins (732), la Touraine fut sauvée avec toute la monarchie franque par la grande victoire de Charles Martel, gagnée, dit-on, à trois lieues de Tours, dans une plaine qu'on appelle aujourd'hui les Landes de Charlemagne. On sait que Charles Martel fut appelé Magnus comme son petit-fils, et que d'ailleurs l'imagination populaire a mis sur le compte du premier empereur d'Occident bien des exploits qui ne lui appartiennent pas. Charles Martel laissa la Touraine à Eudes, duc d'Aquitaine ; mais, en 736, il l'enleva à ses héritiers, et bientôt, d'ailleurs, il commença la soumission de l'Aquitaine môme par ces terribles expéditions que Pépin le Bref et Charlemagne continuèrent.
Ce dernier donna le gouvernement de la Touraine au comte . Hugues, aven une autorité plus étendue que celle des précédents gouverneurs. Ce seigneur fut, peu de temps après, envoyé en ambassade auprès de Nicéphore, empereur d'orient. C'est à cette époque, par les soins de Charlemagne, puis de Louis le Débonnaire, que fut commencé l'endiguement de la Loire ; ce n'est pas d'aujourd'hui que ce fleuve est redoutable par ses débordements ; son nom Liger, suivant l'étymologie celtique, veut dire ravageuse aux eaux froides. D'autres ravageurs désolèrent la Touraine au IXe siècle ; comme tous les pays voisins, elle souffrit des incursions des Normands que combattit avec tant de valeur Robert le Fort, comte de Touraine, d'Anjou et de Blois.
En 940 commence la série des comtes héréditaires, c'est-à-dire le régime féodal, en Touraine. Thibaut le Tricheur, déjà comte de Blois, de Chartres, de Beauvais, de Meaux et de Provins, s'empara, par la force, de la Touraine et la posséda, ainsi que son fils Eudes Ier (978). La Touraine devint alors le théâtre d'une lutte opiniâtre, qui est à peu près l'événement le plus saillant de la pâle histoire de cette époque.
Les comtes de Blois et Champagne étaient les plus puissants seigneurs de la France du centre et de l'est, qui, par l'acquisition de la Touraine, semblait vouloir envahir la France occidentale. Mais celle-ci résista, personnifiée dans les puissants comtes d'Anjou. L'un d'eux, Foulques Nerra ou Faucon Noir, célèbre par son caractère intraitable et par son âpre énergie, s'empara d'une partie de la Touraine, après une lutte violente. Son fils Geoffroy Martel assiégeait Tours lorsque, menacé par une armée ennemie, il leva le siège. Une bataille, livrée près de Montlouis le 22 août 1044, fut fatale à l'héritier légitime de la Touraine, Thibaut III, qui signa, dans la prison de Loches, l'abandon de son fief à la maison d'Anjou.
La Touraine suivit dès lors les destinées de l'Anjou, fut réunie à l'Angleterre en 1152, enlevée en 1204 à Jean sans Terre par Philippe-Auguste et rattachée alors à la couronne de France. Pour gagner l'affection des seigneurs du pays, Philippe rendit la dignité de sénéchal héréditaire en faveur de Guillaume des Roches et créa cinquante-cinq chevaliers bannerets, qui eurent le droit de faire porter leur bannière à l'armée du roi, sous condition de fournir leur contingent.
La Touraine fut séparée du domaine de la couronne, d'abord par Philippe de Valois, qui l'érigea en duché-pairie en faveur de Jeanne de Bourgogne, sa femme (1328), puis par le roi Jean, qui, après la bataille de Poitiers, la donna en apanage à son fils Philippe le Hardi, mais la lui retira ensuite pour y substituer la Bourgogne. Parmi les ducs apanagistes qui succédèrent, il faut remarquer Louis Ier, duc d'Anjou et roi de Naples, à partir duquel les armoiries de la Touraine, qui étaient de gueules, au château d'argent, furent augmentées de la bordure componée de Jérusalem et de Naples Sicile. Le dernier duc apanagiste fut François d'Alençon, fils de Henri II, qui mourut en 1576. La Touraine cessa dès lors de servir d'apanage aux princes du sang.
Jusque-là tranquille et prospère, la Touraine se vit troublée au XVIe siècle par la conspiration d'Amboise (voir plus loin) et par les guerres de religion ; mais elle eut surtout à souffrir de la révocation de l'édit de Nantes, qui, en forçant un grand nombre de chefs d'industrie protestants à s'expatrier, provoqua la ruine de ses fabriques de rubans et d'étoffes de soie.
Avant 1789, la Touraine formait un des 32 gouvernements et donnait son nom à l'une des 35 généralités du royaume. Cette généralité comprenait, en outre, l'Anjou, le Maine, le bas Poitou et venait immédiatement après celles de l'Ile-de-France, de la Normandie et du Languedoc. Sa population était de 1 338 700 âmes et payait 30 millions d'impôt.
Lors de la chute du premier et du second Empire, c'est sur les bords de la Loire, que l'armée française, à la suite du désastre de Waterloo, opéra sa retraite, et c'est là aussi, dans la ville de Tours, que vint résider, au mois d'octobre 1870, le gouvernement de la Défense nationale ; mais, à l'approche des armées allemandes, il dut quitter Tours pour aller siéger à Bordeaux. Le département fut occupé pendant les premiers mois de 1871, jusqu'à la signature des préliminaires de la paix ; et cette occupation de l'une des plus belles et des plus paisibles contrées de la France lui coûta 4 456 535 francs.
Les départements et leur histoire - L'Indre - 36 -
Le département de l'Indre, formé de la partie de l'ancienne province du Berry connue sous le nom de bas Berry, a, dans ses premières origines surtout, une histoire commune avec celle du département du Cher, dont la reproduction ici ferait double emploi, et à laquelle nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui tiendront à avoir des notions plus complètes et plus détaillées sur les annales de la contrée.
Les Romains trouvèrent ce pays occupé par les Bituriges, nation nombreuse et florissante, possédant des villes importantes, parmi lesquelles Issoudun, dont le nom est d'origine toute celtique, est une de celles dont nous aurons à parler. Quelques vestiges de monuments mégalithiques, des traces mieux conservées d'ouvrages romains, guident et éclairent les recherches de l'historien pour ces périodes reculées. On sait que sous Auguste le pays des Bituriges fut compris dans l'Aquitaine, dont Bourges, sous le nom d'Avaricum, devint la capitale.
Entre la domination romaine et l'établissement de la monarchie franque, deux grands faits viennent se placer : l'apparition du christianisme vers le milieu du IIIe siècle, les premières prédications de saint Ursin et la désastreuse invasion des Wisigoths, qui ne furent chassés qu'en 511 par Clovis, vainqueur de leur chef Alaric dans la sanglante bataille de Vouglé.
La période mérovingienne est pleine d'incertitude et d'obscurité en ce qui concerne le Berry. Lors du partage du royaume des Francs entre les enfants de Clovis, le pays de Bourges, dont faisait sans doute partie notre département de l'Indre, fut englobé dans les dépendances du royaume d'Orléans ; il passa ensuite aux ducs d'Aquitaine, et eut sa part de dévastations et de calamités dans la vengeance que tira le roi Pépin de la révolte de Waïfre, l'un d'eux.
Charlemagne rattacha définitivement le Berry à la couronne de France. De son organisation administrative datent les comtes de Berry, dont le pouvoir, centralisé et respecté sous son règne, s'éparpilla, sous celui de ses successeurs, aux mains de seigneurs locaux qui, pour la plupart, suivirent la fortune des comtes de Poitou, qu'ils reconnurent comme suzerains, tout en se réservant une indépendance à peu près complète. Nous suivrons, dans l'histoire spéciale des villes, les développements de quelques-unes de ces familles féodales ; aucune d'elles n'acquit une importance aussi générale sur la contrée qui nous occupe que celle des princes de Déols. Ils avaient la prétention de descendre d'un Léocade, sénateur des Gaules, qui protégea l'établissement du christianisme dans le Berry au IIIe siècle ; à l'époque où nous sommes arrivés, c'est-à-dire sous les premiers successeurs de Charlemagne, le chef de cette illustre maison était Laune, et son frère Géronce occupait le siège archiépiscopal de Bourges.
Son petit-fils, Ebbe ou Ebbon, surnommé l'Ancien et le Noble, fonda, de concert avec sa femme Hildegarde, la célèbre abbaye de Déols. Les fiefs qui dépendaient de la principauté de Déols étaient nombreux et considérables ; on en comptait 168 principaux, au nombre desquels figuraient les villes de Châteauroux, Issoudun, Saint-Gaultier, Saint-Chartier, La Châtre, Argenton, Clais, etc. Celte nomenclature suffit à démontrer quels étroits rapports rattachent l'histoire du bas Berry tout entier à celle des princes de Déols.
En 935, l'invasion hongroise pénètre jusque dans les provinces centrales de la France ; Ebbe l'Ancien réunit ses vassaux, en forme une armée, à la tête de laquelle il poursuit l'ennemi, l'atteint et le bat à Châtillon-sur-Indre. Il veut consolider ses succès par une nouvelle victoire ; il rejoint encore les Hongrois à Loches ; mais, trahi par son ardeur, il est blessé mortellement, et expire à Orléans, où l'église de Saint-Aignan reçoit sa noble dépouille.
Raoul le Large, fils d'Ebbe l'Ancien, jette les fondements de la ville de Châteauroux ; il fortifie la ville construite, lui donne son nom, Château-Raoul, en fait la capitale de sa principauté, abandonnant l'ancien bourg de Déols à l'abbaye qu'y avaient fondée ses ancêtres. Il meurt en 952.
Les craintes superstitieuses, qui, aux approches de l'an 1000, donnèrent une essor si prodigieux aux fondations religieuses, eurent aussi leur influence sur la pieuse famille de Déols : Raoul IV (Thibaut) avait précédé la première croisade ; il avait revêtu l'habit de pèlerin, avait visité Jérusalem et était mort à Antioche ; plus tard, Ébrard de Vatan se fit pour le Berry l'écho de la voix de Pierre l'Ermite, et le prince de Déols prit part, avec un grand nombre de ses vassaux, à l'expédition de 1099.
Ce dévouement chevaleresque n'est pas le seul gage que donnaient ces puissants seigneurs des sentiments religieux qui animaient leur famille. Dès les premiers temps de la fondation de l'ordre de Saint-Benoît, des moines avaient été appelés, et leur établissement dans le bas Berry puissamment encouragé ; ils y avaient fondé, vers la fin du VIIe siècle, les monastères de Saint-Cyranen-Brenne et de Méobec ; celui de Saint-Genou, en 828 ; de Déols, en 917 ; d'Issoudun, en 947, et de Saint-Gildas, quelques années plus tard.
Il ne reste aujourd'hui que de bien rares vestiges de ces riches et antiques établissements ; mais la sainte et laborieuse milice a laissé des monuments plus utiles et plus durables de son passage ; ce sont des marais assainis, des routes tracées, des forêts défrichées, de vastes étendues de terrain livrées à la culture, de nombreux villages créés, le joug de la féodalité rendu plus léger, les mœurs adoucies, les traditions de l'art et de la science antique renouées et la civilisation moderne préparée.
Pendant les deux siècles que nous venons de parcourir, nous avons marqué la part qui revient à la maison de Déols dans le bien qui s'est fait ; l'heure de son extinction allait arriver, et nous avons le regret de ne pas pouvoir ajouter à ses titres de gloire le plus grand bienfait que les vassaux pussent recevoir alors de leurs seigneurs, avec la paix : l'affranchissement. C'est sans doute à la douceur de la domination des Déols faisant la liberté moins indispensable et moins réclamée, qu'il faut attribuer cette lacune que nous regrettons : l'absence, dans le bas Berry, de toute charte communale à une époque où tant de villes en France avaient les leurs.
En 1176, Raoul VI, dernier sire de Déols, meurt au retour de la croisade ; sa fille unique, Denise, devient maîtresse de ses immenses possessions. C'était au plus fort de la lutte entre Philippe-Auguste et Henri II, roi d'Angleterre. Denise était la nièce du prince anglais ; celui-ci, auquel l'alliance d'Éléonore de Guyenne avait livré déjà presque tout l'ouest de la France, ne laissa point échapper une occasion si favorable d'étendre son influence sur les provinces centrales du royaume ; il se présenta donc comme le protecteur naturel de la jeune orpheline, et, secondé par son fils, Richard Coeur de Lion, alors comte de Poitiers, il s'empara des villes de Châteauroux et de Déols, et mit garnison dans tous les autres châteaux et forteresses de la principauté, Boussac et Châteaumeillant exceptés.
Philippe-Auguste ne pouvait voir avec indifférence une semblable extension de la puissance anglaise ; il prétexte la revendication du Vexin injustement retenu par Henri, le refus du serment d'hommage que lui doit Richard pour son comté de Poitou, et, à la tête d'une puissante armée, il marche sur le bas Berry. Issoudun et Graçay tombent en son pouvoir ; les campagnes de la terre déoloise sont ravagées, le siège est mis devant Châteauroux, les deux armées ennemies se sont rejointes et sont au moment d'en venir aux mains, quand une trêve est conclue par l'intermédiaire des légats du pape ; Philippe se retire, ne gardant qu'Issoudun comme garantie des promesses faites par le roi d'Angleterre.
Cette trêve ne pouvait être de longue durée, car aucune des difficultés de la situation n'était résolue ; aussi, en 1189, sur le bruit d'un mariage projeté entre Denise de Déols et André de Chauvigny, l'un des barons du Poitou les plus dévoués aux Anglais, Philippe, prétextant cette fois une expédition de Richard dans le Midi, faite contre le texte des traités, revient sur le Berry, surprend la province sans défense, s'empare de Châteauroux, Buzançais, Argenton, soumet tout le pays et pénètre dans l'Auvergne, menaçant de ce point central et élevé les possessions anglaises de l'Ouest et du Midi.
Cette marche victorieuse eût sans doute assuré la domination française dans tout le Berry, si la question ne se fût compliquée alors de luttes moins heureuses sur d'autres points ; Philippe transigea et accepta de Henri mourant un traité, ratifié ensuite par Richard, son successeur, en vertu duquel il ne restait en possession quo d'Issoudun et de Graçay.
Six ans plus tard, une autre convention, survenue à la suite d'une nouvelle intervention de Philippe, accouru au secours du bas Berry, que ravageait Mercadier, chef de routiers à la solde de Richard, modifia encore l'état politique de la province : le roi d'Angleterre consentit à faire sa soumission et à rendre hommage au roi de France comme comte de Poitou ; mais la terre de Déols continua à relever du prince anglais en sa qualité de duc d'Aquitaine, et les villes d'Issoudun et de Graçay lui furent remises et restèrent en sa possession jusqu'en 1200, époque à laquelle elles furent données en dot à Blanche, nièce du roi Jean sans Terre et femme de Louis, fils de Philippe-Auguste.
Les événements si précipités de cette courte période peuvent donner une idée des vicissitudes auxquelles furent en butte nos malheureuses provinces du centre, incessamment froissées dans la lutte si acharnée et si longue de l'Angleterre et de la France ; les rivalités féodales devaient encore venir apporter de nouveaux éléments de troubles et de discordes à ces déplorables déchirements.
L'espèce d'unité intérieure maintenue dans le bas Berry par la prépondérance des princes de Déols reçut une grave atteinte à l'extinction de cette illustre maison. Son unique rejeton, Denise, avait épousé le baron de Chauvigny, qui devint la souche d'une nouvelle dynastie, celle des comtes de Châteauroux, titre qu'ils empruntèrent à la capitale de leurs domaines. Cette famille conserva pendant plus de trois siècles, de 1189 à 1505, une puissance moins étendue, plus contestée que celle des Déols, mais illustrée souvent par les exploits de ses membres, et dans les archives de laquelle il faut encore chercher les épisodes les plus notables de l'histoire du bas Berry.
Le XIIIe siècle, moins agité, pour notre province, par les événements extérieurs que les siècles précédents et que ceux qui suivirent, se signale surtout par l'affranchissement des communes. L'octroi des chartes était le gage que donnaient les princes aux villes pour s'assurer de leur dévouement et de leur fidélité ; c'était souvent aussi le prix dont ils payaient les sacrifices extraordinaires qu'ils leur imposaient.
Cette politique, appliquée ailleurs depuis longtemps déjà, ne fut importée dans le bas Berry qu'en 1208. Châteauroux fut la première ville à qui semblable faveur fut accordée ; l'exemple gagna bientôt le reste du pays, où chaque seigneur affranchit peu à peu, sans secousses, les serfs de ses domaines ; l'influence royale y poussait de tous ses efforts, sentant tout ce qu'elle avait à gagner à cet amoindrissement de la puissance féodale. On sait, d'ailleurs, que cette époque correspond au règne de rois fermes et résolus dont on sent la politique réagir même à distance sans que l'historien trouve toujours des témoignages palpables de son intervention.
Ici, cependant, nous pouvons produire un fait à l'appui de nos suppositions. Un des droits seigneuriaux les plus importants était celui qu'avaient conservé les comtes de Châteauroux, de battre monnaie ; un pareil privilège, qui abandonnait aux mains d'un homme ou d'une famille un élément aussi essentiel de la fortune publique, était un invincible obstacle à tout essor de l'industrie, à tout développement des transactions commerciales ; aussi voit-on coïncider avec les premiers temps de l'émancipation les premiers murmures contre l'altération de la monnaie, qu'on reprochait aux sires de Chauvigny ; la bourgeoisie, trop timide encore pour articuler ses griefs, laisse la parole à la noblesse et au clergé, qui en appellent au roi de France, et, après de longues réclamations, intervient enfin une déclaration portant la date de décembre 1316, et par laquelle Guillaume III de Chauvigny s'oblige à ne plus émettre de monnaie pendant sa vie et à interdire le droit d'en frapper à ses héritiers pendant les vingt-neuf années qui suivront sa mort.
Ce qu'il y a de plus curieux dans le fait, c'est qu'il se passait pendant que Philippe le Bel, pour alimenter le trésor royal, avait recours à ce même moyen, qu'on interdisait à son vassal, pour augmenter ses richesses féodales, comme si l'instinct public eût compris que la nécessité du temps justifiait pour l'un ce qu'elle défendait à l'autre. Voici, du reste, une preuve plus significative encore des progrès accomplis, dans ce sens, pendant le cours du XIIIe siècle. Ce même Guillaume III de Chauvigny avait commis une violence sur un domaine du seigneur de Culant ; celui-ci porta plainte devant le roi, qui, la cause entendue, condamna Guillaume à une amende ; sur son refus de l'acquitter, il fut saisi et enfermé dans la tour d'Issoudun.
Ces tendances vers l'établissement et la constitution d'une monarchie française forte et puissante furent arrêtées, au XIVe et au XVe siècle, par le réveil des prétentions anglaises et les guerres qu'elles entraînèrent, compliquées encore de la sanglante querelle des Armagnacs et des Bourguignons. A la mort de Charles le Bel, en 1328, la question de succession à la couronne de France divisa la noblesse du bas Berry. Le vicomte de Bresse, fils du baron de Châteauroux, prit parti pour Philippe de Valois ; Robert de Mehun embrassa la cause d'Édouard, roi d'Angleterre ; le prince de Galles s'avança au secours de son champion, dévasta les domaines du sire de Châteauroux et brûla sa capitale.
La guerre eut pour les deux partis des alternatives de revers et de succès : tantôt, comme en 1356, les Chauvigny, toujours fidèles à la cause française, prirent l'offensive en Guyenne sous la bannière de Du Guesclin ; tantôt ils durent défendre pied à pied leurs domaines, sur lesquels faisaient irruption les masses anglaises, comme autrefois les hordes des barbares du nord ; l'histoire de ces temps malheureux n'est qu'un long récit de guerres ruineuses, de prises et reprises de villes et de châteaux.
Un des épisodes dont les traditions locales ont gardé le souvenir est l'héroïsme d'un Guillaume de Brabançois, seigneur de Sarzay, qui, au milieu même des triomphes des Anglais, alors qu'ils occupaient les forteresses de Briantes, du Chassin et du Lis, sans autres forces qu'une petite troupe de quarante lances, se mit en campagne, s'empara de la ville de La Châtre, en 1360, et fit face à l'ennemi partout où il put le rencontrer.
Ces massacres et ces dévastations se continuèrent presque sans interruption dans la contrée qui forme le département de l'Indre, jusqu'au triomphe définitif de Charles VII sur les Anglais et à la mort du dernier duc de Bourgogne ; le siège d'Issoudun, l'incendie de ses faubourgs et le sac de Buzançais, dont nous aurons ailleurs occasion de parler, appartiennent à la dernière période de cette époque désastreuse.
A l'exception de quelques fautes dont la responsabilité appartient aux mœurs du temps plus encore peut-être qu'au caractère des hommes, on a vu l'illustre famille de Chauvigny conserver intact et glorieux l'héritage que lui avaient légué les Déols. Sa constante fidélité à la fortune de la France était alors un mérite assez rare pour qu'on songeât à le récompenser.
Charles VIII acquitta la dette de ses prédécesseurs ; le bas Berry fut érigé en comté en faveur d'André de Chauvigny ; l'acte est daté de 1497. Le nouveau comte de Berry ne jouit pas longtemps de son titre ; il suivit le roi dans ses campagnes d'Italie, eut occasion de lui rendre de signalés services, se distingua particulièrement à la bataille de Fornoue, et mourut en 1502 sans laisser d'enfant. En lui s'éteignit une des maisons les plus anciennes et les plus puissantes de la vieille noblesse française ; avant de traverser trois siècles de notre histoire, comme comtes de Châteauroux, les Chauvigny du Poitou avaient déjà une illustration ancienne et méritée, et les guerres des croisades avaient rendu fameux leur cri de guerre, devant lequel avaient souvent fui les Sarrasins : « Chauvigny ! chevaliers pleuvent ! »
La veuve d'André se maria en 1505 à Louis de Bourbon de La Roche-sur-Yon ; son premier époux l'avait instituée son héritière ; mais les sires de Maillé, descendants du côté paternel du sire de Chauvigny, attaquèrent le testament, qui les frustrait des immenses domaines du comté de Châteauroux ; il survint une transaction en 1519, par laquelle le sieur de Maillé fut reconnu possesseur des seigneuries de Châteauroux, La Châtre et d'autres terres situées sur le comté de la Marche, et les seigneurs et dames de La Roche-sur-Yon restèrent propriétaires des terres du Châtelet, Cluis-Dessous, Neuvy-Saint-Sépulchre, Aigurande, et tout ce qui était assis en la prévôté et ressort d'Issoudun.
Avant d'entrer dans l'époque moderne, jetons un regard sur les monuments élevés dans l'intervalle qui sépara le XIe siècle du XVe, que nous touchons. Nous ne disons rien ici ni des églises ni des châteaux forts dont la fondation se rattache à l'histoire particulière des villes ; ce seront bien souvent des ruines qu'auront à nous offrir les souvenirs de la féodalité : les donjons des vieux manoirs, les remparts des villes autrefois fortifiées ont eu à combattre le double assaut du temps et de la grande Révolution ; mais le Berry offre encore en assez grand nombre les restes plus ou moins bien conservés d'établissements religieux qu'il dut à la dévote munificence de ses principaux seigneurs et parmi lesquels nous devons mentionner : l'abbaye de Miseray, près de Buzançais, fondée au XIe siècle ; celle de Fontgombault, qui date de 1091 ; de Puy-Ferrand, dont il est fait mention en 1145 ; de Landèse, construite en 1115 par les sires de Buzançais, qui y étaient inhumés ; de La Prée, élevée vers 1128 par Raoul, seigneur d'Issoudun, de Barzelle et de Varennes, bâties, la première en 1137, l'autre, vers 1155 ; ces quatre dernières dépendant de l'ordre de Cîteaux ; ajoutons le monastère de Buxière, communauté de femmes dont la création remonte à 1140, et les deux établissements de cordeliers : celui de Châteauroux, oeuvre de Guillaume Ier de Chauvigny en 1213, qui contenait les tombeaux de la plupart des seigneurs de Châteauroux, des familles de Chauvigny et d'Aumont ; et celui d'Argenton, qui ne date que de 1459.
Depuis la fin du règne de Charles VII jusqu'aux premières guerres de la Réforme, pendant tout un siècle, la paix répara les désastres des périodes précédentes : bien des ruines furent relevées, un champ vaste et fécond s'ouvrit à l'activité humaine ; l'art décora les villes ; l'agriculture enrichit les campagnes ; cette époque fut pour notre pauvre Berry, plus que pour beaucoup d'autres contrées, le siècle de la Renaissance ; mais dans l'histoire de la France le calme est presque l'exception, et la guerre l'état normal.
De nouveaux orages s'amoncelaient : de l'est, de l'ouest, du midi, la réforme religieuse pénétrait jusqu'aux régions les plus centrales ; la guerre répondait aux persécutions ; le Berry ne resta pas à l'abri de ses fléaux. Issoudun fut assiégée, en 1562, par les huguenots, qui l'auraient prise sans le secours que prêta le sieur de Sarzay à la cause catholique ; Saint-Benoît-du-Sault fut occupé l'année suivante par les troupes protestantes ; plusieurs autres villes de la contrée eurent le même sort.
La colère des vainqueurs s'exerça particulièrement sur les églises et les monastères ; la guerre toutefois n'y eut point le caractère de barbarie et d'acharnement qu'on a ailleurs à déplorer trop souvent, et la pacification du bas Berry fut plus prompte et plus facile que celle des provinces voisines. Une autre guerre moins sanglante divisait alors les grandes familles du pays. L'héritage des Chauvigny, partagé entre les Maillé et les Aumont, était l'objet des rivalités les plus ardentes. Les deux compétiteurs se disputaient et s'arrogeaient en même temps le titre de comtes de Châteauroux ; aux contestations, aux réclamations avaient succédé les procès ; et l'issue de la lutte était incertaine, lorsque, en 1612 et 1613, le prince Henri de Bourbon-Condé obtint des deux maisons l'abandon de leurs prétentions respectives contre une somme de 435 000 livres, équivalant à près de deux millions de notre monnaie.
Cet avènement d'un prince de sang royal à la suzeraineté du Berry eut pour le pays les conséquences les plus fâcheuses : la Fronde, cette dernière révolte de la féodalité expirante, s'organisait ; Condé, par sa nouvelle position, eut le crédit d'entraîner dans cette cause, perdue d'avance, une partie de la noblesse de la province, et y attira toutes les calamités de la guerre civile. Un seigneur de Vatan, plus obstiné que les autres, se retira dans son château, s'y fortifia et ne voulut plus reconnaître l'autorité du roi ; il paya de sa tête son intempestive et téméraire rébellion.
Le pays avait souffert ; quelques nobles d'un rang secondaire avaient été punis ; Condé, l'instigateur principal de la révolte, en fut quitte pour quelques années de disgrâce et de prison ; ce qui toutefois n'empêcha pas, en 1616, l'érection de la terre de Châteauroux en duché-pairie, comme entrée dans la possession d'un prince du sang, et cela malgré les protestations d'Issoudun, qui voyait soustraire ainsi à la juridiction de son bailliage un grand nombre de sièges de justices inférieures. Châteauroux eut alors dans son ressort, outre les nombreux fiefs démembrés des bailliages d'Issoudun, de Montmorillon, même de Blois, les villes de La Châtre, Lignières, Levroux, Buzançais, Mézières-en-Brenne, Le Blanc, Argenton, Aigurande ; et on n'appelait des sentences du bailli de Châteauroux qu'au parlement de Paris.
Depuis la Fronde jusqu'à la Révolution de 1789, le bas Berry ne fut le théâtre d'aucun événement qui mérite une mention particulière ; le duché de Châteauroux resta dans la maison de Condé jusqu'en 1735, époque à laquelle Louis XV en fit acquisition au prix de 2 700 000 livres, pour l'offrir à sa belle maîtresse, Anne de Mailly-Nesle, marquise de La Tournelle, qui prit dès lors et a gardé dans l'histoire le nom de duchesse de Châteauroux. Cette dame étant morte quelque temps après avoir pris possession du royal présent, la terre retourna à la couronne et constitua plus tard une partie de l'apanage d'un des frères de Louis XVI, le comte d'Artois, qui depuis fut le roi Charles X.
Sous l'ancienne monarchie, le bas Berry dépendait de la généralité de Bourges pour les finances et l'administration ; il formait quatre élections ; celles de Châteauroux, La Châtre, Le Blanc et Issoudun ; l'organisation actuelle a conservé ces divisions ; elle a seulement emprunté pour la formation du département de l'Indre quelques communes qui appartenaient à l'ancienne province de la Marche, telles que Saint-Benoît, Belâbre et quelques villages du même canton. Pour les affaires militaires, le bas Berry faisait partie du gouvernement du Berry ; nous avons vu que, pour la justice, Châteauroux avait hérité d'une grande part dans l'ancienne clientèle d'Issoudun ; ce qui était resté attribué aux bailliages d'Issoudun et de Bourges allait en appel, comme les sentences de Châteauroux, au parlement de Paris.
La Révolution française ne rencontra dans le bas Berry aucune opposition sérieuse ; les habitants subirent sans murmurer toutes ses conséquences, même les longues guerres de l'Empire, et, en 1815, nous voyons fraternellement accueillis sur les bords de l'Indre ces héroïques débris de nos vieilles phalanges républicaines et impériales qu'ailleurs il était de mode alors d'insulter et d'appeler les brigands de la Loire.
Le Berry est au XIXe siècle plus connu que l'Écosse après les romans de Walter Scott ; qui n'a suivi l'auteur de Mauprat et du Champi dans ses ravissantes explorations ? Quelle est la cime qui reste à franchir ? quel est le ravin que nous n'ayons pas traversé, le ruisseau au bord duquel nous ne nous soyons pas assis ? Êtres vivants ou objets inanimés, grâces pittoresques du costume, pensées intimes du coeur, quel coin du tableau est resté sans relief et sans lumière sous le pinceau du maître ? Que reste-t-il à décrire quand George Sand a raconté ?
Les departements et leur histoire -L'Ille et Vilaine - 35 -
Le chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine a été autrefois la capitale de la Bretagne. Nous allons, à son occasion, tracer une rapide esquisse de l'histoire de cette province ; ce sera évidemment faire en même temps l'histoire du département.
La Bretagne jouit d'une grande renommée. C'est un pays qui attire l'attention, qui impose, qui saisit par le caractère original du sol et des habitants, par sa destinée singulière. Presqu'île poussée au milieu de l'Atlantique par les dernières ramifications des montagnes européennes ; éloignée de tous les foyers de la civilisation antique ; noyée au milieu des brumes de l'Océan aussi bien que cette Cornouailles d'Angleterre, sa soeur, qui lui envoya tant de fois des habitants ; sol de granit qui ne soutient le choc éternel des flots de l'Océan, à son extrémité, que par un indestructible entassement de rochers ; fertile seulement sur ses bords, tout autour, le long de la mer, tandis que le milieu , traversé dans sa longueur par la double chaîne des montagnes Noires et des monts d'Arrée, l'échine de la Bretagne, comme les appellent les paysans bretons, ne renferme guère que ces landes couvertes de genêts et d'ajoncs, qui sont, dans la province, aux terres cultivées comme 27 est à 100. Un moine comparait la Bretagne à la couronne de sa tonsure.
Une population celtique l'occupait avant l'invasion romaine. Elle l'avait nommée, dans sa langue, Armorique, c'est-à-dire pays de la mer. Elle se divisait elle-même en plusieurs peuplades ou cités : Curiosolites, dans le pays où s'élève Dinan ; Diablintes, sur le territoire d'Aleth et Dol, avec une portion de la Normandie ; Rhedones, au confluent de l'Ille et de la Vilaine ; Namnètes, sur la Loire, là où est Nantes ; Lexobiens, dans le pays qu'on appelait Dumnonie (Tréguier et Saint-Brieuc) ; Osismiens, dans le Finistère, où ils avaient fondé Kemper et Léon ; Vénètes, enfin, dans le Morbihan, la cité la plus puissante.
Les cités armoricaines, suivant l'usage celtique, se divisaient en tribus, semblables aux clans d'Écosse, et en familles, dont les chefs étaient comme autant de petits souverains. C'étaient les mactierns et les tierns, dont les dignités subsistèrent jusqu'au XIe siècle. Une assemblée et un tribunal, composé des principaux membres de la tribu , décidaient les affaires et les causes importantes. Dans les circonstances difficiles, seulement, les cités armoricaines, comme les peuples de la Grande-Bretagne, élisaient un penteyrn ou brenhin.
L'Armorique avait une grande importance dans le monde celtique. Elle était pour la Gaule le sanctuaire sombre et redouté du druidisme, dont les monuments mystérieux et étranges couvrent son sol encore aujourd'hui. Des relations fréquentes la rattachaient à la Grande-Bretagne, métropole, en quelque sorte, du druidisme.
César ne soumit pas sans difficulté l'Armorique. Elle fournit 36 000 combattants à l'armée de 266 000 hommes que la Gaule opposa au conquérant. Elle parut d'abord se soumettre dès la simple apparition du lieutenant Crassus. Mais, l'hiver suivant, tandis que César était en Italie , les cités armoricaines se coalisèrent, refusèrent les vivres sur lesquels comptaient les légions et se révoltèrent. César accourut et triompha par son génie , malgré les efforts des Vénètes, réfugiés sur leurs énormes vaisseaux.
Les Romains occupèrent fortement l'Armorique, en établissant des garnisons à Léon, à Kemper, à Carhaix, et même dans les solitudes des monts d'Arrée. Ils la firent entrer dans la IIIe Lyonnaise, et ne cessèrent point de lutter contre l'esprit d'indépendance des habitants, surtout contre la religion druidique, qui était l'âme de la résistance.
Jamais ils n'en purent triompher complètement, et aussitôt que l'ébranlement de leur empire offrit à l'Armorique quelque espoir de reconquérir cette indépendance, elle le saisit. Dès l'année 284, elle reçoit dans son sein une émigration venue de la Bretagne ; une autre en 364 ; une troisième en 383, lorsque Maxime se fit proclamer empereur dans la Grande-Bretagne. Maxime nomma gouverneur de l'Armorique un de ses lieutenants, Mériadec, qui prit part à ses victoires, et qui, après sa chute, attira sur le continent les Bretons qui avaient servi la cause malheureuse de l'usurpateur.
Théodose, pour se concilier les chefs de l'Armorique , confirma la distribution de terres faites par lui aux Bretons fugitifs, qui furent appelés Bretons Lètes : et ce nom a été transporté à la Bretagne par certains auteurs, qui l'ont surnommée pays de Létanie. L'invasion barbare du commencement du Ve siècle servit de signal à l'Armorique et à la Bretagne pour se révolter de concert, vers 409, et pour reprendre leur ancienne organisation, ce que Zosime exprime par ces mots : « S'érigèrent en république. » Un peu plus tard, en 418, les Bretons, incapables de défendre seuls cette indépendance reconquise, et forcés de fuir devant les incursions des Pictes et des Scots, émigrèrent chez les Armoricains. Ceux-ci accueillirent avec bienveillance cette invasion amie, et c'est de ce moment que leur pays prit le nom de Bretagne, tandis que l'île qui l'avait porté jusque-là reçut bientôt après celui d'Angleterre, d'une des populations nouvelles, les Angles, qui s'y établirent.
L'empire romain n'avait pu déraciner la religion druidique ; quand il tomba, des collèges de druides existaient encore en Bretagne. Mais là, comme partout ailleurs, il avait servi d'introducteur au christianisme, qui allait triompher de ce qui avait résisté aux efforts du polythéisme romain.
Dès la fin du IIIe siècle après J.-C., saint Clair prêchait en Armorique. L'Évangile trouvait alors plus d'obstacles chez les magistrats romains que chez les druides ; la chute de l'empire, au lieu d'arrêter ses progrès, ne fit donc que les aider dans la Bretagne. Des collèges druidiques devinrent des couvents, et des archidruides devinrent des évêques. L'Église, au reste, avait l'habileté de faire les plus larges concessions à l'opiniâtreté religieuse des peuples conquis, et ce ne fut que longtemps après qu'elle se montra sévère contre les superstitions introduites par eux dans son dogme ou dans ses pratiques au VIIe siècle ; le concile de Nantes ordonna de briser les pierres et d'arracher les arbres autour desquels les paysans se rassemblaient encore dans un but d'idolâtrie.
Délivrée de l'empire romain, l'Armorique, que nous appellerons désormais Bretagne, eut à se défendre contre les barbares : Alains, Wisigoths, Francs, l'attaquèrent tour à tour ; tantôt elle fut envahie, tantôt elle repoussa les agresseurs et les poursuivit jusque sur leur territoire. Les principaux défenseurs du pays sortirent de la Cornouailles , sans que cette partie de la Bretagne établit pourtant sa supériorité sur les autres. La péninsule était une sorte d'Heptarchie formée des pays d'Aleth, de Tréguier, de Goëllo, de Léon, de Cornouailles , de Vannes.
Le grand choc de l'invasion barbare avait porté aussi bien sur les Bretons de l'île que sur ceux de la péninsule. Ceux qui n'avaient pas émigré auparavant, devant les attaques des Pictes et des Scots, émigrèrent cette fois devant les Saxons, après avoir longtemps résisté. Le héros de cette résistance nationale fut Arthur, que la tradition fait sortir de son île et voyager dans la Bretagne continentale ; Arthur toujours attendu par les Bretons et si célèbre au moyen âge avec la Table ronde.
L'est de la Bretagne fut seul soumis par les Francs. Clotaire Ier occupait Rennes, Nantes, Aleth, et imposait sa suzeraineté même au comte de Léon. Chilpéric, son successeur, recevait un tribut du comte de Vannes. La diversion produite par les guerres de la Neustrie et de l'Austrasie délivra la Bretagne, et Charlemagne eut à la reconquérir. Ce n'est que par trois expéditions, dont la dernière surtout fut considérable, qu'il y réussit ; conquête fort imparfaite, puisqu'il n'inscrivit pas la Bretagne dans son dernier testament.
A peine fut-il mort, que les Bretons proclamèrent de nouveau leur indépendance, et tentèrent de se donner de l'unité en nommant roi un de leurs mactierns, Jarnithin. Jarnithin n'eut point de successeur immédiat, quoiqu'il eût deux fils, ce qui prouve le peu de consistance de cette royauté non héréditaire. Morvan, comte de Léon et de Cornouailles, qui fut élu roi en 818, est resté populaire à cause de sa lutte contre Louis le Débonnaire. Il tomba sous la francisque, comme dit le poète chroniqueur de l'époque, et les Francs pénétrèrent dans les épaisses forêts de la Bretagne.
Nouvelle révolte sous Wiomarch, successeur de Morvan, et comblé en vain des présents de l'empereur. Enfin Louis le Débonnaire donna le gouvernement de la Bretagne à Noménoë, qu'il avait précédemment nommé comte de Vannes, et ce Noménoë servit avec plus d'habileté que les Bretons eux-mêmes la cause de l'indépendance bretonne, en faisant de sa vie deux parts : tant que vécut Louis le Débonnaire, il lui resta fidèle et ne se servit de l'autorité qu'il avait reçue que pour donner force et unité au pays par une bonne administration ; puis, Louis mort, il se considéra comme dégagé du serment qu'il lui avait prêté, et, prenant le titre de roi, il affranchit de la domination de Charles le Chauve la Bretagne devenue redoutable.
Le petit-fils de Charlemagne, battu sur les bords de la Vilaine, se retira (845). Ses successeurs ne furent pas sans faire de nouvelles tentatives : elles n'eurent point de succès, et, ce qu'ils purent faire de mieux, ce fut de ramener indirectement la Bretagne sous leur dépendance. Charles le Simple, en effet, donna la suzeraineté des terres bretonnes à Rollon, devenu son vassal comme duc de Normandie, en 912. Les patriotes bretons ne veulent point, il est vrai, que ce mot terres bretonnes désigne, dans le traité de Saint-Clair-sur-Epte, la Bretagne, mais seulement le pays d'Avranches, de Coutances, et quelques districts des comtés de Rennes et de Nantes, conquis par les rois francs.
Cette opinion, appuyée sur de graves autorités, est très probable. Mais ce qui est aussi très certain, c'est que cette extension du mot terres bretonnes à toute la Bretagne eut lieu de fort bonne heure, puisque les rois d'Angleterre et les rois de France se considérèrent successivement comme suzerains de la Bretagne, par l'intermédiaire du duché de Normandie.
Arrière-fief de la France, la Bretagne le devint de l'Angleterre après la conquête de ce pays par les Normands, et le redevint de la France après la conquête de la Normandie par Philippe-Auguste. L'hommage que prêtaient les ducs de Bretagne n'était point lige, comme le fit si bien entendre le duc François II à Louis XI : « Monseigneur, tel hommage que mes prédécesseurs vous ont fait, je vous le fais, mais ne l'entends et ne vous le fais point lige. »
Les descendants de Noménoë régnèrent jusqu'en 874. Le dernier fut Salomon III. Ils avaient été sans cesse inquiétés par les Normands, contre lesquels plusieurs d'entre eux avaient lutté avec énergie.
Alain Barbe-Torte, héritier, par les femmes, des souverains précédents, donna naissance à une dynastie nouvelle. Constance, fille de Conan IV, porta ensuite le duché aux Plantagenets, par son mariage avec Geoffroy, troisième fils de Henri II (1164) ; puis, les Plantagenets s'étant éteints en Bretagne avec Arthur, que son oncle Jean sans Terre fit périr, l'héritière Alix épousa Pierre de Dreux, petit-fils de Louis le Gros par une branche cadette (1212), et de Pierre de Dreux sortit la dynastie qui eut pour derniers représentants les derniers souverains de Bretagne, François II et Anne , qui épousa Charles VIII.
Dans cet intervalle prit place la rivalité de Charles de Blois et de Jean de Montfort, épisode considérable de la guerre de Cent ans. Ce sanglant débat, qui livra longtemps la Bretagne à l'influence anglaise, eut pour cause une question de succession en ligne collatérale. Jeanne de Penthièvre avait des droits supérieurs à ceux de Monfort ; mais celui-ci prétendait la précéder en sa qualité de mâle, en quoi il méconnaissait le caractère féodal du duché de Bretagne, où les femmes ont toujours succédé.
La plupart des grands seigneurs féodaux ont réussi, au moyen âge, aussi bien que les rois, à réduire leurs vassaux. Les ducs de Bretagne commencèrent leur tâche de très bonne heure et y travaillèrent avec beaucoup d'énergie et d'habileté. Main Barbe-Torte et ses successeurs agrandirent le domaine ducal des comtés de Rennes, de Nantes, de Cornouailles, de Léon, de Vannes ; Pierre de Dreux entra en lutte ouverte avec le clergé et la noblesse de Bretagne et remporta une victoire signalée.
L'autorité des ducs fut depuis ce temps presque absolue, réserve faite toutefois de la large part d'indépendance revendiquée et retenue sans cesse par les illustres familles bretonnes. Contre celles-ci, les ducs s'appuyèrent quelquefois sur la bourgeoisie : Conan III affranchit plusieurs communes.
Cependant, si l'on excepte Morlaix et Saint-Malo, les municipalités bretonnes eurent rarement le caractère démocratique et révolutionnaire des communes du nord-est de la France. Le tiers état fut admis dans l'assemblée des états de la province, à peu près dans le même temps qu'en France dans l'assemblée des états généraux ; ce qui montre avec quel ensemble ce progrès s'accomplissait dans toutes les parties de notre pays. C'est à l'assemblée de Ploërmel, en 1309, que parurent pour la première fois les députés du tiers état breton.
Les législateurs de la Bretagne sont Hoël le Grand , à qui remonte le droit coutumier de la province, Jean II et Jean III, qui fit réunir toutes les coutumes du pays avec des emprunts aux Établissements de saint Louis. Divers pays avaient, en outre, leurs usances particulières.
L'éloignement de ce département du coeur du pays l'a préservé des commotions violentes qui ont agité la France en 1870-.1871. Toutefois, ses enfants n'ont pas été les derniers à verser leur sang pour la patrie en danger, et les mobiles d'Ille-et-Vilaine ont glorieusement pris part aux combats livrés, sous les murs de Paris, contre l'ennemi commun.
Les departements et leur histoire - L'Hérault - 34 -
Le territoire du département de l'Hérault était occupé avant la conquête romaine par les Volces Tectosages. Nous n'y trouvons aujourd'hui que peu de monuments de cette époque ; ils se bornent à quelques tombeaux celtiques découverts sur la colline de Regagnach, et à quelques dolmens, que les habitants appellent Oustals de las fadas (maisons des fées), dans l'arrondissement de Lodève, à Saint-Maurice.
Les Massaliotes eurent assurément des établissements sur cette partie du littoral méditerranéen de la Gaule. L'étymologie grecque du nom d'Agde en fait foi. Après la conquête romaine, le territoire de l'Hérault fut enveloppé dans la Narbonnaise, plus tard dans la première Narbonnaise. Il était compris approximativement dans la circonscription des deux antiques cités de Béziers (Civitas Beterrensium) et de Lodève (Civitas Lutevencium). Ce département n'a pas, dans l'époque romaine, une aussi belle part que ses voisins les départements du Gard et de l'Aude ; il ne peut s'enorgueillir, comme le second, d'avoir possédé la capitale de la province, Narbonne, où, comme le premier, d'avoir conservé de magnifiques monuments romains. Montpellier n'existait pas ; Substantion, Forum Domitii, Forum Neronis, qui n'existent plus, n'étaient que des villes du second ou du troisième ordre.
Les traces de la domination romaine sont nombreuses toutefois, si elles ne sont pas aussi imposantes que dans le Gard. On retrouve fréquemment des tronçons de la voie Domitienne (via Domitia), qui traversait le pays parallèlement à la côte. A Saint-Thibéry, on voit les traces d'un camp romain, situé, au sommet d'un cirque de basalte, et les ruines d'un pont du même temps ; ailleurs, des débris de bassins destinés à contenir les eaux (à Cette), des thermes en ruine, des colonnes milliaires, des tombeaux, des statuettes, des inscriptions, des médailles, des vases, des ustensiles de toutes sortes. La colline abrupte où s'élevait Substantion, sur le bord du Lez, est particulièrement renommée pour la grande quantité de médailles d'or et d'argent qu'on trouve ; c'est à ce point qu'il s'est formé une légende digne des Mille et une Nuits qu'un poète languedocien a racontée dans une petite pièce intitulée lou Trésor de Sustantioün.
La Narbonnaise fut cédée par Honorius aux Wisigoths, qui lui donnèrent le nom de Septimanie. Au VIIIe siècle, les Sarrasins l'envahirent. Les Carlovingiens enveloppèrent tout le midi de la Gaule dans leur vaste puissance. Aucune des villes du département ne joua un grand rôle dans ces diverses révolutions. C'est encore Narbonne et Nîmes, à l'ouest et à l'est, qui sont le théâtre des grands événements. C'est seulement après la chute des Carlovingiens, et avec le système féodal, que le pays qu'arrosent l'Orb, l'Hérault, la Vidourle, sortit de son obscurité et reçut de la fortune comme un magnifique dédommagement. Alors, en effet, Montpellier, Béziers devinrent les capitales de deux des principales puissances féodales du Midi et les points les plus brillants du littoral languedocien.
La seigneurie de Montpellier prit naissance vers 990. Un certain Guilhem ou Guillaume, vassal du comte de Melgueil, obtint de l'évêque de Maguelonne, moyennant hommage et redevance, le bourg de Montpellier avec son territoire. Il est le père de l'illustre famille des Guilhem, qui, plus tard, prit rang parmi les premières maisons du Languedoc. Huit princes de ce nom se transmirent successivement, de 990 à 1180, la seigneurie de Montpellier.
Nous les voyons s'allier aux rois d'Aragon et Guilhem VIII épouser même Eudoxie, fille de l'empereur d'Orient Manuel Comnène. Ils durent surtout leur puissance à la sagesse de leur conduite vis-à-vis de la papauté. En effet, lors de la guerre des Albigeois, quoique Guilhem VIII partageât l'aversion de tout le midi de la France pour les hommes du Nord, il eut la sagesse de contenir sa haine et de, ne tremper en rien dans l'hérésie.
Seul fidèle à l'Église au milieu de tant de seigneurs qui s'armaient contre elle, il n'en eut que plus de titres à sa reconnaissance. En 1195, l'adroit Guilhem, qui venait de répudier Eudoxie pour épouser Agnès de Castille, demandait à Célestin III, en même temps que la sanction de son divorce, l'envoi d'un légat qui résiderait à Montpellier et s'opposerait aux progrès de l'hérésie. Innocent III, qui succéda alors à Célestin, lui envoya le frère Reynier, porteur des plus flatteuses paroles.
Voilà comment les seigneurs de Montpellier demeurèrent debout, et plus puissants que jamais, au milieu de la tempête qui désola le Languedoc. Guilhem VIII était traité de prince par le célèbre docteur Main, de Lille, qui lui dédiait un de ses écrits (Prologus ad principem Montispessulani). Ses domaines étaient considérables, surtout depuis qu'il avait réuni toute la seigneurie de Montpellier en rachetant la part des vicaires. Il possédait en toute propriété les châteaux de Lattes, de Montferrier, d'Aumelas, de Pouget, de Popian, de Cournonsec, de Montbazin, de Paulhan, de Montarnaud, de Saint-Pons, de Mauchiens, de Pignan, de Frontignan, de Saint-Georges, de Murviel, de Vendémian et de Mirival. En outre, de nombreux vassaux lui devaient l'hommage féodal et le service mille taire ; tout cela étayé par une orthodoxie habilement calculée. On ne s'étonnera plus de voir les Guilhem s'intituler seigneurs par la grâce de Dieu, et prétendre rattacher leur généalogie à Charlemagne lui-même.
Guilhem VIII mourut après avoir rempli son testament de fondations pieuses (1203) ; mais, quoiqu'il n'eût pu faire légitimer son second mariage, il n'en persistait pas moins dans ses desseins favorables aux enfants d'Agnès, dont l'aîné lui succéda sous le nom de Guilhem IX.
La malheureuse Marie, fille de sa première femme Eudoxie, ne venait, dans l'ordre de succession tel qu'il le régla, qu'après les six fils de sa belle-mère. Celle-ci, pour se débarrasser d'elle, la maria d'abord au seigneur Barrai, vicomte de Marseille, puis, ce premier époux étant mort, au comte de Comminges, Bernard IV, lequel avait déjà deux femmes encore vivantes et devait bientôt en prendre une quatrième, après avoir répudié à son tour la pauvre Marie. La marâtre eut soin d'obliger sa belle-fille à insérer dans ses deux contrats de mariage des clauses de renonciation fondées sur la « coutume incontestable et consacrée (indubitata et inveterata consuetudo) » en vertu de laquelle la souveraineté et juridiction de la seigneurie de Montpellier et de ses dépendances « ne doit jamais passer aux personnes du sexe féminin tant qu'il reste des mâles. »
Donc, dans cette seigneurie, le principe de la loi salique avait été suivi jusque-là. Toutes les précautions d'Agnès furent déjouées. Un an n'était pas écoulé, depuis la mort de Guilhem VIII, que les habitants de Montpellier chassaient son fils, rappelaient Marie et lui donnaient pour époux un seigneur bien capable de défendre ses droits ; cet époux était le roi d'Aragon lui-même, Pierre II, qui, par cette alliance, comptait recouvrer Tortose et établir solidement son influence sur tout le littoral occidental de la Méditerranée.
On peut remarquer que, si le comte de Commisses avait alors quatre femmes vivantes, Marie, de son côté, eut alors deux maris bien portants ; on ne songea même pas qu'elle était déjà mariée. Elle plaisait fort à Pierre comme héritière, mais peu comme femme. Quoiqu'il eût juré sur les saints Évangiles de ne jamais prendre d'autre femme qu'elle, il trouvait cependant qu'elle n'était « ni si bien faite que lui ni d'un âge proportionné au sien » et il n'en eut point d'enfants. Une jeune veuve de la suite de Marie attira ses regards, mais refusa de satisfaire ses désirs.
Or c'était une Montpelliéraine pleine de sentiments patriotiques, et qui désirait vivement, comme tous ses compatriotes, le rapprochement de Pierre et de son épouse. Par le conseil des consuls, elle parut céder et promit au roi de se laisser conduire dans sa chambre, mais dans le mystère d'une complète obscurité. Pierre consentit et crut posséder l'objet de son amour ; mais au matin quand les douze consuls, qui avaient passé la nuit en prières dans la pièce voisine, entrèrent cierges en main, il s'aperçut qu'il tenait sa femme dans ses bras. Il eut l'esprit de rire de la mystification ; mais les prières des consuls ne furent pas exaucées et Marie se trouva encore stérile.
Une autre tentative fut plus heureuse. La reine était au château de Mirival, où elle se plaisait fort ; le roi était au château de Lattes, où il visitait ses haras. Un jour qu'il était animé parla chasse et en belle humeur : « Seigneur, lui dit un gentilhomme de sa suite, parmi les plaisirs de la chasse nous pourrions bien passer à Mirival et voir la reine, notre bonne maîtresse. Votre Majesté passerait une seconde nuit avec elle ; nous veillerions, le cierge en main, si vous vouliez, et Dieu par sa bonté vous donnerait un fils de bénédiction. » La distance fut bientôt franchie, et neuf mois après naquit le petit Jacte, qui devint plus tard ce grand Jayme Ier, Conquistador, tant de fois vainqueur des infidèles.
On dit que, le lendemain de cette nuit féconde, le roi Pierre prit joyeusement sa femme en croupe et rentra ainsi dans Montpellier au milieu de l'ivresse de la population, qui inventa sur-le-champ, à cette occasion, la charmante danse allégorique du chevalet (lou chivalet). Ce succès, ne produisit pas un rapprochement de longue durée entre Pierre et sa femme ; il demanda à la cour de Rome l'annulation de son mariage. Il alléguait le mariage antérieur de Marie avec le comte de Comminges, et Marie tenait ce mariage pour nul à cause des deux alliances précédentes du même comte. Elle se rendit elle-même à Rome et y mourut empoisonnée ; ainsi finit sa triste existence. Peu de temps après, Pierre II alla se faire tuer à la bataille de Muret (1213).
Les Montpelliérains regrettèrent peu Pierre II, qui avait été achever sa vie dans le camp des hérétiques ; mais ils entourèrent de leur amour le roi Jacques, le fils de leur chère Marie, qu'ils avaient eux-mêmes baptisé. Ce baptême avait été singulier : douze cierges pareils, portant les noms des douze apôtres, furent allumés en même temps, celui qui s'éteignit le dernier portait le nom de l'apôtre Jacques.
C'est sous le roi Jacques que le roi de France, maître du reste du Languedoc, s'immisça dans les affaires de la seigneurie de Montpellier. L'évêque de Maguelonne fut amené par l'habile Gui Folencis, agent de la reine Blanche de Castille, à reconnaître que la ville de Montpellier et ses dépendances avaient toujours appartenu au roi de France, et, en 1255, il prêta serment de fidélité comme feudataire de la couronne ; de sorte que le roi d'Aragon, vassal de l'évêque de Maguelonne pour Montpellier, se trouva lui-même indirectement soumis à la suzeraineté du roi de France.
Jayme II, second fils de Jayme I°r, lui succéda comme roi de Majorque et seigneur de Montpellier. Plus faible que son père, puisqu'il n'avait que la moitié de ses États, et, d'ailleurs, en rivalité avec son frère, Pierre III, Jayme II n'était pas en état de défendre contre les rois de France sa seigneurie de Montpellier, déjà resserrée entre les sénéchaux de Beaucaire et de Carcassonne, qui s'en disputaient les appels.
Moyennant une rente annuelle de cinq cents livres melgoriennes, Bérenger de Fredol, évêque de Maguelonne, qui avait à se plaindre du roi de Majorque, transféra à Philippe le Bel (1293) tous ses droits temporels sur le fief de Montpelliéret, la seigneurie de Montpellier et la châtellenie de Lattes. Le sénéchal de Beaucaire, Alphonse de Rouvroi, prit possession du Montpelliéret au nom du roi. Le dernier seigneur de Montpellier de la dynastie aragonaise fut Jayme III, pauvre prince qui se vit, d'une part, enlever Majorque et le Roussillon par le roi d'Aragon, son beau-frère, et, d'autre part, fut obligé de vendre Montpellier au roi de France.
C'est le 18 avril 1349 que le contrat de vente fut signé. La famille de Jacte resta encore en possession de certains domaines sous le titre de baronnie de Montpellier, auxquels elle ne renonça que sous Charles VI, par une transaction spéciale avec ce prince et Isabelle de Montferrat. Les peuples n'eurent pas à se féliciter de leur passage sous la domination de la couronne de France ; mais désormais c'est à l'histoire générale du Languedoc qu'appartient le récit des exactions des ducs d'Anjou et de Berry sous les rois Charles V et Charles VI et toute la suite.
Si la seigneurie de Montpellier comprenait, au Moyen Age, la plus grande partie du territoire qui forme aujourd'hui le département de l'Hérault, c'est-à-dire à peu près tout le pays situé entre l'Hérault et la Vidourle, ce territoire, pourtant, renfermait encore plusieurs autres fiefs importants : la vicomté de Béziers, celle. de Lodève, le comté de Melgueil, etc.
Parlons d'abord, en deux mots, du comté de Melgueil, à cause des rapports de suzeraineté qui l'unissaient aux premiers seigneurs de Montpellier. Il fut soumis, en 1085, à la suzeraineté du saint-siège, qui délégua d'abord les évêques de Maguelonne pour y surveiller ses intérêts, et qui, sous Innocent III, l'inféoda à ces mêmes évêques moyennant une redevance annuelle.
Le comté de Béziers fut établi par Pépin le Bref, qui le donna à Ansemond. En 845, sous Charles le Chauve, le titre de comté fut chassé en celui de vicomté. Bientôt les simples gouvernements se transformant partout en fiefs héréditaires, le vicomte Raynard transmit la vicomté de Béziers à sa fille Adélaïs. Celle-ci, en épousant Boson, vicomte d'Adge (897), réunit les deux fiefs dans une même main. D'abord soumis à la suzeraineté des ducs de Septimanie et des marquis de Gothie, les vicomtes de Béziers passèrent ensuite sous celle des comtes de Toulouse.
A plusieurs reprises, l'extinction des mâles laissa cette vicomté à des héritières qui la portèrent d'abord au comte de Carcassonne, et plus tard (1067) au vicomte d'Albi et de Nîmes, Raymond-Bernard. Au siècle suivant, elle fut de nouveau isolée en faveur de Raymond-Trencavel, qui prit part à la seconde croisade. Trencavel s'empara de Carcassonne, mais cette conquête fut pour lui une source de malheurs ; elle le mit en guerre d'abord avec le comte de Barcelone, dont il fut obligé de reconnaître la suzeraineté, puis avec le comte de Toulouse, qui le fit prisonnier et auquel il fut contraint de transporter son hommage.
Il périt assassiné par ses sujets de Béziers, et son fils, Roger II, ne rentra dans cette ville qu'avec l'appui du roi d'Aragon. Cette alliance valut à Roger, comme à son père, l'hostilité du comte de Toulouse, Raymond V, auquel il céda et dont il épousa la fille ; elle lui apportait en dot le comté de Rasez, les châteaux de Bolognier et de Confolens et le pays de Limoux.
Un mariage non moins avantageux avec Agnès de Montpellier valut à son fils Raymond-Roger-Trencavel les châteaux de Tourbes et de Pézenas. C'est ce jeune et courageux Raymond-Trencavel qui osa, après la soumission du comte de Toulouse en 1209, tenir tête à lui seul à la croisade catholique contre les Albigeois, ce qui attira sur la ville de Béziers une effroyable catastrophe. Obligé de se réfugier à Carcassonne, il y fut pris. Raymond-Trencavel II, son fils, rentra dans ses domaines en 1224, mais dut se retirer devant Louis VIII.
Enfin, en 1240, le dernier vicomte de Béziers fit une nouvelle tentative armée ; mais, assiégé à Montréal et forcé de capituler, il abandonna à Louis IX tous ses droits moyennant six cents livres de rente. La vicomté de Béziers devint une viguerie royale comprise dans la sénéchaussée de Carcassonne.
Le pays de Lodève ou Lodévois était un comté dès le IXe siècle. Il fut compris, au Xe siècle, dans le marquisat de Gothie sous le titre de vicomté. En 949, on voit deux vicomtes de Lodève, appelés princes du peuple, Eudes et Hildin, jouissant « d'une partie du domaine du Lodévois » sous la suzeraineté du comte de Toulouse. Au milieu du XIe siècle, Nobilie, héritière de la vicomté de Lodève, épousa le vicomte de Carlad ; leur fille Adèle, héritière à son tour, faute de mâles, épousa le vicomte de Millau, Bérenger II, dont le fils aîné, Richard, réunit aux vicomtés de Lodève et de Carlad le comté de Rodez.
Ces réunions de domaines pouvaient faire du Lodévois un fief puissant ; mais les évêques de Lodève ruinèrent son avenir en se faisant céder successivement, par les comtes de Rodez, les comtes de Toulouse et les vicomtes de Béziers tout ce qu'ils possédaient dans leur diocèse. En 1191 donc, l'évêque Raymond-Guillaume était seul seigneur temporel du Lodévois et comptait parmi ses vassaux de riches barons. Après la soumission du Languedoc à la couronne royale, le Lodévois fit partie de la viguerie de Gignac, dans la sénéchaussée de Carcassonne.