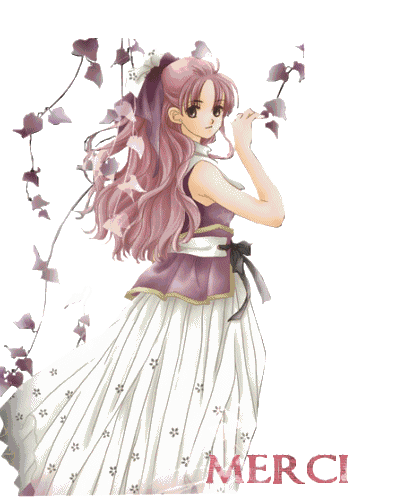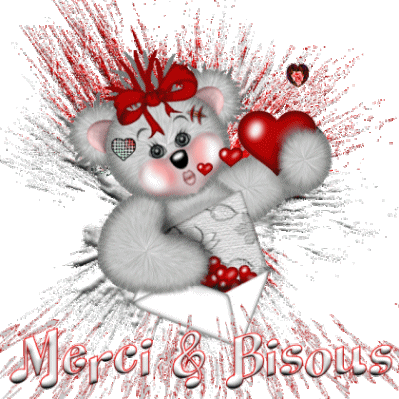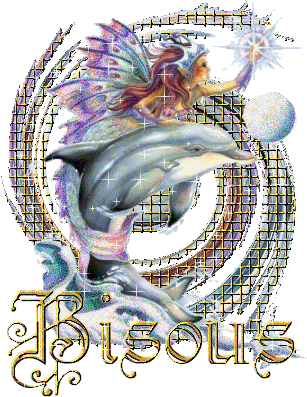animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
- · le symbolisme dans le roman la rose des vents
- · passage obligé minarik
- · les bienfaits et les mefaits des invertebres
- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman
- · valerie maurice est elle mariee
- · les bienfaits des invertebres
- · turfvoyance@yahoo.fr
- · gouran tchad
- · bamwisho muhiya jean
- · royauxnorvegiens
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Animaux - Serpent - Histoire et évolution -
Les lépidosauriens forment l’immense majorité des reptiles actuels (9 espèces sur 10). Les plus connus sont les lézards et les serpents ; le plus rare est le sphénodon.
Apparu il y a environ 150 millions d’années, le serpent doit sa réussite à ses formidables capacités d'adaptation.
La peau du Serpent

Un boomslang
Les serpents sont majoritairement carnivores ou insectivores et sont plutôt timides, surtout vis-à-vis de l’homme.
Le serpent: Une évolution surprenante
- Les anapsides qui ont donné les tortues
- Les synapsides qui ont donné naissance aux véritables mammifères
- Les diapsides qui comprennent d'une part, les lépidosauriens (lézards, serpents et le sphénodon); et, d'autre part, les archosauriens (crocodiles et oiseaux)
Ce tout nouveau mode de locomotion leur a permis d’occuper une nouvelle niche écologique.
On ignore ce qui a poussé l’évolution à favoriser la locomotion par reptation.

Vipère de Péringuey (Bitis peringueyi)
Certains chercheurs ont avancé l’hypothèse que les premiers serpents étaient peut être souterrains ou marins.
On constate d’ailleurs que les fossiles les plus anciens ont été découverts dans des gisements marins ou côtiers.
De multiples adaptations
On les trouve également dans les cimes des arbres. Certains serpents arboricoles peuvent planer sur une dizaine de mètres.

Mamba vert, un serpent arboricole.
Au fil de l’évolution, leur mâchoire s’est modifiée. C’est ce cinétisme inter crânien qui permet à certaines espèces d’avaler des proies bien plus grosses qu’elles.
Danger : Venin
Une seule morsure suffirait à tuer une demi-douzaine de personnes.

Cobra au crépuscule.
Leurs ancêtres en avaient et ce n'est donc pas pour mieux nager, puisqu'ils sont apparus sur la terre ferme.
La théorie avancée veut que leurs pattes aient peu à peu disparues parce que cela leur donnait la possibilité de mieux se faufiler dans de petites failles pour attraper leurs proies...
Du nouveau sur la reptation des serpents
Archéologie - La cité D'our -
En 1927-1928, dans les ruines de l’ancienne capitale d’Our, des archéologues anglais retrouvent seize tombes royales des dignitaires de la Ier dynastie d’Our (entre 2600 et 2400 avant notre ère).
Au IIIe millénaire, la Mésopotamie est morcelée en une trentaine de cités-Etats. Our est l’une d’entre elles.
La fondation de la cité est évoquée dans la Bible. Our serait la patrie d’origine d’Abraham.
Le site d’Our (Tell el-Mukayyar actuel) s’élevait sur une pleine sablonneuse près de l’Euphrate.
Sur ce site, la plus extraordinaire découverte est celle des tombes royales qui sont remplies d’un véritable trésor. Ces sépultures nous donnent également de nombreuses précisions sur les rites funéraires de la Mésopotamie ancienne.
La cité d’Our
Au début du IIIe millénaire (époque protodynastique), la Mésopotamie méridionale, où prédomine la culture sumérienne, est constellée de cités-Etats.
Chaque cité est gouvernée par un souverain et protégée par une divinité. Les dynasties royales se disputent l’hégémonie de la région.
150 ans plus tard, cet empire s’effondre et c’est Our, sous l’égide des grands rois de la troisième dynastie qui domine à son tour « le Pays entre les deux fleuves » c’est-à-dire la Mésopotamie.

Image Danielle Kellogg
Sous le règne d’Our-Nammou, la ville couvrait une superficie de plus de 60 ha et protégeait une population d’environ 24 000 personnes.
Vie quotidienne à Our
L’éclairage se faisait uniquement par les portes.

Table de jeu retrouvée dans une tombe royale d'Our (Vers 2450 avant notre ère. Musée de Birmingham).Image Kevin Saff
- Une femme adultérine est mise à mort
- Un mari peut prendre une seconde femme et lui faire des enfants
- Si un homme marié ne veut plus de sa femme, il lui suffit de verser de l’argent
- Si une femme mariée veut changer de mari, elle est mise à mort
Ils apprenaient également les mathématiques et la grammaire. Un « chargé du fouet » faisait régner la discipline.
Apparemment, le fouet était largement employé si on en juge par un récit sur tablette écrit par un écolier sumérien.
De ces écoles austères sortaient les futurs scribes, sur lesquels reposait tout le système administratif et religieux.
Les filles ne bénéficiaient d’aucune scolarité.
Mais, assez paradoxalement, l’esclave dispose d’un statut : il a le droit de monter une affaire, de posséder des biens, de racheter sa liberté ou de se marier avec une femme libre.
La grande cour du dieu Nanna (ou Nanna-Sin) était destinée à accueillir les offrandes.
Le contenu de ces chambres funéraires est incroyable.

Casque-perruque en alliage naturel d'or et d'argent. Ce casque était porté par les rois lors des batailles. (Vers 2450 avant notre ère. Musée de Bagdad). Image Woodiefish
Celle de la reine Puabi, qui vécut aux environs de 2500 avant notre ère, abritait un char de bois décoré d’une mosaïque de pierres de couleur et de nacre blanche.
On y a également retrouvé une harpe ouvragée avec une tête de taureau. La tête est faite de feuilles d’or et la toison est ciselée dans du lapis-lazuli.
Le taureau symbolisait la force et la fécondité.

Harpe ouvragée. (British Museum). Image Kevin Saff

"Etendard 'Our" (vers 2600 avant notre ère. British Museum). Image Seriykotik 1970
Il s’agit d’une mosaïque composée de coquille marine, de lapis-lazuli et de cornaline, incrustée sur une boite de 45 cm de long.
Ce diptyque composé de deux panneaux représente sur une face la guerre et sur l’autre la paix.

"Etendard 'Our" (vers 2600 avant notre ère. British Museum). Image Seriykotik 1970
Les rois sont entourés de chars avec les ânes, les bœufs et les cochers. La « grande fosse de la mort » renferme 74 victimes : 6 soldats en armes, et 68 femmes dont 4 musiciennes.
Une partie de cette tribu, sous la conduite d’Abram, descendit vers Canaan, où le patriarche, après son alliance avec Yahvé, prit le nom d’Abraham, le « père des nations. »
En 1500 avant notre, période présumée du passage d’Abraham à Our, les habitants n’étaient plus des nomades depuis longtemps.
Il y a bien effectivement la preuve d’inondations. Mais s’agit-il du Déluge ?
Bonjour à tous...
La rose de novembre
Il n’est plus belle fleur qu’une rose d’automne,
Quand elle sait déjà que ses jours sont comptés,
Et que près de sa fin, généreuse, elle donne
Encor plus de parfum qu’aux beaux jours de l’été.
Dans le brouillard léger d’une aube de novembre,
Quand les oiseaux frileux ne savent plus chanter,
Elle va défroisser sa robe d’or et d’ambre
Pour s’offrir aux regards dans toute sa beauté.
Mais un souffle de vent la blesse, la défeuille.
Sitôt qu’il a séché ses larmes de rosée,
Elle cache ses joues dans son écrin de feuilles,
Pour vivre encor un peu, encor une journée.
Ô toi qui ne sais pas combien est éphémère,
La rose qui s’endort, et va vers son trépas,
Si tu passes près d’elle au jardin de ta mère,
Je t’en supplie, enfant, non ! Ne la cueille pas !
Laisse la retenir la vie qui l’abandonne.
Suivre des vols d’oiseaux glissant dans le ciel clair.
Il n’est plus belle fleur qu’une rose d’automne,
Qui se meurt doucement, aux premiers jours d’hiver.
Renée-Jeanne Mignard
Bonjour à tous...
L'Allégorie de la grenouille
Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir.
"Quelle peine ! Elles n'y arriveront jamais !"
"Quelle peine ! Elles n'y arriveront jamais !"
L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander
comment elle avait fait pour terminer l'épreuve.
Et découvrit qu'elle était ... sourde !
car elles volent les meilleurs espoirs de votre coeur.
Belle citation... Merci Toinette...
Cadeau d'amitié... Merci Nat...
Magnifiques roses... Merci Krystal...
Parcs et Jardins - Les Jardins du Manoir d'Eyrignac -
Les jardins du Manoir d'Eyrignac se situent au cœur du Périgord, près de la commune de Sarlat. Tracés au XVIIIe siècle, ils ont obtenu le label Jardin Remarquable, décerné par le Ministère de la Culture, en 2004.
Le jardin s'étend sur quatre hectares sur lesquelles 4 essences principales se dispersent : le buis, le charme, le cyprès et l'if. Il est structuré autour de six parties principales : le jardin à la française, la roseraie, l'Allée des Charmes, l'Allée des Vases, le Manoir et les Miroirs. L'art topiaire, art consacré à la taille des arbres à finalité décorative, se découvre au fil de la promenade. Les jardins d'Eyrignac en font une démonstration puissante et mêlent fantaisie et rigueur.

Géométrique, rigoureux et harmonieux, les jardins ont évolué au fil du temps et des modes : jardins à la française inspirés des villas italiennes, puis jardin à l'anglaise. Aujourd'hui, les diverses influences se reconnaissent et se complètent harmonieusement. C'était le souhait de Gilles Sermadiras, et son fils Patrick Sermadiras, l'actuel propriétaire du domaine, perpétue cet art.

Les jardins du Manoir d'Eyrignac se situent au cœur du Périgord, près de la commune de Sarlat. Tracés au XVIIIe siècle, ils ont obtenu le label Jardin Remarquable, décerné par le Ministère de la Culture, en 2004.

L'Allée des Charmes date de 1966. Créée par Gilles Sermadiras de Pouzols de Lile, elle assemble sur 100 mètres de long une double enfilade de colonnes d'ifs, enlacés par des charmes taillés en spirales.

Le Manoir est une construction érigée au XVIIe siècle. Classé Monument Historique, il appartient à la même famille depuis 500 ans.

Les jardins sont composés pour l'essentiel de quatre essences principales : cyprès, ifs, buis et charmes déclinent un camaïeu de verts des plus étonnants

Pour conférer à l'allée une symétrie parfaite, les guirlandes de charmes sont inversées depuis le centre de l'allée. Ainsi, quelque soit la perspective d'où elles sont admirées, elles offrent les mêmes structures géométriques.

C'est l'Allée des Charmes qui réclame le plus d'effort au niveau de la taille. Une guirlande est en effet composée de douze pieds de charmes. Cette plante, qui pousse très rapidement, doit être taillée au moins quatre fois par an.

Devant le manoir, le jardin français expose ses arabesques formées de buis nains. Ces jardins ont été conçus pour donner à la vue du premier étage de la demeure une vue agréable et originale.

La roseraie complète le jardin à la française. Toute en symétrie, elle est révélée discrètement par l'alliance du vert et du blanc. Cinq bassins animés de mouvement d'eau lui confèrent une grande fraîcheur.

Au bout de l'Allée des Vases, les vases italiens sont surmontés d'ifs taillés en plateau et couronnés de boules rondes.

L'Allée des Vases est discrète et sombre. Bornée par une haie d'ifs, de forme triangulaire, carrée ou en demi-lune, elle tient son nom de la série de vases italiens en terre cuite qui la ponctuent.

Quatre variétés de roses blanches composent la roseraie : Opalia, Fée des neiges, Albéric Barbier et Iceberg.

Le jardin à la française a été conçu un siècle après le manoir. A l'image d'un tableau, ils ont été créés pour inviter à la contemplation.

Le Jardin Blanc, autre nom de la roseraie, évoque à la perfection le calme et l'harmonie qui caractérise ce lieu.

L'art topiaire est l'art consacré à la taille des arbres à finalité décorative. Les jardins d'Eyrignac en font une démonstration puissante et mêlent fantaisie et rigueur.

Le Manoir n'est pas en reste. Cette construction typique du Haut Moyen Age est un vrai trésor de famille, que 22 générations ont entretenu depuis la construction du premier castel ou repaire noble.

Le jardin à la française est prolongé par cette allée de buis qui mène paisiblement à la roseraie.

Les jardins d'Eyrignac ont évolué au fil du temps et des modes : jardins à la française inspirés des villas italiennes, puis jardin à l'anglaise. Aujourd'hui, les diverses influences se reconnaissent et se complètent harmonieusement.

Les jardins d'Eyrignac ont été honorés de nombreuses fois de prix et de labels prestigieux. Il s'agit également du seul jardin parmi les 21 sites touristiques ouverts au public à faire partie du club des "3 étoiles au Guide Vert Michelin".

L'impression générale dégagée par les Jardins du Manoir d'Eyrignac est celle de structures géométriques et de jeux de perspectives à ciel ouvert.
Archéologie - La Tour de Babel -
Cependant, ce récit n’est pas qu’une simple légende. En effet, Babylone et la tour de Babel ont bien existé.
Si l’on s’en réfère à tous les récits relatifs à la tour de Babel, toutes les races et les langues auraient surgi en ce lieu unique.
Quelle est l’origine de toutes les langues ? Ont-elles surgies de nulle part comme par magie ou par hasard ?
Bien qu’il n’existe aucun consensus de la communauté scientifique sur ces différentes questions, certaines découvertes archéologiques tendent à démontrer que Babylone et sa célèbre tour ont joué un rôle primordial dans l’histoire de l’humanité.
Le récit biblique de la tour de Babel
La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent : » Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la Terre ! »
En punition de leur vanité, les hommes perdent la possibilité de se comprendre et sont dispersés.
C’est donc là que se trouverait l’origine de la diversité des langues.
Elle est faite de plates-formes superposées de dimensions décroissantes. Chaque ziggourat est dédiée à un dieu local. Elle est surmontée d’un temple qui sert de lieu de passage à ce dieu lors de ses voyages sur Terre.
Il est difficile d’y voir un simple hasard.
Cette tour s’appelle Etemenanki « la demeure du ciel et de la terre ». Elle a très certainement servi de modèle à la tour biblique.
La guerre d’Irak a stoppé ce projet colossal.

La porte d'Ishtar a été reconstruite au musée Pergamon de Berlin. Image Rictor Norton et David Allen
Babylone « La Porte du dieu » était le centre du culte du dieu Mardouk. Les vestiges de la cité, encore visibles, datent du roi Nabuchodonosor II (604-562 avant notre ère), qui avait entreprit une vaste reconstruction.

Enceinte extérieure longue d'environ 18 km (à l'origine) qui protégeait Babylone
Le récit de la bible est conforme aux découvertes archéologiques. La tour de Babel a bien été édifiée en briques cuites, solidarisées par du bitume.
Cette tour avait été érigée bien avant le règne de Nabuchodonosor II. Elle reposait sur une base carrée et mesurait 91 mètres de haut.
Elle dominait la cité de ses sept étages couronnés par un temple dédié au dieu Mardouk.

Guerriers qui décorent la porte d'Ishtar. Image Rictor Norton et David Allen
Les preuves archéologiques et les textes suggèrent que la plupart des ziggourats étaient peintes dans des teintes magnifiques, et abondamment décorées de tuiles émaillées et de sculptures dorées.

Porte d'Ishtar. Image Rictor Norton et David Allen
Une inscription babylonienne affirme que la ziggourat d’Etemenanki était en « briques cuites émaillées d’un bleu resplendissant ».
Grandeur et décadence de la tour de Babylone
Les fouilles ont permis de reconstituer sa splendeur.
Mardouk était devenu le dieu principal de la Mésopotamie.
Les chercheurs ont daté la langue indo-européenne, la plus connue, à environ 3 000 ans avant notre ère.
Cela se situe donc à peu près au moment des évènements de Babel. Après, c’est le flou le plus complet.
Cette langue originale aurait donc été parlée il y a plusieurs millénaires, à une époque où l’écriture n’était pas née.
Une inscription de Nabuchodonosor en atteste : "Tous les peuples de nations nombreuses (…) je (les) contraignis au travail. "
Cette diversité ethnique n’a pas empêché l’achèvement de la tour.
C’est peut-être là l’origine du mythe que nous a transmis la Bible.
Bonjour à tous...
Fragilité
Le monde est une fleur fragile,
Cinq continents en ses pétales,
Un cœur à l’essence subtile,
Quelques pigments pour capitales.
La tige a sa simple racine
Pour ancrage au cœur de la Vie,
Mais bien souvent, elle s’incline
Face au vent qui la crucifie
Ce vent de toutes les colères
Qui saccage sur son passage
Le grand jardin et ses mystères,
L’homme et son cœur, en son ravage
Car cette fleur d’humanité
Porte en elle meilleur et pire,
Mille fléaux, ou la bonté
Selon qu’elle inspire ou expire
Ainsi va la Vie de la fleur,
Entre la nuit et la lumière. .
Ainsi, va ce monde qui meurt
Entre la folie, la prière
Il suffirait de presque rien
Pour le pire, un jour, éviter. .
Si chacun devenait gardien
De l’Amour et de la Beauté
Ces temps là ne sont point encore
Et il faudra mille et un jours
Avant de voir poindre l’Aurore. .
La fleur vivra t-elle toujours ?
(auteur inconnu)