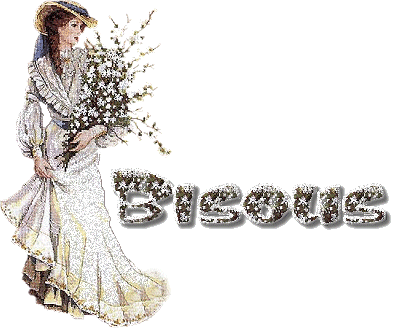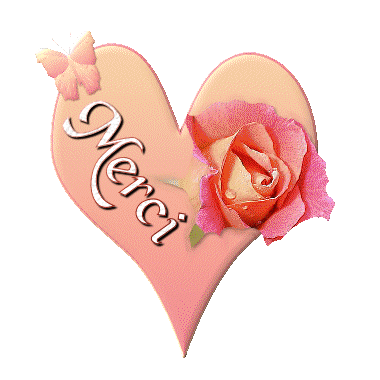animaux années 50 antiquité aquariophilie eau douce arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
- · le symbolisme dans le roman la rose des vents
- · passage obligé minarik
- · les bienfaits et les mefaits des invertebres
- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman
- · valerie maurice est elle mariee
- · les bienfaits des invertebres
- · turfvoyance@yahoo.fr
- · gouran tchad
- · bamwisho muhiya jean
- · royauxnorvegiens
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Voyage - l'Inde du Nord - 1 -
Du désert du Thar dans le Rajasthan, jusqu'aux cimes de l'Himalaya en passant par les temples d'Agrâ, de Jaïpur ou les palais d'Udaïpur, le nord de l'Inde se distingue par le faste de ses monuments et la variété de ses paysages. Partout, la vie semble battre à son maximum, dans les rues des villes où cohabitent le trafic dense des voitures et les milliers de piétons ; dans les célébrations sacrées et religieuses où se mêlent l'exaltation musicale, l'éclat des couleurs et l'intensité des rituels mais aussi dans les campagnes éloignées, dans les villages des hauteurs et dans les temples hindouistes anciens où résonnent encore le pas des maharadjahs et des brahames. L'Inde du nord, c'est aussi l'extrême pauvreté qui se mêle au luxe et aux apparats, c'est la complexité des castes où les "impurs" ne sont pas forcément les plus pauvres. Partir en Inde, c'est découvrir un pays où le problème ne la modernité ne se pose pas, elle s'entrelace tout simplement (sans mélange) avec les traditions ancestrales.

Si le sud de l'Inde se caractérise par ses paysages naturels denses et colorés, les états du nord incarnent l'Inde historique et sacrée, celle des maharadjas, des temples et du Taj Mahal, du Gange, des rites hindouistes et des villes embouteillées. Mais c'est aussi l'Himalaya, ses monastères bouddhistes ainsi que les étendues arides du désert du Thar.

La ville d'Agra, dans l'état de l'Uttar Pradesh, affiche un patrimoine d'une richesse extrême, la plupart des trésors de l'Inde y sont situés. Ici, le Fort Rouge.

Arches de marbre
Agrâ fut la capitale de l'Empire moghol à la fin du XVIe siècle, c'est à cette époque qu'elle acquiert sa grandeur avec la construction du Lâl Qila (le Fort Rouge), du Taj Mahal et sa petite copie rebaptisée "Baby Taj".

Une jeune indienne et une danseuse traditionnelle.

L'histoire de la construction du Taj Mahal a traversé les siècles, la plupart des personnes qui se rendent à Agra viennent uniquement pour voir ce monument.

Le Taj Mahal
C'est le sultan moghol Shah Jehan qui fit construire cette sépulture à l'image de l'amour qu'il portait à sa femme Mumtaz Mahal. Le souverain fit assassiner la femme de l'architecte perse chargé de l'édification du monument afin qu'il puisse ressentir la grandeur de sa peine.

Les gravures et les incrustations de pierres précieuses sur la façade de marbre blanc confèrent au Taj Mahal un charme et une magie qui justifient pleinement la réputation du monument.

Détails des murs du Fort Rouge.

Ici, une offrande faite au Gange, fleuve sacré pour tous les hindous qui s'immergent dans ses eaux afin de se purifier.

La ville de Varanasi (ou Bénarès) située plus au sud dans l'Uttar Pradesh, est l'une des 7 villes saintes de l'hindouisme. Elle est bordée par le Gange, les pèlerins peuvent y accéder grâce aux ghats, des escaliers qui mènent au fleuve. Les rituels et les crémations y sont pratiqués.

Les sentiers d'un pélerinage à Varanasi.

La ville d'Orcha, non loin de Jhansi à la frontière de l'Uttar Pradesh et de l'état du Madhya Pradesh accueille également de nombreux temples et palais datant du XVIe siècle.

Le Ladakh est situé à l'extrême nord de l'Etat Jammu-et-Cachemire. A l'origine état bouddhiste indépendant, il fut, au terme de plusieurs invasions, annexé à l'Inde. Il est parfois surnommé "le petit Tibet".

Cette région comprend une partie de l'Himalaya.

Ici, les fameux drapeaux de prières. La couleur de l'étoffe représente un élément naturel : la couleur bleu est utilisée pour symboliser l'espace, le jaune pour la terre, le rouge pour le feu, le blanc pour l'eau, et enfin le vert pour l'air et le vent.

Un peu plus au sud, se trouve le petit village de Manali, devenu en peu de temps une station de ski branchée. Ici, les plaines environnantes.

Parés de brocarts de toutes les couleurs, les "moines volants" sautent et tournoient sur eux-mêmes dans une danse irradiante et spirituelle.

Recueillement à Leh, capitale du Ladakh.
Bonjour à tous...
"Déclaration des droits de l'homme et de la femme à l'Existence :
Tout vivant, sans distinction d'âge, de sexe, de race, de nationalité, de religion, A LE DROIT :
- de penser ce qu'il pense
- d'imaginer ce qu'il imagine
- de rêver ce qu'il rêve
- d'espérer ce qu'il espère
- d'éprouver ce qu'il éprouve
- de ressentir ce qu'il ressent
- de désirer ce qu'il désire
- de rencontrer qui il rencontre
- de se dire avec ses mots à lui
- et de cheminer sur son chemin au rythme qui est le sien.
En conséquence, tout vivant, est en droit d'être reconnu, respecté et confirmé dans ce qu'il pense, imagine, rêve, espère, éprouve, ressent, désire, sur son chemin et à son rythme."
Jacques Salomé
Inventions et découvertes - La Monnaie -
La monnaie est une étape clé dans l’histoire économique du monde. On peut d’ailleurs s’étonner que l’invention de la monnaie soit si tardive.
La tradition, relayée par les principaux historiens grecs (Hérodote ou Xénophane), nous dit que les Lydiens, peuple d’Asie Mineure occidentale, seraient les premiers à utiliser la monnaie.
Avant la monnaie, les peuples marchands utilisaient le troc pour effectuer leurs échanges commerciaux.
Tout au long de l’Antiquité, en Egypte, en Mésopotamie, en Phénicie ou dans l’Indus, le régime des échanges reste celui du troc.
Les premiers moyens d’échange
En attestent divers contrats d’ordre privé ou le témoignage écrit des grecs et des hébreux.
Les fresques peintes sur les tombeaux égyptiens sont de véritables livres ouverts.
On échangeait du blé contre des liqueurs ou des dattes contre des poutres de bois.

Tétradrachme (pièce de quatre drachmes) à l'effigie d'Alexandre le Grand. Bibliothèque nationale de Paris.
- Il n’est pas périssable
- Il est moins volumineux
- Il est facilement divisible
Rapidement, la balance devient un instrument indispensable à la réalisation de toutes les transactions.
La monnaie pesée est la monnaie la plus archaïque.
La nécessité de garantir la teneur et le poids de ces métaux amènent les particuliers à estampiller les lingots.

Monnaie siculopunique, frappée par les Carthaginois en Sicile. Cette pièce représente un palmier avec des régimes de dattes. IVe siècle avant notre ère). Bibliothèque nationale de Paris.

"Double", monnaie d'or frappée à Babylone. L'archer est peut-être le roi Darios III (IVe siècle avant notre ère). Bibliothèque nationale de Paris.
Cette monnaie est appelée « la monnaie frappée », c’est-à-dire la monnaie garantie par une autorité politique ou religieuse qui lui attribue une valeur fixe.
La première monnaie connue

Le dieu Janus sur la plus ancienne monnaie romaine (Musée national Rome). Image Sebastia Giralt
Des archéologues ont découvert des pièces de monnaie dans les fondations du temple d’Artémis à Ephèse, construit vers 645 avant notre ère. Ce sont des pièces d’électrum frappées de têtes de lion, l’emblème royal de la capitale de la Lydie, Sardes (Turquie actuelle.)
La première monnaie remonterait donc au VIIe siècle avant notre ère. Cette découverte confirme les propos d’Hérodote qui précise qu’il s’agit d’une monnaie d’or et d’argent.
En effet, l’électrum est un alliage d’or et d’argent.

Monnaie Lydienne de l'époque de Crésus frappée avec une tête de lion et de taureau (VIe siècle avant notre ère). Bibliothèque nationale de Paris.
On suppose qu’il a voulu ainsi remédier à l’inconvénient de l’électrum qui contient une quantité variable d’or.
Corinthe suit à partir de 610 puis Athènes vers 594.

Monnaie frappée en l'honneur de la déesse Athéna. (Ve siècle avant notre ère). Image g-foucault
Chaque cité adopte un type caractéristique : chouette pour Athènes, figure d’Aréthuse ou superbe quadrige pour Syracuse, etc. La technique de frappe est cependant sommaire.
Il existe de nombreuses monnaies dans la Grèce antique : Darique, Drachme, Obole etc...

Monnaie d'Athènes avec la chouette d'Athéna, déesse de la cité (VIe siècle avant notre ère). Image g-foucault
Les premières monnaies romaines sont en bronze : sesterce, dupondius, semi, quadrans.L’argent métal apparaît dans le système monétaire romain avec le « denier » en 211 avant notre ère.

Sesterce frappé à l'effigie de l'empereur Trajan. Image Sebastia Giralt .
A l’époque de Jules César, l’aureus fait son apparition. C’est une monnaie d’or qui vaut 25 deniers.
Les monnaies sont frappées à l’effigie des empereurs ou commémorent leurs victoires.

Pièce en bronze de l'époque de Vespasien. Elle célèbre la prise de Jérusalem par les Romains en 70 après notre ère (Musée d'Israël, Jérusalem)
En Gaule, la monnaie fait son apparition au VIe siècle avant notre ère par l'intermédiaire d'une colonie grecque établie à Marseille.
Chaque peuple gaulois fabriquait sa propre monnaie en assez petite quantité. Les styles de monnaies sont très variés.

Vercingétorix. Statère d'or arverne. Ier siècle avant notre ère. Bibliothèque nationale de Paris.
Parmi les monnaies gauloises les plus connues, on trouve le statère d'or fabriqué par les Arvernes (peuple du Massif central qui a légué son nom à l’Auvergne) grâce à leurs mines d’or.
Les Parisii, le peuple de Lutèce (actuelle île de la Cité, ancêtre de Paris) employait l’or pour frapper sa monnaie.

Avers d'une pièce de monnaie en or des Parisii (IIe siècle avant notre ère). Musée de Brno, Tchécoslovaquie. Image Pragus .
Chaque cité frappe sa monnaie ce qui explique cette grande disparité sur cet immense continent qui n’est pas encore unifié.
On pouvait ainsi relier avec une cordelette plusieurs pièces pour les transporter.

Pièce de monnaie indo-grecque en argent. Les Indiens ont appris des Grecs à frapper les monnaies avec des symboles (Epoque hellénistique). Musée de Kaboul. Image Pragus
Cette science est riche d’enseignements sur l’histoire, l’histoire des religions et des mœurs et, naturellement, sur la connaissance des échanges et de l’économie à toutes les époques.
Bonjour à tous...
Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés, le matin, à la table des anges.
(Khalil Gibran)
Cadeau d'amitié... Merci Toinette...
Animaux - Félins - Le Tigre - Présentation -
Sur les huit sous-espèces de tigres, seules cinq sous-espèces survivent encore aujourd’hui dont le tigre de Sibérie et le tigre du Bengale. La légende du tigre « mangeur d’hommes » a été colportée par des chasseurs. En fait, sur 1000 tigres, seuls trois auraient attaqué des hommes. Quant au tigre blanc, ce n'est pas une espèce à part entière mais une variété du tigre du Bengale
Evolution du Tigre
La diversification de cette famille a abouti aux différentes espèces actuelles dont le tigre.
Il faut remonter au Pléistocène (1,73 Ma -10 000 ans) pour retrouver les premiers félins tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Les tigres aux dents de sabre comme le Smilodon n’ont aucun lien de parenté avec nos tigres actuels et se sont éteints sans laisser de descendance.

Impressionnantes canines d'un smilodon. Image Brendan Adkins
Le tigre du Pléistocène était bien adapté au froid. Cependant, l’extension des glaciers poussèrent certains tigres à migrer vers le sud.
Ils arrivèrent en Inde, en Asie Mineure, sur les îles de Sumatra, de Bali et de Java.
Les tigres s’adaptèrent à leurs environnements respectifs et évoluèrent vers des sous-espèces distinctes.
Les sous espèces de tigres

Tigre de Sibérie
Tigredu Bengale ou tigre royal( Panthera tigris tigris): Egalement baptisé « Tigre royal du Bengale», sa survie est très menacée par la surpopulation en Inde. C'est la sous-espèce la plus répandue. Il est un peu plus petit que le tigre de Sibérie avec un poids maximum de 300 Kg.

Tigre du Bengale
Tigre de Sumatra(Panthera tigris sumatrae): C’est l’un des plus petits tigres. Le mâle pèse de 100 à 140 kg et la femelle de 75 à 110 kg. Il mesure en moyenne 1,40 à 2,50 m . Il se distingue aussi par son pelage fauve orangé très coloré.Il ne resterait en 2007 qu'environ 400 individus en liberté d'après la WWF.

Tigre de Sumatra. Image Brian Scott
Tigre d’Indochine(Panthera tigris corbetti): Il n’en reste que quelques centaines dans le sud est asiatique. C'est le plus petit et les rayures de son pelage sont plus fines. Autrefois, on le trouvait en abondance dans le sud de la Chine, au Vietnam, au Cambodge ou en Thaïlande. Le mâle pèse jusqu'à 190 kg environ et la femelle 140 kg.

Tigre d'Indochine
Les scientifiques pensent que le tigre d'Indochine est à l'origine des sous-espèces du tigre de Java, de Sumatra et de Bali.
Le Tigre : un solitaire ?
Le territoire d’un mâle interfère avec celui de plusieurs femelles.

Pourtant, le tigre accepte parfaitement le passage d’un autre mâle sur son domaine. Les combats entre mâles sont rares et jamais mortels. On a même observé quatre tigres qui chassaient ensemble. Ce prédateur serait donc plus sociable qu’on ne le pensait.

Tigre de Sibérie. Image Tambako the Jaguar
Un tigre revient régulièrement sur les frontières de son territoire pour y laisser sa marque. Il asperge buissons et rochers d'urine, laboure l'écorce des arbres et gratte le sol.
Une morphologie de prédateur

Tigre à l'affût
Le tigre peut parcourir 20 km par jour en quête de nourriture. Il a besoin de tuer un ongulé tous les 3 à 5 jours.

Les robustes pattes sont munies de griffes rétractiles de 7 à 8 cm en moyenne. Grâce à elles, il peut agripper sa proie, transpercer les peaux les plus dures et immobiliser l’animal avant de lui porter la morsure fatale.

Pattes d'un tigre blanc. Image Tambako the Jaguar

Après une gestation de 104 à 106 jours, la femelle met au monde 2 à 3 petits qui ne pèsent pas plus d'un kilo. Les premières semaines, la tigresse n'accepte personne, y compris le père. Les petits tètent pendant environ 6 mois.

Bébé tigre
Bonjour à tous...
De même que la valeur de la vie n'est pas en sa surface mais dans ses profondeurs,
les choses vues ne sont pas dans leur écorce mais dans leur noyau,
et les hommes ne sont pas dans leur visage mais dans leur coeur.
Khalil Gibran
Cadeau d'Amitié... Merci Laure...
Monuments - Wat Phra That Doï Suthep -
La Thaïlande est réputée pour ses nombreux temples. Wat Phra That Doï Suthep est un temple bouddhiste situé à une quinzaine de kilomètres de Chiang Maï.
Le temple trône à 1 000 m d’altitude sur le Doï Suthep.
Régulièrement, des fêtes bouddhiques sont célébrées dans le Wat Phra That Doï Suthep qui renferme plusieurs Bouddhas.
Structure classique d’un temple thaï

Wat Phra That Doi Suthep. image Michael Brandon
L’accès au temple peut s’effectuer soit par chemin de fer à crémaillère, soit en montant le vaste escalier qui comporte 306 marches.

Escalier de Wat Phra That Doi Suthep. Image Alcguy
Une statue de Thorani, déesse de la Terre, monte la garde au bas des marches. Ces dernières sont ornées d’une rampe somptueuse en forme de naga, qui symbolise la quête de l’illumination par l’homme.

Rampe en forme de naga de Wat Phra That Doi Suthep. Image Vtveen

Vue panoramique sur Chiang Maï. image Adrian Whelan
De nombreuses statues démoniaques défendent l’accès au temple. Il est impératif de retirer les chaussures avant de pénétrer dans le temple.

Wat Phra That Doi Suthep. Image Vtveen
Le chedi, tour-reliquaire, est haut de 20 m. Il est entouré de quatre parasols de filigrane doré ajoutés au 18e siècle par le roi Kawila.
A l’origine le chedi était différent. Il a été restauré et remanié dans le style du Lan Na en 1478. Par la suite, on lui a rajouté sa flèche dans le style birman.

Chedi de Wat Phra That Doi Suthep. Image Cindy Andrie
Le wihan (vihara) est le lieu de culte des laïcs et des moines. Il renferme des représentations du Bouddha.
Le wihan de ce temple comporte des portes richement décorées et sculptées.

Wat Phra That Doi Suthep. Image Cindy Andrie
Les Bouddhas en bronze sont de différentes périodes. Bouddhisme et hindouisme sont mélangés et vous pourrez observer une statue du Dieu indou Ganesh.

Bouddha de Wat Phra That Doi Suthep. Image Cindy Andrie
Bonjour à tous...
Rappelle toi
un rien aussi fait plaisir...
Que tu peux être semeur
d'optimisme, de courage, de confiance...
Que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres...
que tu peux, en tout temps, dire un mot aimable...
Que ton sourire non seulement t'enjolive,
mais qu'il embellit l'existence de ceux qui t'approchent...
Que tu as des mains pour donner
et un coeur pour pardonner...