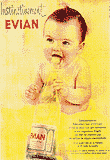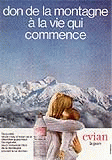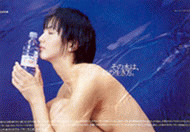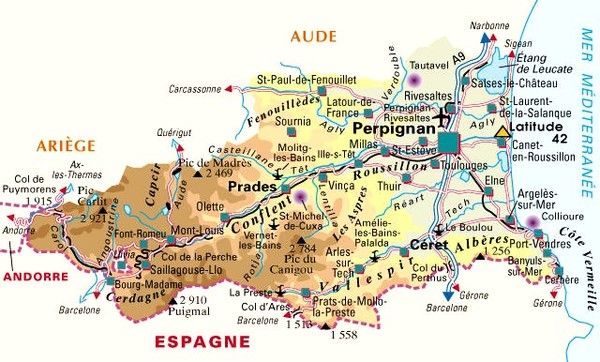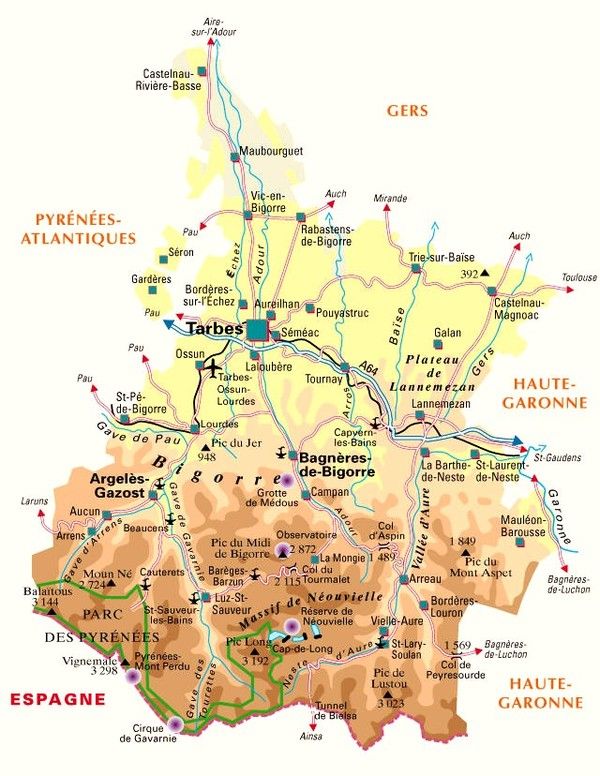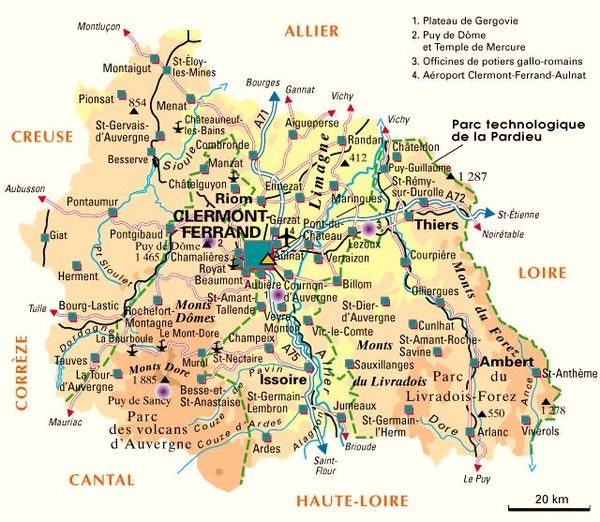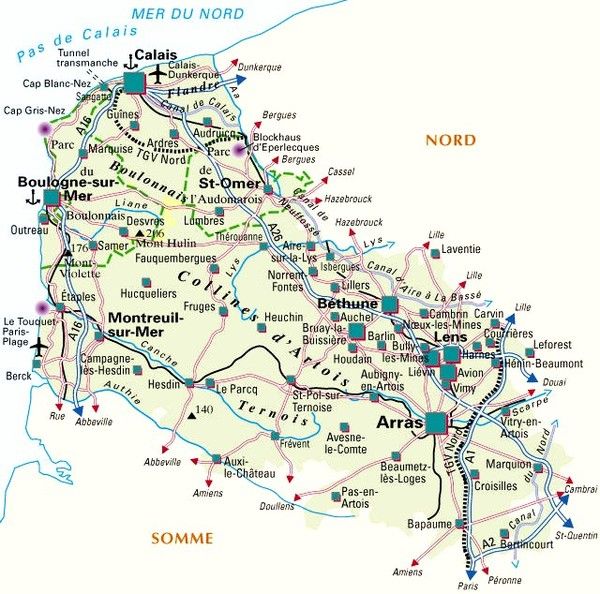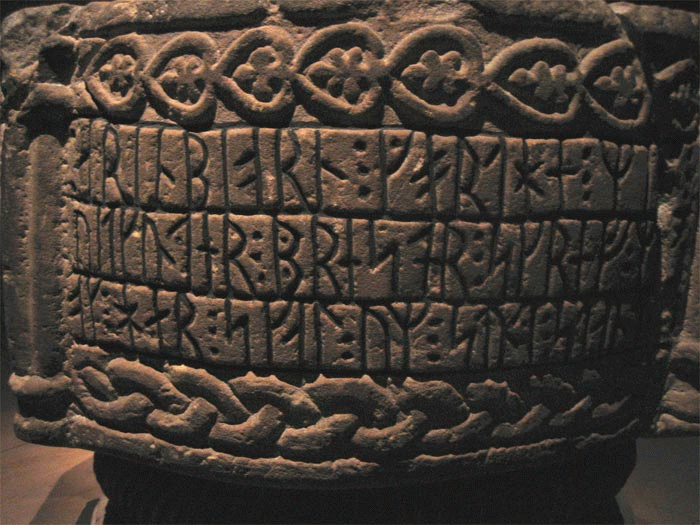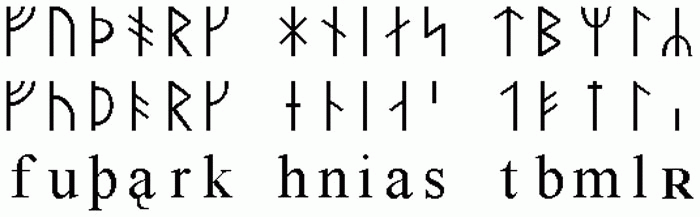animaux années 50 antiquité aquariophilie eau douce arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
- · le symbolisme dans le roman la rose des vents
- · passage obligé minarik
- · les bienfaits et les mefaits des invertebres
- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman
- · valerie maurice est elle mariee
- · les bienfaits des invertebres
- · turfvoyance@yahoo.fr
- · gouran tchad
- · bamwisho muhiya jean
- · royauxnorvegiens
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
La saga des marques - Garnier -
Autant de marques, certaines patrimoniales, d'autres plus récentes qui, placées sous l'ombrelle Garnier, témoignent de sa triple expertise dans le domaine du capillaire, de la peau et de la coloration (cf encadré). Avec, comme règle d'or depuis ses origines : l'alliance de la nature et de la technologie. Et, comme objectif, à l'orée du XXIe siècle : devenir, avec L'Oréal Paris et Maybeline,une de trois marques mondiales de la division Produits Publics de L'Oréal.
Déposée au tribunal de Blois, le 2 juin 1904, la lotion Garnier, à base de plantes, fortifie les cheveux, favorise la mise en plis et se révèle efficace contre les pellicules et les cheveux gras.
À l'époque où les gens se lavaient les cheveux au savon, cette lotion crée une innovation qualifiée aujourd'hui de "rupture" par la nature du produit, sa fonction et la création du marché des produits capillaires. Son entreprise est encore artisanale quand Alfred Garnier cède, en 1909, son magasin à un coiffeur prénommé Gobert.
Des communiqués fleurissent dans la presse, comme Le Petit Parisien, pour informer les lecteurs, futurs consommateurs, des vertus de la lotion grâce à des recommandations médicales et des conseils de coiffeurs,premiers clients de la marque. Si les mannequins ne prêtent pas encore leur nom et leur visage, du moins certaines personnalités des arts et du spectacle s'adonnent à la réclame. Ainsi, Gabrielle Robine, sociétaire de la Comédie-Française affirme que "la lotion Garnier est une bonne et vieille recette française, elle est supérieure à toutes les autres." Dirigée depuis 1929 par Bernard Guilpin, chimiste et Gaston Roussel, médecin et fondateur de la société Uclaf, les Laboratoires Garnier proposent d'autres spécialités constituant ainsi la première gamme Garnier.
Commercialisée dans les pharmacies et les grands magasins, la lotion Garnier se fait l'écho de l'émancipation des femmes comme l'atteste cette réclame la recommandant "dans les cas de séborrhée grasse, si fréquent aujourd'hui chez la femme depuis la mode des cheveux courts".
Parallèlement à la conquête de la France, la marque fait celle du monde et les dépôts se multiplient aux Etats-Unis et en Argentine, en 1926, en Suisse, en 1935.
Les Laboratoires Garnier lancent en 1946 un produit révolutionnaire à base d'extrait de moelle, inventé par le docteur Paris, chimiste de la société Roussel.
Synonyme de vitalité, le produit, vendu exclusivement chez les coiffeurs,connaît un vif succès."Les cheveux ont soif ! Seul le traitement Moelle Garnier les hydrate sans les graisser", conseille la réclame.
La gamme s'enrichit avec une lotion capillaire, une brillantine et un "Bain de moelle Garnier, shampooing mousse", vendu en tube ! Dirigée par Pierre Wicart depuis 1950, ce dernier n'hésite pas à promouvoir lui même la Moelle Garnier et son rapport qualité/prix dans des publicités comme celle en 1955 : "amis coiffeurs, utiliser un produit de qualité même cher est la forme la plus intelligente de l'économie car les bons produits font les bonnes affaires".
L'audace commerciale prend les airs quand, en 1947, l'avion Moelle Garnier survole le Tour de France. L'année suivante, le Cirque d'hiver accueille plus de 6 000 personnes pour le Noël des enfants de la coiffure. La même année, la Teinture Garnier, "sans toxique" est vendue dans une bouteille au style Art déco avec, pour nouveau logo, le portait d'un femme et pour slogan "Garnier, la vie du cheveu".
Durant les années 1950, Moelle Garnier élargit son territoire comme l'atteste cette annonce : "Hydratez vos cheveux, shampooing à la moelle. Illuminez votre visage : Moelle Color Reflets Lumière. Effacez vos cheveux blancs : Moelle Color Reflets naturels". La moelle s'introduit dans Cristal Color, lancé durant cette décennie, "Le premier shampooing colorant intégral chez votre coiffeur, le seul shampooing colorant à la moelle." La promotion utilise un nouveau mode de communication :la radio.Garnier sponsorise alors deux émissions, "Europe-Vedette", chaque soir à 21 h 30 sur Europe 1 et "Vedette du soir" à 22 h sur Monte Carlo.
Puisque la coloration à domicile fait ses premiers pas, et sur fond de développement des grandes surfaces, les Laboratoires Garnier lancent au début des années 1960 Belle Color, première coloration à domicile mais aussi "Un psycho-coloris Cristal Color pour changer la couleur des cheveux. Whisky blond, Coca Bella, Noir Marine parmi les 42 coloris-vedettes de Cristal Color". Lacto se décline en Lacto Clair, shampooing décolorant agit comme un démaquillant pour ensuite utiliser Cristal Color "la couleur que vous voulez, la douceur que vous aimez". Révolution dans la salle de bain en 1963 : Garnier lance O.Ba.o. (Obao en 1995), le premier produit parfumé pour le bain "à la japonaise". Le mot vient de l'expression japonaise "O.Fu.Ro" qui désigne le rituel du bain.
Son acquisition paraît la solution la plus pertinente malgré une situation financière déficitaire. Conscient de l'actif immatériel considérable de Garnier, François Dalle parvient à convaincre les financiers réticents de L'Oréal en leur démontrant que "Garnier est un peu comme une terre en jachère, mais son humus est très riche, c'est un terreau sur lequel on peut obtenir, peu à peu, de très belles récoltes, à condition de vouloir l'ensemencer et de le travailler correctement."
Le rachat de Garnier par L'Oréal en 1965 donne à la société un nouvel élan tant sur le plan de la recherche de nouvelles formules que sur ceux de la commercialisation et de la communication publicitaire.
L'Oréal va progressivement confier à Garnier la commercialisation de certains produits nouveaux issus de ses laboratoires ou de produits existants dont la nature paraît mieux s'associer à l'image de Garnier.
L'année du lancement de Douceur Blonde, shampooing éclaircissant doux pour avoir toujours les cheveux de l'été, les Laboratoires Garnier créent en 1969 le Service-Conseils Garnier destiné à répondre aux questions des consommatrices adeptes d'un nouveau temple de la consommation : la grande surface. Durant les années 1970 le shampooing "Moelle Garnier" se décline en Garnier rouge pour cheveux secs ou normaux, Garnier jaune pour cheveux gras ou laqués, Garnier vert antipelliculaire. Cette nouvelle gamme est proposée dans des nouveaux flacons familiaux incassables, formule enrichie, avec, toujours pour slogan "La vie du cheveu".
La publicité vante alors les vertus du shampooing Moelle Garnier : "Le shampooing Moelle Garnier lui lave les cheveux mais en plus lui restitue sa protection naturelle avec la moelle. 120 000 cheveux lavé en douceur et nourris en profondeur". On en parle pas encore d'extension du territoire de la marque quand, durant la même décennie, les Laboratoires Garnier lancent la gamme Réponses et ses cinq shampooings : "Légèreté des cheveux gras, démêlage et douceur des cheveux secs ou normaux, propreté des cheveux à pellicules, éclat des cheveux colorés, douceur pour lavages fréquents".
Le nouveau slogan "Garnier et vos cheveux sont beaux" témoigne de l'évolution du territoire de la marque vers l'univers de la beauté. Où l'on découvre, durant les années 1970, Simone Garnier et Guy Lux vanter Misopan, mise en plis à l'isopan (complexe d'extraits végétaux).
Marque patrimoniale, Ambre Solaire est par excellence, le symbole des vacances, des congés payés, de l'ère des loisirs et du bien-être corporel. La marque innove dans le domaine du soin et de la protection contre les ultraviolets et lance, en 1987, Ambre Solaire à l'indice de protection (12) le plus élevé du marché, hors pharmacie. Il atteindra 60 en 1997 ! La découverte, en 1995,par les laboratoires Garnier d'une molécule filtrante photostable, baptisée Mexoryl SX, permet de contrer les effets néfastes des ultraviolets de type A (UVA). Il est à la pêche et à l'abricot pour les enfants !
Depuis 1997, une gamme spécifique, Lait enfant et Spray Haute Protection Solaire, leur est dédiée.
Pour celles et ceux qui, sur la terrasse d'un café, un court de tennis ou bien ailleurs, ne disposeraient pas de leur tube de crème, Ambre Solaire a tout prévu ! Des lingettes solaires haute protection et des cataplasmes apaisants en cas de. coup de soleil.
Récemment, la marque innove en démocratisant les autobronzants en grande distribution avec les lingettes autobronzantes "No trace bronzeur" vendues à l'unité. Nomadisme oblige, elle lance un lait protecteur en format Pocket.
Soin du corps : Body Repair, Body Cocoon, Body Tonic;
Solaires : Ambre Solaire, Ambre Solaire UV Ski.
Soin du cheveu : Fructis, Ultra Doux ;
Coloration : 100% Color, Nutrisse, Belle Color, Kit Nuanceur, Cristal Blonds,Movida, Expression ;
Coiffants : Fructis Style, Grafic.
Hygiène : Obao, Neutralia.
Commercialisé en 1996, Fructis est le premier shampooing fortifiant aux concentrés d'actif de fruits. Cette nouvelle marque rompt avec les codes traditionnels du marché en jouant la carte du naturel et de la douceur quand le discours est alors très "technologique".
Dans le domaine de la coloration, Garnier qui gère déjà Belle Color, Movida, Expression et Cristal Color se singularise en 1998 avec Natea, premier masque colorant nutritif, coloration unique qui prend soin du cheveu en même temps qu'il le soigne.
Pour les 12/25 ans, Garnier lance en 1999 Synergie Pure, une gamme de soin aux actifs naturels pour les peaux grasses ainsi que l'anti-rides Synergie Lift A. Davantage qu'un soin antirides, Synergie Lift a été conçu pour redonner de la fermeté et de l'élasticité aux contours du visage. Sa formule onctueuse et légèrement parfumée est composée avec des essences de cerises 100 % naturelles, un extrait de myrtilles et du gingembre.
Extension de la marque Fructis en 2000 avec Fructis Style, gamme de coiffants de quinze références sensorielle par ses parfums fruités et ses textures onctueuses. Aux produits incontournables comme les gels, les mousses et les sprays, la gamme ajoute trois eaux disciplinantes pour cheveux courts, bouclés ou longs, une cire polissante qui apporte de la brillance aux cheveux, une pâte modelante dont la texture fibreuse permet les effets les plus extravagants et un lait lissant destiné à maîtriser les boucles. Tradition oblige, Fructis Style est formulée à partir de microcires de fruits (citron, orange, kiwi), de vitamine PP et de pro-vitamine B5.
En 2001,la gamme s'enrichit avec les Pschitts Gels et leur effet "secoué-décoiffé". Elle ouvre en 2002 un nouveau segment en créant une gamme à part entière dans les soins sans rinçage à base de micro-huiles de fruits avec quatre références autour des promesses antidessèchement, antifourches, anti-affadissement, anti-frisottis. Dans la gamme de produits capillaires Ultra Doux pour enfants apparaît en 2000 avec une formule à l'extrait de pomme verte. Comme les autres shampooings de la gamme,celui-ci a été conçu pour respecter les cheveux fins et fragiles des enfants. De plus, il permet de les démêler facilement. Deux nouveaux soins capillaires Ultra Doux sont lancés en 2001 avec le masque nourrissant à l'huile d'olive et au citron, pour cheveux secs et ternes, et le masque réparateur, pour cheveux longs et mi-longs,à l'extrait naturel de vanille.
En 2003, Garnier complète sa gamme de produits capillaires Ultra Doux, avec un shampoing et un après-shampoing au lait végétal. Cet ingrédient apporte aux cheveux normaux et aux cuirs chevelus desséchés une nutrition optimale, sans les alourdir. C'est aux femmes de 30 à 40 ans qu'est destiné en février 2001 le soin Synergie Stop qui associe le rétinol et la vitamine C pour réduire les premières rides, illuminer le teint, hydrater, lisser la peau et affiner les pores.
Pour soulager en quinze minutes, les Laboratoires Garnier lancent en mars 2001 des cataplasmes apaisants à l'extrait de melaleuca. Partie intégrante de la gamme Ambre solaire, ces SOS Coups de soleil complètent l'offre de lingettes protectrices qui remplacent l'application de crème ou de lait solaire. Après le visage, le corps. 42 % des femmes ne prendraient pas soin de leur corps par manque de temps ou par négligence.
Pour démocratiser ce geste au quotidien, Garnier lance en novembre 2001 une gamme de soins corporels baptisée Skin Naturals (ex-Synergie) avec deux déclinaisons : Body Cocoon pour nourrir en profondeur les peaux sèches et Body Tonic pour réhydrater et raffermir. La marque casse les codes du marché notamment par les couleurs, jaune et orange et par une approche très sensorielle. Les formules de Body Cocoon comprennent des micro-huiles de fruits, celles de Body Tonic, des essences d'agrumes.
En juin 2003 Garnier étoffe sa gamme de soins pour le corps Bodytonic avec un gommage aux essences de fruits. Pour obtenir un bon lissage de la peau, la marque utilise trois types de particules dans sa formule : des microcristaux cubiques de sucre, des particules de polymère et des billes de cire dont la forme a un effet de micromassage.
La marque n'oublie pas ses origines et lance en 2003 Garnier 100% Color qui offre des couleurs intenses à des femmes qui aiment se transformer avec la coloration.
Pour tout nouveau produit, Garnier privilégie le plus souvent possible les ingrédients naturels et son expertise scientifique lui permet d'étudier la manière dont la nature fonctionne afin d'en tirer le meilleur en terme de force et de douceur. Tous les procédés industriels, les packagings et les formules sont élaborés pour respecter l'environnement. En termes d'image, Garnier entend s'identifier à la beauté jeune et accessible tant sur le plan du prix que sur celui de la distribution et celui du discours. Publicis, l'agence historique de la marque, met en scène des tribus jeunes et métissées.
L'internationalisation conduit à capitaliser sur la marque Garnier en construisant une marque ombrelle forte accueillant des marques filles comme Ambre Solaire, Fructis, Belle Color, Nutrisse (ex Natea), Skin Naturals. Visite recommandée sur le site My Beauty bar,espace de bien-être et de service qui propose des diagnostics beauté et les dernières tendances de la coiffure. On peut choisir sa coloration de coiffure en testant le résultat à partir d'une photo scannée. Toujours par... Amour.
Et d'abord pour soi puisque depuis 2006 Garnier recommande : "Prends soin de toi."
2 - Cf La Revue des marques, n°2 avril 1993.
La saga des marques - Evian -
Deux millions de bouteilles vendues en 1898, 1,5 milliard en l'an 2000 ! Quel produit alimentaire peut se targuer d'une telle progression -un volume multiplié par 750 "en l'espace d'un siècle ? Derrière la froideur des chiffres, une histoire, celle de l'eau minérale naturelle, Evian, en tête du palmarès des marques dites de "confiance". Elle est, aujourd'hui, l'eau minérale la plus vendue dans le monde
Plus qu'un produit, elle relève du sacré. A la seule évocation du nom Evian, surgissent des images et des référents qui fondent l'identité de la marque: l'eau des bébés, 1es Alpes, 1a nature et la pureté. Les racines de sa longévité et les clés de sa modernité sont inscrits dans ses gènes.
C'est moins à son symbole qu'à son utilité que le marquis de Lessert s'attache quand, fuyant les eaux troubles d'un Paris en proie à la fièvre révolutionnaire, ce gentilhomme auvergnat fait une halte au bord du lac Léman. Pour sauver sa tête -nous sommes en 1789 -et soigner ses reins. C'est à Amphion, petite station thermale en Savoie qu'il décide de "prendre les eaux". Non loin de là, sur la rive sud du Léman, une autre station, pour l'heure inconnue: Evian. Son des- tin bascule quand notre marquis s'arrête devant la fontaine Sainte-Catherine, située dans le jardin du sieur Cachat.
Sur le plan industriel, le verre fait son apparition au début du XX' siècle. Vendue dans des bonbonnes en osier depuis 1901, Evian l'est également en bouteille. Une réclame, parue en 19 10, annonce une grande révolution: munie d'une capsule en aluminium, la bouteille se débouche "sans aucun instrument" et garantit deux promesses, "simplicité" et "inviolabilité absolue". Elle est fabriquée, depuis 1908, par les verreries Souchon- Neuvesel, de Givors, également actionnaires minoritaires de la société. Commercialisée exclusivement en pharmacie (2) jusqu'en 1960 -on compte alors 500 millions de litres vendus -, Evian doit à Antoine Riboud, alors président de Souchon-Neuvesel, son essor en grande surface. Aux commandes de la société des Eaux minérales d'Evian depuis 1964, il va faire de la marque un produit de grande consommation et la placer au premier rang des marques d'eau minérale plate en France. Date capitale de son histoire: en 1971, Boussois Souchon Neuvesel (BSN)(3) prend le contrôle de la société à 100%. Evian devient la première société de la future branche alimentaire (4) du groupe qui prendra le nom de Danone en 1993.
La force de la marque réside dans son aptitude à qualifier un produit certes incontournable -l'être humain boit environ 35 000 litres d'eau au cours de sa vie -, mais dont les spécificités, une eau de type bicarbonaté, calcique et magnésien, sont invisibles au commun des consommateurs. Et, si celles-ci demeurent, immuables, qualité oblige, ceux-là expriment des attentes différentes selon les époques ! Rien de commun entre la France rurale des années 30 et celle d'aujourd'hui; Beaucoup de facteurs changent les relations du consommateur à l'eau : l'urbanisation, la pollution:l'hygiène, la sécurité alimentaire, la représentation du corps, etc. Il revient à la communication de traduire ces changements, sans travestir l'identité de la marque, en respectant les deux axes que sont la qualité de l'eau et ses bienfaits sur la santé.
La naissance des Alpes remonte entre 30 et 60 000 ans avant J.-C. L'eau minérale d'Evian provient des pluies et des neiges tombées sur les contreforts du Chablais, au nord des Alpes de Haute-Savoie. Au quaternaire, un filtre naturel s'est constitué . une couche de sables glaciaires enserrée entre deux plaques d'argiles imperméables. L'eau met plus de 15 ans à passer au travers des sables glaciaires. Elle est captée par des drains de quatre-vingt mètres de long et amenée par des conduites en acier inoxydable vers l'usine d'embouteillage d'Amphion. Plus de trois cents contrôles bactériologiques sont effectués, tous les jours, sons oublier ceux de l'Institut Pasteur de Lyon et du Service des Mines pour le captage, l'embouteillage et le transport. La municipalité est propriétaire de la source depuis 1892 et ce, jusqu'en 2027 et donne à bail moyennant redevance la source à la Société. le "Centre Evian pour l'eau" a été crée le 22 mars l 999. Association loi de l 901 , elle regroupe 28 chercheurs qui couvrent toutes les disciplines concernant l'eau. le site Internet centre-evian.com réunit toutes les études sur l'eau. L'association édite une lettre trimestrielle.
Sa "pureté bactérienne" ne nécessite pas de la faire bouillir: "Evian-Cachat, eau idéale de l'allaitement artificiel." Elle est plus que jamais "l'eau des biberons" quand, en 1948, une campagne est initiée auprès des médecins et des sages-femmes. Le bébé est alors au centre de toutes les réclames.
Si le thème des Alpes apparaît pourra première fois en 1958- "L'eau d'Evian, issue des Alpes, a le goût délicieux des sources de montagne" -, il devient récurrent à partir de 1960. Séjour des dieux, symbole de l'éternité, centre et axe du monde, la montagne exprime la pureté, la sécurité et l' immutabilité. Désormais, la chaîne des Alpes sera un élément distinctif de la marque aussi bien dans les campagnes de communication que sur l'étiquette.
l'eau de source ne peut prétendre avoir des effets bénéfiques sur la santé; elle n'a pas obligation d'a- voir une composition minérale cons- tante et caractéristique. Elle n'est donc pas reconnue par l' Académie de médecine. l'eau minérale naturelle se différencie par une composition constante et des propriétés favorables à la santé dûment constatées par l' Académie de médecine et agréées par le ministère de la Santé.
Après le thème de la purification, Evian (re)devient en 1998 l'eau de jouvence, l'eau qui régénère le corps, l'eau de la jeunesse. L'immersion rétablit l' être dans un état nouveau. Où l'on découvre, sur le petit écran, le film le ballet des bébés, véritable prouesse technique, unanimement saluée comme en témoignent les scores d'agrément (94% quand la moyenne est de 70% ) et de reconnaissance (91 %). La campagne, orchestrée par Euro RSCG BETC, met en scène quelques soixante-dix bébés dans une comédie inspirée des chorégraphies hollywoodiennes d'Esther Williams (Le bal des sirènes) sur la musique de By Bye Baby (5).
En 1900, elle est implantée dans toute l'Europe. Mais sa véritable expansion internationale débute à partir de 1980 quand elle relève le défi américain pour y créer le marché de l'eau minérale. Vendre de l'eau aux consommateurs de soda et de bière 1 Pari gagné puisque les Etats-Unis sont, avec 250 millions de litres vendus tous les ans, le deuxième marché derrière la France. "Le discours publicitaire repose sur la dimension statutaire de la marque, le prestige culinaire de la France et l'imaginaire des Alpes", explique Patrick Buffard. "Pour vendre, aux Etats-Unis, la première boisson santé, nous avons utilisé des personnalités du sport.
Citons, au nombre des opérations récentes, celle menée en partenariat avec la Croix-Rouge, "Aidons à déplacer les montagnes", celle avec les Restos du Cœur Bébés en 1998 et, plus récemment, "l'Heure de l'Enfant", opération initiée par le groupe Danone avec la Fondation de France pour "aider les enfants à grandir." Preuve que, dans une société aujourd'hui désacralisée, l'eau demeure source de vie. .
(2) 1926 : 1a source Cachat est déclarée d'intérêt public.
(3) Souchon Neuvesel qui détient, en 1964, 25% du capital de la société des Eaux minérales d'Evian, fusionne, en 1966, avec Boussois, troisième producteur de verre plat en Europe.
(4) En 1965, la société des Eaux minérales d'Evian acquiert la Phosphatine Falières, Saint-Galmier Badoit et la Blédine Jacquemaire.
(5) Chanson rendue célèbre par Marylin Monroe dans le film Les hommes préfèrent les blondes. Le ballet des bébés à été réalisé par Jean Pierre Roux, assisté de la chorégraphe Muriel Hermine. Réputé impossible à produire, il à reçut le prix "coup de cœur" du jury des prix du Centre national des archives de la publicité, (CNAP) en 1999.
(6) Le film, réalisé par Médhi Norowzian, n'est pas truqué. Il met en scène quinze hommes et autant de femmes, âgés de soixante-huit à quatre-vingt-quatre ans.
(7) Deux diversifications n'ont pas été couronnées de succès : Evianaise, dans les années 50 et Evian fruité dans les années 70.
(8) La bouteille en verre est destinée aux cafés, restaurants, hôpitaux, hôtellerie.
(9) Matériau dédié jusqu'alors à l'exportation.
(10) Réalisée par Aastuce.
Les départements et leur histoire -Pyrénées Orientales-66
(Région Languedoc-Roussillon)
Le département des Pyrénées-Orientales a été formé du Roussillon et de l'ancienne Cerdagne. Ce qu'on sait de plus positif ou de plus probable sur l'origine des premiers habitants de ces contrées, c'est que les Gaulois, dans leur émigration du nord au sud, y substituèrent leur domination à celle de colons sardes ou tyriens qui y avaient fondé d'importants établissements.
Les vainqueurs empruntèrent des vaincus ou leur imposèrent le nom de Sardones, qui devint celui d'une puissante tribu de la confédération des Consorani et des Tectosages. On sait que ces peuples tentèrent de lointaines expéditions en Orient et jusqu'en Asie. Les Romains, qui avaient appris à les connaître, leur envoyèrent des ambassadeurs pour solliciter leur alliance contre Annibal, qui, d'Espagne, marchait sur l'Italie. Les Sardones refusèrent de prendre aucun engagement, et quand à son tour se présenta le général carthaginois comme hôte, disait-il, et non comme ennemi, le passage dans les campagnes lui fut laissé libre, mais pas un des soldats de son armée ne put pénétrer dans les villes. Tite-Live, qui rapporte cet épisode dans ses annales, rend hommage à la fière indépendance de ces premiers Roussillonnais.
Si le pays n'échappa point alors pour longtemps aux armes romaines, sa défaite a quelque chose d'honorablement exceptionnel par l'éclat des grands noms qui s'y trouvent mêlés. Après Annibal, c'est Marius qui apparaît, venant punir les Cimbres d'une double invasion ; c'est ensuite le grand Pompée, dressant sur la cime des Pyrénées la colonne commémorative de sa victoire sur Sertorius. César, enfin, vient après eux, et plus habile dans son orgueil, c'est aux dieux qu'il élève un autel pour marquer son passage.
La conquête du pays des Sardones, compris plus tard dans la Gaule Narbonnaise, remonte à l'an de Rome 633 et est attribuée à Q. Marcius, le fondateur de la colonie de Narbonne. Cette période dura jusqu'à l'année 409 de l'ère chrétienne. La position géographique du Roussillon sur la route d'Es pagne, la richesse de ses villes, dont l'une, Elne, comptait dès lors parmi les sept sièges épiscopaux de la Septimanie, le désignaient fatalement comme une proie à l'avidité des Barbares.
Vandales, Suèves et Alains s'y étaient installés, quand les Wisigoths les en chassèrent. La domination de ces derniers dura trois siècles environ et laissa une profonde empreinte dans les moeurs et dans la législation du pays. Entre Euric et Roderic, le premier et le dernier roi de la monarchie wisigothe, l'événement qui affecta le plus spécialement la province dont nous nous occupons est la révolte de Paul, un des lieutenants du prince Wamba.
Envoyé par son maître, qui résidait alors à Tolède, en Septimanie, pour y comprimer une sédition populaire, ce général se mit à la tête des rebelles et se . fit proclamer roi d'Orient en 673. Wamba fut obligé de venir en personne combattre l'usurpateur ; il traversa deux fois le Roussillon ; la seconde, après la défaite et la prise de son rival, il s'y arrêta pour réglementer l'administration ; il donna des délimitations nouvelles aux diocèses, réforma sur différents points la discipline ecclésiastique, rendit entre autres une ordonnance qui obligeait. les prêtres à prendre les armes pour la défense du sol et, après une étude sérieuse des besoins du pays, laissa à ses agents de sages instructions qui ne furent pas sans une heureuse influence sur la province.
Deux siècles après la bataille de Vouglé, le Roussillon était encore au pouvoir des Wisigoths ; rien n'indique .que cette possession fût même menacée par les princes francs ou les ducs d'Aquitaine, lorsque les Sarrasins, maîtres de l'Espagne, apparurent sur la crête des Pyrénées, invasion méridionale venant se heurter contre les hordes victorieuses du Nord.
Le Roussillon fut le premier champ de bataille et la première conquête des Sarrasins. La grande épopée de Charles Martel, la journée de Poitiers, les exploits décisifs de Pépin n'appartiennent point à cette notice ; nous nous bornerons donc aux faits dont notre province fut le théâtre. C'est en 719 que le Roussillon fut envahi par Zama, gouverneur de l'Espagne pour les califes de Damas.
Cette province et la ville de Narbonne étaient les points où l'autorité musulmane s'était le plus solidement établie. Un des lieutenants d'Abd-er-Rahman, nommé Manuza, se laissa séduire par les charmes de Lampégie, fille d'Eudes, duc d'Aquitaine, l'épousa, et conclut une trêve de trois ans avec son beau-père. Cette inaction de Manuza au moment d'une lutte suprême souleva la colère d'Abd-er-Rahman ; il envoya contre le traître un autre chef nommé Gedhi ; c'est dans le Roussillon que les deux généraux se rejoignirent pour combattre : Manuza, vaincu, alla mourir dans les murs de la petite forteresse de Livia, dont on voit encore quelques ruines.
Sa femme, captive, fut conduite à Damas, au sérail du calife. A cette époque, en 731, les Maures étaient encore maîtres du Roussillon, et Charles Martel avait échoué dans ses tentatives sur Narbonne ; c'est seulement vingt ans environ après, alors que Pépin prenait enfin la ville vainement assiégée par son père, que les Roussillonnais chassent eux-mêmes les soldats du prophète et se donnent au fondateur de la seconde dynastie franque.
Il fallait que les circonstances fissent de ce rapprochement une nécessité bien impérieuse, car de longs siècles devaient s'écouler avant qu'aucune fusion fût possible entre les conquérants des Gaules et les habitants des Pyrénées. Lorsque Charlemagne traversa le pays en 778, rendant l'offensive aux armes des Francs, il apprécia, dans son génie, le rôle que pouvait jouer, dans son nouvel empire, la race roussillonnaise ; conciliant avec l'intérêt de la patrie commune l'indépendance ombrageuse et la belliqueuse fierté de ces populations, il fit de cette province un de ces comtés qui, sous le nom de marches d'Espagne, devaient, comme des sentinelles avancées, veiller sur les frontières naguère menacées.
Mais le grand monarque n'avait point prévu le rapide affaissement de son oeuvre et les déchirements auxquels la faiblesse de ses successeurs livrerait son immense empire. Les comtes du Roussillon furent des premiers à secouer le joug royal. Les chefs de cette maison féodale étaient les comtes de Barcelone, qui apanagèrent deux branches cadettes de leur famille, l'une de la Cerdagne et l'autre du Roussillon.
Cette période est la plus confuse et la plus désastreuse de l'histoire de la province ; le nom même des seigneurs possesseurs du pays disparaît dans ce chaos qui dure plus de trois siècles. Gaucelme ou Gancion échappe à cet oubli des chroniques par la part qu'il prend à la lutte de Pépin d'Aquitaine contre Louis le Débonnaire et par sa mort tragique. Étant tombé aux mains de Lothaire, il eut la tête tranchée, et sa soeur, prisonnière comme lui, fut enfermée dans un tonneau et jetée dans la Saône.
Aux attaques incessantes des Maures, aux courses dévastatrices des Normands, se joignaient les horreurs d'une guerre civile presque permanente, les rivalités locales mettant sans cesse les armes aux mains des petits chefs féodaux. Ces désordres devinrent tels, qu'une intervention des seigneurs tant laïques qu'ecclésiastiques dut s'efforcer d'y apporter remède : des constitutions de paix et trêve, désignées sous le nom de treuga Dei (trêve de Dieu), furent décrétées dans deux conciles tenus dans la petite ville de Toulouges, près de Perpignan, en 1041.
Les clauses principales de ces traités prouvent à quel degré le mal était arrivé. Il était défendu de se saisir des bestiaux utiles à l'agriculture au-dessous de six mois, tant on redoutait l'anéantissement des espèces. Chacun avait le droit de tuer quiconque était reconnu coupable d'avoir violé la trêve de Dieu ; on alla plus loin encore, et, pour stimuler l'ardeur des vengeurs de la justice, on déclara que ceux qui auraient puni un homme condamné pour ce fait recevraient le titre de zélateurs de la cause divine.
Quelques fondations pieuses, les exploits d'un Guinard au siège d'Antioche, la lutte impie d'un autre Guinard contre son père Gausfred III et, à la suite de ces déchirements, la désolation de la province réduite à recourir à l'aumône de la Septimanie chrétienne, tels sont les faits principaux dans lesquels se résume l'histoire du Roussillon pendant cette déplorable époque.
Enfin ce Guinard, auquel son père avait pardonné et qui avait hérité de ses domaines, ne s'étant pas marié, légua son comté au roi d'Aragon, Alphonse II, en 1172. Il avait été précédé dans cette détermination par Bernard-Guillaume, comte de Cerdagne, dont le testament, en 1117, avait institué, pour hériter de ses petits États, Raymond V, comte de Barcelone, qui devint roi d'Aragon en 1134, par son mariage avec Pétronille, fille de Ramire II. Un dernier lien, malgré ces donations, rattachait le Roussillon à la France : les princes d'Aragon reconnurent pour ces contrées la souveraineté de nos rois jusqu'à la renonciation qu'en fit saint Louis en faveur de Jacques Ier, et en échange des prétentions de ce dernier sur une partie du Languedoc, prétentions qu'il abandonna par le traité de Corbeil, en 1258.
Quoiqu'il en puisse coûter à notre amour-propre national, il faut reconnaître que la domination aragonaise inaugura pour le Roussillon une ère de réparation et de prospérité. Alphonse, vaillant, habile, doué de qualités aussi solides que brillantes, mit tous ses soins à faire accepter par les sympathies et les intérêts des provinces cédées leur incorporation à son royaume d'Aragon.
Perpignan devint une de ses résidences de prédilection et l'objet de ses faveurs les plus signalées. Sa cour était le rendez-vous des poètes et des savants de l'époque ; aux bruits de guerre avaient succédé les chants d'amour, et les vers des troubadours, les poétiques légendes remplaçaient le sinistre récit des. batailles. Guillaume de Cabestaing, le trouvère roussillonnais, était un ami particulier d'Alphonse ; sa fin tragique, qui rappelle la sanglante histoire de Gabrielle de Levergies, fut vengée par le roi.
Ce nom n'est pas le seul qui ait illustré le règne d'Alphonse ; il faut lui joindre ceux de Bérenger de Palazol, de Raymond Bistor, de Pons d'Odessa et Tormit de Perpignan, gracieux talents de la môme époque dont le Roussillon garde encore aujourd'hui le glorieux souvenir. Alphonse avait créé de nouveaux comtes de Roussillon ; mais, pour prévenir toute division, tout déchirement, c'est dans sa famille, au profit de son frère don Sanche, qu'il avait constitué cet apanage.
Les traditions d'Alphonse furent suivies un siècle environ après sa mort, arrivée le 25 avril 1196. C'est dans cet intervalle que le roi don Jayme Ier, surnommé le Conquérant parce qu'il avait agrandi ses États des îles Baléares et du royaume de Valence, obtint de Louis IX sa renonciation à la souveraineté de la Cerdagne et du Roussillon.
Ce prince, regardant comme solidement établie la domination de sa maison sur les diverses parties de son royaume, le partagea à sa mort entre ses deux fils, don Pèdre III et don Jayme. Le premier, qui était l'aîné, eut l'Aragon, Valence et la Catalogne ; Majorque et les possessions françaises échurent à l'autre. Ce malheureux partage replongea nos provinces dans toutes les calamités de la guerre. Les prétentions de suzeraineté soulevées par don Pèdre jetèrent son frère dans les bras du roi de France.
L'excommunication fulminée par le pape contre le roi d'Aragon fournit un prétexte à Philippe le Hardi, qui vint se faire battre au pied des Pyrénées et mourir à Perpignan le 5 octobre 1285. La couronne de Majorque perdit beaucoup de son prestige à cette défaite, et le Roussillon en particulier, théâtre de la lutte, en éprouva des dommages considérables.
Les successeurs immédiats de don Jayme cherchèrent à faire oublier les torts et les revers de leur aïeul par leur attitude humble et soumise ; mais les éléments de rivalité n'en subsistaient pas moins ; la lutte recommença entre Pierre IV et Jayme II. Cette fois, elle fut décisive. Malgré l'obstination désespérée de Jayme, toujours vaincu et toujours menaçant, malgré l'infatigable dévouement des Roussillonnais, la dernière heure était venue pour le royaume de Majorque ; en 1374, il était définitivement réuni à l'Aragon, et le Roussillon retombait pour trois siècles sous la domination espagnole.
Il y eut un retour momentané à la France ; mais ce court épisode se rattache au XVe siècle et au règne de Louis XI, dont le nom se représente partout où sont tentés les premiers efforts pour constituer l'unité française, et près de deux cents ans nous en séparent encore. Pierre IV était un prince d'une haute capacité ; l'énergie qu'avaient déployée les Roussillonnais pour la défense du royaume de Majorque lui inspira plus d'estime pour leur caractère que de rancune pour la résistance qu'ils lui avaient opposée ; recommençant la politique d'Alphonse II, c'est par une administration bienveillante qu'il voulut s'attacher ses nouveaux sujets.
Il les associa à la législation catalane, les admit aux états généraux ou Cortès, encouragea l'industrie et la navigation par des traités avec les nations voisines, protégea l'agriculture et fit replanter d'arbres les contrées ravagées dans les dernières guerres. Jean Ier, fils et successeur de Pèdre IV, ne suivit pas l'exemple de son père ; il abandonna le Roussillon à l'administration d'un gouverneur général et d'officiers royaux, plus soucieux de leur enrichissement et de leur élévation que des intérêts du pays ; le seul acte qui signale ce règne est une ordonnance à la date du 13 décembre 1388, qui ouvre le Roussillon aux criminels expulsés des autres provinces de l'Aragon.
Martin, qui succéda à Jean Ier, était sympathique aux Roussillonnais, il répara une partie des maux causés par l'incurie de son prédécesseur. Ce prince étant mort sans héritier, les états du royaume décernèrent sa couronne à Ferdinand infant de Castille, dont le règne fut déchiré par le schisme de Benoît III. Alphonse V, qui lui succéda, passa presque toute sa vie à guerroyer en Italie ; le Roussillon n'eut qu'à se louer de la régence de la reine Marie, sa femme, dont l'administration laissa dans le pays des traces de grande sagesse et des souvenirs de bonté.
C'est en 1458 que Jean II monta sur le trône, et c'est presque aussitôt qu'éclatèrent ses démêlés avec le roi de France. La Catalogne s'était soulevée, le Roussillon s'était associé à la révolte ; Jean, impuissant à faire rentrer ses sujets dans le devoir, s'adressa à Louis XI et sollicita de lui un secours de sept cents lances.
Le rusé monarque y consentit, mais à la condition que les frais de l'expédition, évalués à deux cent mille écus, seraient à la charge du roi d'Aragon, et que, si cette somme n'était pas exactement payée dans un délai donné, le Roussillon et la Cerdagne deviendraient les gages de la créance. Jean ne tarda pas à s'apercevoir du piège caché sous les conditions de son allié ; il mit alors toutes ses espérances dans le succès de cette sédition qu'il était naguère si désireux de comprimer. Les soldats français furent reçus et traités en ennemis.
Louis XI n'en fut sans doute que médiocrement affecté ; il envoya à leur secours une armée de trente mille hommes. La résistance fut encouragée et organisée alors par le roi d'Aragon ; c'était la guerre ; elle fut vaillamment soutenue de part et d'autre, mais Louis XI n'était pas homme à se dessaisir facilement de ce qu'il avait une fois tenu.
Les négociations achevèrent l'oeuvre que les armes avaient commencée, et en 1475 le Roussillon et la Cerdagne appartenaient à la France. Mais le génie n'est point héréditaire ; Charles VIII n'était capable ni de comprendre ni de poursuivre les grandes traditions politiques de son père ; il avait, d'ailleurs, pour antagoniste ce Ferdinand qui, par son mariage avec Isabelle, venait de réunir sous le même sceptre Aragon et Castille, et dont la couronne allait s'enrichir de tous les trésors de l'Amérique.
Une intrigue ourdie par deux moines à la solde de l'étranger jeta le trouble dans la conscience du jeune roi, qui, malgré l'avis de son conseil, malgré la résistance des gouverneurs provinciaux, s'obstina à restituer Ies conquêtes paternelles ; Ferdinand et Isabelle firent leur entrée solennelle à Perpignan en septembre 1493. Toutefois, cette faute était si énorme qu'elle excita de fréquents regrets chez Charles VIII et Louis XII, qui tentèrent d'inutiles efforts pour revenir sur cette déplorable cession.
L'occasion perdue ne devait pas sitôt renaître ; Louis XII, aussi peu heureux à la guerre que dans les négociations, renouvela authentiquement la restitution du Roussillon en échange du royaume de Naples, qu'il ne devait pas mieux conserver ; déçu des deux côtés, il recommença la lutte, triste héritage pour son successeur François Ier. En Roussillon, comme à Pavie, tout fut perdu fors l'honneur sous le règne du chevaleresque monarque, et pendant soixante-dix ans la domination espagnole ne fut plus même contestée.
La seule consolation que nous puissions nous donner est le tableau de l'ignorance et de la misère où le pays resta plongé pendant cette période de la domination étrangère. Pestes, famines, envahissement des esprits par les superstitions les plus absurdes, persécutions des prétendus sorciers, plus absurdes encore, rien ne manque à la honte et au malheur des populations.
Enfin la tâche de Louis XI put être reprise. Richelieu gouvernait la France, lorsque les animosités soulevées par Olivarès, premier ministre de Philippe IV, firent explosion en Catalogne ; le Roussillon fit, comme toujours, cause commune avec la province révoltée ; Olivares, en recourant aux moyens de répression pratiqués ailleurs par le duc d'Albe, poussa les esprits au désespoir.
Vers le même temps, une attaque des Espagnols sur la ville de Trèves, sans déclaration de guerre préalable, fournissait à Richelieu un prétexte d'intervention. Condé entra dans le Roussillon ; les habitants songeaient alors à fonder une république fédérative ; on leur fit comprendre qu'on attendait un autre prix du secours qu'on leur apportait. En haine de la domination espagnole, ils se donnèrent à la France.
Louis XIII vint en personne faire le siège des places fortes. En 1642, tout le Roussillon était occupé par l'armée française ; en 1659, le traité de la Bidassoa consacrait les droits de la France sur tout le versant septentrional des Pyrénées, et le Roussillon prenait place parmi nos provinces. Une conspiration de quelques nobles, découverte en 1674 par suite d'une indiscrétion amoureuse, fut la seule protestation contre le nouveau régime. La crise de la Révolution, les désastres de l'Empire ont trouvé les populations inébranlablement dévouées à la France.
Au XIXe siècle, si quelques usages, quelques détails de costume, quelques traits de la physionomie trahissent encore chez les Roussillonnais leurs longues et intimes relations avec l'Espagne, sous tant d'autres rapports l'assimilation est si complète, qu'il faut relire l'histoire pour ne pas oublier que cette, contrée n'est française que depuis un peu plus de trois siècles.
Les départements et leur histoire-Hautes-Pyrénées-65-
Le département des Hautes-Pyrénées est formé, pour sa plus grande partie, de l'ancien Bigorre. Les Bigorrais (Bigerri, Bigerrones) étaient un des peuples aquitaniques qui furent soumis par Crassus, lieutenant de César. Leur capitale était Bigarra, que les savants croient reconnaître dans le village actuel de Cieutat (Civitas, la Cité), à 15 kilomètres de Bagnères-de-Bigorre.
Lorsque, à la fin de sa huitième campagne, le conquérant lui-même vint avec deux légions séjourner quelque temps en Aquitaine, peut-être visita-t-il le pays de Bigorre ; on retrouve du moins son nom en plusieurs lieux ; ainsi le village de Juillan, vicus Julianus, près duquel on montre un camp de César. Près de Pouzac, on voit un autre camp de César où l'on a trouvé des ossements et une épée romaine.
Au peuple bigorrais appartenaient plusieurs peuplades : les Tornates, les Campons, les Onosubates, les Crébennes. Ces peuples montagnards se couvraient, comme aujourd'hui, de vêtements tissés avec la laine brute de leurs moutons noirs ou bruns ; la peinture qu'en faisait Sulpice Sévère serait encore très juste : Bigerricam vestem brevemque atque hispidam. Probablement aussi ils portaient des peaux de bête en guise de manteau : Dignaque pellitis habitas deserta Bigorris, écrivait saint Pantin à Ausone.
Maîtres de ce pays, les Romains en explorèrent presque toutes les vallées et tirent grand usage des eaux minérales qui s'y rencontrent avec abondance. On retrouve encore des traces de voies romaines, et peut-être des tronçons de celle de Toulouse à Dax dans les lieux suivants : près de Tournay, dans la lande de Capvern, où le chemin s'appelle encore Césarée, à l'Estelou-de-Vieille ; et, enfin, à une lieue au nord de Lourdes, près d'une métairie nommée Strata et qu'on prétend occuper la place d'une ville antique.
On indique saint Saturnin, évêque de Toulouse, et son disciple saint Honeste comme les premiers prédicateurs de l'Évangile dans le Bigorre, au IIIe siècle ; mais leur prédication eut peu de succès, car ce pays n'eut point encore d'évêque. C'est seulement vers le commencement du VIIe siècle que saint Savin, fils de Hentilius, comte amovible de Poitiers, vint chercher une retraite dans les montagnes ; il s'arrêta au couvent de Saint-Lézer, près de Vie-de-Bigorre, et obtint de l'abbé Forminius un diacre nommé Julien, avec lequel il s'achemina vers les hauteurs du Lavedan ; ils y construisirent un petit ermitage au lieu que l'on nommait le palais Émilien.
Charlemagne y bâtit plus tard un riche monastère qui occupait toute la place où est actuellement le bourg. Les Normands qui, après sa mort, ravagèrent le pays et pénétrèrent partout, vinrent détruire ce monastère au coeur même de la montagne ; le comte de Bigorre, Raymond Ier, le releva un siècle après.
Avant l'invasion des Normands, les Bigorrais, devenus tout à fait chrétiens, avaient eu à subir celle des Sarrasins ; quand ces barbares du Midi, vaincus à Poitiers, s'enfuirent vers les Pyrénées, les Bigorrais se rassemblèrent sous un certain Missolin et anéantirent un corps de troupes maures au lieu qui a conservé depuis le nom de Lanne Maurine, près d'Ossun. On y a trouvé des tombeaux et des ossements. Comme tous les Sarrasins ne furent pas exterminés dans ce combat, on 'prétend que ceux qui survécurent se fixèrent dans les Pyrénées et furent la souche de la population malheureuse et réprouvée des Cagots. Certains savants, entre autres Ramond, pensent, peut-être avec plus de raison, que les Cagots sont un reste des Wisigoths ariens. Francisque Michel, dans son travail sur les races maudites, préfère y voir des chrétiens d'Espagne qui auraient suivi Charlemagne lorsqu'il revint de son expédition contre les Maures.
Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'entre la domination des Romains et celle des Francs s'était placée celle des Wisigoths, refoulés en Espagne par la bataille de Vouillé. Sous Charlemagne, le Bigorre forma un des comtés dont se composait le duché de Gascogne. Louis le Débonnaire le donna comme fief héréditaire à Donat-Loup, descendant de Waïfre. Le second comte de Bigorre fut Inigo, surnommé Arriscat à cause de sa valeur et de son esprit entreprenant ; les qualités et la réputation de grand guerrier le firent élire pour roi par les Navarrais, occupés alors à s'affranchir du joug des Sarrasins.
Inigo accepta et alla fonder au delà des Pyrénées la puissance de cette redoutable maison, qui donna des rois illustres à tous les trônes chrétiens d'Espagne. Mais, en montant sur le trône de Navarre, il abandonna à son frère le comté de Bigorre sous la réserve de l'hommage. Ainsi le Bigorre releva de la Navarre sans cesser pour cela de dépendre de la haute suzeraineté du roi de France.
En 1036, le Bigorre passa à la maison de Carcassonne par suite du mariage de l'héritière Gersende avec Bernard-Roger, vicomte de Carcassonne, comte de Couserans, seigneur de Foix,- etc. Un comte de cette maison, Bernard Ier, régularisa le premier, vers 1060, les coutumes du pays de Bigorre. Le droit écrit et les lois romaines avaient disparu dans l'invasion des Normands, il n'en restait que des débris confus mêlés à des usages barbares ; Bernard tenta de coordonner et de fixer ces coutumes, de sorte qu'elles pussent servir de règle constante dans l'administration de la justice.
A la fin du XIe siècle, la maison de Béarn succéda à celle de Carcassonne dans la personne de Bernard II, fils de la comtesse Béatrix et de Centulle de Béarn. Bernard II acheva ce que Bernard Ier avait commencé et fit rédiger par écrit les coutumes de Bigorre, « poussé, dit le texte même, par l'inspiration divine et par les exhortations des grands de sa terre..., et avec le consentement de tout le clergé et de tout le peuple. »
La charte commence par régler les devoirs du comte : avant de recevoir le serment de ses vassaux, il doit lui-même leur jurer de ne point enfreindre leurs fors et son serment doit être appuyé de celui de quatre gentilshommes du pays ; il doit, en outre, fournir deux cautions à chacune des vallées de Lavedan et de Barèges, dont les habitants, comme nous aurons occasion de le raconter, montrèrent toujours un grand esprit d'indépendance.
Ces devoirs remplis, tous les gentilshommes du pays, et généralement tous les habitants des vallées, doivent prêter au comte le serment de fidélité, et ceux dont il exigerait des cautions doivent en fournir. Le comte avait seul le droit d'est et de chevauchée à l'exclusion de ses vassaux ; mais il ne pouvait faire marcher les habitants de Lavedan et de Barèges qu'en cas d'invasion étrangère. La charte est soigneuse d'assurer l'autorité du comte sur ses vassaux, non seulement en établissant le droit exclusif dont nous venons de parler, mais surtout en stipulant qu'aucun gentilhomme ne pourra élever un fort, ni même réparer un vieux château sans l'aveu du comte. Le comte n'a droit d'hébergement que dans six gîtes désignés, et les personnes libres lui doivent pour toutes redevances : trois corvées par an, un repas, une poule à Noël, un agneau à Pâques. Le jugement par les épreuves ou par le combat se rencontre dans la charte de Bernard II.
Telles sont les dispositions les plus frappantes de ces coutumes, rédigées en 1097, à une époque où aucun État de l'Europe féodale n'avait encore écrit les siennes. Nous ajouterons seulement qu'on y rencontre des traces fort curieuses de la guerre faite alors par le régime féodal naissant à l'ancien régime des alleux et des hommes libres ; ainsi, cette charte défend l'acquisition des alleux dont la franchise est ignorée, et interdit les recherches propres à les faire revivre ; elle oblige de plus toutes les personnes libres à se choisir un seigneur parmi les vassaux du comte ; et, à défaut par elles de se conformer à cette disposition, le comte peut les attribuer à celui de ses chevaliers qu'il voudra.
Les comtes de Bigorre furent en général vaillants et belliqueux. Nous les voyons constamment chercher aventure d'un côté ou de l'autre des Pyrénées ; tantôt se mettant au service des ducs d'Aquitaine contre les comtes de Toulouse, tantôt marchant contre les Maures sous la bannière des rois de Navarre et d'Aragon, qui les en récompensent en leur donnant des dignités et des terres en Espagne ; Nous remarquerons en passant que, par suite du testament de Sanche le Grand, la suzeraineté de Bigorre fut transportée de la Navarre à l'Aragon.
A la maison de Béarn succéda, faute, d'héritier mâle, la maison de Marsan ; le vicomte Pierre, fondateur de la ville de Mont-de-Marsan, devint comte de Bigorre vers 1127. C'est sous un de ses successeurs, Centulle III, que la révolution communale s'opéra dans le Bigorre, mais sans violence ; le désir de se donner un appui contre les vicomtes ses vassaux décida ce seigneur à donner des chartes à la plupart des villes de ses États. Mais déjà la maison de Marsan avait fait place à celle de Comminges, quand les Albigeois attirèrent sur le Bigorre la croisade catholique de Montfort.
Les hérétiques occupèrent les places les plus importantes du pays jusqu'en 1216 ; à cette époque, un mariage eut lieu entre Pétronille, héritière du comté, et Gui de Montfort, fils de Simon. Ce mariage livra le Bigorre aux croisés. Il y eut, pendant près d'un siècle, des querelles provoquées en partie par l'avidité de cette insatiable maison de Monfort, particulièrement du fameux comte de Leicester.
Ce fut Philippe le Bel qui mit fin à ces discordes féodales : ce monarque énergique mit en séquestre le Bigorre, ajourna les prétendants au parlement, ordonna une enquête sur la valeur du comté et l'administra souverainement pendant plusieurs années. Il confirma particulièrement tous les privilèges accordés aux villes par Centulle III. Le parlement laissa traîner longtemps la décision de la rivalité des prétendants, et le Bigorre parut, sous Philippe le Bel et sous ses premiers successeurs, réuni à la couronne de France, qui y entretenait un sénéchal.
Si cette réunion n'existait pas en effet, du moins la France exerçait désormais une suzeraineté directe sur le Bigorre ; car l'Aragon avait abandonné la sienne par le traité conclu avec saint Louis en 1258, et l'église du Puy-en-Velay, qui avait aussi un degré de suzeraineté sur le Bigorre en vertu d'un vœu fait autrefois par un chef sarrasin du nom de Mirat, maître du château de Lourdes, fit une renonciation semblable. Ce n'est qu'en 1425, après avoir été cédé aux Anglais par le traité de Brétigny, puis recouvré par la France, que la question de succession fut résolue par un arrêt du parlement de Paris, qui attribua le Bigorre à Jean, comte de Foix. Soixante-dix ans plus tard, l'héritière Catherine porta le Bigorre à la maison d'Albret par son mariage avec Jean d'Albret (1496). Ici, le Bigorre cesse d'avoir une histoire particulière.
Le Bigorre avait, sous l'ancien régime, ses états particuliers. Ils se composaient de trois chambres, qui opinaient séparément ; celle du clergé était composée de l'évêque, des abbés de Saint-Severde-Rustan, Saint-Savin, Saint-Pé et Saint-Orens-de-la-Reüle, des prieurs de Saint-Lézer et de Saint-Orens-de-Lavedan, et du commandeur de Bordères (c'était l'ancienne commanderie des templiers).
Le corps de la noblesse était la réunion des barons de Bigorre, dont le vicomte de Lavedan était le premier. Parmi les familles qui ont laissé un nom dans nos annales, il faut citer celle des Bourbon-Malauze, issue d'un fils naturel de Jean II, duc de Bourbon, et de Jeanne d'Albret, maison éteinte depuis longtemps ; celle des vicomtes d'Aster et d'Aster-d'Aure, qui se confondit avec les Gramont ; celle des barons de Bessac et de Montant, unie aux Navailles ; celles des d'Antin, et des Pardaillan, érigées en duchés d'où sortait le marquis de Montespan, dont la femme joua un si grand rôle sous le règne de Louis XIV.
A cette liste, il convient d'ajouter les comtes. d'Ossun et les seigneurs de Baudau, devenus plus tard comtes de Parabère. Le tiers état se composait des consuls ou officiers municipaux des communes et des députés des vallées : la présidence appartenait d'abord au sénéchal, lieutenant politique du comte et chef de la noblesse du pays ; niais elle fut transférée, en 1611, à l'évêque, à la faveur de la réaction catholique qui s'opérait alors.
Quant à l'administration de la justice, le sénéchal l'exerçait au nom du comte ; sa cour se composait d'un juge mage et de plusieurs conseillers : là se jugeaient les appels des tribunaux inférieurs ; ceux-ci étaient formés des jurats élus par les communes et présidés par le viguier ou vicaire du comte.
Le pays était couvert d'atalayes ou forts guetteurs, correspondant entre eux par la vue ; ils étaient généralement composés d'un donjon entouré de murailles, du haut duquel, en cas de danger pour la liberté du pays, se transmettaient, à l'aide d'un système de signaux ou de feux allumés, les avis et les convocations.
On trouve dans les chroniques du Bigorre un témoignage affligeant des préjugés superstitieux que l'ignorance entretint si longtemps dans nos provinces ; au milieu des populations, mais repoussée par elles, vivait une caste maudite comme les parias de l'Inde. C'étaient les cagots, capots, appelés quelquefois aussi gahets. On n'a jamais connu bien positivement ni leur origine, ni les motifs de la malédiction dont ils étaient frappés.
Quelques anciens auteurs, plus éclairés et plus impartiaux que le vulgaire, les qualifient de chrétiens gézitains, affirmant qu'ils sont bons catholiques, honnêtes gens, habiles dans leurs métiers de charpentiers ou de tonneliers, ne parlant aucune autre langue que celle du pays, de belle prestance, d'aspect sain et robuste. Et cependant on n'entretenait avec eux aucune communication. Ils ne pouvaient vivre et se marier qu'entre eux ; une place isolée leur était assignée à l'église ; ils ne pouvaient y faire leurs dévotions qu'à part et à des heures spéciales.
Deux écrivains du XVIe siècle, Thevet et Belleford, expliquent ainsi l'opinion inhumaine qu'ils partageaient : Ces gens, disent-ils, étaient infects et puants ; ils naissaient ladres ou le devenaient aisément, de sorte qu'il est dangereux de les fréquenter. Belleford croit qu'ils tirent leur nom de gézitains de Giézé, disciple d'Élisée, que ce prophète guérit de la lèpre ; celui de cagots serait une réminiscence de certains Goths bannis d'Espagne pour y avoir contracté de honteuses et dangereuses maladies. Marcs, le prélat historien du Béarn, s'est occupé, lui aussi, de cette secte infortunée, mais pour la réhabiliter et pour la défendre. Il reconnaît qu'autrefois cette population a pu être atteinte des infirmités qu'on lui reproche,. mais qu'elle en est complètement guérie.
II pense que ce sont des Sarrasins venus de l'Espagne conquise par eux, établis en France, et persistant à y demeurer après la victoire de Charles Martel. Pour y vivre en sécurité, ils se firent baptiser ; mais on les soupçonna d'être chrétiens de mauvaise foi, d'être ladres et de ne s'être fait baptiser que parce qu'ils croyaient que cette sainte absolution les guérirait de leur maladie.
D'ailleurs, les vieux chrétiens, les sachant circoncis, s'obstinaient à croire qu'ils étaient toujours juifs ou mahométans dans le coeur. C'est pour cela que les peuples du Bigorre demandèrent aux états de les forcer à porter une marque particulière qui permît de les reconnaître et de les éviter. Ajoutons à l'honneur des états de Bigorre que cette demande fut rejetée ; ce qui n'éteignit malheureusement pas le mépris et la haine dont les pauvres cagots continuèrent à être les victimes.
L'Assemblée constituante érigea la province en un département, qui fut appelé d'abord de Bigorre, et peu de temps après des Hautes-Pyrénées. On doit rendre hommage à l'excellent esprit dont sont animées les populations de l'ancien Bigorre.
Nul département de la France n'est plus tranquille, plus facilement administré, plus soumis aux lois, plus dévoué au travail. Chacun sent qu'il a quelque chose à perdre comme propriétaire, quelque chose à gagner comme travailleur. On y a compris que l'agriculture, qui est à la fois le premier des arts et la plus productive des industries, est la source du bien-être le plus solide et des plus durables prospérités ; aussi, .y a-t-on le spectacle si satisfaisant et trop rare de la petite culture dans une contrée fertile dont presque tous les habitants possèdent et cultivent une partie.
Au XIXe siècle, les établissements d'eaux thermales sont pour le pays un surcroît de consommation et de revenu. C'est le tribut payé par l'étranger qui aide à payer l'impôt national. L'élevage du bétail, des chevaux et des mulets, est une des richesses du pays, qui pourrait s'augmenter par l'acclimatation d'espèces négligées. Comme ombres à ce tableau, on reproche alors aux habitations rurales leur manque de salubrité et de propreté, quoique, depuis quelques années les améliorations soient sensibles. Les plantations d'arbres, surtout d'arbres fruitiers, sont trop rares et trop peu encouragées ; enfin des hommes compétents trouvent que l'industrie pyrénéenne ne tire pas un parti suffisant des ressources métallurgiques que possèdent ses montagnes.
Les départements et leur histoire-Pyrénées Atlantiques-64-
Le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques appartenait, au moment de la conquête romaine, aux peuples désignés sous le nom générique d'Aquitains ; ils étaient formés du mélange des Ibères, les plus anciens possesseurs du sol et des Celtes qui autrefois les avaient conquis et refoulés dans leurs montagnes.
Rome, avant César, avait déjà tenté de les soumettre ; deux fois ses armées avaient été repoussées. Le jeune Crassus, lieutenant de César, fut plus heureux. Malgré l'énergique résistance des belliqueux habitants de ces contrées, il réussit à les dompter, et si quelques peuplades durent à leur éloignement ou à leur situation dans les montagnes d'échapper d'abord à la conquête romaine, elles ne tardèrent pas à se soumettre à César lui-même, qui, cinq ans après Crassus, vint en Aquitaine. Le pays se révolta sous Auguste, et fut de nouveau subjugué par le proconsul Messala ; ces succès méritèrent au vainqueur l'honneur d'un triomphe rappelé par Tibulle, son ami : Genlis Aquitanae celeber Messala triomphis.
Sous Adrien, le pays fit partie de la Novempopulanie. Il est fait mention, sous l'empire, de deux villes importantes, dont l'une, Iluro, est devenue Oloron ; l'autre, Beneharnum, d'où vient le nom de Béarn, a donné lieu à de grandes discussions ; on croit que la ville de Lescar est bâtie sur l'emplacement de cette antique cité.
Ravagée par les barbares : Vandales, Alains, Wisigoths, qui prenaient ce chemin pour envahir l'Espagne, la contrée fut, au VIIe siècle, occupée par les Vascons, chassés de Pampelune et de Calahorra par les Wisigoths : ces peuples intrépides luttèrent contre Dagobert et les autres rois francs de la première race, qu'ils inquiétèrent perpétuellement par leur humeur turbulente et guerrière.
Plus tard, ce furent les Vascons, qui, à Roncevaux, firent subir à l'arrière-garde de Charlemagne, revenant d'Espagne, la fameuse défaite où périt Roland. Louis le Débonnaire, successeur de Charlemagne, vengea cette défaite au lieu même où son père avait été surpris par les Vascons et où ceux-ci lui avaient à lui-même tendu une nouvelle embuscade. Après de nouvelles guerres contre ces peuplades insoumises, l'empereur franc fait bannir le duc de Vasconie, Loup Centulle, et un peu plus tard donne le pays de Béarn à un frère du dernier duc. Ce n'est pourtant qu'en 905 que nous voyons commencer la maison des vicomtes de Béarn, vassaux du comte de Gascogne ; le premier d'entre eux fut Centulle Ier.
L'histoire des premiers vicomtes de Béarn, qui, tous, portent le nom de Centulle, présente peu d'intérêt : leur turbulence guerroyante à l'égard de leurs voisins, leur dévotion et leur libéralité envers les monastères, voilà tout ce qu'on peut signaler dans cette période. L'un d'eux cependant, Centulle III, se montra moins généreux que les autres envers les moines. « Aussi, dit la chronique de Lescar, fut-il blessé et mourut-il de ses blessures, Dieu merci ! »
Un cartulaire du temps constate un jugement rendu sous lui, et qui peint l'époque : les moines de Saint-Pée réclament l'héritage de Guillaume Fel, qui, selon eux, leur en avait fait donation. Les enfants de Fel le contestent et redemandent leur patrimoine. Tout se termine par un duel judiciaire ; le champion du couvent est vainqueur, et, en conséquence, les enfants de Fel sont dépouillés de l'héritage paternel. Nous voyons encore un fait assez curieux dans le testament de Raymond, second fils de Centulle III : il lègue au même monastère un paysan, qui ne devait cesser de leur appartenir que si le vicomte de Béarn jugeait à propos de le racheter ; le prix du rachat est déterminé : trois cents sols.
Centulle III avait commencé l'émancipation de sa vicomté et agrandi ses domaines. Aussi, après avoir enlevé au vicomte d'Acqs deux hameaux, ce baron gascon se qualifie-t-il pompeusement dans une charte de grand dominateur de la terre, magnus dominator terrae. Sous son petit-fils, Centulle IV, le duc d'Aquitaine, pour récompenser quelques services qu'il en avait reçus, fit remise au vicomte de Béarn de tous devoirs de vassalité. Centulle IV bâtit ou embellit quelques villes.
Gaston IV (1088) se signala par son courage chevaleresque à la croisade en Orient et contre les Maures ; mais la postérité lui doit plus de reconnaissance pour le libéralisme qui respire dans ses institutions. Avant Louis le Gros, il donna un exemple d'affranchissement communal : Morlaàs fut par lui déclarée ville libre. Par ses autres institutions, il établit l'ordre dans ses États, et protégea le faible contre le fort. Il fonda des hôpitaux, et s'occupa surtout d'arrêter les progrès de la lèpre, maladie affreuse que les croisés avaient rapportée d'Orient.
On sépara les lépreux de la société ; ils eurent en Béarn, dans chaque commune, des maisons isolées ; il leur était défendu d'en sortir, et ils y vivaient seuls. On leur permettait cependant d'assister aux exercices religieux dans les églises ; mais ils y entraient par une porte réservée pour eux seuls ; ils avaient en particulier un bénitier, une place, et jusqu'à un cimetière, afin que, même après leur mort, ils n'eussent rien de commun avec leurs concitoyens. On ne les admettait point dans les armées, et on ne leur permettait point d'exercer aucun autre métier que ceux auxquels on travaille en plein air. La lèpre était regardée comme une punition infligée directement par la main de Dieu ; c'est ce qu'on appelait un mal sacré. Les ecclésiastiques, déjà chargés du soin des pauvres, devinrent aussi les tuteurs des lépreux.
Gaston IV, que son ardeur belliqueuse avait entraîné en Espagne dans une croisade contre les Maures, y fut tué dans une embuscade. Son corps, porté à Saragosse, y fut inhumé dans l'église de Notre-Dame del Pilar ; on y montre encore aujourd'hui son cor et ses éperons, et les historiens espagnols s'accordent à célébrer sa bravoure et les services qu'il a rendus à leur pays. Il avait reçu de ses alliés le titre de vicomte et de pair d'Aragon.
Les successeurs de Gaston IV n'ont point marqué dans l'histoire, et sa famille ne tarda pas à s'éteindre. Marie, seule héritière de cette maison, fait hommage, pour sa principauté, à Alphonse d'Aragon, sous la tutelle duquel elle vivait encore, et se laisse imposer par lui une union avec Guillaume de Moncade, né d'une des premières familles de Catalogne (1170). Le Béarn se trouvait ainsi lié à l'Espagne et détaché de la France ; mais l'hommage que le nouveau seigneur fit au roi d'Aragon alarma l'humeur fière et indépendante des Béarnais ; ils le déposèrent, et déclarèrent le trône vacant. Ils élurent pour souverain un chevalier du Bigorre ; mais celui-ci, n'ayant point respecté leurs privilèges, fut tué par eux au bout d'un an.
Même sort était réservé à son successeur, venu d'Auvergne, et qui offensa par son orgueil la fierté des Béarnais. La cour de Béarn le fit tuer d'un coup de pique par un écuyer sur le pont de Saranh. Alors, dit une ancienne pièce dont la copie (du XIVe et du XVe siècle) est conservée aux archives de Pau, alors les Béarnais entendirent parler avec éloge d'un chevalier de Catalogne, lequel avait deux fils jumeaux. Les gens du Béarn tinrent conseil, et envoyèrent deux prud'hommes lui demander pour seigneur un de ces enfants. Arrivés en Catalogne, ils allèrent les voir, et les trouvèrent endormis : l'un tenait les mains ouvertes, l'autre les tenait fermées.
Ils choisirent le premier, parce que ses mains ouvertes annonçaient qu'il serait libéral. Ce prince de trois ans, si singulièrement choisi, régna sur eux sous le nom de Gaston VI. Sa famille prit le nom de Moncade. Avec lui commença la seconde dynastie des seigneurs du Béarn.
Malgré sa libéralité envers les églises, Gaston VI fut excommunié comme albigeois. Sa soumission, ses protestations pacifiques ne purent lui faire obtenir grâce de Simon de Montfort, l'ambitieux et terrible capitaine chargé d'exécuter les sentences fulminées par le pape Innocent III. Gaston, obligé de se défendre, réunit ses troupes à celles de ses voisins excommuniés comme lui. Vaincu à Muret par Simon de Montfort, il rentra pourtant dans le sein de l'Église, et fut relevé de son excommunication par l'évêque d'Oloron, qui lui accorda sa grâce en échange des seigneuries de Sainte-Marie et de Catron. A la mort de Gaston, en 1215, les Béarnais lui donnèrent pour successeur son frère, Guillaume-Raymond.
Ce prince, dont la jeunesse avait été violente et orageuse, se montra un habile législateur. Sous lui fut établie une cour de justice composée de douze jurats : cette charge était héréditaire, et devint très importante. A ceux qui la remplissaient fut réservé bientôt le titre de baron à l'exclusion des autres gentilshommes.
Sous ses successeurs, dont l'histoire est insignifiante, le Béarn s'agrandit sans bruit par des héritages et des mariages avec des familles royales. C'était l'époque de la lutte entre l'Angleterre et la France ; ils prirent parti contre les Anglais, qui jamais ne franchirent la frontière de leurs États. Le dernier prince de la famille de Moncade, Gaston VII, se voyant mourir sans 'enfants mâles, choisit pour successeur son gendre, le comte de Foix ; mais les Béarnais exigèrent que leur pays restât distinct du comté de Foix, et Roger-Bernard, leur nouveau souverain, vint fixer sa cour à Orthez, la capitale des derniers princes de la maison de Moncade. C'est ici que commence la période la plus éclatante de l'histoire du Béarn.
Le plus illustre de ses princes fut Gaston Phoebus (1343), renommé en son temps parmi tous les chevaliers de la chrétienté pour sa beauté, sa bravoure et sa courtoisie envers les dames, « grand clerc d'ailleurs en fait de lettres, aimant les dons de ménétriers et s'y connoissant, et faisant lui-même des vers. » A quinze ans, Gaston fit ses premières armes contre les Maures d'Espagne. Il épousa Agnès de Navarre, soeur de Charles le Mauvais ; mais, loin de tremper dans les intrigues de son beau-frère, il défendit ses États contre les Anglais, refusant d'ailleurs de rendre hommage au roi de France pour le Béarn, et déclarant qu'il ne devait hommage qu'à Dieu.
Il fut le premier des souverains du Béarn à qui les états accordèrent des subsides ; ce qui en fit un riche seigneur. Il se lança dans les aventures et parcourut les pays étrangers. Il revenait, dit Froissart, en compagnie du captal de Buch, d'une croisade contre les païens de la Prusse, et était arrivé à Châlons en Champagne, lorsqu'il y apprit la pestilence et l'horribleté qui couroit alors sur les gentilshommes. C'était l'insurrection de la Jacquerie ; et les paysans, exaspérés par de longs siècles de misères et de cruautés, s'abandonnaient à d'affreuses représailles.
Un grand nombre de dames s'étaient réfugiées à Meaux, déjà menacé par les Jacques. Gaston Phoebus et le captal de Buch y courent ; la ville est déjà envahie. Ils pouvaient être quarante lances et non plus ; ils n'entreprirent pas moins de déconfire et de détruire ces vilains. Ce qui diminue un peu la valeur de leur résolution, c'est que, comme ajoute Froissart, les vilains estoient noirs et petits, et très mal armés, tandis que les chevaliers, couverts de fer, eux et leurs chevaux, des pieds à la tête, étaient à peu près invulnérables.
Ils se ruèrent sur les paysans et n'eurent qu'à tuer. « Ils les abattoient à grands monceaux, dit le chroniqueur, et les tuoient ainsi que bestes, et en tuèrent tant qu'ils en estoient tous lassés et tannés, et les faisoient saillir en la rivière de Marne. Finalement ils mirent à fin en ce jour plus de sept mille, et boutèrent le feu en la désordonnée ville de Meaux, et l'ardirent toute, et tous les vilains du bourg qu'ils purent dedans enclore. »
Animés par cette facile boucherie, les chevaliers poursuivirent les vilains, brillant et égorgeant sans merci, et dévastant le pays mieux que ne l'eussent pu faire les Anglais ; ce qui ne leur en attira pas moins beaucoup de gloire et un grand renom par toute la chrétienté.
Gaston, de retour dans ses États, eut à soutenir contre des seigneurs révoltés ou des voisins belliqueux des guerres plus difficiles. Il vainquit et fit prisonniers le sire d'Albret et le comte d'Armagnac ; il se réconcilia avec ce dernier, dont la fille fut fiancée au fils de Gaston. Gaston devint bientôt un très redouté seigneur, riche et fastueux, aimant les fêtes et les tournois ; la chasse, son plaisir favori, prenait une partie de son temps, et il entretenait une meute qui, dit-on, ne comprenait pas moins de seize cents chiens. Froissart, bien accueilli et choyé à la cour d'Orthez, ne tarit pas d'éloges sur ce prince, qui, en bien comme en mal, doit être cité comme un des types les plus caractérisés des temps féodaux.
Malgré sa courtoisie, des crimes, abominables même pour l'époque, souillèrent la mémoire de ce prince : il tua son frère naturel, Pierre Arnaud, attiré dans un guet-apens. Son jeune fils, touché du délaissement où Gaston tenait sa mère, reçut, un jour de Charles le Mauvais, son oncle, le conseil de jeter dans les aliments de sou père une certaine poudre qu'on lui donna, et qui devait rendre à sa mère tout l'amour de son mari. Le crédule enfant tente l'expérience ; la poudre était du poison. Son père demande vengeance aux états, qui essayent vainement de protéger contre le vicomte de. Béarn ce fils qu'ils regardent comme innocent.
Voici comment Froissart raconte la mort de l'enfant. Après avoir dit que le fils de Gaston, dans sa douleur, refusait de manger, et que les serviteurs du comte vinrent l'en prévenir, le chroniqueur ajoute : « Le comte, sans mot dire, se partit de sa chambre, et s'en vint vers la prison où son fils estoit ; et tenoit à la malheure un petit long couteau, dont il appareilloit ses ongles et nettoyoit. Il fit ouvrir l'huis de la prison, et vint à son fils ; et tenoit la lame de son couteau par la pointe, et si près de la pointe, qu'il n'y en avoit pas hors de ses doigts la longueur de l'épaisseur d'un gros tournois. Par maltalent, en boutant ce tant de pointe en la gorge de son fils, il l'assena ne sait en quelle veine, et lui dit : Ha ! traiteur, pourquoi ne manges-tu point ? Et tantôt s'en partit le comte sans plus rien dire ni faire, et rentra en sa chambre. L'enfant fut sang mué et effrayé de la venue de son père, avec cela qu'il estoit foible de jeûner, et qu'il vit ou sentit la pointe du couteau qui le toucha à la gorge comme petit fust, mais ce fust en une veine ; il se tourna d'autre part, et là mourut... Son père l'occit voirement, mais le roi de Navarre lui donna le coup de la mort. » Gaston n'avait pas d'autre enfant légitime ; il ne lui restait que deux bâtards.
D'ailleurs, il administrait ses États avec vigilance et habileté, et fut prud'homme en l'art de régner. Quand Froissart le vit à Orthez, « le comte Gaston de Foix avoit environ cinquante-neuf ans d'âge. Et vous dis que j'ai en mon temps vu moult chevaliers, rois, princes et autres ; mais je n'en vis oncques nul qui fut de si beaux membres, de si belles formes, ni de si belle taille, et visage bel, sanguin et riant, les yeux vairs et amoureux, là où il lui plaisoit son regard asseoir. De toutes choses il estoit si très parfait qu'on ne le pourroit trop louer. Il aimoit ce qu'il devoit aimer, et haïssoit ce qu'il devoit haïr. Sage chevalier estoit, et de haute emprise et plein de bon conseil. Il disoit en son retrait planté d'oraisons, tous les jours une nocturne du psaultier, heures de Notre-Dame, du Saint-Esprit, de la Croix et vigiles des morts, et tous les jours faisoit donner cinq francs en petite monnoie pour l'amour de Dieu, et l'aumône à sa porte à toutes gens.
« Il fut large et courtois en dons, et trop bien savoit prendre où il appartenoit, et remettre où il afféroit ; les chiens sur toutes bètes il aimoit, et aux champs, été ou hiver, aux chasses volontiers estoit. D'armes et d'amour volontiers se déduisoit.... Briefvement, tout considéré, ajoute Froissart, avant que je vinsse en cette cour, j'avois été en moult cours de rois, de ducs, de princes, de comtes et de hautes clames ; mais je ne fus oncques en nulle qui mieux me plut. » Évidemment, l'enthousiasme du bon Froissart se ressentait un peu de la générosité de Gaston Phoebus envers les étrangers ménétriers.
Le comte de Foix mourut subitement d'apoplexie au retour d'une chasse à l'ours (1390). Nous lui devons le livre intitulé : Phébus, des déduiz de la chasse des bestes sauvaiges et des oiseaux de proye, au début duquel il prend Dieu, la Vierge Marie et la sainte Trinité à témoin que pendant toute sa vie « il s'est délité par espécial en trois choses, l'une est en armes, l'autre est en amours, et l'autre si est en chasse. » Ce livre est encore de nos jours un des traités les plus complets de vénerie.
Son cousin, Matthieu de Castelbon, lui succéda, et mourut sans enfants ; en lui s'éteignit la ligne masculine de la maison de Foix. Sa soeur, Isabelle, qui lui succéda, épousa Archambault de Grailli, captal de Buch, qui prit le nom de Foix. Ses descendants n'ont joué aucun rôle important jusqu'au jeune et vaillant Gaston de Foix, duc de Nemours, le compagnon d'armes de Bayard, qui fut tué à l'âge de vingt-trois ans, en 1512, à la bataille de Ravenne, en poursuivant les ennemis qu'il venait de vaincre.
Le mariage d'un de ces princes avec l'héritière du royaume de Navarre avait augmenté la puissance de cette maison ; mais le duc d'Albe, au nom de Ferdinand le Catholique, enleva aux comtes de Béarn la plus grande partie de ce royaume, et les réduisit à la basse Navarre. A la maison de Foix avait succédé celle d'Albret (1500), dont un des membres, Jean II, avait épousé Catherine de Foix. Henri d'Albret, son fils, combattit vaillamment à Pavie aux cotés de François Ier ; fait prisonnier avec lui, il reçut après sa délivrance le prix de son dévouement en épousant la sœur du roi, la brillante Marguerite, si connue par l'élégance de son esprit, et qui nous a laissé dans ses contes une fidèle peinture des mœurs licencieuses de cette époque.
Jeanne d'Albret (1555), fille de Henri, épousa Antoine de Bourbon. Ce prince, après avoir embrassé le calvinisme, l'abjura ; sa femme, au contraire, quitta le catholicisme, et demeura inébranlable dans sa nouvelle religion. Marguerite de Navarre avait déjà favorisé le calvinisme ; Jeanne, devenue seule souveraine du pays depuis la mort de son mari tué au siège de Rouen, établit en Béarn l'exercice public du culte réformé.
Protestante rigide, elle honore ses convictions par ses vertus, par l'élévation de son esprit et de son coeur ; elle le propage avec ardeur au moyen de ministres instruits. Le pape fait afficher un décret du saint office sommant Jeanne de comparaître en personne comme suspecte d'hérésie, et prononçant en cas de refus la confiscation de ses domaines ; la cour de France obtint du pape qu'il suspendît la publication de ce décret.
Mais Jeanne ayant fourni des secours au prince de Condé, chef des protestants, Charles IX fait déclarer Jeanne rebelle et prononcer la confiscation de ses terres par le parlement de Bordeaux. Le féroce Blaise de Montluc est chargé d'exécuter l'arrêt ; il marche sur le Bigorre, tandis que son lieutenant Terride répand la terreur dans le Béarn. Le sire de Terride s'empare de Pau, et convoque les états, qui protestent contre l'envahissement du pays.
Mais Jeanne a réuni une armée ; le terrible Montgomery en est le chef, il envahit le Béarn, le reconquiert en quinze jours, et exerce d'affreuses représailles. Maître des dix principaux chefs catholiques qui s'étaient enfermés avec Terride dans le fort Moncade, et qu'il amène à capituler en leur promettant la vie sauve, il les fait poignarder au mépris de la foi jurée : Terride seul échappe, on ne sait comment. Jeanne rentre dans ses États et y rétablit la foi protestante.
Elle commit, comme la plupart des chefs de la religion réformée, l'imprudence de se fier aux avances de ses ennemis ; elle se laissa entraîner à la cour de Charles IX par Catherine de Médicis, qui lui proposait le mariage de sa fille avec le prince de Béarn (depuis Henri IV). Jeanne se rend à Paris, et meurt peu de temps après, empoisonnée, dit-on. « C'estoit, dit Agrippa d'Aubigné, une femme n'ayant de femme que le sexe, l'âme en fière aux choses viriles , I'esprit puissant aux grandes affaires, le cour invincible aux grandes adversités. » Elle fut la mère de Henri IV.
Nous n'avons pas à raconter la vie de ce prince, dont l'histoire appartient moins au Béarn qu'à la France. Rappelons seulement ce qui se rapporte plus particulièrement à son pays natal. Henri rétablit en Béarn la religion catholique, dont sa mère avait proscrit l'exercice public après l'invasion de ses États par les troupes du roi Charles IX.
Les états rassemblés à Pau protestent contre l'édit du roi, et de nouveaux désordres ensanglantent le pays. Mais bientôt, après le massacre de la Saint-Barthélemy, Henri révoque l'édit, et vient visiter ses États avec sa femme Marguerite de Valois. Il donne aux Béarnais pour régente sa sœur Catherine, qui réussit à s'en faire aimer. Devenu roi de France, Henri s'occupa du Béarn, flatta ses premiers sujets au point de leur dire qu'il avait « donné la France au Béarn, et non le Béarn à la France." C'est dans ces paroles, comme en beaucoup d'autres, qu'on reconnaît la vérité du jugement de d'Aubigné sur lui : « C'estoit le plus rusé et madré prince qu'il y eut jamais. » Sa mort fut sentie en Béarn plus vivement qu'en aucun lieu de la France.
Louis XIII, malgré la résistance des états, réunit la Navarre et le Béarn à la couronne de France, ce que son père n'avait osé tenter. L'opposition fut si vive, que le roi jugea à propos d'aller lui-même à Pau, détruisit l'ancienne organisation du pays, supprima les conseils souverains de Béarn et de basse Navarre, et établit un parlement unique siégeant à Pau. Il laissa cependant au pays ses états, qui, du reste, ne se réunirent plus que pour voter l'impôt.
Depuis cette époque, le Béarn n'a plus joué un rôle distinct dans notre histoire. Seulement, au commencement de la Révolution, les Béarnais, inspirés par un étrange esprit de patriotisme local, hésitèrent à nommer des députés à l'Assemblée constituante ; ils finirent pourtant par s'y décider, mais continuèrent à montrer un esprit hostile à la Révolution. Chose non moins extraordinaire, aucune réaction violente ne vint, de la part des révolutionnaires, châtier un pays si mal disposé, et le Béarn, qui avait paru songer un moment à se reconstituer en un pays indépendant, se laissa tranquillement enclaver dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Aux annales du Béarn succède l'histoire du département dans lequel il a été incorporé, et les événements dont il a été le théâtre participent à 1a grandeur de la nouvelle patrie. Le mot historique : « Il n'y a plus de Pyrénées » n'a pas toujours été un oracle de paix depuis l'union des deux branches de la famille de Bourbon. La cour de Madrid manifesta des intentions hostiles contre la Révolution ; mais l'établissement d'un camp au pied des Pyrénées, quelques démonstrations vigoureuses, et l'influence des victoires des armées républicaines sur les autres frontières, imposèrent à l'Espagne sa neutralité à défaut de sympathie.
Les Pyrénées furent franchies par les armées de Napoléon Ier qui, pour assurer le succès de son rêve continental, voulait avoir un membre de sa famille sur le trône des héritiers de Philippe V. L'intervention de l'Angleterre venant en aide aux résistances nationales, les Pyrénées virent reculer pour la première fois nos aigles victorieuses. Une sorte de revanche fut prise sous la Restauration, lors qu'un arrière-neveu de Philippe V, le duc d'Angoulême, alla défendre le trône bourbonien menacé par la junte insurrectionnelle de Cadix, se contentant des stériles exploits du Trocadéro.
Depuis lors, les échos des Pyrénées n'ont été réveillés que par des bruits de guerre civile et des brigandages que les autorités françaises ont eu à surveiller et à réprimer, mais sans aucune participation directe. Le mariage de Napoléon III avec une comtesse espagnole ne fut, pour le département, l'occasion d'aucune faveur spéciale ; il y gagna toutefois, au cours du règne, des embellissements et des libéralités pour quelques localités visitées ou affectionnées par l'épouse du souverain.
Les départements et leur histoire - Puy-de-Dome-63-
Le département du Puy-de-Dôme occupe environ les trois cinquièmes de l'ancienne province d'Auvergne, dont le Cantal, une partie de la Haute-Loire, de la Creuse et de la Corrèze complètent la circonscription.
Ce pays était occupé lors de l'invasion romaine, par une des plus puissantes tribus de l'ancienne Gaule, les Arvernes (ar, haut ; verann, habitation), dont la domination ou l'influence s'étendait depuis le Tarn et les Cévennes jusqu'au cours supérieur de l'Allier, du Cher et de la Creuse, et depuis la Vezère et la Corrèze jusqu'à la haute Loire. Ils avaient pour clients les Vellavi (Velay), les Gabali (Gévaudan), les Rutheni (Rouergue), et pour alliés les Cadurci (Quercy), le dernier peuple de la Gaule qui subit la domination romaine. Le roi des Arvernes pouvait lever deux cent mille combattants et tenir en échec les puissantes tribus des Éduens, des Séquanes et des Bituriges.
La capitale de l'Arvernie était Gergovia (près de Romagnat, à 6 kilomètres au sud de Clermont), dont le nom disparaît de l'histoire après l'héroïque défense de Vercingétorix. Après sa destruction, il n'est plus question que de Nemetum ou Nemossus (aujourd'hui Clermont), qui s'élevait dans le voisinage de Gergovie.
Nous ne savons rien des événements dont ce pays a été le théâtre pendant la domination gauloise. Des guerres de peuplade à peuplade, des incursions sur des territoires peu ou point limités, des alliances conclues ou rompues, le tout sans résultats politiques importants, sans noms historiques, sans chronologie ; voilà ce que nous connaissons des Arvernes, comme de leurs voisins, avant l'arrivée des légions romaines.
Leur nom figure parmi ceux des tribus gauloises qui, dès l'an 150 de Rome, vinrent, sous la conduite de Bellovèse et de Sigovèse, s'établir dans le nord de l'Italie, appelé, de cette invasion, Gaule cisalpine. Luer, Luern ou Luérius est le premier roi dont il est fait mention ; il régnait vers l'an 130 avant notre ère ; il s'est rendu célèbre par sa magnificence et ses libéralités. Son fils Bituit s'est fait un nom illustre parmi les chefs de la Gaule ; avec lui commence l'histoire de l'Arvernie, c'est-à-dire l'histoire de la décadence et de l'asservissement de sa nation.
Les Romains avaient pénétré jusque chez les Allobroges (Savoie et Dauphiné) ; la conquête de ce territoire devenait pour les Arvernes une menace imminente d'invasion. Bituit offrit sa médiation ; il envoya au consul Domitius Abenobarbus une ambassade qui lui permit d'étaler aux yeux des austères conquérants toute la pompe d'un roi barbare, mais qui n'eut aucun résultat. Il se hâta d'appeler aux armes sa nation et ses clients, et leva une armée qu'on n'évaluait pas à moins de deux cent mille hommes. Mais il n'arriva que pour assister à la défaite de ses alliés ; tout ce qu'il put faire, ce fut d'empêcher les vainqueurs de poursuivre momentanément leurs succès.
Il ne les arrêta pas longtemps. Le consul Fabius Maximus vint amener à son collègue un renfort de vingt mille hommes. Bituit se porta au-devant de l'ennemi, franchit le Rhône et offrit la bataille (121 avant J.-C.). Plein de confiance dans le nombre de ses soldats, il regardait avec mépris cette poignée d'envahisseurs qui se proposait de dicter des lois à une grande nation. « Il n'y a pas là de quoi nourrir mes chiens, » disait-il dans son orgueilleux dédain.
Cependant la tactique parut un instant céder au nombre. Fabius fit alors charger les éléphants. C'était la première fois que les Arvernes se trouvaient en présence de pareils ennemis. La panique se mit dans les rangs ; ce fut un sauve-qui-peut général ; on compte qu'il périt, tant sous le fer de l'ennemi que dans les eaux du Rhône, plus de cent vingt mille hommes. Ce chiffre, quelque énorme qu'il soit, ne paraîtra pas exagéré, du moins quant à la proportion des morts sur le nombre des combattants, si l'on songe qu'à cette époque les batailles se terminaient presque par l'extermination de l'armée vaincue, témoin la défaite des Cimbres et des Teutons par Marius.
Bituit, assez heureux pour échapper au massacre, s'enfuit dans les montagnes, laissant au vainqueur son char et ses trésors. A quelque temps de là, Domitius l'attira dans une entrevue, sous prétexte de propositions de paix, et le fit traîtreusement prisonnier. L'infortuné Bituit fut envoyé à Rome pour figurer dans la solennité des honneurs du triomphe décernés à ses vainqueurs. Il mourut à Albe. Son fils Congentiat, amené également à Rome, où le sénat avait promis de le faire instruire, disparut, sans que l'on sût jamais ce qu'il était devenu. Malgré la grandeur d'un tel échec, les Arvernes ne furent point traités en peuple conquis. Les Romains n'étaient pas encore en mesure de se maintenir dans le pays.
Bituit n'eut point de successeur. La nation resta constituée en une sorte de république, sans chef prépondérant, et Celtill, pour avoir aspiré à la royauté, fut mis à mort par ses concitoyens.
Ce fut vers l'an 58 avant J.-C. que César pénétra dans les Gaules. Il venait au secours des Éduens, menacés de dépossession par les Helvètes et les Germains d'Arioviste. En quelques mois, le général romain refoula les envahisseurs dans leurs montagnes et au delà du Rhin, avec des pertes considérables. Mais, au lieu d'un allié, les Éduens avaient amené un maître.
La prodigieuse activité par laquelle César soumit, en quelques années, toute la Gaule et la Grande-Bretagne fera l'éternel étonnement de l'histoire. Cependant, si l'on considère que, dans leurs guerres de tribus à tribus et de nation à nation, il s'agissait, entre barbares, non d'une question de prédominance, mais de la possession même du sol, on sera moins surpris de la facilité avec laquelle les Gaulois subirent la domination romaine, qui leur laissait leurs champs, leurs villes, une partie de leurs institutions, et ne leur imposait qu'un tribut et une garnison.
C'était la civilisation instruisant la barbarie. Aussi, le héros romain est-il populaire chez ceux mômes qu'il vient de soumettre. Toutefois, ce travail d'éducation est avant tout l'oeuvre du temps, et avant qu'il ait porté ses fruits, les puissances déchues n'ont pas renoncé à ressaisir leur influence. Si la masse, qui n'a fait que changer de maîtres, accepte une autorité qui s'annonce d'abord par des bienfaits, les chefs, les bardes, les prêtres, les grands feront appel à tous les sentiments de religion, de patrie, d'indépendance, afin d'entraîner les peuples à la révolte et de ressaisir leur suprématie.
Le retour de César en Italie et son séjour prolongé à Rome parurent aux Gaulois une occasion favorable de prendre l'offensive. Les Arvernes, qui avaient subi sans trop de résistance la conquête, se trouvent cette fois les meneurs de l'insurrection nationale. Vercingétorix, qu'ils viennent de placer à leur tête, devient le chef de tous les confédérés. Ce n'était plus une révolte que les Romains avaient à combattre, mais le soulèvement général d'un peuple, jusque-là divisé, mais uni cette fois contre l'ennemi commun, et résolu, pour l'affamer, à ne laisser derrière lui que la ruine et la mort.
A la nouvelle des événements, César quitte brusquement l'Italie, franchit les Alpes Maritimes et parait tout à coup sur le territoire des Arvernes, brûlant et saccageant tout, afin de faire un exemple et de contenir les populations par la terreur des représailles. Vercingétorix était alors chez les Bituriges avec son armée. Il revient à la hâte défendre son pays. Déjà le général romain, laissant un détachement sous les ordres de son lieutenant Brutus, est allé rejoindre ses légions cantonnées au pays des Lingons. Il reparaît à la tête de nouvelles forces en Arvernie et vient mettre le siège devant Gergovia. Mais la résistance des assiégés et le soulèvement des Eduens l'obligent à la retraite.
Encouragé par le succès, Vercingétorix poursuit l'armée romaine jusque hors de son territoire, sur les bords de la Saône ; malheureusement, il a l'imprudence d'offrir la bataille. Ce n'était pas la bravoure qui manquait aux Gaulois. Aussi la mêlée fut-elle des plus sanglantes. Cependant le nombre dut céder encore à la tactique, et le chef arverne fut trop heureux d'échapper au massacre avec quelques débris de son armée.
La défaite n'abattit pas ses espérances ; il réussit à rallier quatre-vingt mille hommes et s'enferma dans Alésia (Alise), une des forteresses les plus redoutables de la Gaule. La résistance ne fut pas moins opiniâtre qu'à Gergovie ; mais Alésia fut forcée de se rendre, et Vercingétorix, fait prisonnier, fut envoyé à Rome et lâchement assassiné dans sa prison six ans plus tard. Ce fut le dernier effort de l'indépendance. A dater de ce moment (l'an 705 de Rome), et jusqu'à l'invasion des barbares, la Gaule n'est plus qu'une province de l'empire.
Les Romains, cruels jusqu'à la lâcheté envers leurs ennemis, comme on l'a vu par l'exemple de Bituit et de Vercingétorix, ne s'occupaient plus, après la victoire, que des moyens de s'attacher les vaincus. Comprise dans la Gallia comata (Gaule chevelue), Nemetum, la nouvelle capitale de l'Arvernie, eut son capitole, son sénat, ses monuments, ses écoles.
En reconnaissance des bienfaits d'Auguste, elle voulut s'appeler Augusto-Nemetum. Elle eut bientôt des savants, des artistes, des orateurs dont la réputation ne le céda en rien à ceux de la métropole : Marcus Cornélius Fronton, professeur d'éloquence, atteignit une telle célébrité qu'il fut mandé à Rome, où il devint l'instituteur et l'ami de Marc-Aurèle ; plus tard, nous trouvons les Avitus, Sidoine Apollinaire, etc.
Le christianisme ne commença d'être prêché aux Arvernes que vers l'an 250. L'Église a consacré le souvenir des premiers apôtres de ce pays : saint Austremoine, saint Alyre, saint Népotien, saint Rustique, saint Éparque. Elle tient également en vénération la mémoire du sénateur Injuriosus, qui vécut avec sa femme dans une perpétuelle continence et dont l'histoire se trouve rapportée au long dans Grégoire de Tours.
Malgré ses montagnes et les fortifications naturelles dont elle se trouve protégée, l'Arvernie ne fut point à l'abri des incursions des barbares. Elle fut ravagée tour à tour par les Vandales, les Mains, les Suèves ; Crocus, chef d'une de ces bandes, pénétra jusqu'à Nemetum et détruisit le fameux temple de Wasso, l'une des merveilles de l'antiquité.
Les Huns y passèrent à leur tour (439). Trop faibles pour résister à l'invasion, les empereurs romains avaient cru prudent de lui faire sa part. Dès 419, Honorius avait cédé l'Aquitaine aux Wisigoths. En 475, Népos dut acheter quelques moments de trêve en leur cédant encore l'Auvergne, où ils avaient déjà fait une incursion l'année précédente. Ils la gardèrent trente-deux ans ; et, après la bataille de Vouillé, qui leur fit perdre toutes leurs possessions des Gaules, l'Auvergne passa sous la domination des rois francs, comme partie du royaume d'Austrasie (507). Thierry, fils de Clovis (511-534) fut obligé de reconquérir cette partie de ses États sur Childebert, roi de Paris, qui, pendant que son frère était occupé au delà du Rhin, s'était emparé de Clermont.
Le règne de Théodebert (534-547) et celui de Théodebald (547-553) permirent aux Auvergnats de réparer les désastres des invasions précédentes. Clotaire Ier, roi de Soissons et bientôt après de toute la monarchie franque, confia le gouvernement de l'Auvergne à son fils Chramne, dont la révolte ramena encore une fois les fléaux de la guerre sur cette province. Vaincu par ses frères Caribert et Gontran, le nouvel Absalon périt au milieu des flammes (560).
L'Auvergne, ravagée encore une fois en 573 par les Saxons, fut comprise dans le royaume d'Aquitaine, fondé en 630 par Dagobert en faveur de son frère Caribert. Pendant un siècle et demi, les annales se taisent sur les événements politiques de cette contrée. A défaut de chefs de hordes, promenant après eux le pillage et l'incendie, elles conservent les noms de quelques bienfaiteurs de la civilisation : saint Gal ; saint Avit, qui fit construire, en 580, l'église du Port ; saint Genès, d'une famille sénatoriale, qui fonda deux monastères et un hospice ; saint Bonnet, grammairien et jurisconsulte ; saint Avit II.
De 730 à 732, invasion des Sarrasins ; de 750 à 768, guerre entre Waïfre, duc d'Aquitaine, et Pépin, chef de la seconde dynastie franque. Nouveaux désastres pour le pays. Clermont est livré aux flammes (761). Au IXe et au Xe siècle, incursions des Normands.
C'est de la domination des rois d'Aquitaine que date la création du comté d'Auvergne, dont les titulaires, d'abord simples gouverneurs amovibles, finirent par se rendre héréditaires. Guillaume le Pieux, le premier comte par droit de succession, succéda à son père Bernard en 886. En 893, Eudes le nomma roi d'Aquitaine. Cependant la suzeraineté du comte de Poitiers fut presque constamment reconnue.
Les Auvergnats, qui avaient subi plutôt qu'accepté l'autorité des Carlovingiens, ne se montrèrent pas moins hostiles aux fondateurs de la troisième race. La déposition de Charles le Simple ne les empêcha point de dater leurs actes par les années de son règne ; et, après sa mort, ils adoptèrent la formule : « Christo regnante, Rege deficiente ; Christ régnant, le roi manquant. »
Au XIe siècle s'arrêtent les incursions des barbares.. Indigènes et conquérants ont fini par trouver place sur le sol. La nouvelle société est en travail d'organisation. Ce sont les beaux jours de la féodalité. En attendant que la puissance royale, confisquant à son profit toutes les suzerainetés secondaires, ne reconnaisse plus dans les provinces que des gouverneurs amovibles, chaque pays, chaque canton va avoir son seigneur.
A côté des comtes d'Auvergne surgissent ceux de Murat, de Carlat, de Thiers, de Mercoeur, de Brioude, etc. Aux seigneuries laïques viennent s'ajouter les fiefs ecclésiastiques : le chapitre de Clermont, l'abbaye de Saint-Austremoine, celles de Mauzac, de Mauriac, d'Aurillac, de La Chaise-Dieu. C'est la guerre civile en germe ; elle ne tardera pas à faire oublier les maux de l'invasion. Toutefois la première croisade, résolue au concile même de Clermont (1095), en réunissant toutes les activités vers un but commun, arrête un instant l'explosion des querelles intestines. Mais, dès 1121, Guillaume VI entre en campagne contre l'évêque, qui appelle à son secours le roi Louis le Gros. Le comte est forcé de céder. Son fils Robert III va à son tour chercher querelle aux chanoines de Brioude.
A sa mort, son fils Guillaume VII le Jeune était en Terre sainte ; son frère puîné, Guillaume VIII le Vieux, s'empara du comté. Les deux compétiteurs en appelèrent à leurs suzerains ; l'oncle s'adressa au roi de France, le neveu au duc d'Aquitaine, qui était alors Henri II, roi d'Angleterre. La querelle des vassaux venait de soulever une question de compétence, il en sortit la guerre entre les suzerains.
Les deux Guillaume s'arrangèrent par un partage, et Guillaume le Jeune devint la souche des comtes de Dauphiné. La guerre n'en continua pas moins entre les rois de France et les rois d'Angleterre. Les ceintes se déclarèrent contre le premier, et Philippe-Auguste fut obligé de reconquérir une à une toutes les places de l'Auvergne (1213). Saint Louis en rendit une partie à Guillaume X (1230).
Le XIIIe et le XIVe siècle nous montrent la bourgeoisie aux prises avec les seigneurs. C'est la lutte des communes pour leur affranchissement, lutte autrement féconde que les querelles des hobereaux et des abbés. Les cités d'Auvergne obtinrent sans trop de résistance leurs franchises, et dès le commencement du XIVe siècle, treize villes avaient leurs représentants aux états provinciaux.
A cette époque, les comtes d'Auvergne semblèrent accepter complètement la suzeraineté royale et ne se signalèrent plus que par leur zèle à servir la couronne. Nous les trouvons avec leurs vassaux et toute la noblesse aux guerres de Flandre et aux combats d'Azincourt, de Crécy, de Poitiers. Citons, en passant, la mort tragique d'un comte de la branche aînée, le templier Gui, brûlé avec Jacques Molay, en 1313.
Le traité de Brétigny vint distraire l'Auvergne de l'administration royale en la constituant en duché-pairie au bénéfice de Jean, troisième fils du roi, à qui ce même traité enlevait le comté de Poitou, cédé aux Anglais. La fin du XIVe siècle fut signalée par les ravages des Anglais, des grandes compagnies et par la révolte des paysans contre leurs seigneurs. Béraud II, dauphin, et Louis II, duc de Bourbon, firent de vains efforts pour arrêter les désordres.
Le XVe siècle vit éclore sous les auspices des ducs de Bourbon, comtes d'Auvergne, deux révoltes contre le pouvoir royal : la première, la Praguerie, comptait parmi ses chefs le dauphin, depuis Louis XI ; la seconde, la ligue du Bien public, était dirigée contre ce même prince devenu roi. Ces deux insurrections trouvèrent peu de partisans chez les Auvergnats ; aussi la couronne en eut-elle bon marché.
En 1510, réunion des trois états de la province, afin de mettre en harmonie les coutumes et le droit écrit et d'arriver à une sorte d'unité de législation. 1533, voyage de François Ier allant au-devant de Catherine de Médicis, fiancée à son second fils Henri ; il passe par l'Auvergne, où on lui offre des fêtes splendides.
Nous arrivons aux guerres de religion. Les doctrines de la Réforme avaient pénétré en Auvergne et y avaient trouvé de zélés partisans. Les supplices et les exécutions ne pouvaient manquer de suivre. En 1548, Jean Brugière, du village de Piernoël, avait été brûlé vif à Issoire ; en 1553, Antoine Magne, d'Aurillac, avait été supplicié à Paris. En 1561, massacre de tous les protestants d'Aurillac. C'était assez de violences pour légitimer la révolte. Les protestants levèrent une armée et battirent les catholiques en 1568. Les succès de chacun des deux partis furent signalés par des atrocités et des supplices. La ville d'Issoire dut à sa qualité de place forte d'être assiégée, pillée et saccagée par les huguenots et par les catholiques.
L'Auvergne ne sortit des troubles religieux que pour tomber dans ceux de la Ligue. Les rebelles avaient à leur tête, dans cette province, Louis de La Rochefoucauld, comte de Randon, gouverneur du pays, et son frère François, évêque de Clermont. La population résista tant qu'elle put à l'entraînement des partis. Mais la guerre n'en dévasta pas moins la contrée, et ce fut encore la malheureuse ville d'Issoire qui en paya les frais. Les royalistes s'en emparèrent en 1590, le jour même où Henri IV gagnait la bataille d'Ivry. Ce fut la ruine de la Ligue.
En 1606, l'Auvergne se trouve définitivement réunie à la couronne ; nous résumons ici les mutations qu'elle a subies jusqu'à cette époque. Nous avons parlé du partage qui eut lieu vers 1155 entre Guillaume VII et Guillaume VIII. Le Dauphiné d'Auvergne resta dans la famille de Guillaume VII jusqu'en 1436 ; à cette époque, il passa dans la maison de Bourbon-Montpensier, par la mort de Jeanne, femme de Louis de Bourbon, décédé sans postérité.
Le comté d'Auvergne proprement dit subit encore un démembrement. Gui II, troisième successeur de Guillaume VIII, était en guerre avec son frère, l'évêque de Clermont. Ce dernier appela à son secours le roi de France Philippe-Auguste. Le comte, vaincu, fut dépouillé de son titre, dont fut investi Gui de Dampierre. La famille du nouveau seigneur s'éteignit en la personne de son fils. Le comté, réuni à la couronne, fut de nouveau constitué en apanage, en 1225, par Louis VIII, et divisé en deux parts : la plus considérable, érigée en duché, fut donnée à Alphonse, comte de Poitou, second fils du roi ; l'autre fut rendue par saint Louis à Guillaume X, fils de Gui II, dépossédé par Philippe-Auguste.
Le duché, réuni à la couronne à la mort d'Alphonse, reconstitué au bénéfice de Jean de France, duc de Berry, fut cédé, en 1416, à la maison de Bourbon, déjà maîtresse du Dauphiné. La confiscation des biens du connétable (26 juillet 1527) fit rentrer à la couronne ces deux fiefs importants. Quant au comté rendu à Guillaume X, il resta dans la mémo famille jusqu'en 1505. A cette époque, Jeanne,. héritière de Jean III, se voyant sans postérité, légua ses biens à Catherine de Médicis, sa nièce par son mariage avec Henri II.
Le comté échut par héritage à Marguerite de Valois, soeur de Henri III et première femme de Henri IV. Elle en fit don au dauphin, depuis Louis XIII (1606), et l'annexion de toute la province à la couronne se trouva complète.
L'histoire de l'Auvergne se confond, à dater de ce moment, dans l'histoire générale. Nous devons mentionner la tenue des Grands-Jours à Clermont, en 1665. Les guerres de religion et les troubles de la Fronde causèrent de grands désordres en Auvergne et dans le centre de la France ; l'autorité royale y était méconnue, et la plupart des nobles et des seigneurs y avaient ramené les tyrannies et les exactions de la féodalité.
Le roi et le parlement s'émurent des plaintes qui leur parvenaient, et, le 31 août 1665, une déclaration royale ordonna la tenue d'une juridiction ou cour, vulgairement appelée les Grands-Jours, dans la ville de Clermont, pour l'Auvergne, le Bourbonnais, le Nivernais, le Forez, le Beaujolais, le Lyonnais, la Combrailles, la Marche et le Berry. Un président au parlement, Potier de Novion, un maître des requêtes, Caumartin, seize conseillers, un avocat général, Denys Talon, et un substitut du procureur général furent désignés pour tenir ces assises extraordinaires.
Leurs pouvoirs étaient à peu près absolus. L'arrivée des commissaires royaux, de Messieurs des Grands-Jours, comme on les appelait, produisit dans toute l'Auvergne une émotion extraordinaire. Le peuple accueillit les magistrats parisiens comme des libérateurs, et l'on a conservé un remarquable monument de sa joie, c'est le Noël des Grands-Jours. La terreur, au contraire, planait sur les châteaux ; une foule de gentilshommes quittaient la province ou se cachaient dans les montagnes ; d'autres s'efforçaient d'amadouer les paysans, et ceux que avaient été les tyrans des pauvres devenaient leurs suppliants. Fléchier, alors simple abbé, âgé de trente-trois ans, qui accompagnait M. de Caumartin en qualité de précepteur de son fils, a laissé une curieuse relation de son voyage en Auvergne et de ces assises judiciaires.
Le vicomte de La Mothe-Canillac fut condamné à mort et exécuté, ainsi que le sieur de Veyrac ; le marquis Jacques-Timoléon de Montboissier-Canillac, l'Homme aux douze Apôtres ; Gaspard, marquis d'Espinchal ; le comte d'Apchier ; les comtes du Palais, alliés à la maison de Turenne ; le baron de Sénégas, et bien d'autres, furent condamnés par contumace, leurs châteaux furent démolis et leurs biens confisqués.
Il y eut 273 contumaces condamnés au gibet, 96 au bannissement, 44 à la décapitation, 32 à la roue et 28 aux galères. De sages règlements furent édictés pour prévenir le retour des abus de la noblesse. Les Grands-Jours furent levés après trois mois d'assises, d'octobre 1665 à janvier 1666, et une médaille, frappée à cette occasion, en consacra la mémoire. L'effet moral qu'ils avaient produit fut très considérable. La dernière secousse violente imprimée au pays fut la révocation de l'édit de Nantes (1685). Des villes entières furent ruinées par cet acte impolitique que l'histoire a reproché au grand roi.
Les départements et leur histoire -pas de Calais- 62
L'histoire de ce département est toute dans son nom : Pas-de-Calais, passage de Calais ; c'est de là qu'on passe le plus aisément du continent dans cette grande île voisine qui s'allonge, jalouse et fière, en face de nos côtes. Pas de Calais, c'est le nom de ce canal étroit au delà duquel on aperçoit, de notre territoire, le rivage de l'Angleterre. Partout ailleurs, nos côtes se retirent devant elle, excepté pourtant la presqu'île du Cotentin (département de la Manche), qui la menace de Cherbourg. Mais Cherbourg est moins hardie ; elle s'arrête à 25 lieues ; Calais se pose audacieusement jusqu'à 8 lieues de la grande puissance rivale, audace tantôt glorieuse pour notre pays et tantôt fatale.
Ce rivage a porté au-devant de la Grande-Bretagne tous ceux qui ont voulu l'aller chercher chez elle, depuis le conquérant des Gaules, qui, deux fois, descendit chez les Bretons d'autrefois, jusqu'à cet autre conquérant qui avait juré la ruine d'Albion, et qui, moins heureux que César, ne put donner à ses soldats la conquête qu'il leur avait montrée du doigt. Ce même rivage, en des jours de plus triste mémoire, a servi de premier marchepied à ces mêmes ennemis que jamais nous n'avons pu troubler dans le repos de leurs foyers. Trop rapproché d'eux alors, il leur offrait une prise facile, et, pour peu qu'ils étendissent le bras, ils saisissaient Calais, Boulogne et se trouvaient maîtres des poternes de la France.
La première fois qu'une armée franchit le détroit, ce fut sous Jules César. Il venait de rejeter au delà du Rhin les Germains qui menaçaient de lui disputer la Gaule ; il voulut de même refouler dans la Bretagne les secours et les inspirations que les peuples gaulois recevaient de ce foyer de la religion druidique. Il s'embarqua dans le pays des Morins. Les Morins, les Atrebates (d'où Arras), tels étaient les peuples qui occupaient notre département et qui venaient de reconnaître, non sans une glorieuse résistance, l'empire des aigles romaines.
Parti de chez eux, César reparut bientôt, vainqueur des Bretons et pourtant forcé de revenir sur ses pas ; mais déjà, par les soins de Labiénus, une flotte mieux équipée se préparait à Itius portus, qu'on croit être aujourd'hui Wissant, et César, avec ces ressources nouvelles, fut cette fois plus heureux. A Itius portus fut établie une des grandes stations navales de l'empire romain.
Mais les siècles s'écoulent ; Alains, Suèves, Vandales, Burgondes, franchissant le Rhin inférieur, inondent, ravagent les Belgiques et ce pays même des Morins, attribué par Honorius à la Belgique IIe. Ce torrent passe et va, bruyant et dévastateur, se perdre au loin dans les sables de l'Afrique ; cependant notre province respire à peine, que déjà les Francs y pénètrent et en font une de leurs premières conquêtes.
Les Mérovingiens y règnent pendant tout le cours de leur existence ; comprise dans toutes les vicissitudes des partages, elle appartient au royaume de Soissons, quand les fils de Clovis, en 511, font quatre morceaux de la Gaule ; plus tard, quand la division, moins arbitraire et plus réelle, en Neustrie et en Austrasie prévaut dans l'empire des Francs, elle se trouve rattachée à la Neustrie, c'est-à-dire au pays qui deviendra français, et que le cours de l'Escaut sépare de l'Austrasie, destinée à être longtemps germanique.
Alors que la dynastie carlovingienne en décadence voyait les bénéficiers retenir insolemment et transmettre à leurs héritiers des terres que les rois et les empereurs ne leur avaient point données à ces conditions, le pays des Atrebates fut un des derniers à partager le sort des autres parties de la Gaule et à sortir des mains du souverain pour passer dans celles d'un bénéficier ; ce n'est qu'en 863 que Charles le Chauve l'aliéna en autorisant sa fille Judith à le porter en dot au comte de Flandre, qui en fut souverain pendant plusieurs siècles.
Un mariage l'avait donc détaché de la couronne ; un mariage l'y ramena. Les mariages jouaient un grand rôle dans le monde féodal. Ils rassemblaient tour à tour et séparaient les provinces, les fiefs. C'étaient bien plutôt les terres qui s'épousaient que les seigneurs et les nobles dames. Philippe-Auguste épousa (1180) la nièce du comté de Flandre, Isabelle, qui avait en dot le pays d'Artois (Atrebatensis terra). Ce pays n'était pas encore un comté. Il ne reçut ce titre qu'en 1238, et déjà il était séparé de nouveau de la couronne ; il est vrai que c'était à d'autres conditions qu'auparavant : saint Louis venait de le donner en apanage à son frère cadet, Robert, de sorte que l'Artois fut une des premières provinces qui servirent à former cette chose toute nouvelle et pleine de si graves conséquences, les apanages, par lesquels la maison royale trouvait moyen d'établir partout ses propres membres et de former une féodalité nouvelle 'toute dévouée.
Grâce à son titre de frère de saint Louis, le premier comte d'Artois faillit devenir empereur d'Allemagne. Le pape lui offrait cette couronne, qu'il voulait arracher à Frédéric II. Mais les états du royaume de France répondirent « qu'il suffisoit a M. le comte Robert d'être frère du roi de France, qui était le plus grand prince de la terre, » et refusèrent cette offre. Ce n'est pas sur le trône impérial, mais bien tristement, loin de sa patrie, que devait mourir le malheureux Robert. Il accompagna saint Louis dans la septième croisade.
Il était un des plus vaillants et des plus téméraires parmi toute cette chevalerie brillante qui fit connaître sa bravoure aux musulmans des bords du Nil. Depuis un mois, l'armée chrétienne se consumait en vains efforts pour franchir le canal d'Aschmoun, au delà duquel se riaient d'eux les musulmans, lorsqu'on trouva un gué. Robert d'Artois le passa le premier avec trois cents chevaliers seulement, malgré la défense du roi son frère. « Je vous jure sur les saints Évangiles, avait répondu le jeune imprudent, de ne rien entreprendre qu'après votre passage. » Promesse vite oubliée !. A peine vit-il les Sarrasins fuir devant lui que, transporté d'ardeur, il s'attacha à leurs pas et les poursuivit jusque dans Mansourah. Mais une fois dans cette ville, il fut cerné, écrasé sous les poutres et les pierres et succomba (1250).
Aussi brillant, aussi téméraire, aussi malheureux fut Robert II d'Artois. Armé chevalier par saint Louis, il accompagna le pieux roi, son oncle, dans cette funeste croisade de Tunis, où il recueillit son dernier soupir. On le vit ensuite, sous Philippe III et Philippe IV, aller soutenir vaillamment en Navarre, dans les Deux-Siciles, en Flandre, l'influence française, alors portée partout par des princes de la famille royale. Quand Boniface VIII excommunia Philippe le Bel, il osa, lui, déchirer la bulle pontificale, si menaçante pour l'indépendance de la France.
C'est lui encore qui commandait l'armée française dans cette funeste bataille de Coudray, si fatale à la noblesse de notre pays, et qui fut cause de ce grand désastre. Ce fut une seconde édition de la Mansourah. Le sage connétable de Nesle, qui voulait le retenir, se vit accuser de trahison : « Je ne suis pas un traître, répondit froidement le prudent capitaine ; suivez-moi seulement ; je vous mènerai si avant que nous n'en reviendrons ni l'un ni l'autre. » Cette triste prédiction s'accomplit : Robert succomba, percé de trente coups de pique (1302).
Avant cette catastrophe, en récompense des services de Robert, Philippe le Bel, par lettres royaux du mois de septembre 1297, avait érigé en pairie le comté d'Artois. Ce titre de pairie semblait assurer mieux que jamais la succession masculine dans ce comté, quand même il n'eût pas été généralement admis dans le droit féodal de l'époque que les femmes ne succédaient pas.
Pourtant cette grave question fut résolue alors différemment. Robert II avait laissé une fille, Mahaut, et un neveu Robert. Mahaut succéda ; Robert réclama. Il fut débouté de sa demande, en 1309, par un jugement des pairs, et Mahaut non seulement demeura comtesse, mais même siégea dès lors, et plusieurs fois, dans le parlement, comme pairesse (chose toute nouvelle).
Robert ne put se résigner. Il renouvela ses protestations sous les fils de Philippe le Bel, et plus vivement encore sous Philippe de Valois. Il avait eu le tort de fabriquer de fausses lettres par lesquelles Robert II aurait fait cession de son comté à son père Philippe. Le parlement découvrit la fraude, et, à la suite d'un procès scandaleux, une certaine Jeanne Divion, complice du coupable, fut brûlée en 1331.
Pour lui, il refusa de comparaître. Déjà faussaire, il se fit encore sorcier et envoûta le roi, c'est-à-dire qu'il fabriqua une petite image de cire représentant le roi et la perça au coeur avec une aiguille ; un homme envoûté, selon les superstitions du Moyen Age, était un homme perdu. Pourtant Philippe de Valois continua de se porter fort bien, et Robert, craignant les longs bras du parlement, jugea prudent de s'en aller ailleurs. II passa donc d'abord en Flandre, puis en Angleterre et mit le comble à ses crimes en appelant dans son pays le roi d'Angleterre, Édouard III. Ainsi cette famille d'Artois mérite le reproche d'avoir contribué à allumer ce triste incendie de la guerre de Cent ans qui devait dévorer la France.
En 1382, le comté d'Artois fut réuni à celui de Flandre, sous le fameux Louis de Male, et deux ans après, en mourant, il le laissa à Marguerite, sa fille, qui avait épousé le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Quand elle mourut à son tour (1405), elle le transmit à Jean, son fils, qui avait hérité de Philippe le duché de Bourgogne, et depuis lors le comté et le duché demeurèrent réunis jusqu'à la mort de Charles le Téméraire.
A ce moment (1477), où la grande puissance des ducs de Bourgogne se trouva démembrée, l'Artois fut porté, avec la Flandre et la Franche-Comté, dans la maison d'Autriche, par le mariage de Marie de Bourgogne avec l'archiduc Maximilien, mais à la charge de l'hommage envers la France. Bien plus, par le désastreux traité de Cambrai (1529), résultat de la bataille de Pavie, François Ier fut obligé de renoncer à toute suzeraineté sur l'Artois, comme sur la Flandre, et ce ne fut que cent vingt ans après que les victoires du grand Condé le rendirent à la France.
C'est ce que consacra le traité des Pyrénées (1659), confirmé par celui de Nimègue (1678). Depuis lors, ce comté ne fut plus jamais détaché de la monarchie française, et même, depuis 1757, il fut désigné pour servir d'apanage au second frère du roi ; c'est à ce titre que le possédait le roi Charles X avant de monter sur le trône.
Pendant les cent cinquante ans environ qu'il fut soumis à la domination espagnole, l'Artois s'était fait maintenir ou accorder par ses souverains étrangers, fort intéressés à user de ménagement envers un pays aussi important par sa richesse et sa position, des privilèges qu'il conserva après son retour à la couronne de France.
Aussi demeura-t-il pays d'états, ne connaissant ni douanes, ni aides, ni gabelles, et même ayant le droit d'exercer un contrôle nominal sur la levée des deniers royaux. Relativement à ses divisions ecclésiastiques et administratives, il comptait deux évêchés, Arras et Saint-Omer, et se divisait en huit bailliages et une gouvernante, celle d'Arras ; il faisait partie du gouvernement militaire de Picardie et relevait de l'intendance de Flandre pour les finances. Sa population était évaluée à 319 200 habitants. Quant à la langue, l'Artois est remarquable pour avoir été et être encore le théâtre de la lutte du picard et du flamand, en d'autres termes du français et de l'allemand. Le picard a l'avantage à présent et fait des progrès qui refoulent peu à peu son rival.
La province d'Artois a formé, pour la plus grande partie, le département du Pas-de-Calais ; pourtant leurs limites sont loin de coïncider, et ce serait une grave omission dans l'histoire du département que celle des pays, du reste bien moins importants, du Boulonais, du Calaisis, de l'Ardrésis, qui dépendaient anciennement de la basse Picardie.
Comme le Loiret, le Pas-de-Calais, pendant la guerre de 1870-1871, a été témoin d'une victoire remportée par l'armée française sur les Prussiens. C'était le 2 janvier 1871. Commandée par le général Faidherbe, l'armée du Nord, qui déjà, le 23 décembre 1870, avait brillamment soutenu l'effort de l'ennemi à Pont-Noyelles, se trouvait alors divisée en deux corps, le 22e, sous les ordres du général Paulze d'Ivoy, et le 23e, sous les ordres du général Lecointe. « Une division du 2e corps dirigea une attaque vigoureuse sur le village de Béhagnies, qu'elle ne réussit point à enlever ; mais la 1re division du 2e corps (colonel du Bessol) chassa des villages d'Achiet-le-Grand et de Bihucourt les troupes prussiennes commandées par le général de Goeben. Le 3 janvier, toutes les positions ennemies, à Favreuil, Supinies, Avesnes-lès-Bapaume, Ligny, Tilloy, Grévillers, furent enlevées. A six heures du soir, porte la relation officielle, nous avons chassé les Prussiens de tout le champ de bataille, couvert de leurs morts. »
Les pertes éprouvées par le département du Pas-de-Calais pendant la guerre de 1870-1871 ont été évaluées à 2 014 893 francs.
0.V.N.I.S.... - Les cercles de culture -
Les "crop circles" apparaissent notamment dans la campagne anglaise. Dans des régions, principalement céréalières, des dessins géométriques apparaissent comme par magie en une nuit, voire en quelques minutes.
Les cercles de cultures sont souvent associés à l’apparition d’ovni. Les scientifiques qui se sont penchés sur ce mystère ont fait des découvertes interessantes.
Depuis 1980, rien qu’en Angleterre, on en a répertorié environ 800. Environ 9 000 cercles ont été répertoriés à travers le monde sur les trente dernières années.
Lorsqu’il s’agit de cercles concentriques, le sens de la spirale s’inverse dans chacun des cercles successifs.
Le résultat est donc très différent de celui que l’on obtiendrait si l’on marchait dessus.
Dans un des cercles en Angleterre, les analyses ont révélé la présence de 10 radioéléments rares que l’on ne trouve pas habituellement dans les plantes :
Les billes sont toujours découvertes à l’intérieur des cercles mais jamais à l’extérieur.
Certains mathématiciens ont étudié les figures. Ils ont le sentiment qu’ils relèvent d’une géométrie holistique qui permettrait une autre approche des mathématiques.
Ces cercles pourraient, selon eux, représenter un prolongement de nos connaissances actuelles.
- Une planche sur laquelle on s’attache un pied
- Une corde reliée à un point central qui permet de tourner de manière symétrique
En effet, les deux hommes n’ont pu expliquer comment des cercles sont apparus de manière simultanée dans plusieurs pays, l’Angleterre, les USA et la Russie.
De même, ils n’ont pu expliquer comment ils avaient pu réaliser des figures de près de 700 m d’envergure en si peu de temps.
L’altération de la structure moléculaire ne peut être obtenu par un simple piétinement des plaisantins.
- Phénomènes d'origine électromagnétique observés sur les lieux : boussole affolée
- Perturbation d'appareils électroniques
- Perturbation des radiofréquences
- Animaux incommodés
Elles laisseraient à leur point d’impact les cercles de culture. Les aurores boréales sont un exemple de phénomènes dus aux plasmas.
Ce météorologue avait supposé que les conditions atmosphériques et la topographie des lieux pouvaient donner naissance à des vortex, ou mini tourbillons.
Seulement, la topographie voulue, à savoir des collines ou des bois, n’est pas présente sur tous les lieux.
De plus, les cercles de cultures sont d’une grande complexité et de moins en moins cylindriques.
On en trouve dans des rizières, des forêts de conifères et sur les montagnes enneigées de Turquie.
La fabuleuse histoire de l'écriture - Les Runes -
Les origines des runes demeurent un mystère. Cependant, nous savons que d’autres peuples germaniques les utilisaient, bien avant l’ère viking.
Les runes se composent de droites qui sont plus faciles à graver que les courbes. On n'utilisait pas les runes pour écrire de longs documents.
Malgré tout, la plus longue inscription connue comporte 700 symboles.
Les historiens actuels donnent à l’alphabet runique le nom de futhark.
Il s’agit souvent de pierres tombales, portant le nom du défunt. D’autres inscriptions runiques servaient de bornes ou indiquaient le nom du propriétaire d’un coffre ou d’une arme.
En effet, l’écriture dite d'Hallristinger, l’ancêtre du futhark, date de la fin de la préhistoire.
Elle pourrait être constituée d’un mélange d’alphabets.
Cette épreuve peut-être d’ailleurs assimilée à la crucifixion du Christ.
Ce mythe n’est indiqué que dans une seule source, un poème intitulé Hávámal « Les Paroles du Très Haut », mentionné par l’Edda Poétique :
Percé par l’épieu/Livré à Odin/Livré à moi-même/
Sur cet arbre/Dont personne/Ne connaît les racines/
Sans recevoir de pain/Ni boire à la corne/Je scrutais les profondeurs/
Je saisis les runes/En hurlant je les saisis/Puis je retombais.
Une grande fête de 9 jours se tenait tous les 9 ans à Uppsala en Suède, au cours desquels on sacrifiait 9 individus de chaque race d’êtres vivants, y compris un être humain.
Un cercle de pierre de Björketorp en Suède présente une inscription qui parle de « runes de pouvoir » et invoque une malédiction sur quiconque détruirait les mégalithes.
On pouvait par exemple jeter un sort maléfique ou bénéfique en gravant des runes sur un os, un morceau de bois ou de métal.
L’inscription indique qu’elle a été érigée par un forgeron en l’honneur d’un certain Troels, qui lui a donné « l’or et le salut ».
Il existait plusieurs versions différentes de cet alphabet. L'alphabet original des runes nordiques comporte 24 lettres qui représentent les 24 constellations visibles des anciens Scandinaves.
Celle des Scandinaves est la plus courte avec 16 caractères.
On utilisait « t », »k » ou »b ».
Certains inscriptions sont donc difficiles à traduire à cause de ces ambiguïtés.
Kaunan (lettre k) pouvait signifier la torche ou le bateau.
Symboles et symbolique - Le Diable -
Qu’on le nomme Belzébuth, Satan, Tengu, Démon ou Lucifer, le diable symbolise les forces qui affaiblissent la conscience.
C’est l’éternel combat entre le monde des ténèbres et le monde de la Lumière.
L’homme doit en permanence lutter contre ses instincts. Satan est là pour le pousser au péché, comme le Serpent de la Genèse.
Le diable symbolisant l’obscurité, il brûle dans un monde souterrain. Dans la plupart des mythes, il devient le maître des Enfers.
Le mythe du diable est d’ailleurs très proche des mythes du Dragon, du Serpent et des monstres gardiens des ténèbres.
Sans cesse bourdonnantes, elles ne cessent de poursuivre tous les êtres vivants.
En Egypte, l’âne rouge est l’une des entités les plus dangereuses que rencontre l’âme dans son voyage vers l’au-delà.
L’araignée est un animal diabolique et le diable se réincarne souvent en elle.
Il sera plus tard supplanté par Osiris.
Les défunts doivent passer cette épreuve avec succès s’ils veulent renaître dans l’au-delà.
Le niveau inférieur appartient aux asouras, des démons qui détiennent des pouvoirs occultes.
Devas et asouras se livrent des luttes permanentes.
En effet, le diable est symbole de tyrannie.
La réussite est au bout du chemin pour celui qui est capable d’assumer cette force occulte d’une façon dynamique.