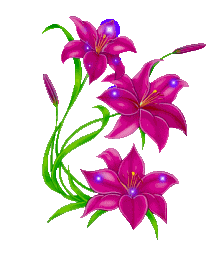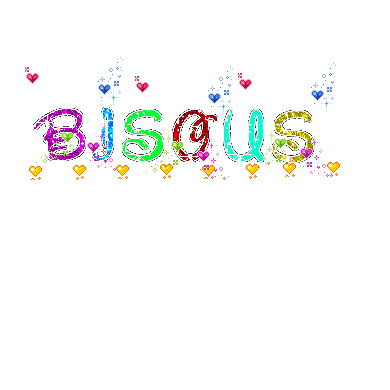Départements animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
- · le symbolisme dans le roman la rose des vents
- · passage obligé minarik
- · les bienfaits et les mefaits des invertebres
- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman
- · valerie maurice est elle mariee
- · les bienfaits des invertebres
- · turfvoyance@yahoo.fr
- · gouran tchad
- · bamwisho muhiya jean
- · royauxnorvegiens
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Cadeau en commun de Judithe
Merci Judithe pour ce joli cadeau
Bisous
Cadeau pour Mumu
Bonjour, bonne journée à tous....
Un lever de soleil (Alphonse Lamartine)
L'Orient jaillit comme un fleuve,
|
Et des pleurs de la nuit, le sillon boit la pluie,
|
Notre terre éblouie du rayon qui la dore,
|
Les pointes des forêts que les brises agitent,
|
Celui qui sait d'où vient l'aurore qui se lève,
|
(Harmonies poétiques II)
à demain
Auteur : Aliza Claude Lahav
Depuis peu j'ai un nouvel ami. Il est toujours réconfortant de se dire que l'on est encore capable de se faire de nouveaux amis. Une nouvelle amitié c'est un renouveau d'espoir et d'énergie. C'est la vie qui s'écoule et qui met sur notre chemin des rencontres qui, on ne sait pourquoi, deviennent plus significatives que d'autres. L'amitié est une plante fragile, elle pousse sur tout terrain mais elle demande beaucoup de soins et d'attention.
Pourtant, seul le principe de réciprocité peut nous enrichir et nous avons besoin du " regard virtuel " de l'autre pour parfaire notre identité de penser. Internet a élargi notre monde nous permettant des possibilités d'échanges qui étaient impensables il y a quelques années, il nous offre également les moyens de nous ouvrir aux autres et à nous-mêmes. Ces dernières années j'ai eu la chance d'acquérir de nombreux amis, d'ailleurs la plupart d'entre eux lisent ces lignes en ce moment.
Belle expérience que l'internautamitié !!!
Les départements-(histoire)- Tarn - 81 -
Castres
2ème partie
Le plan tracé par le pape était de ménager le comte, s'il ne paraissait pas empressé à secourir les hérétiques. Milon n'avait été nommé légat que pour donner le change a Raymond, qui s'était plaint de la raideur de l'abbé de Cîteaux.
La conduite indécise du comte de Toulouse favorisa les vues d'Innocent. Dans une assemblée réunie par lui à Aubenas (Vivarais), son neveu, Raymond-Roger Trencavel, vicomte de Béziers, Albi, Rasez, Carcassonne, lui conseillait valeureusement de convoquer tous ses amis, de mettre en défense toutes ses places fortes et de tenir tête à l'orage.
Effrayé d'un si grand danger, le comte répondit qu'il ne voulait pas se brouiller avec l'Église. II se rendit a Valence, où l'appelait le légat, et lui remit les clefs de sept de ses plus forts châteaux ; il se laissa ensuite conduire a Saint-Gilles. Là, en présence de vingt archevêques ou évêques, il fit amende honorable ; on lui mit au cou une étole, et le légat, le tirant par cette étole, l'introduisit dans l'église en le flagellant ; enfin la croix parut sur sa poitrine en signe qu'il allait prendre les armes contre ses propres sujets.
L'armée s'ébranla, passa par Montpellier, fondit sur Béziers, dont nous raconterons ailleurs la catastrophe. L'esprit de cette guerre se résume dans ce mot, qui, malheureusement, appartient bien à l'histoire d'Arnaud-Amaury : « Tuez-les tous, Dieu saura bien distinguer les siens. » - « Brûlez-les tous deux, disait de même Simon de Montfort ; si celui-ci parle de bonne foi, le feu lui servira pour l'expiation de ses péchés ; s'il ment, il portera la peine de son imposture. »
Après Béziers, ce fut le tour de Carcassonne, où fut pris traîtreusement le vicomte Raymond-Roger, qui mourut en prison peu de temps après, de dysenterie, dit-on. Il laissait un fils en bas âge, Raymond Trencavel II, né en 1207.
Le bel héritage des quatre vicomtés que cet enfant semblait destiné a recueillir lui fut enlevé, et le légat l'offrit successivement au duc de Bourgogne, aux comtes de Nevers et de Saint-Pol, qui tous le refusèrent. « Le légat, fort malcontent et embarrassé, offrit en dernier lieu la seigneurie à Simon, comte de Montfort, lequel la désirait et la prit. » Pour intéresser l'Église à lui conserver ces nouveaux domaines, Simon ordonna qu'un cens de trois deniers, par feu ou par maison, serait levé au profit de la cour de Rome, sans compter une redevance annuelle dont il fixa la somme.
Le chef des croisés n'occupait encore que Castres dans l'Albigeois ; il s'y rendit en personne, s'empara de Lombers, où cinquante chevaliers avaient formé un complot pour s'emparer de sa personne ; il entra dans Albi, dont l'évêque lui ouvrit les portes. Une révolte, excitée par le roi d'Aragon, ne tarda pas à le chasser de presque toutes ces places ; mais il y rentra bientôt l'épée à la main ; une bulle du pape le confirma dans la possession d'Albi (1210).
L'Albigeois était le chemin de Toulouse. Le comte voyait avec terreur approcher les croisés. Il courut à Paris et de Paris à Rome. Philippe-Auguste, qui approuvait peu la croisade et qui en avait refusé le commandement sous prétexte « qu'il avait à ses côtés deux grands lions menaçants, le roi d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne, » lui donna une lettre pour le pape. Innocent se montra bien disposé en sa faveur.
Mais les légats, plus zélés que le pape, l'évêque de Toulouse, Fouquet, troubadour transfuge, l'abbé de Cîteaux, Simon de Montfort, ne voulaient point se laisser arracher leur proie. Le concile d'Arles (1211) dicta au comte. des lois de fer. Raymond et le roi d'Aragon, Pierre II, qui intercédait en sa faveur, attendirent longtemps à la porte du concile, en plein air, « au froid et au vent. » Enfin on leur remit la charte qui contenait des conditions inacceptables.
Cette charte fut utile à Raymond ; il la montra partout, et ses sujets, chevaliers ou bourgeois, jurèrent de périr plutôt que d'accepter un tel esclavage. L'évêque Fouquet fut chassé de Toulouse ; défense faite aux habitants de donner des vivres aux croisés. Montfort, qui venait de prendre Lavaur, échoua devant la capitale du Languedoc.
La campagne fut tenue habilement et avec succès pendant l'hiver par les capitaines albigeois, particulièrement le comte de Foix. Montfort n'avait que peu de troupes dans cette saison ; la plupart des croisés ne donnant que le service de quarante jours, « le flot de la croisade tarissait vers L'automne pour ne revenir qu'au printemps. » (H. Martin.) II s'occupait de régler la conquête, de distribuer des fiefs aux hommes de la langue d'oil. Les moines se pourvoyaient de leur côté ; l'abbé de Cîteaux était élu évêque de Narbonne, et accolait à ce titre celui de duc ; l'abbé de Vaux-de-Cernai devenait évêque de Carcassonne.
Pierre II d'Aragon, libre du côté de l'Espagne par la bataille de Las Navas de Tolosa, intervint plus énergiquement. Raymond, qui était son beau-frère, remit entre ses mains « ses terres, son fils et sa femme. » Les représentations de Pierre émurent un instant le pape, qui suspendit la prédication de la croisade Hais, à l'instigation des chefs croisés, Innocent III revint sur ses dispositions indulgentes et exhorta Pierre à abandonner « le toulousain. »
Pierre n'en fit rien, et, le 10 septembre 1213, il assiégeait Muret. La grande bataille qu'il livra devant cette place, et qui lui coûta la vie, fut le coup fatal des Albigeois. Toulouse prise fut démantelée. Simon de Montfort fut institué « prince et monarque du pays » par les canons du concile de Montpellier, confirmés par le pape. Le quatrième concile de Latran, solennelle assemblée de 71 archevêques, 412 évêques et plus de 800 abbés et prieurs (1215), renouvela sa réfutation des doctrines hétérodoxes, le symbole de Nicée, et prescrivit des mesures qui, dans le Languedoc, devaient prévenir le retour de l'hérésie.
Le concile ratifia la fondation de deux ordres religieux nouveaux, spécialement établis en vue de l'hérésie albigeoise. « L'Église avait été ébranlée par la prédication hétérodoxe ; Dominique entreprit de la soutenir par la création d'un ordre exclusivement destiné à prêcher la foi catholique, et, sous les auspices de l'évêque Fouquet, il jeta les fondements de l'ordre des Prêcheurs dans Toulouse même, la métropole de l'hérésie. L'Église avait été attaquée au nom de l'inspiration mystique et du renoncement évangélique, François d'Assise transporta le mysticisme et la réalisation littérale de la pauvreté et de l'humilité chrétienne dans le sein de l'Église ; il fonda un ordre de moines qui renonçaient absolument, non plus seulement à la propriété individuelle, ainsi que les autres moines, mais a la propriété collective, et faisaient vœu de ne vivre que d'aumônes. »
C'est en vain que, du sein même de l'assemblée catholique, quelques voix courageuses protestèrent contre les effets désastreux de la croisade, qu'un chevalier ajourna le pape au jour du jugement s'il ne rendait pas au fils du vicomte de Béziers et d'Albi son héritage, que l'archidiacre de Lyon lui-même s'écria, montrant Fouquet : « Cet évêque fait vivre dans le deuil plus de cinq cent mille hommes, dont l'âme pleure et dont le corps saigne ! »
Innocent III, disposé à s'attendrir, ne put réserver au fils de Raymond VI que le marquisat de Provence, « s'il s'en rendait digne. » Tout le reste fut donné à Simon de Montfort, qui alla demander au roi Philippe-Auguste l'investiture du comté de Toulouse et du duché de Narbonne (1216), et qui se vit accueilli partout dans les campagnes de la langue d'oil à ce cri : « Béni soit celui qui. vient au nom du Seigneur ! ».
Les peuples de la langue d'oc pleuraient leur brillante et gracieuse civilisation broyée sous le fer des masses d'armes et jetée au feu des bûchers. « Ah ! s'écrie un troubadour, Toulouse et Provence, terre d'Agen, Béziers et Carcassonne, quelles je vous vis, et quelles je vous vois ! »
La mort d'Innocent IIII (1216) et celle de Simon de Montfort (1218) mirent fin à la première période de la guerre des Albigeois. Amaury, fils de Simon, confirmé dans la possession des conquêtes paternelles par le pape Honorius III, entra dans Albi. De son côté, Raymond VI entra dans l'Albigeois, qui devint le théâtre de la lutte. Raymond VII, lui ayant succédé (1222), enleva Albi à son rival, qui était dans le même temps attaqué d'un autre côté par Raymond Trencavel II, héritier des quatre vicomtés (1224). Amaury s'enfuit en France. L'hérésie releva la tête.
En 1222, Amaury avait offert à Philippe-Auguste ta cession de tous ses droits sur le comté de Toulouse. Ce monarque les avait refusés, et avait seulement autorisé son fils Louis à prendre part à la croisade. Devenu roi, Louis VIII reprit la croix et accepta l'offre d'Amaury ; puis avec 100 000 hommes il assiégea Avignon.
Le Languedoc, pendant ce temps, se soumettait à lui ; il parut à Albi et y séjourna quelque temps ; il reçut le serment de fidélité des habitants par l'intermédiaire de l'évêque, et c'est dans cette ville qu'il régla le sort des pays acquis par lui à la couronne ; il en confia le gouvernement a Humbert de Beaujeu, qui, bientôt abandonné à lui-même, déploya beaucoup d'énergie et d'habileté à poursuivre la guerre contre les hérétiques et contre Raymond VII.
Enfin le comte de Toulouse céda. En 1229, il reçut l'absolution de la main du cardinal légat dans l'église de Notre-Dame de Paris. Il s'engageait a démanteler trente une places fortes de ses États, entre autres, dans l'Albigeois, Lavaur, Gaillac, Rabastens, Montaigu, Puicelci ; les châteaux de Cordes et de Penne étaient remis à Louis IX pendant dix ans. La partie de l'Albigeois située sur la rive gauche du Tarn était réunie, avec Albi, au domaine royal ; la rive droite demeurait au comte. Castres fut inféodé a Philippe, neveu de Simon de Montfort.
Les deux parties de l'Albigeois eurent chacune un sénéchal, l'une pour le roi, l'autre pour le comte. Celle-ci était divisée en sept bailliages. La vaine tentative faite plus tard par Raymond VII, avec le secours de Henri III, roi d'Angleterre, et du comte de la Marche ayant échoué, Raymond Trencavel II, l'héritier dépouillé des quatre vicomtés, vendit tous ses droits a Louis IX, moyennant une pension de 600 livres sur la sénéchaussée de Beaucaire (1247).
Le siècle ne s'écoula pas sans que l'Albigeois de la rive droite du Tarn fût réuni à la couronne. Jeanne, fille de Raymond VII, et son mari, Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, en héritèrent à la mort de Raymond, et quand ils moururent à leur tour, ce pays fut réuni par les commissaires de Philippe le Hardi au domaine royal (1271).
La soumission du comte de Toulouse consomma la défaite de l'hérésie. Lui-même était obligé de se tourner contre elle, et s'engageait, par le traité de 1229, à payer pendant deux ans deux marcs d'argent, et, dans la suite, un marc à quiconque livrerait un hérétique, à confisquer les biens des sectaires, à les exclure des charges publiques, comme les juifs. II ordonna même de raser les maisons des protecteurs et fauteurs des hérétiques.
Saint Louis envoya a ses baillis une ordonnance dans le même sens, et le concile de Toulouse organisa l'inquisition permanente en établissant que les évêques « députeraient dans chaque paroisse un prêtre et deux ou trois laïques de bonne réputation, » qui visiteraient « toutes les maisons depuis le grenier jusqu'à la cave. » L'obligation de dénoncer commençait à quatorze ans pour les hommes, à douze ans pour les femmes ; on devait alors prêter un serment.
Les hérétiques convertis devaient porter sur la poitrine deux croix de couleurs tranchantes. Le concile de Narbonne (1244) obligea les hérétiques en voie de conversion a se présenter tous les dimanches a l'église, le corps en partie nu, avec une poignée de verges pour recevoir la discipline. Le comte de Béziers (1246) établit la peine du feu pour tous les partisans qui refuseraient d'abjurer. Le concile d'Albi (1254) ordonna la construction de prisons dans chaque diocèse pour recevoir les hérétiques.
Le pape Grégoire IX, en 1233, prétendit donner plus de rigueur encore à l'Inquisition en attribuant aux frères prêcheurs des pouvoirs absolus, supérieurs même à ceux des évêques. Les protestations de Raymond VII, de Louis IX, du haut clergé de France ne l'arrêtèrent pas. Raymond fut de nouveau excommunié ; mais toutes les populations étaient pour lui, et en plusieurs lieux maltraitèrent les inquisiteurs dominicains.
Ceux-ci n'en continuèrent pas moins leur sanglante mission jusqu'au règne de Philippe le Bel, qui d'abord envoya des commissaires (1302), puis vint lui-même (1304) dans le Languedoc pour faire cesser la tyrannie des dominicains. Un édit rendu par lui à Toulouse ordonna que les commissaires royaux visiteraient avec les inquisiteurs les prisons de l'Inquisition et veilleraient à ce qu'elles servissent « pour la garde et non pour la peine des prisonniers ; » que les évêques ou leurs vicaires instruiraient le procès des accusés sur le sort desquels il n'aurait pas été statué. Un peu plus tard, un décret du concile de Vienne, confirmé par Clément V, défendait aux inquisiteurs de procéder contre les hérétiques « sans le concert des évêques diocésains. »
Alors seulement, après un siècle de souffrances terribles, le Languedoc respira et le châtiment de l'hérésie albigeoise fut arrêté. Chose singulière, ruinée en Languedoc, elle s'était réfugiée et se relevait dans les pays étrangers, principalement en Lombardie . c'est de là qu'on vit dès lors partir souvent deux à deux, suivant la règle, des ministres parfaits, qui allaient à leur tour, à travers mille dangers, vêtus de bure, vivant d'aumônes, exhorter les habitants du Languedoc à leur rester fidèles.
L'histoire de l'Albigeois sera courte à achever après que nous avons terminé celle de l'hérésie albigeoise. Ce pays souffrit des guerres des Anglais et plus encore des ravages des routiers, quoiqu'il n'ait jamais été un des principaux théâtres de ces grandes luttes nationales.
Il fut agité au temps des guerres de religion comme toutes les contrées de la France. Les hérétiques y furent durement traités, et pourtant, en 1569, ils y possédaient trente-huit villes, bourgs ou villages, dont Gaillac, Lombers et Réalmont. L'année suivante, le fléau de la guerre cessant, celui de la famine commença avec accompagnement de fièvres pestilentielles, qui sévirent cruellement dans les pays d'Albi et de Castres.
Après la mort de Henri III, la Ligue établit son influence dans l'Albigeois. L'évêque d'Albi, d'Elbène, dont elle se méfiait, fut dépouillé de ses biens, et, en 1592, Antoine-Scipion de Joyeuse, maréchal de France de la création de Mayenne, battit les royalistes près de Montets ; ceux-ci eurent leur revanche à Vilennet, où ils enlevèrent le camp de Joyeuse, et ce malheureux maréchal alla en fuyant se noyer dans le Tarn. Son frère, Henri de Joyeuse, prit sa place dans le commandement et convoqua des états à Albi pour obtenir des subsides. Albi et Gaillac étaient les seules villes qui restaient à la Ligue. La paix de Folembray (1596) replaça tout le pays sous l'autorité royale.
Sous Louis XIII, la révolte du duc de Rohan et des protestants donna lieu à des événements militaires dans l'Albigeois. Lombers, Réalmont furent assiégées. Mais les protestants furent battus par le duc d'Angoulême, qu'accompagnait Alphonse d'Elbène, évêque d'Albi. Ce même évêque changea de rôle plus tard, et, moins fidèle à la cause royale, fut un des instigateurs de la révolte du duc d'Orléans, et jeta Albi et son diocèse dans le parti des rebelles. Les capucins et les jésuites d'Albi tournèrent contre lui les populations, et, quand la révolte fut apaisée, une commission ecclésiastique, nommée en vertu d'un bref d'Urbain VIII, le déposa (1634).
Depuis ce temps, on peut dire que les événements politiques n'ont que peu troublé le repos de l'Albigeois. La Révolution n'y commit que peu de violences. L'affaire de Fualdès, après la chute du premier Empire, fut la seule qui y réveilla les émotions endormies.
En 1790, l'Assemblée constituante avait réuni en un département les diocèses de Lavaur et de Castres ; cette dernière ville avait été choisie pour chef-lieu ; elle fut privée de ce titre par le Directoire, qui, pour la punir de quelques mouvements séditieux, le transféra à Albi. Le Concordat (1802) supprima le siège archiépiscopal d'Albi, érigé sous Louis XIV (1676) aux dépens de l'archevêché de Bourges, et comprit tout l'Albigeois dans le diocèse de Montpellier ; mais, sous la Restauration, ce siège fut rétabli, avec les évêchés de Cahors, Rodez, Perpignan et Mende pour suffragants.
Les départements-(histoire)- Tarn - 81 -
Partie 1
Le pays d'Albi était habité avant l'invasion romaine par un des peuples gaulois les plus belliqueux, celui des Volces Tectosages. Les Tectosages, dit-on, composaient en grande partie l'armée de Brennus. Au passage d'Annibal, ils tentèrent de lui fermer la route. On les voit ensuite s'enrôler dans les armées étrangères pour aller chercher des aventures dans les pays lointains, et étonner la Grèce et la Thrace de leur valeur indomptable.
Les Tectosages, selon quelques auteurs, faisaient partie de la confédération des Cadurques et ce serait eux que César désignerait sous le nom de Cadurci Eleutheri. Selon d'Anville, ils dépendaient des Rutheni provinciales. Le nom d'Albigeois, qui est resté à cette province, n'apparaît, pour la première fois, que dans la Notice de l'empire, qui est du commencement du Ve siècle ; on y rencontre la Civitas Albientium, et, dans la liste des dignités de l'empire, on trouve des cataphractarii Albigenses, que quelques-uns ont traduit par des cuirassiers albigeois.
Cette traduction n'est-elle pas téméraire, et ces cuirassiers, que la Notice nous montre cantonnés en Thrace, venaient-ils des rives du Tarn ? Voilà ce qu'on peut difficilement décider. On donne à ce nom d'Albigenses ou Albienses deux étymologies différentes : l'une, latine (albus, blanc), rappellerait les terres blanches des coteaux qui environnent Albi ; l'autre, celtique (alp ou alb, hauteur, sommet), l'éminence sur laquelle s'élevait l'ancien château de cette ville, Castelviel.
Toutefois, ce n'est que fort tard que le nom d'Albigeois fut appliqué au pays même dont a été formé le département du Tarn. Compris, après la conquête de César, dans la province Romaine, et sous Auguste dans l'Aquitaine, ce pays n'eut point de dénomination propre jusqu'au temps où Charlemagne forma un comté ayant pour chef-lieu Albi ; en devenant une circonscription administrative particulière, il reçut le nom particulier d'Albigeois.
Ni l'époque celtique ni l'époque romaine n'ont laissé beaucoup de monuments dans le département du Tarn. On n'y trouve que quelques dolmens, des pierres levées, des médailles et certains ornements. A peu de distance de la route qui conduit de Cordes à Saint-Antonin, dans la commune de Saint-Michel-de-Vax, on voit un dolmen composé d'une large pierre de 3m 60 de longueur sur 2m 56 de largeur, posée horizontalement sur deux blocs de rocher.
A Tonnac, on en voit un plus considérable encore, et sous lequel on a trouvé des ossements humains fluant aux monuments romains, ce sont, avec des tombeaux, bien conservés et des fragments de voies et d'aqueducs, des pavés en mosaïques, des médailles, des urnes, des fragments de poterie, que des fouilles ont mis au jour.
Dévasté par les Vandales, le pays fut occupé en 478 par les Wisigoths, et conquis par les Francs a la suite de la bataille de Vouillé (507). Ces nouveaux dominateurs n'y régnèrent point tranquilles. En 512, Théodoric les en chassa momentanément, et bientôt, sous les descendants de Clovis, l'Albigeois devient, comme tout le Midi, le théâtre, l'objet et la victime des querelles sanglantes de ces princes rivaux. Caribert en est maître en 564 ; en 574, Théodebert s'y précipite avec ses bandes austrasiennes, ne respectant rien, pillant, brûlant et ravageant églises et monastères.
En 575, le duc de Toulouse, Didier, chasse les soldats de Sigebert et s'empare du pays pour le compte de Chilpéric. En 576, c'est Mummol, le général du roi de Bourgogne, Gontran, qui vient à son tour désoler cette malheureuse contrée, d'où il emmène une foule de prisonniers. Quatre ans après (580), Chilpéric en redevient possesseur. Nous ne suivrons point ces vicissitudes presque annuelles, toujours accompagnées des plus barbares violences. En 615, apparaît le premier comte d'Albi, Syagrius, issu d'une très riche famille d'origine gauloise et frère des deux évêques de Cahors Rustique et Didier (saint Géry).
Dans leur décadence, les Mérovingiens perdirent la domination des pays méridionaux soumis à leur autorité. Eudes, duc d'Aquitaine, s'empara de l'Albigeois en 688. Ses successeurs ne jouirent pas paisiblement de cette conquête ; un demi-siècle n'était pas écoulé que l'Albigeois était en proie aux incursions dévastatrices des Sarrasins (720-732).
Cette invasion eut pour résultat indirect de ramener les rois francs, rudes libérateurs des chrétiens de la Gaule méridionale. En 766, Pépin le Bref s'empara de l'Albigeois en même temps que de tout le Languedoc, et c'est douze ans après que Charlemagne, définitivement maître de ces contrées, établit Aimon comte de l'Albigeois.
Le gouvernement de ce grand monarque profita au Languedoc, et surtout à l'Albigeois, par l'abolition de l'impôt militaire appelé foderum, que ce pays payait en proportion de la richesse de ses récoltes (795). Ermengaud, qui vivait au temps de Charles le Chauve, fut le dernier comte de l'Albigeois qui relevât des rois de France. Il se distingua par la prudence avec laquelle il mit la contrée en état de défense contre les Normands qui y portaient le ravage en 864. Garsinde, sa fille et son héritière, en épousant Eudes, comte de Toulouse, lui porta en dot cette province, qui fut depuis lors gouvernée par des vicomtes sous la suzeraineté des comtes de Toulouse.
Au commencement du Xe siècle, la contrée désignée sous le nom d'Albigeois comprenait, outre la vicomté d'Albi et d'Ambialet, celle de Lautrec et Paulin. Elle ne remonta au rang de comté qu'en 987. Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, l'ayant cédée à son frère Pons, celui-ci prit le titre de comte d'Albi. C'était l'année même où Hugues Capet commençait humblement la nouvelle dynastie française. On a remarqué avec quelle liberté, depuis plus d'un siècle, les pays du Midi disposaient d'eux-mêmes, se rapprochaient, s'unissaient, se séparaient à leur gré, non seulement ne voyant plus les rois, mais ne sentant plus même leur autorité. Aussi le nouveau monarque ne fut-il point reconnu dans l'Albigeois pendant d'assez longues années.
Le voyage que le roi Robert fit en 1031 dans l'Albigeois fut de peu d'effet pour l'autorité royale. Les seigneurs du Midi ne furent pas moins indépendants de fait que par le passé pendant le XIe siècle.
Ce siècle vit s'accroître considérablement la puissance des vicomtes d'Albi. Aton II, qui mourut en 1032, était vicomte d'Albi et de Nîmes. Bernard III, son successeur, s'intitule, dans l'acte de fondation du pont d'Albi, proconsul de Nîmes et prince d'Albi. Raymond-Bernard, qui vint après lui, y ajouta par un mariage le comté de Carcassonne et les vicomtés de Béziers et d'Agde (1061). C'est lui qui porta le premier le surnom de Trencavel, qui servit depuis à désigner cette puissante famille.
Bernard-Aton IV, homme tout à fait remarquable, porta enfin à son plus haut période cette agglomération de fiefs, qui était au moyen âge le secret des grandes puissances, en joignant la vicomté de Rasez à toutes les autres. A sa mort, malheureusement, cette couvre de la patiente ambition des Trencavel se brisa par un partage entre ses trois fils.
Mais les débris en furent encore imposants : les vicomtés d'Albi et d'Ambialet échurent d'abord à l'aîné, Roger, puis à sa mort a Raymond Trencavel, le second, lequel posséda en même temps Béziers, Carcassonne et Rasez (1150). Vicomte de Béziers avant de l'être d'Albi, Raymond Trencavel donna la priorité de rang a la première de ces deux villes. L'Albigeois, dont les seigneurs étaient naguère les dominateurs du Midi, déchut du rang où il avait été élevé et ne fut plus qu'une dépendance de la vicomté de Béziers. Mais ce qui devait faire à jamais sa célébrité, ce qui devait graver le nom d'Albigeois dans l'histoire en lettres ineffaçables, c'est l'hérésie et la croisade fameuses dont nous allons rappeler les principaux traits.
Depuis plus d'un siècle, des doctrines malsonnantes inquiétaient l'Église catholique. En 1022, sous le roi Robert, on brûlait à Orléans des manichéens ; c'est du moins sous ce nom que le concile désigna les malheureux qui périrent alors sur le bûcher. Soissons fut témoin d'un supplice semblable en 1115.
Les hérétiques se multipliaient partout, mais principalement dans le Midi. Ils avaient reçu, disait-on, les doctrines manichéennes des Bulgares, qui les tenaient eux-mêmes des Arméniens, et l'on ajoutait que leur pape résidait en Bulgarie. Aussi les appelait-on quelquefois bulgares ou boulgres par abréviation. Ces hérésiarques s'élevaient ; et leur voix était écoutée des peuples. Il y en eut à cette époque deux célèbres, Pierre de Bruys et Henri, qui prêchèrent avec un grand succès dans le Dauphiné, la Provence et la province de Narbonne.
Les auteurs catholiques les accusaient de piller les églises ; de brûler les croix et de s'abandonner à la débauche. Pierre de Bruys fut livré au bûcher dans la petite ville de Saint-Gilles « en punition des croix qu'il avait brûlées. » Henri, son disciple, ancien religieux qui avait quitté la vie monastique, ne fut point ébranlé par ce terrible avertissement, et, continuant de prêcher, se rendit à Toulouse, sans doute en traversant l'Albigeois. Ses sectateurs furent appelés henriciens.
Déjà, au milieu du XIIe siècle, les progrès de l'hérésie étaient assez considérables pour inspirer des alarmes au pape Eugène III, venu en France pour y prêcher la seconde croisade (1147). Ce pontife envoya à Toulouse le cardinal Albérie, évêque de Chartres et saint Bernard, accablé des infirmités de la vieillesse, mais toujours plein d'ardeur. Saint Bernard, qui était le véritable chef de cette mission par son génie, fut frappé de l'aspect religieux du pays. « Les églises, écrivait-il, sont sans peuple, les peuples sans prêtres, les prêtres sans ministère. »
Ce n'était point merveille : les hommes du Midi n'avaient sous les yeux qu'un clergé livré au luxe et aux mauvaises mœurs. Ils accueillirent avec dérision et outrage la pompe du légat, mais avec respect et enthousiasme l'austère simplicité du moine éloquent qui dominait son siècle, et dont l'ambition était toute religieuse. Verfeil, près de Toulouse, fut le seul lieu où saint Bernard n'obtint pas le silence du respect ; obligé de se taire devant les clameurs de la foule, il secoua contre ce lieu la poussière de ses sandales et se retira. La mission passa alors dans l'Albigeois.
Les doctrines hétérodoxes prospéraient dans cette province. Elles y étaient particulièrement favorisées par Raymond Trencavel, qui, sans cesse en guerre avec son suzerain, Raymond V, comte de Toulouse, protégeait par système les hérétiques pour s'en faire un appui, Presque tous les habitants d'Albi étaient henriciens. Ils rirent au légat une réception burlesque : montés sur des ânes et battant du tambour, ils allèrent au-devant de lui.
Quand il prêcha à Sainte-Cécile, il eut environ trente auditeurs. On ne traita pas de même saint Bernard : sa parole tomba sur mie foule pressée, avide de l'entendre, émue, que la cathédrale ne pouvait contenir. Elle écouta, non sans se troubler, la réfutation qu'il fit de point en point des doctrines henriciennes, et quand il s'écria : « Choisissez entre les deux doctrines ! » tous répondirent qu'ils détestaient leur erreur, qu'ils revenaient à la foi catholique. « Faites donc pénitence, ajouta-t-il, vous qui avez péché ! » Et il leur fait à tous lever le bras en signe qu'ils jurent d'être fidèles à l'Église. Mais leur retour aux saines doctrines ne devait pas être de longue durée : saint Bernard parti, ils oublièrent leur serment.
Il sembla à Guillaume, évêque d'Albi, qu'un concile spécialement convoqué pouvait seul porter remède à l'état de choses et venir à bout de l'hydre qu'il s'agissait d'étouffer. Ce concile fut indiqué pour la fin du mois de mai 1165, et dut se réunir dans une ville de l'Albigeois, alors forte et considérable, aujourd'hui très obscure, la ville de Lombers, à 30 kilomètres au sud d'Albi.
On y interrogea sur leur doctrine et leur profession de foi les hérétiques, qui s'appelaient les bons hommes, les parfaits ; ce dernier titre toutefois n'appartenait qu'à un petit nombre d'entre eux, puritains de la secte, qui se distinguaient par l'austérité de leur vie ; la foule ne portait que le nom de croyants. Affranchis par la révolte des obligations morales de la loi catholique, les croyants se passaient de toute morale et vivaient dans la licence, persuadés que les vertus des parfaits rachèteraient leurs vices.
Quant à cette dénomination d'Albigeois, qui est demeurée aux hérétiques de cette secte, répandue également dans tout le Languedoc, on peut admettre qu'elle prit naissance à cette époque, peut-être même à l'occasion de ce concile tenu dans l'Albigeois pour examiner et condamner la doctrine nouvelle.
Pour résumer l'exposé des croyances albigeoises, nous dirons que, aux yeux de ces hérétiques, Satan, principe du mal, était l'auteur du monde physique ; de là cette condamnation de la chair, de la vie d'ici-bas et du mariage, qui conduisit quelques femmes égarées à faire périr leurs enfants. Le Jéhovah de l'Ancien Testament n'est autre que Satan lui-même, et de plus tous les Pères de l'Ancien Testament sont damnés jusqu'à saint Jean-Baptiste, l'un des majeurs démons et pires diables. Le bon esprit, c'est Jésus-Christ ; mais il ne s'est point incarné, c'eût été s'asservir à la chair, au mauvais principe ; il n'a pris que les apparences de la chair, de la vie et de la mort, et est venu, pur esprit, régénérer les esprits des hommes.
Non seulement les Albigeois attaquaient ainsi le dogme, mais ils attaquaient aussi le clergé. L'habit noir des parfaits était un reproche aux somptueux vêtements des évêques. Ils avaient des cimetières particuliers où ils enterraient publiquement leurs adeptes. Enfin, ils recevaient, dit Pierre de Vaux-de-Cernai, des legs plus abondants que les gens d'église, tant les populations de ces contrées étaient séduites par eux !
« Moi, Gaucelin, évêque de Lodève, par ordre de l'évêques d'Albi et de ses assesseurs, je juge que ces prétendus bons hommes sont hérétiques, et je condamne la secte d'Olivier et de ses compagnons, qui est celle des hérétiques de Lombers, quelque part qu'ils soient. » Tel fut l'arrêt rendu par le concile de Lombers. Quatorze ans après, le concile de Latran (1179) énonçait, à propos des Albigeois, cette maxime : « Bien que l'Église rejette les exécutions sanglantes, elle ne laisse pas d'être aidée par les lois des princes chrétiens ; et la crainte du supplice fait quelquefois recourir au remède spirituel. » Nouveaux anathèmes au concile de Montpellier (1195).
Tant d'excommunications n'écrasaient pas les Albigeois. Ils n'en acquéraient que plus de célébrité, d'importance et d'audace. Au concile catholique de Lombers, ils opposèrent, deux ans après, un concile hérétique présidé par Niquinta, leur pape, à Saint-Félix-de-Caraman, où se réunirent des représentants des églises dissidentes de l'Albigeois, du pays de Toulouse, de Carcassonne et de la vallée d'Aran.
L'hérésie ne se contenait plus même dans le midi de la France, elle débordait sur le nord et sur les pays étrangers, l'Angleterre, la Catalogne, l'Aragon. Ce n'est pas qu'il y eût bien des divergences d'opinion dans cette diffusion de l'hérésie, et le nom d'Albigeois couvrait sans doute plus d'une secte. Néanmoins, c'était un formidable ensemble de rébellions contre l'unité catholique.
Le glaive temporel allait donc être tiré du fourreau. Quelle serait la main qui le ferait mouvoir ? Ce droit et ce devoir n'appartenaient-ils pas tout d'abord aux souverains temporels des pays qui étaient le siège de l'hérésie ? Mais, soit connivence, soit impuissance véritable, ces souverains cherchaient à s'affranchir de cette tâche. « Je ne puis trouver le moyen de mettre fin à de si grands maux, écrivait Raymond V au chapitre général de Citeaux, en 1177, et je reconnais que je ne suis pas assez fort pour réussir. »
Raymond V était sincèrement catholique. Son fils Raymond VI penchait vers l'hérésie : « Je sais, disait-il, que je perdrai ma ferre pour ces bons hommes, eh bien ! la perte de ma terre, et encore celle de ma tête, je suis prêt a tout endurer. »
II y eut, dès 1178, une petite guerre religieuse dirigée contre l'Albigeois proprement dit. Le fils de Raymond Trencavel, Roger II, suivait les errements paternels. Non seulement il était toujours en querelle avec son suzerain, le comte de Toulouse, dont il épousa pourtant la fille Adélaïde, mais il favorisait ouvertement les hérétiques ; il leur permettait de s'établir en maîtres à Lavaur et même à Lombers, qui naguère avait retenti des anathèmes lancés contre eux ; il leur laissait le champ libre pour provoquer les évêques à la discussion.
En démêlé lui-même avec l'évêque d'Albi, il finissait le débat un beau jour en le faisant mettre en prison, et en l'y faisant garder par des hérétiques Cette cruelle plaisanterie fut mal prise par la cour de home. Le légat, qui s'était rendu à Toulouse, envoya dans l'Albigeois Henri, abbé de Clairvaux, accompagné du vicomte de Turenne et de Raymond de Castelnau, qui devaient lui prêter main-forte. Roger se retira prudemment dans des lieux inaccessibles et se laissa sans autre souci excommunier dans la ville de Castres, dont son épouse Adélaïde avait ouvert les portes. Il fut déclaré traître, hérétique et parjure. Henri, qui avait prononcé l'anathème, devint lui-même légat du saint-siège peu de temps après, et résolut d'employer l'autorité étendue que lui donnait cette dignité à frapper l'hérésie avec quelque vigueur.
Il retourna dans l'Albigeois, entraînant sur ses pas les catholiques en armes, assiégea vivement Lavaur, qui ouvrit ses portes, et obligea Roger d'abjurer l'hérésie et de livrer les hérétiques pris dans cette place (1180). Mais à peine eut-il le dos tourné, que le vicomte et ses sujets revinrent aux doctrines qu'ils avaient feint de quitter, se riant des tentatives inutiles de l'Église. En 1194, Roger mourant laissait la tutelle de son fils à un seigneur hérétique.
Le saint-siège, qui ne pouvait être vaincu dans cette lutte, redoubla l'énergie de ses moyens. Dès 1198, les frères Gui et Raynier, de l'ordre de Cîteaux, parcouraient le Midi comme commissaires du pape, chargés de représenter sa puissance tout entière. Leurs successeurs, Pierre de Castelnau et Raoul, moines du même ordre, réunirent dans leurs mains tout le faisceau des foudres pontificales, en vertu d'une bulle qui les autorisait à « détruire, arracher et planter tout ce qui était nécessaire dans les pays infectés d'hérésie. »
Ces dictateurs commencèrent par suspendre tous les évêques modérés, dont la tiédeur eût pu ralentir leur marche impitoyable. L'opiniâtreté de l'hérésie résista encore a leurs efforts. Obligés de cacher leurs croyances et leurs réunions, les Albigeois en confiaient le mystère aux ténèbres de la nuit. Pierre de Castelnau se décourageait lui-même, lorsqu'il rencontra l'évêque d'Osma qui voyageait en France avec un de ses chanoines nommé Dominique. « Renoncez, lui dit l'évêque, à ces somptueux appareils, à ces chevaux caparaçonnés, à ces riches vêtements ; fermez la bouche aux méchants en faisant et enseignant comme le divin Maître, allant pieds nus et déchaux, sans or ni argent ; imitez la manière des apôtres. »
Mais le luxe était devenu tellement inséparable de la cour de Rome, que les légats n'osèrent point reprendre les simples habits de moine : ce serait, dirent-ils, une trop grande nouveauté ; ils ne pouvaient prendre cela sur eux. Ils se bornèrent à suivre l'évêque d'Osma et Dominique, qui se mirent à parcourir pieds nus les campagnes, soutenant des discussions solennelles contre les Albigeois. L'évêque mourut, Dominique resta seul.
C'est saint Dominique, le patron de l'Inquisition. Il avait la tendresse d'âme et les vertus d'un saint Vincent de Paul. Dans une famine, il vendit ses livres pour en donner l'argent aux pauvres ; une autre fois, il voulut se vendre lui-même pour racheter un captif. Mais il avait aussi la cruauté d'une logique inflexible qui lui faisait désirer, par amour des hommes, l'extermination des suppôts de l'enfer qui perdaient tant de milliers d'âmes.
Ce qu'il souhaitait avec la dernière ardeur, c'était le martyre, et le plus cruel de tous, afin de mériter une plus riche couronne. Qu'importaient à cet homme les outrages, la boue, les crachats, les bouchons de paille attachés par derrière à ses vêtements ? Il en remerciait le ciel. Ce n'était pourtant pas une preuve du succès de sa prédication ; aussi Castelnau retombait dans l'abattement, et répétait que l'affaire de Jésus-Christ ne réussirait pas dans ce pays jusqu'à ce que quelqu'un d'entre eux fût mort pour la défense, de la foi, et Dieu veuille, ajoutait-il, que je sois la première victime !
En 1207, il se rendit à la cour de Raymond VI, alors en guerre avec ses voisins, et le somma de faire la paix ; sur son refus, il lança une excommunication que le pape Innocent III confirma en termes accablants. Raymond céda sur un point, mais feignit de ne point entendre les injonctions du légat qui lui ordonnait de persécuter les hérétiques. La colère de Castelnau n'eut plus de bornes : il excommunia de nouveau Raymond, et l'accabla en face des injures les plus violentes. Le comte, à son tour, s'emporta, et répondit qu'il saurait bien le retrouver. Un de ses chevaliers recueillit cette parole, et Castelnau fut égorgé au moment où il s'embarquait sur le Rhône (1208).
L'épée du chevalier de Raymond VI déchira l'effroyable nuée des colères pontificales amoncelée depuis un demi-siècle sur le Languedoc. A la voix du pape Innocent III, à celle d'Arnaud, abbé de Liteaux, et des moines des nombreux couvents de cet ordre, tout le nord de la France se croisa ; ducs, comtes, évêques, chevaliers, brodèrent la croix sur leur poitrine (jusque-là elle se portait sur l'épaule ). Français, Normands, Champenois, Bourguignons, s'armaient avec joie pour aller combattre ces hommes du Midi, objet de leur aversion, cette gent empestée de Provence ; des Méridionaux catholiques les joignirent en grand nombre. Lyon était le rendez-vous de cette armée de 300 000 hommes. Arnaud-Amaury, abbé de Citeaux, homme de fer, et Milon, légat a latere, dirigeaient la croisade.
Les départements-(histoire)- Somme - 80 -
La Somme constitue l'ancienne province de Picardie, province dont le nom a été, pour les étymologistes, le texte de si longues et si stériles dissertations. Les Romains trouvèrent ce territoire occupé par de nombreuses tribus dont ils nous ont transmis les noms ; c'étaient, au nord, les Morini ; à l'ouest, les Ambiani, qui avaient pour capitale Somarobriva, et les Britanni ; les Veromandui, à l'est, et, au sud, les Bellovaci et les Sylvanectenses. Les Ambiani, les Morini et les Bellovaques prirent une large part à la guerre de l'Indépendance sous Vercingétorix ; mais, vaincus comme les autres peuples de la Gaule, ils se soumirent et firent partie de la seconde Belgique.
La résistance des habitants à la domination étrangère leur mérita l'estime des vainqueurs. D'importants privilèges, Marges franchises municipales, de nombreux embellissements dans les villes assurèrent la paix dans le pays jusqu'à l'arrivée des Francs. Clodion est le premier chef qui y pénétra, au commencement du IVe siècle ; c'est à peu près vers la même époque qu'apparaissent aussi les premiers propagateurs de la foi chrétienne, saint Firmin, saint Crépin et saint Crépinien, saint Valère, saint Ruffin, saint Quentin, saint Vaast, saint Valery, saint Ricquier, saint Lucien et les apôtres de l'Église irlandaise.
Leur lutte contre le druidisme et le paganisme romain fut laborieuse et rude ; les traits principaux du caractère picard se retrouvent aussi prononcés, à cette époque, qu'ils se sont maintenus depuis. La ténacité, l'obstination, la fidélité aux vieilles croyances furent de sérieux obstacles à l'établissement de la foi nouvelle. Mais hâtons-nous d'ajouter que la vérité, une fois connue et acceptée, ne trouva nulle part de plus zélés sectateurs ni de défenseurs plus intrépides.
Sous les princes de la première race, la Picardie demeura inféodée au domaine royal ; elle taisait partie de ce qu'on appelait alors la France. Ce fait s'explique quand on se rappelle que, jusqu'à Charlemagne, Soissons fut, à vrai dire, la capitale de la monarchie franque et la résidence la plus habituelle des rois. Sous les successeurs du grand empereur, l'immensité des possessions conquises nécessita la création de comtes ou lieutenants, chargés de gouverner les provinces au nom du souverain, qui en vivait éloigné.
C'est en 823 que nous voyons Louis le Débonnaire abandonner pour la première fois l'administration de la Picardie à un comte. On sait quels furent les rapides envahissements de ces nouveaux pouvoirs, et en combien de lieux et de circonstances ils parvinrent à se rendre indépendants. Grâce à l'inamovibilité des fiefs féodaux, les alliances de famille concentrèrent bientôt entre les mains de quelques seigneurs une puissance rivale de celle des rois. Le développement de ces usurpations remplit toute la seconde race et aboutit au triomphe définitif, au couronnement de la haute féodalité dans la personne des Capet, comtes de Paris.
La Picardie suivit la loi générale. Un Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui avait épousé une comtesse de Vermandois, voulut, après la mort de sa femme, retenir le comté d'Amiens, qui devait retourner à Aliénor, comtesse la Saint-Quentin, soeur cadette de la défunte. L'injustice de cette prétention était si flagrante, et l'ambition du comte Philippe prenait des proportions si menaçantes, que le roi de France crut devoir enfin intervenir ; il ne s'agissait ni de remontrances ni d'arbitrage, c'est une guerre sérieuse qu'il fallut entreprendre pour réduire l'ambitieux vassal ; et encore une dernière satisfaction lui fut-elle donnée par le traité de paix qui intervint . il fut convenu que le beau-frère et la belle-soeur jouiraient successivement de la province en litige, et qu'après leur mort elle appartiendrait à la, couronne.
C'est à Philippe-Auguste qu'on doit cet arrangement, qui fit rentrer la partie la plus importante de la Picardie dans le domaine national. Le Ponthieu, dont Abbeville est la capitale, passa successivement dans les maisons d'Alençon, de Dammartin, de Castille et d'Angleterre. Philippe de Valois le reprit sur Édouard III par confiscation ; ce comté, ainsi que celui de Santerre (territoire de Péronne), avait été rattaché à la couronne, lorsque Charles VII, en 1435, engagea au duc de Bourgogne, pour quatre cent mille écus, toutes les villes situées sur la Somme.
Le droit des rois de France étant enfin reconnu, cette aliénation ne devait être que momentanée. Le premier soin de Louis XI, deux ans après son avènement au trône, en 1463, fut d'acquitter la dette contractée par son père et de rentrer dans l'entière possession de la Picardie.
Depuis cette époque, la province n'a pas cessé d'être française. Elle comprenait alors l'Amiénois, le Boulonnais, le Ponthieu, le Santerre, le Vermandois, le Thiérache, le Pays reconquis, le Beauvoisis, le Noyonnais et le Laonnais ; on y réunit l'Artois. Dans la suite, les territoires de Beauvais, Noyon et Laon en furent détachés au profit de l'lle-de-France ; puis, en 1790, dans la dernière division du sol français en départements, Boulogne et Montreuil furent affectés au Pas-de-Calais ; l'Aisne eut les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins ; tout le reste forma le département de la Somme.
Depuis la réunion de la Picardie à la France, son histoire, comme province, se confond avec l'histoire générale du pays. L'intérêt et l'importance des événements qui s'y sont passés sont tout entiers dans les chroniques particulières des villes ; nous y renverrons donc le lecteur, nous contentant ici de quelques observations sur la physionomie générale de la province.
La grande lutte de Charles le Téméraire trouvera sa place dans la notice de Péronne, et les chroniques d'Amiens nous diront l'histoire de la rivalité des maisons de France et d'Espagne. Ce qu'il importe de constater ici, comme aperçu synthétique, c'est la profonde empreinte laissée sur le sol picard par chacune des grandes crises sociales qui ont tour à tour transformé notre pays. Le caractère des habitants, lent et paresseux dans ses évolutions spéculatives, défiant dans sa naïveté, après avoir opposé aux principes nouveaux une résistance obstinée, s'en est laissé pénétrer plus profondément qu'aucun autre.
Nous avons parlé de l'enracinement des croyances païennes en face de la Gaule presque entièrement convertie au christianisme ; dès que la vraie foi se fut emparée des intelligences et des coeurs, la Picardie devint le pays le plus religieux peut-être de la chrétienté. Est-il besoin de citer les fameuses écoles monastiques de Corbie et de Saint-Ricquier, les pèlerinages si célèbres et si fréquentés à Notre-Dame de Liesse, à Notre-Dame de Boulogne et à l'église du Saint-Esprit de Rue ?
L'époque des croisades surtout éclate en glorieux témoignages de la piété des Picards ; et, pour emprunter les paroles d'un historien moderne de la province, c'est un Picard, Pierre l'Hermite, qui prêche la première croisade et marche à l'avant-garde ; c'est un Picard, le baron Creton d'Estourmel, qui, le premier, plante sa bannière sur les murs de Jérusalem, et sa famille, en mémoire de ce fait d'armes, inscrit sur son blason cette noble devise : « Vaillant sur la crête » ; enfin, c'est un Picard, Godefroy de Bouillon, le plus glorieux peut-être, qui porta le premier la couronne de Jérusalem. Voilà pour le sentiment religieux.
Quant à l'esprit féodal, les preuves de son développement, en Picardie, sont bien plus nombreuses encore. Suivant le même auteur, on comptait dans la mouvance directe du comté de Ponthieu 250 fiefs et plus de 400 arrière-fiefs ; dans la mouvance du comté de Guines, 12 baronnies et 12 pairies.
La plupart des seigneurs avaient haute et basse justice, et sur aucun point du royaume peut-être le droit féodal ne présentait des usages plus bizarres, des symboles plus étranges. Les familles nobles, sous le règne de Louis XIV, étaient au nombre de 500, toutes d'origine ancienne ; et, parmi les plus illustres, nous citerons les maisons d'Ailly, de Boufflers, de Créqui, de, Rambures, d'Estrée, d'Humières, de Melun, de La Motte-Houdancourt, de Gamaches, de Mailly, de Rubempré, de Senarpont ; n'oublions pas qu'outre Godefroy de Bouillon, la noblesse picarde a donné huit rois au trône de, Jérusalem.
Non, cependant, que la sève du pays soit épuisée par cette exubérance de floraison aristocratique ; lorsqu'à bout de résignation et de patience, après un long et sérieux travail des esprits, l'indépendance municipale essayera ses premières manifestations, quels magnifiques exemples d'habile persévérance, de courageuse initiative et d'invincible fermeté, les villes de Picardie ne donneront-elles pas au reste de la France ?
Vers 1250, l'affranchissement des communes était à peu près complet dans la province entière. Cette vaillance proverbiale des Picards, mise au service des intérêts locaux, n'a jamais fait défaut non plus dans les grandes questions nationales ; depuis Bouvines jusqu'aux immortelles campagnes de la République et de l'Empire, les Picards ont toujours marché au premier rang parmi les défenseurs de la patrie ; le bataillon de la Somme fut toujours un de ceux qui se firent le plus remarquer par leur valeur et leur patriotisme.
Pendant la guerre de 1870-1871, le département de la Somme fut envahi par les Prussiens. Après les combats de Mézières, de Boves et de Villers-Bretonneux, ils occupèrent Amiens et sa citadelle, abandonnées par l'armée du Nord, qui, sous les ordres du général Faidherbe, ne tarda pas à reprendre l'offensive, en s'emparant de la forteresse de Ham, et en livrant, à Pont-Noyelles, aux Prussiens, un combat qui leur fit éprouver des pertes considérables.
Cependant, Péronne, assiégée et bombardée pendant plusieurs jours, dut capituler ; mais Abbeville ne fut occupée qu'après l'armistice, jusqu'au 22 juillet 1871, où les Prussiens évacuèrent le département. L'invasion lui avait coûté 22 850 443 fr. 27 cent. Puis le génie industriel s'est emparé, tout aussi puissamment qu'avant la guerre, du département de la Somme, le coton et la laine y étant travaillés sous mille formes diverses. Amiens était ainsi devenue au XIXe siècle une des villes manufacturières les plus importantes de France ; l'agriculture était très perfectionnée dans les localités où le sol avait pu répondre aux efforts des cultivateurs ; les vastes tourbières étaient soumises à une exploitation chaque jour plus savante.
Les départements-(histoire)-Deux Sèvres - 79 -
Des trois départements qui ont été formés avec l'ancien Poitou, celui des Deux-Sèvres occupe la région centrale ; confinant à l'est à la Vienne, et à la Vendée à l'ouest, il fait vers le sud-ouest une pointe dans la Saintonge, à laquelle il a emprunté 25 921 hectares de son territoire. Cette position explique l'absence d'une histoire particulière pour cette contrée, après les notices que nous avons données sur le haut et le bas Poitou, dans les parties de cet ouvrage qui s'y rapportaient plus directement. De la conquête romaine à l'établissement de la féodalité, nous n'avons pas à citer un seul fait qui ne rentre ou dans l'histoire générale de la province, ou dans les annales particulières des localités.
Comme le reste du Poitou, ce pays était habité par les Pictones, quand les Romains l'envahirent. Après avoir pris part à la lutte nationale, qui se termina par la chute d'Alésia et la défaite de Vercingétorix, ils se soumirent à César, et firent partie de l'Aquitaine, dont ils suivirent la fortune, tour à tour conquis par les Wisigoths et par les Francs. Au commencement du VIe siècle, saint Agapit et saint Maixent prêchèrent dans le pays la foi nouvelle, et y fondèrent une abbaye. Vers 732, les Sarrasins y parurent, mais pour être bientôt dispersés par Charles-Martel.
Sous les Carlovingiens, quand le pouvoir des grands vassaux se substitua, dans la France entière, à l'autorité royale, quand les puissants comtes de Poitiers, créés par Charlemagne, eurent affermi leur domination sur les vastes territoires devenus leurs fiefs héréditaires, on vit se reproduire en petit, dans leur province, ce qui s'était passé dans le royaume. Les barons, qu'ils avaient préposés à l'administration des diverses parties de leurs domaines, affectèrent vis-à-vis d'eux la même indépendance que les comtes affectaient eux-mêmes envers le roi de France, et de même que l'État n'était plus que l'assemblage fictif de provinces à peu près indépendantes, le Poitou ne fut plus que la réunion de seigneuries obéissant à des maîtres différents, soumises chacune à des lois et à des usages particuliers et trop souvent en guerre les unes contre les autres.
C'est alors que prirent naissance ces désignations de Niortais, de Bressuirois, de Mellois, souvenir rajeuni des subdivisions gauloises, qui donnaient à chaque canton ou pagus ses frontières, son administration et sa petite capitale. Ce fractionnement était un obstacle à toute influence sérieuse des populations dans les grandes affaires du pays. Il fallait qu'un danger commun ou qu'un principe nouveau brisât les vieilles barrières, ralliât toutes ces forces disséminées et refit un corps de ces membres épars.
Ce résultat, que l'ancien ordre de choses ne permettait pas d'espérer de la paix, on l'obtint d'abord de la lutte contre les Anglais, et plus tard, quelque contradictoire que paraisse cette assertion, des guerres civiles et religieuses qui bouleversèrent la province. L'émotion répandue par ces alternatives de succès et de revers finit par pénétrer jusqu'au fond des contrées les plus insouciantes ou les plus étrangères aux grands intérêts qui étaient en jeu ; les sympathies des populations devenant un appoint important dans les opérations de la guerre, on se préoccupa de part et d'autre de se concilier leur intérêt, dont jusque-là on avait fait si bon marché.
C'est ainsi que nous voyons en quelque sorte mis aux enchères le concours de la bourgeoisie des villes, et cette précieuse alliance achetée au prix de chartes communales, de privilèges commerciaux, qui initiaient les habitants à la vie publique. Cette révélation de droits nouveaux, rayonnant des cités dans les campagnes, y éveilla des sentiments de solidarité dans lesquels était en germe le nationalisme français.
Après une si longue ignorance, et cet isolement séculaire de tous les intérêts généraux, il dut y avoir beaucoup d'hésitation et de grandes incertitudes. Les princes anglais, ducs héréditaires de Guyenne, comtes de Poitou, étaient-ils bien des étrangers ? Et le roi de Paris, qui était si loin et qu'on ne voyait jamais, était-il bien le monarque légitime ?
Il fallut de longues années et de rudes épreuves pour que la vérité se dégageât des événements. Les trois siècles qui séparent le règne de Louis le Jeune de celui de Charles VII y suffirent à peine ; mais, au XVe siècle, le résultat était cependant en grande partie obtenu : le Poitou était province française et avait le sentiment de sa nationalité. Un autre progrès s'était encore accompli, le pouvoir s'était centralisé, et le roi, vainqueur de l'étranger, rattachait plus directement à son autorité souveraine les provinces dont il était le libérateur. Les habitants du territoire des Deux-Sèvres commencent donc à sortir de la passivité où le régime féodal les avait tenus jusqu'alors, et entrent dans la sphère d'action au milieu de laquelle s'agitent les siècles suivants.
Pendant la période anglaise, quoique le pays fût souvent le théâtre de la lutte et se trouvât presque toujours atteint par ses résultats, les habitants n'eurent encore qu'un rôle relativement passif, et furent, pour ainsi dire, moins acteurs que spectateurs ; c'est seulement dans la période suivante que leur initiative commence à se dessiner. Il semble que la population tout entière prît à coeur de se venger de la longue insignifiance de son passé par l'ardeur avec laquelle elle se jeta dans le grand drame religieux du XVIe siècle. Il n'y eut pas une ville, pas une bourgade qui ne se mêlât alors aux révoltes des protestants, comme plus tard aux agitations de la Ligue.
Ce fut à Châtillon, en 1568, que les chefs du parti réformé se rassemblèrent pour la première fois après s'être assurés des places voisines, telles que Thouars, Parthenay, Oyron, etc. Dandelot, frère de l'amiral Coligny, fit capituler Niort et passa au fil de l'épée la garnison de la tour Magné. Saint-Maixent se rendit à lui dans le même temps. Les armées des ducs de Montpensier et d'Anjou se rencontrèrent près de Pamproux, où la campagne se termina par une escarmouche. Les chefs protestants et la reine de Navarre passèrent l'hiver à Niort, où ils s'occupèrent à réunir des forces, à pourvoir aux finances de leur parti par la vente des biens ecclésiastiques, et à se ménager les secours de l'Angleterre.
Après la journée de Moncontour, si fatale aux protestants, les villes de Châtillon, de Thouars et d'Oyron furent évacuées ; l'amiral Coligny recueillit les débris de l'armée à Niort, et, après y avoir laissé garnison, se retira à La Rochelle. Niort capitula à l'arrivée du duc d'Anjou, et tout le Poitou se soumit.
Une tranquillité, du moins apparente, régna jusqu'en 1588. A cette époque, les protestants, menacés dans La Rochelle, se remirent en campagne. D'Aubigné s'empara de Niort et de Saint-Maixent. Thouars et les places environnantes se rendirent aux protestants un an après. L'avènement de Henri IV au trône ramena la paix.
La guerre ne recommença qu'en 1621, sous Louis XIII, lorsque le projet d'établir une république protestante surgit dans le conseil des chefs protestants. La Bretagne et le Poitou devaient être un des huit cercles de cette république. L'énergie déployée en cette circonstance par le cardinal de Richelieu et la présence du roi en Poitou déterminèrent la soumission de Niort et de Saint-Maixent ; la prise de La Rochelle, en 1628, mit le sceau à la paix définitive.
Cent cinquante ans de paix succédèrent a ces longues agitations ; mais le souvenir des rivalités locales, le réveil des haines mal éteintes donnèrent, en 1792, à l'explosion contre-révolutionnaire un caractère particulier d'obstination. Quatre-vingt-sept communes du département se soulevèrent et prirent une part active à la lutte.
Les arrondissements de Bressuire et de Parthenay fournirent aux rebelles leurs principaux chefs, La Rochejacquelein entre autres. Pendant que Niort devenait le quartier général de l'armée républicaine, Châtillon était le siège du conseil supérieur de l'armée royale. Thouars fut la première ville importante dont les Vendéens s'emparèrent ; Parthenay, Bressuire et un grand nombre de villes de la Gâtine et du Bocage furent tour à tour prises ; reprises, incendiées, démantelées, détruites même pendant cette déplorable guerre civile.
Nulle part ne fut plus manifeste et plus tranchée la ligne qui séparait alors l'opinion des villes de celle des campagnes. Autant la naïve ignorance, le culte du passé, les pieuses traditions de famille firent des uns les aveugles instruments des agents royalistes, autant l'intelligence des autres fut prompte à comprendre le problème posé parla Révolution, autant cette conscience de l'avenir les rattacha étroitement à sa cause.
C'est cette foi également ardente et sincère des deux côtés qui donna à la lutte ses proportions gigantesques ; l'héroïsme des uns n'eut de comparable que le dévouement des autres, et aux fabuleux exploits des intrépides paysans il n'y a à opposer que les glorieuses et stoïques expéditions de ces gardes nationaux des villes, eux aussi soldats improvisés, quittant, eux aussi, leur foyer, leur famille, et sachant aussi mourir pour la cause qu'ils avaient embrassée. Depuis la pacification, nous ne trouvons dans l'histoire du département qu'un seul fait important à noter, c'est la fameuse conspiration de Berton, en 1822.
Si la guerre civile a trop longtemps désolé le département des Deux-Sèvres, il n'a pas eu, en compensation, à souffrir de la guerre étrangère. Situé loin de la frontière, il a dû à sa position de n'avoir subi ni les hontes ni les malheurs des invasions. Ce qui ne l'empêcha point de payer largement sa dette à la patrie, en envoyant ses enfants aux armées qui, en 1814 et 1815 d'abord, puis en 1870 et 1871, luttèrent si vaillamment, mais hélas ! si inutilement, pour repousser l'étranger.
Quoique, depuis cinquante ans, les moeurs se soient bien modifiées dans la contrée qui nous occupe ; quoique, là comme ailleurs, s'accomplisse chaque jour l'œuvre de progrès et d'assimilation, le département des Deux-Sèvres est encore un de ceux qui a gardé, dans certaines parties, le plus de son ancienne originalité ; nous en emprunterons quelques traits à un de ses plus habiles administrateurs, M. Dupin, qui y fut préfet dès les premières années de l'Empire :
« Le département des Deux-Sèvres, composé de trois parties bien distinctes, savoir : le Bocage, qui comprend tout le nord-ouest, c'est-à-dire la presque totalité des premier et deuxième arrondissements et une partie du troisième ; le Marais, qui occupe une portion sud-ouest du troisième arrondissement, et, enfin, la Plaine, offre les mêmes différences dans la constitution physique et morale de ses habitants.
« 'homme du Bocage a une taille médiocre, mais assez bien prise ; tête grosse et ronde, teint pâle, cheveux noirs, yeux petits, mais expressifs ; son tempérament est bilieux et mélancolique ; son esprit est lent, mais non sans profondeur ; son cœur est généreux, mais irascible ; sa conception peu facile, mais sure. Il a conservé toute la simplicité des mœurs anciennes, quoique la guerre en ait un peu altéré la pureté. Il est bon, hospitalier, juste et d'une fidélité inviolable à ses engagements ; mais taciturne a l'excès, méfiant pour tout ce qui vient de l'autorité, fortement attaché au sol qui l'a vu naître, plus attaché encore à la religion de ses pères, et capable des actions les plus héroïques pour la défense de sa foi.
« Dans tous les temps, on l'a vu prendre part aux guerres religieuses. Son humeur mélancolique et les préjugés superstitieux qui le gouvernent tiennent essentiellement au pays qu'il habite. II vit isolé dans sa chaumière, ne voyant autour de lui aucune autre. habitation. S'il sort pour cultiver son champ, il y est encore seul ; de larges fosses, des haies impénétrables lui interdisent la vue de son semblable. Il n'a d'autre société que celle de ses bœufs, à qui il parle sans cesse, et pour qui même il fait des chansons. S'il veut vendre quelques bestiaux à une foire, la foire est rarement à plus d'une lieue ; souvent même les marchands viennent le trouver dans son enclos. Il n'y a dans ces contrées aucune ville qui répande la civilisation, aucune routé qui y conduise les étrangers, qui favorise la circulation, qui permette aux habitants de se fréquenter, et aux passions humaines de s'adoucir et de s'user par un frottement journalier.
« La Plaine est traversée par plusieurs grandes routes, et ses habitants sont plus civilisés que ceux du Bocage ; ils ont un caractère moins prononcé et plus confiant ; ils aiment le repos, la danse, le vin, sans toutefois en faire excès ; leur taille est plus élevée, leur physionomie plus ouverte, leur carnation plus vive. Ils sont aussi braves, mais moins industrieux et plus processifs ; ce qui provient sans doute de ce que leurs propriétés n'ont pas des limites aussi immuables. Quoique leur esprit, plus flexible, se soit plus facilement détaché des prêtres, il n'est pas moins ouvert à tous les préjugés de l'ignorance. Il existe pourtant, dans la Plaine, une différence assez notable entre les catholiques et les protestants ; ceux-ci sont, en général, plus laborieux et plus instruits.
« L'habitant du Marais est encore plus grand que celui de la Plaine ; il a plus d'embonpoint, ses membres sont plus massifs, mais il manque de santé et d'agilité ; il est grossier, apathique et ne pousse pas loin sa carrière. Une cabane de roseaux, un petit pré, quelques vaches, un bateau qui sert a la pêche, et souvent à voler du fourrage le long de la rivière, un fusil pour tuer les oiseaux d'eau, voila toute sa fortune et tous ses moyens d'industrie. »
Au XIXe siècle, les usages, sauf les cérémonies des noces, qui offrent quelques traits particuliers, n'ont rien de remarquable. Les fêtes et divertissements tiennent aux travaux champêtres et à la croyance religieuse. C'est ainsi que la récolte des châtaignes, dans certaines contrées, et, dans d'autres, la tonte des brebis, le fanage, la moisson sont accompagnés de jeux et de danses ; que le jour de tel saint il faut se régaler de crêpes pour empêcher le blé de se carier, etc.
Pendant l'été, il y a beaucoup de ballades ou fêtes champêtres. C'est là que les hommes boivent et que les jeunes gens dansent au son de la musette, ou plus souvent à la voix d'une vieille femme qui chante gravement un air monotone et sans paroles ; c'est là que se forment les inclinations, que s'arrangent les mariages. Une jeune fille qui paraît à la ballade sans un garçon qui lui tire les doigts est méprisée de ses compagnes. C'est aussi aux ballades qu'on choisit les domestiques : ils y viennent parés d'épis, s'ils se destinent aux travaux de la moisson ; de fleurs, s'ils veulent servir aux travaux du ménage.
Les fêtes de l'été ont donné naissance aux inclinations, les mariages se concluent en automne. Le fiancé, accompagné d'un de ses parents et d'un parent de sa prétendue, va faire les invitations. Il a grand soin de régler l'ordre de ses visites sur les différents degrés de parenté ; c'est une étiquette a laquelle on tient strictement. Il attache dans chaque maison, au lit du maître, un petit bouquet de laurier, orné de rubans, et fait son invitation par un compliment très long, qui est le même pour tous et de temps immémorial. Ces visites sont accompagnées de fréquentes libations.
Le jour des noces est suivi d'un lendemain plus joyeux et plus bruyant encore ; l'épisode le plus caractéristique de la cérémonie est le bouquet symbolique offert a la mariée par les jeunes filles, ses compagnes, accompagnant leur offrande d'une chanson qui n'a pas varié depuis trois cents ans, et qui retrace toutes les peines réservées à la jeune femme dans son ménage.
Les départements-(histoire)-Yvelines - 78 -
Partie 2
Le canton de SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Les règnes suivants devaient être agités par les guerres de la Réforme. Les idées nouvelles pénétrèrent de bonne heure dans l'Ile-de-France ; elles avaient de nombreux adhérents dans le Vexin, où Calvin avait été accueilli par le seigneur d'Hargeville, dans son château situé près de Wy ou Joli-Village ; il y résida quelque temps, y composa une partie de ses ouvrages et prêcha lui-même sa doctrine dans les villages environnants, à Limay, Avernes, Arthies, Jambville et Gadancourt.
Henri Ier, François Il et Charles IX, pendant les premières années de son règne, passèrent alternativement de la rigueur à la tolérance dans leur attitude vis-à-vis des protestants. C'est dans le pays de Seine-et-Oise que se tinrent les premières réunions où les représentants des deux cultes travaillèrent à la pacification des esprits et a la conciliation des consciences ; les états généraux furent d'abord convoqués dans ce but à Saint-Germain ; puis, quelques années plus tard, en 1561, s'ouvrit le colloque de Poissy, fameux par les discussions violentes de Théodore de Bèze ; de nouvelles conférences eurent lieu l'année suivante à Saint-Germain sans amener de meilleurs résultats, et la guerre éclata tout à coup par le massacre de Vassy.
Qui ne se rappelle les sanglants épisodes de ces déplorables guerres, les tristes exploits de Coligny, de Condé et de Montmorency ; ce malheureux département en fut trop souvent le théâtre ; les points stratégiques que les partis ennemis se disputèrent avec le plus d'acharnement furent Corbeil, qui commande le cours de la haute Seine, et Étampes qui domine la ligne de communication entre la capitale et les provinces de l'ouest et du sud.
Cette dernière ville, prise par Condé, resta au pouvoir des protestants jusqu'au traité de paix de Longjumeau ; dans l'intervalle eut lieu la bataille de Dreux, gagnée par Montmorency, commandant l'armée catholique, et la bataille de Saint-Denis, qui amena la petite paix, trêve de six mois rompue par le massacre de la Saint-Barthélemy. Les fanatiques égorgeurs de Paris durent avoir des complices nombreux dans le département de Seine-et-Oise ; mais le rang et le nom des victimes parisiennes ont trop fait oublier les martyrs plus obscurs des campagnes environnantes.
La soif de vengeance que la trahison du Louvre alluma au coeur des huguenots rendit la guerre plus ardente et plus implacable encore. La tiédeur et l'hésitation que les zélés catholiques reprochaient à Henri III avaient grandi l'influence des Guises. L'ambition héréditaire de cette famille n'allait à rien moins qu'à s'emparer de la couronne, dont elle n'était plus séparée que. par un prince maladif et peu populaire, et par Henri de Béarn, chef du parti huguenot. L'assassinat du roi de France, frappé à Saint-Cloud par un jacobin fanatique nommé Jacques Clément, simplifiait encore la question : d'un côté, le droit et la légitimité avec Henri le huguenot ; de l'autre, l'usurpation avec les Guises, forts de leur valeur personnelle, de leur clientèle fanatisée et de la puissante organisation de la Ligue.
A l'exemple de Paris, l'Ile-de-France tenait en grande partie pour les Guises ; aussi fut-elle encore le théâtre des luttes qu'eut à soutenir Henri IV lorsqu'il vint jusque sous les murs de la capitale revendiquer ses droits à l'héritage de Henri III. La conversion du roi acheva l'oeuvre de pacification si glorieusement commencée par la victoire d'Ivry ; la sage administration de Sully, l'esprit de tolérance et d'économie du gouvernement, eurent bientôt cicatrisé les plaies faites par les dernières guerres ; l'Ile-de-France, dont le sol offre tant de ressources, releva toutes ses ruines ; la culture encouragée reprit un rapide essor ; Sully en donnait l'exemple, et, comme, propriétaire du château de Rosny, il fit de nombreuses plantations de mûriers ; Mantes, dont il était le gouverneur, vit s'élever dans ses murs une fabrique de draps ; le château de Saint-Germain fut reconstruit, celui d'Étampes restauré et le duché concédé à la belle Gabrielle d'Estrées.
Les bienfaits de ce règne furent répartis avec tant d'à propos et, d'intelligence, la pacification des esprits fut si complète, qu'à la mort du roi les désordres qui signalèrent la régence de Marie de Médicis n'affectèrent quo d'une façon peu sensible les pays de Seine-et-Oise.
L'administration de Richelieu consolida encore pour eux les bienfaits de celle de Sully. Nous n'avons à citer, sous le règne de Louis XIII, que la naissance à Saint-Germain de Louis XIV, en 1638, et, en 1641, l'assemblée générale que tint le clergé de France dans la ville de Mantes.
La haute noblesse, qui avait été obligée de courber la tête sous la main de fer de Richelieu, voyait à la mort de Louis XIll, dans la perspective d'une longue minorité, une occasion favorable pour revendiquer ses prétendus droits et reconquérir ses privilèges.
La confiance de la reine régente, abandonnée à un autre cardinal dévoué aux idées de Richelieu, son continuateur présumé, à un étranger, à Mazarin, souleva l'indignation des grands et dès princes ; l'opposition des parlements, suscitée par là noblesse, fut le prélude d'hostilités plus sérieuses ; les promesses des meneurs, les épigrammes des beaux diseurs, l'influence du clergé, parvinrent à entraîner les bourgeois de Paris dans cette non-elle Ligue.
Les frondeurs disputaient à la reine mère et au cardinal la personne du jeune roi ; la cour dut quitter Paris et se réfugier à Saint-Germain, sous la protection d'une armée de huit mille hommes ; de leur côté, les rebelles organisèrent leurs forces : le prince de Conti fut nommé généralissime. Les villes de Seine-et-Oise furent, comme toujours, les points qu'on se disputa le plus vivement ; Étampes, Corbeil, Saint-Cloud, Dourdan, dont la Fronde était maîtresse, furent d'abord repris par Condé : une paix de peu de durée fut la conséquence de ces premiers succès de l'armée royale ; une rupture, qui éclata entre la cour et Condé, donna à la lutte un caractère plus sérieux ; Turenne fut opposé par Mazarin à ce redoutable adversaire ; personne n'a oublié les exploits plus affligeants encore que brillants des deux illustres capitaines, ni le fameux combat du faubourg Saint-Antoine, où ils faillirent eux-mêmes en venir aux mains ; cette guerre sans motifs sérieux, et à laquelle devait mettre fin la majorité de Louis XIV, n'en causa pas moins de grands malheurs dans nos pays : Corbeil, Saint-Cloud, Palaiseau, Mantes, furent victimes de l'indiscipline. des soldats des deux armées, qui, manquant de vêtements et de solde, pillaient et rançonnaient les villes et les campagnes. Enfin Paris, éclairé sur le but réel des princes et des organisateurs de la Fronde, se détacha de leur cause et ouvrit ses portes au roi, qui y fit son entrée en 1653.
Les pays de Seine-et-Oise, qui avaient eu une si large part dans tous les revers et toutes les épreuves de la royauté, participèrent plus que toute autre province aux splendeurs du triomphe : le règne de Louis XIV, est raconté par toutes les magnificences des châteaux dont il nous reste à faire l'histoire. La guerre, portée au delà de nos frontières, n'ensanglanta plus les campagnes de l'Ile-de-France ; et Versailles a gardé le glorieux souvenir des années de paix.
Il en est de même pour le règne des princes qui se sont succédé jusqu'à nos jours sur le trône de France ; l'importance des châteaux royaux et des résidences princières rattache désormais à leurs lambris le souvenir des faits principaux qui seuls sont du domaine de cette notice. C'est à Louveciennes et à Marly que nous étudierons Louis XV ; pour son malheureux successeur, Trianon complètera Versailles, Saint-Cloud nous dira le 18 brumaire, et les douloureux mystères de la Malmaison nous conduiront des gloires du premier Empire aux désastres de l'invasion.
Ajoutons que, depuis 1789, l'immense développement de Paris a absorbé toute importance politique, toute originalité saillante dans Seine-et-Oise qui l'entoure ; ce qui nous reste à dire du département n'est plus guère qu'une oeuvre de statistique.
Jusqu'à la Révolution de 1789, il était compris dans le gouvernement de l'lle-de-France ; on y comptait, sous le rapport judiciaire, les prévôtés royales de Poissy, Montlhéry, Corbeil, Arpajon, Gonesse, qui toutes relevaient des prévôté et. vicomté de Paris ; puis venaient : le bailliage et présidial de Mantes, les bailliages simples de Montfort-l'Amaury et d'Étampes, les bailliage et prévôté de Pontoise, etc. Le ressort de ces juridictions était plus ou moins étendu. La coutume de Paris les régissait presque toutes, à l'exception des paroisses du bailliage de Pontoise, qui suivaient les unes la coutume de Senlis et les autres celle du Vexin français.
Sous le rapport financier, le département était de la généralité de Paris, et on y comptait les élections d'Étampes, Mantes, Montfort-l'Amaury et Pontoise. Corbeil, Versailles, Saint-Germain et leurs dépendances étalent de l'élection de Paris. Des gouverneurs royaux commandaient dans les principales villes qui étaient du domaine de la couronne.
Le département, formé en 1790 par l'Assemblée nationale dans un sentiment de défiance contre Paris qu'elle craignait de rendre trop redoutable au reste de la France, fut alors divisé en 9 districts administratifs et judiciaires : Versailles, Montlhéry, Mantes, Pontoise, Dourdan, Montfort-l'Amaury, Étampes, Corbeil et Gonesse. L'organisation impériale de 1804, qui a prévalu jusqu'à nos jours, le partagea en 5 arrondissements : Versailles, chef-lieu ; Corbeil, Étampes, Mantes et Pontoise.
En 1811, Rambouillet fut érigé en 6e arrondissement, pour la formation duquel on prit sur ceux d'Étampes et de Versailles ; ces 6 arrondissements se subdivisent en 36 cantons, comprenant chacun en moyenne 19 communes. Le Concordat de 1801 a établi a Versailles un évêché, qui étend sa juridiction sur tout le département.
Il serait difficile de caractériser la population de Seine-et-Oise ; la diversité de race de ses anciens habitants a été remplacée par la variété des travaux, la différence des positions, l'inégalité des fortunes ; de même que le sol se prête à tous les genres de culture, le génie des habitants s'est plié à toute espèce d'industrie : l'usine y touche à là ferme, la chaumière du vigneron au château du banquier millionnaire.
Seine-et-Oise est à la fois, et le jardin de Paris et là succursale de ses manufactures ; le campagnard ne travaille qu'en vue de Paris, qui consomme et qui achète ; il y a toujours au bout des rêves du Parisien un point des riants paysages de l'Ile-de-France, comme but de sa promenade des dimanches, comme retraite promise aux loisirs de sa vieillesse ; ces rapports étroits, intimes, ce frottement continuel, ont donné au paysan de Seine-et-Oise un caractère qui n'est déjà plus celui du campagnard et qui cependant n'est pas encore celui du citadin ; ce type nouveau, que la rapidité des communications développe de jour en jour, mériterait une étude plus approfondie que ne le comporte le cadre de cet ouvrage ; il nous appartenait seulement d'en signaler l'apparition, qui n'est nulle part plus. sensible que dans cette contrée.
Que nous reste-t-il à dire après tout ce qui a été écrit sur les sites délicieux de ce pays ? Quel est celui de ses bois, de ses coteaux ou de ses vallons qui n'ait eu ses peintres, ses historiens, ses poètes ? A ces tableaux, qui sont encore devant tous les yeux, à ces descriptions qui sont dans toutes les mémoires, nous n'ajouterons qu'un mot, c'est que ni l'inspiration des uns ni l'enthousiasme des autres n'a exagéré les gracieuses merveilles de la réalité; c'est que, malgré tout ce qu'ont pu ajouter aux délices du paysage les fantaisies du luxe, les ressources de l'art, les magnificences des rois, on peut dire que pour lui la nature avait fait plus encore.
Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le département de Seine-et-Oise fut, parmi les départements qui subirent alors les douleurs et les hontes de l'invasion, un de ceux qui eurent le plus à souffrir. La situation de son territoire, qui enveloppe Paris de tous les côtés, l'exposait plus que tout autre au danger ; en effet, aussitôt après la lamentable défaite à Sedan, dès le 4 septembre, la capitale de la France devenait l'objectif des Allemands : la IIIe armée, celle du prince royal de Prusse, moins les Bavarois, se mettait en marche dans cette direction.
Le 12 septembre, deux éclaireurs sont aperçus à Ablon, dans le canton de Longjumeau; le 15, des cavaliers se montrent à Draveil; le 16, dès le matin, des troupes de toutes armes, venues de Lagny et de Brie-Comte-Robert, inondent le canton de Boissy-Saint-Léger et se massent dans la plaine de Vigneux. A ce moment, Paris était prêt d'être investi : la IIIe et la IVe armée allemandes sont à deux marches de la capitale, dans la direction du nord-est et du nord-ouest : la 5e et la 6e division de cavalerie, chargées d'éclairer les colonnes, s'avancent vers Pontoise; le même jour, les Prussiens occupent la voie ferrée entre Ablon et Athis, puis ils descendent vers Mongeron.
Le 17, un pont de bateaux est jeté sur la Seine, près de Villeneuve-Saint-Georges, et une avant-garde de 1 000 hommes, appartenant au XIe corps bavarois, se présente dans le faubourg de Corbeil. Le 18 septembre, la 6e division de cavalerie, commandée par le duc de Mecklembourg (IVe armée) marche sur Poissy et y franchit la Seine; la 5e division de cavalerie occupe Pontoise ; le IVe corps atteint Le Mesnil-Amelot, entre Dammartin et Saint-Denis ; la brigade des uhlans de la garde attachée à ce corps marche sur Argenteuil, entre Saint-Denis et Pontoise; la garde se porte sur Thieux, entre Claye et Dammartin. Le XIIe corps (prince de Saxe) s'établit à Claye, en avant de Meaux et de Dammartin, tandis que la 2e division de cavalerie de la IIIe armée, celle du prince royal de Prusse, se dirige sur Sarlay, au sud de Paris, occupe la route qui y mène et se lie par Chevreuse avec la cavalerie du prince de Saxe ; le Ve corps de la même armée passe la Seine a Villeneuve-Saint-Georges (grande route de Melun à Paris) et s'avance jusqu'à Palaiseau ; le IIe corps bavarois marche sur Longjumeau, détachant une brigade à Montlhéry ; le VIe corps occupe Villeneuve-Saint-Georges et Brunoy.
Le quartier général de l'armée de la Meuse (ive armée) est à Saint-Souplet, entre Meaux et Dammartin, près de l'embranchement des routes, sur Paris, de Meaux, Nanteuil et Senlis. Celui de l'armée du prince royal (IIIe armée) s'établit à Saint-Germainlès-Corbeil, a la porte de Corbeil.
Le 19 septembre, le blocus est sur le point d'être complété par les deux armées allemandes; le seul côté moins fortement investi est l'espace compris en avant des forts de l'Est : la 6e division de cavalerie marche sur Chevreuse, la 5e sur Poissy; le IVe corps est à Argenteuil, la garde en avant de Pontoise ; le XIIe corps contourne Saint-Denis ; la 2e division de cavalerie, vers Chevreuse et Saclay, relie la droite de la lVe armée avec la gauche de la IIIe ; le Ve corps est a Versailles même et pousse ses avant-postes jusqu'à Sèvres et Saint-Cloud ; le IIe corps bavarois est près de l'Hay, vers Meudon jusqu'à la Bièvre ; le VIe corps est entre la Seine et la Bièvre, avec une brigade et deux escadrons sur la rive droite du fleuve et de forts avant-postes entre la Marne et la Seine.
Le 21 septembre, l'ennemi complète l'investissement de Paris sur un périmètre extérieur de près de 80 kilomètres ; il établit des communications télégraphiques directes reliant tous les quartiers généraux des divers corps d'armée par un fil électrique qui n'a pas moins de 150 kilomètres de développement.
A la date du 22 septembre, écrit Gustave Desjardins, le département de Seine-et-Oise avait sur son territoire environ 216 bataillons d'infanterie, 244 escadrons de cavalerie avec 774 canons. L'investissement de Paris était fait par 216 bataillons et 140 escadrons. Cet effectif varia peu durant le siège. Le Ier corps bavarois et la 22e division du XIe corps prussien furent détachés, le 6 octobre, et remplacés par le XIe corps prussien envoyé dans les premiers jours de novembre. Le IIe corps marcha vers l'est le 3 janvier ; mais le Ier corps bavarois revint occuper le canton de Boissy-Saint-Léger.
A l'extrême gauche de la Ille armée, la landwehr de la garde prussienne, rendue disponible par la prise de Strasbourg, avait pris position à Chatou, donnant la main à la IVe armée. L'ennemi put prendre ses positions sans rencontrer pour ainsi dire de résistance. Quelques échauffourées eurent lieu çà et là, sans autre résultat que de motiver les pillages et les exécutions sommaires.
On conçoit d'ailleurs qu'une pareille concentration de troupes sur un même point n'ait pu se faire sans un grand dommage et de grandes vexations pour les habitants, auxquels les menaces, les coups, la mort même ne furent pas épargnés. Les villes et les villages furent submergés par ce flot envahisseur qui ne cessait de grossir. Les soldats, dit Gustave Desjardins, pénètrent avec effraction dans les maisons fermées, s'installent par groupes, arrachent les habitants de leur lit.
A Verrières-le-Buisson, ils mettent leurs chevaux dans les boutiques et les rez-de-chaussée, pillent en masse les marchands de comestibles. Corbeil est écrasé : 90 000 hommes y passent en trois jours. Tout est envahi : magasins, maisons, églises ; dans le tribunal s'installe une boucherie.
A Versailles, les Allemands n'osent pas entrer dans les casernes qu'ils supposent minées et occupent les promenades. En un clin d'oeil, la ville du grand roi se transforme en campement de horde germanique. On n'entend plus que le bruit des patrouilles. et les cris rauques des sentinelles. Le 20 septembre, Saint-Germain est menacé de bombardement ; cinq bombes sont même lancées du Pecq sur cette ville.
Les faits militaires ont été peu nombreux dans le département de Seine-et-Oise, et cela se conçoit facilement, puisque l'armée régulière n'existait pas ; les gardes nationales étaient a peine armées et mal instruites ; les francs-tireurs seuls opposèrent de la résistance et quelquefois avec succès. Dans son expédition vers Mantes, la 5e division de cavalerie prussienne rencontre, après avoir brûlé Mézières, des francs-tireurs parisiens. Deux bataillons, sous les ordres du commandant de Faybel, traversent . Mantes, chassent les patrouilles prussiennes ; mais ils sont obligés de se retirer en combattant, par Écquevilly et Mareil-sur-Mauldre, sur Mantes, et de là à Vernon, devant des forces supérieures.
Dans l'arrondissement de Rambouillet, des paysans s'organisent en guérillas. Pour venir à bout de la résistance, le général de la 6e division de cavalerie prussienne ordonna une battue dans ce pays couvert de bois, et ses soldats se livrèrent à d'indignes cruautés contre des habitants inoffensifs.
Le 8 octobre, les Français attaquent les Prussiens et les Bavarois barricadés dans Ablis, près de Dourdan, et font, après une demi-heure de combat, 70 hussards prisonniers. Le lendemain, après le départ des francs-tireurs, une colonne ennemie envahit la commune, brise les portes et les fenêtres et la livre au pillage. A La Montignotte, près de Milly, le 28 septembre, quelques francs-tireurs unis à des gardes nationaux font éprouver des pertes sensibles à une colonne de 800 hommes envoyée de Melun pour châtier Milly.
A Parmain, commune de Jouy-le-Comte, dans le canton de L'Isle-Adam, des volontaires accourus de Pontoise, de Valmondois, de Méry, de Jouy-le-Comte et d'autres localités environnantes, unis à quelques francs-tireurs de la légion Mocquart, se barricadent et s'apprêtent a défendre énergiquement le passage de l'Oise. Le 27 septembre, à 10 heures du matin, quelques centaines de Prussiens, avec quatre pièces d'artillerie, essayent de s'emparer des barricades. Ne pouvant y parvenir, ils s'en prennent à la population de L'Isle-Adam. Le 29, à midi, 4 500 Prussiens sont dirigés sur Parmain, et une partie ayant réussi à passer l'Oise à Mours, tourne le village que les francs-tireurs ont le temps d'évacuer. Le 30, les Prussiens bombardaient Nesles et brûlaient Parmain.
Le chapitre des réquisitions exigées serait interminable, s'il fallait tout relater. Contentons-nous d'un court résumé. Huit jours après leur entrée dans le département, il n'était pas un village qui n'eût reçu la visite des Prussiens. On voyait d'abord paraître trois ou quatre cavaliers, sondant de l'œil tous les recoins du pays ; au premier bruit suspect, ils détalent au galop comme des daims effarouchés. Semble-t-on avoir peur, ils deviennent plus hardis, commencent par briser le télégraphe et intiment avec arrogance aux habitants l'ordre de combler les tranchées pratiquées dans les routes ; si une foule irritée les entoure, ils montrent beaucoup de modération et tâchent de se tirer de ce mauvais pas sans faire usage de leurs armes ; mais ils reviennent un instant après menaçants, soutenus par des forces imposantes. lis savent que leurs chefs veillent sur eux avec sollicitude, leur porteront secours à temps et feront payer cher le moindre attentat envers leurs personnes.
A Dourdan, on s'ameute contre des hussards ; un homme porte la main à la bride du cheval d'un officier. Le lendemain, un parlementaire signifie a la municipalité, que si pareille offense se renouvelle, la ville sera livrée aux flammes et les habitants pendus jusqu'au plus petit enfant, comme dans les guerres bibliques. A Poissy, le général Schmidt fait savoir que si la ville ne lui rend pas deux dragons pris par la garde nationale, elle sera bombardée et frappée d'une contribution de 200 000 francs...
Dans les campagnes, l'ennemi se contente de provisions de bouche ; dans les villes, il demande des couvertures, des matelas, des balais, des gants, des semelles, des fournitures de bureau, des objets de toilette, de l'amidon, du cirage, des bandages herniaires, des peaux de sanglier et de chevreuil, tout ce que sa fantaisie imagine. Le major de Colomb, commandant de place à Corbeil, entendant qualifier de riche en cuirs un paysan dont le langage est orné de liaisons superflues, saute sur une plume et s'empresse de libeller un ordre de livrer 60 peaux pour basaner les culottes de ses dragons : Ab uno disce omnes.
Certains officiers affectent une politesse exagérée, suivie aussitôt d'une menace froide ; d'autres, en arrivant, mettent le revolver au poing et parlent de tout tuer et brûler si l'on n'obéit sur-le-champ. A la plus petite objection, coups de cravache et coups de sabre pleuvent comme grêle... On n'a rien de mieux à faire que d'obéir et de les gorger de vin et d'avoine...
Pour les héros de l'Allemagne moderne, comme pour leurs aïeux les reîtres du XVIe siècle, la guerre est une franche lippée. Le majordome, préparant à Versailles les logements de la cour du roi de Prusse, veut contraindre le maire à violer le domicile d'un absent qui a dans sa cave des vins dignes de la taule de son maître. Dès les premiers jours d'octobre, ils sont entièrement nos maîtres ; la résistance a été partout comprimée avec une sauvage rigueur, et la terreur prussienne règne dans le département. On annonce l'arrivée à Versailles de Guillaume le Victorieux.
On pouvait espérer que l'arrivée du roi de Prusse mettrait fin aux exactions, aux réquisitions et aux vexations. M. de Brauchitsch, nommé préfet prussien de Seine-et-Oise, présenta, en effet, au conseil municipal de Versailles, convoqué pour entendre ses communications, le plus séduisant tableau des intentions de son auguste souverain. Mais ce n'était là qu'une déclaration platonique ; aux exactions et aux violences brutales des soldats allaient succéder des exactions et des violences hypocrites.
Dans son livre intitulé Versailles pendant l'occupation, E. Delérot écrit : « Nous avons pu juger par expérience comment la Prusse contemporaine entendait l'administration civile des pays occupés : le préfet de Brauchitsch est, à ce titre, un échantillon curieux de cupidité à étudier. Ses actes et ceux des subordonnés placés sous ses ordres sont d'autant plus intéressants qu'ils s'accomplissaient sous les yeux du roi, par conséquent avec son assentiment tacite. »
Le préfet prussien essaya d'abord de se servir de l'organisation française ; mais il se heurta au refus ou au mauvais vouloir des anciens employés qui, pour la plupart, ne voulurent pas reprendre leurs fonctions et s'y dérobèrent même par la fuite. Pour avoir des huissiers, le préfet dut les faire empoigner par les gendarmes. Ceci se passait à Versailles et fut d'un salutaire effet pour le reste du département. A Corbeil seulement, il fut possible aux Allemands de réorganiser le personnel de la sous-préfecture.
Devant la mauvaise volonté générale, le préfet prussien du département de Seine-et-Oise réorganisa l'administration sur la base du canton. Le maire du chef-lieu, investi de tous les pouvoirs, était chargé des communications avec l'autorité centrale, de la réparation des chemins, du service de la poste, de la perception des contributions. Le refus absolu était à peu près impossible ; car le préfet terminait son injonction par ces mots, dans le cas de non-acceptation : « Je me verrai obligé, contre mon gré, à en recourir à la force ; ce qui serait toujours regrettable. »
Les exactions, bien entendu, continuèrent de plus belle. Au mois de janvier 1871, M. de Brauchitsch « s'avisa que la perception des contributions indirectes était interrompue et voulut la remplacer. II ajouta à l'impôt foncier un supplément de 950 pour 100 ; mais il n'eut pas le temps d'en poursuivre partout le recouvrement ; toutefois, il extorqua ainsi, dans l'arrondissement de Versailles, près d'un million et demi. En arrivant, les Prussiens avaient frappé le département d'une contribution extraordinaire d'un million. D'autres exigences furent encore présentées ; elles prirent ; celles-la, la forme d'un emprunt forcé qui fournit 1 101 279 fr. »
Nous avons dit que, lors de son installation, le préfet prussien avait promis formellement que les réquisitions cesseraient ou du moins seraient payées. L'armée d'occupation parut ignorer complètement ces engagements, et la population de Seine-et-Oise ne trouva dans la présence de M. de Brauchistch qu'une aggravation à ses maux : elle dut payer l'impôt et fournir les réquisitions.
Les vexations et les réquisitions ne cessèrent même pas durant l'armistice, et le département de Seine-et-Oise ne fut délivré des hordes germaniques que le 12 mars 1871. Les pertes qu'il supporta s'élevèrent à la somme énorme de 146 500 930 fr. 12, la plus considérable après le département de la Seine.
Les départements-(histoire)- Yvelines - 78 -
Partie 1
C'est en 1968 que fut officiellement constitué le département des Yvelines, composé exclusivement de communes appartenant à l'ancien département de la Seine-et-Oise.
Le département de Seine-et-Oise ; compris autrefois dans la province de l'Ile-de-France, n'a jamais eu plus d'unité que nous ne lui en voyons aujourd'hui ; bien avant les développements qu'a pris Paris comme capitale de la France, avant même que l'ancienne Lutèce eût acquis l'importance que lui donna la domination romaine, les habitants des contrées qui nous occupent étaient divisés en nations distinctes et souvent hostiles les unes aux autres.
Les rives de la Seine étaient occupées par les Parisii, peuplade adonnée à la navigation ; les Vellocasses étaient possesseurs de la partie septentrionale du département, qui s'étend entre l'Oise et la Seine, et qui fit plus tard partie du Vexin ; l'ouest appartenait aux Carnutes, dans un espace compris entre l'emplacement actuel de Mantes et le canton de Rambouillet ; enfin, toute la région méridionale, c'est-à-dire le territoire des arrondissements d'Étampes et de Corbeil, avait pour maîtres les Sénonais. Les immenses forêts qui s'étendaient à l'ouest protégeaient les mystères religieux des druides ; aussi leurs principaux collèges étaient-ils dans le pays des Carnutes. César rend hommage au caractère belliqueux de ces habitants de la Gaule celtique ; contre eux, il eut plus souvent recours aux ruses de la politique qu'à la force des armes.
Quand Vercingétorix fit appel au patriotisme gaulois, Carnutes, Sénonais et Parisii furent des plus ardents à se ranger sous ses ordres, et le département de Seine-et-Oise put compter, selon les récits de César lui-même, vingt mille de ses soldats parmi les premiers martyrs de l'indépendance nationale. La victoire définitive des Romains eut pour conséquence l'effacement des nationalités entre lesquelles se partageait le territoire ; de nouvelles délimitations furent tracées, de nouvelles dénominations furent imposées : jusqu'au IVe siècle, Lutèce et tout le territoire actuel de Seine-et-Oise firent partie de la quatrième Lyonnaise ou Sénonie.
Sur ce sol si profondément remué depuis, l'établissement de la domination romaine a laissé peu de traces ; nous savons cependant que des routes furent ouvertes pour le passage des légions ; Paris, que sa position fit adopter par les vainqueurs comme un des centres de leur gouvernement, a pu conserver quelques ruines des monuments de cette époque ; mais, dans le pays environnant, couvert de forêts profondes, habité par des populations aguerries et menaçantes, il convenait peu à la politique romaine d'encourager le développement des anciens bourgs ou l'établissement de villes nouvelles dont l'importance aurait réveillé les souvenirs et les espérances des nationalités vaincues.
Sur un sol aussi remué et fouillé que l'a été celui de Seine-et-Oise, on ne peut guère compter sur la conservation des monuments mégalithiques, celtiques et gallo-romains : Cependant on rencontre encore quelques-uns de ces monuments. On connaît, par exemple, les. dolmens de Meudon, les menhirs de Bruyères-le-Châtel ; le nom du village de Pierrefitte rappelle le souvenir d'un de ces monuments, et, près de Chars-en-Vexin, le docteur Bonnejoy a sauvé de la mise en moellons une autre pierre connue autrefois sous le nom de la Pierre qui tourne.
A Gency, on montre une pierre levée que l'on appelle dans le pays le Palet de Gargantua, la Pierre du Fouet ou la Pierre qui pousse, et, comme à la plupart des monuments de ce genre, la légende ne manque pas. A Jouy-le-Moutier, on en montre une autre. A Bougival et à La Celle-Saint-Cloud, à Marcoussis, sur la lisière du bois des Charmeaux, on a trouvé des débris de poteries et de tuiles de l'époque gallo-romaine.
Aux Mureaux, dans le canton de Meulan, Guégan a retrouvé des traces du séjour des populations préhistoriques. Au Pecq, à Marly, au lieu dit la Tour aux Païens, on a mis au jour des sépultures, des armes en silex, des poteries. Le dragages de la Seine, du Pecq à Conflans-Sainte-Honorine, a aussi fourni son contingent d'antiquités celtiques. A L'Étang-la-Ville, on a mis au jour, en 1878, un dolmen qui renfermait de nombreux ossements : on peut évaluer a cent cinquante le nombre des individus qui y avaient été enterrés.
A Mareil-Marly, dans la tranchée du chemin de fer de Grande-Ceinture, on a trouvé des vestiges romains qui font supposer que ce lieu était un poste de surveillance pour maintenir en respect les populations gauloises. Enfin, en pratiquant une tranchée pour le petit chemin de fer d'intérêt local de Beaumont (Seine-et-Oise) à Neuilly-en-Thelle (Oise), Guégan a trouvé, sur le territoire de la commune de Baines, un cimetière celto-gaulois, gallo-romain et mérovingien.
C'est dans les annales du christianisme qu'il faut chercher les seuls faits importants à recueillir pour l'histoire des quatre premiers siècles de notre ère. Saint Denis fut le premier des apôtres qui pénétra dans le pays des Parisii ; mais la date de son arrivée est incertaine et les détails de son martyre sont plutôt une sainte légende qu'une réalité historique. On cite, après lui, saint Nicaise, mort comme lui victime de son zèle apostolique ; quoique ses prédications datent du commencement du IVe siècle, certains auteurs disent qu'il fut martyrisé à Vadiniacum, aujourd'hui Gasny-sur-Epte ; d'autres assignent, comme théâtre a cet événement, Meulan, qui a choisi ce saint pour patron.
La piété des nouveaux chrétiens nous aurait conservé sans doute de précieux documents sur cette époque de transformation sociale, si l'invasion des barbares eût bouleversé moins profondément cette contrée de Lutèce où les proconsuls romains et l'empereur Julien en personne firent leurs dernières tentatives de résistance. C'est par la nuit et le silence qu'elles ont laissés derrière elles qu'on peut juger les ravages de ces invasions, qui passèrent sur la Gaule celtique comme un torrent.
Quelques points oubliés du territoire étaient encore restés sous la domination des Romains ; Clovis, à la tête des Francs, s'avance du nord sur la Gaule ravagée ; sa conversion à la foi nouvelle achève l'oeuvre de la conquête ; le flot des premiers barbares s'est écoulé ; rien ne subsiste plus de la puissance romaine ; un nouvel empire se fonde entre la Meuse et la Loire. Mais, à la mort du fondateur, déjà le nouvel empire se démembre, et notre département échoit en partie, avec la royauté de Paris, à Childebert, un des quatre fils de Clovis.
C'est de cette époque que commence à dater la notoriété historique de la plupart des villes de l'ancienne Ile-de-France ; mais hélas ! cette gloire fut chèrement payée : les divisions arbitraires des territoires, les rivalités des souverains furent, pendant les temps mérovingiens, la cause de guerres incessantes ; l'Ile-de-France semblait condamnée à être le champ clos où Neustrie et Austrasie venaient vider leurs sanglantes querelles.
Cependant, à côté du spectacle affligeant qu'offraient les déchirements des jeunes monarchies, l'histoire nous montre une puissance nouvelle grandissant dans le silence et la paix, s'enrichissant des présents du vainqueur et des dépouilles du vaincu : c'est la puissance des abbés ; dans leur ferveur de néophytes, les Mérovingiens avaient fondé et enrichi le monastère de Saint-Denis et celui de Saint-Germain-des-Prés ; l'exemple des maîtres avait été suivi par les leudes ou seigneurs ; au vine siècle, l'abbaye de Saint-Germain tenait en sa possession Palaiseau, Verrières, Jouy-en-Josas, La Celle-lès-Bordes, Gagny, Épinay-sur-Orge, La Celle-Saint-Cloud, Villeneuve-Saint-Georges, Mer-sang ; Le Coudray-sur-Seine, Maule et autres domaines de moindre importance ; et l'abbaye de Saint-Denis, maîtresse d'une grande partie du Vexin, était à la veille de voir inféodées ses pacifiques conquêtes, par un édit de Charlemagne, sous le titre de fendum sacrum sancti Dionysii.
Il faut reconnaître que, dans ces temps de barbarie, la domination ecclésiastique fut quelquefois moins dure pour le peuple que celle des leudes et .des rois, prenant à leurs vassaux leur sang dans la guerre, et le fruit de leur travail lorsqu'ils étaient en paix. Ce fut donc un bonheur pour cette époque que le prodigieux accroissement de puissance des abbayes de Saint-Germain et de Saint-Denis ; leurs domaines furent un refuge pour l'artisan des villes ou le laboureur, qui ailleurs ne trouvait pas même le repos dans la servitude.
Aucun document n'est parvenu jusqu'à nous concernant l'organisation administrative, sous les Romains, du pays dont nous retraçons brièvement l'histoire ; ce n'est que sous les Mérovingiens que nous retrouvons, à l'aide des chartes, les principales divisions administratives des pagi ou cantons. Le département de Seine-et-Oise était irrégulièrement composé : 1édeg; du grand pagus de Paris, subdivisé plus tard ; 2° du pagus Castrensis (de Châtres ou Arpajon), qui fut depuis le Hurepoix ; 3° du pagus de Poissy, autrement le Pincerais (Pinciacensis) ; 4° de celui de Madrie (Madriacensis), dont le chef-lieu était probablement Méré, près de Montfort-l'Amaury ; ces deux derniers étaient du diocèse de Chartres ; ajoutons-y le pagus Stampensis ou d'Étampes, au diocèse de Sens. Plusieurs de ces pagi devinrent des comtés au IXe siècle, et leurs possesseurs convertirent leurs dignités en fiefs, comme on le verra plus tard.
La grande époque de Charlemagne fut une ère de paix et de prospérité relative pour le pays de l'Ile-de-France ; l'empereur avait transporté sa capitale sur le Rhin, à Aix-la-Chapelle ; la haute direction des affaires publiques était confiée, dans l'intérieur du pays, à des inspecteurs impériaux, missi dominici ; sous leur surveillance, l'administration de l'Ile-de-France resta aux mains et sous l'influence des deux puissants abbés de Saint-Germain et de Saint-Denis.
La mort de Charlemagne jeta la France dans une période de guerre et d'anarchie que la faiblesse de Louis le Débonnaire et de ses successeurs ne put arrêter. Par suite du partage de l'empire, les pays de Seine-et-Oise furent dévolus à Charles le Chauve. La trêve accordée à ces malheureuses contrées n'avait point été de longue durée ; aux guerres intestines succèdent les invasions des Normands.
En 845, Épine est brûlée ; en 865, Mantes est pillée onze ans plus tard, l'ennemi remonte la Seine jusqu'à Meulan. A chaque invasion nouvelle, il pénètre plus au cœur du pays : Étampes ne doit son salut, en 885, qu'à la valeur du comte Eudes ; Pontoise, moins heureux, est réduit par la famine ; les hostilités ne cessent, en 911, qu'après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, par lequel Charles le Simple abandonne à Rollon, chef des barbares, la Normandie et le Vexin jusqu'à la rivière d'Epte.
Les malheureux successeurs de Charlemagne ne savaient pas mieux défendre leur autorité à l'intérieur que leurs frontières contre l'ennemi. Charles le Chauve, en consacrant en droit, par le capitulaire de Quierzy, en 877, la transmission des bénéfices des mains des possesseurs en celles de leurs héritiers, avait constitué définitivement la féodalité ; les comtes et les autres officiers royaux s'empressèrent de convertir leurs charges en fiefs et propriétés personnelles ; dans le pays de Seine-et-Oise, la transformation féodale fut instantanée et complète.
L'histoire du département offre l'exemple le plus frappant des conséquences qu'entraîna cette grande mesure. Grâce à elle, en moins d'un siècle, l'hérédité des titres et la transmission des fiefs firent des comtes de Paris la souche d'une troisième dynastie. La capitulaire de Charles le Chauve inféodait à leur maison les comtes du Vexin, seigneurs de Pontoise, qui absorbèrent bientôt à leur tour les comtes de Madrie et les comtes de Meulan, les comtes de Corbeil, les barons de Montfort-l'Amaury, de Montlhéry et de Montmorency.
C'est encouragé et aidé par ses puissants vassaux, que Hugues le Grand se fit proclamer roi de France ; mais le prix de leur concours, c'était le partage du pouvoir. Hugues Capet roi, c'était la féodalité couronnée. Les Normands n'avaient rencontré sur leur chemin que des tours en bois construites pour protéger le cours de la Seine ; maintenant que les comtes et barons ont leurs, domaines à défendre, nous verrons les pierres amoncelées s'élever en formidables remparts, les rochers taillés à pic devenir des murailles imprenables, les rivières détournées de leur cours inonder les fossés des châteaux forts.
Nous verrons grandir au nord les colossales assises de Montmorency, et surgir au sud les massifs créneaux de la tour de Montlhéry ; il n'y aura plus de montagne qui n'ait son castel bâti sur sa crête comme un nid de vautour ; plus de vallée qui n'ait à son embouchure son fort menaçant et sombre prêt à disputer et à faire payer le passage. La paix ne pouvait pas sortir de préparatifs aussi peu pacifiques ; la guerre fut donc la vie du XIe siècle. Dans leur indépendance, les grands vassaux refusent obéissance à leurs souverains et s'attachent à la fortune des princes dont ils espèrent meilleure récompense.
En 1015, le trône du roi Robert est menacé par une ligue dont font partie Galeran Ier, comte de Meulan, et Gauthier, comte du Vexin ; ce n'est que par l'intervention de Fulbert, évêque de Chartres, que la guerre est suspendue. Vingt ans plus tard, ce même Galeran s'allie aux comtes de Brie et de Champagne, dans la guerre qu'ils soutiennent contre Henri Ier. En 1102, Houchard IV de Montmorency refuse à Louis le Gros de faire réparation des dommages causés par lui à l'abbaye de Saint-Denis, et se laisse assiéger dans sa forteresse, dont les soldats du roi sont contraints d'abandonner le siège.
Pendant près d'un siècle, la malveillance impunie des sires de Montlhéry entrave les communications de la capitale avec Étampes, demeuré fief de la couronne. En rattachant les souvenirs de ces faits recueillis parmi beaucoup d'autres aux impressions produites par la vue des ruines féodales qui couvrent encore le sol, on pourra se faire une. idée des désordres et de l'anarchie de cette déplorable époque, pendant laquelle les Normands, toujours habiles à profiter de l'affaiblissement du pouvoir central, vinrent ajouter les ravages de leurs excursions aux misères de nos déchirements intérieurs ; en 1060, Meulan avait été encore une fois pris et saccagé par eux ; en 1087, Pontoise et Mantes furent livrés aux flammes.
Dans la lutte devenue inévitable entre les rois et les seigneurs féodaux, la royauté eût probablement succombé sans le mouvement religieux qui entraîna vers les croisades cette noblesse ambitieuse et turbulente ; pendant que le roi Philippe Ier se faisait représenter à la première expédition, en 1083, par Eudes d'Étampes, les plus indociles et les plus redoutables de ses sujets prenaient la croix et s'enrôlaient sous la sainte oriflamme.
Quelques-uns revenaient comme le fameux Simon de Montfort, qui continua si cruellement contre les Albigeois ses exploits de Constantinople et de Palestine ; mais beaucoup d'autres y mouraient ou trouvaient au retour leurs domaines aux mains de nouveaux maîtres.
L'autorité royale n'avait pas seule gagné dans cet amoindrissement de la puissance féodale ; plusieurs seigneurs, pour payer les préparatifs de l'expédition et les frais du voyage, avaient vendu, contre argent, certaines franchises aux bourgeois de leurs villes ; les rois avaient encouragé, de leur pouvoir moins contesté, ces premières tentatives d'émancipation des communes ; pour la royauté d'alors, grandir le peuple, c'était affaiblir d'autant le seigneur intraitable et si souvent menaçant ; c'était créer un antagonisme dont elle se réservait l'arbitrage.
C'est donc de cette époque que sont datées les premières chartes octroyées par les rois de France aux communes. Mantes a les siennes en 1110, Étampes quelques années plus tard, Pontoise en 1188, Meulan en 1189 : un maire et des échevins ou jurés nommés parles bourgeois étaient chargés de l'administration des deniers communaux, de la garde de la ville et de l'exercice plus ou moins étendu de la justice.
L'essor que prirent dès lors les communes, l'importance toujours grandissante de la bourgeoisie assura désormais la soumission des seigneurs contre lesquels la royauté avait partout des alliés reconnaissants. Certes, le trône de France eut encore de rudes assauts à soutenir ; les maisons féodales qui résistèrent à cette première secousse n'en devinrent que plus puissantes et plus redoutables ; c'est à la politique de Louis XI, c'est au génie de Richelieu qu'il était réservé de leur porter les derniers coups ; mais, dans ce pays de Seine-et-Oise, dans l'histoire duquel notre récit doit se circonscrire, la féodalité rebelle, menaçante, rivale parfois de la royauté, cette féodalité ne survécut pas au règne de Philippe-Auguste.
Si l'habile modération qui fut la règle de conduite des puissants abbés de Saint-Germain et de Saint-Denis explique la paisible possession dans laquelle les laissèrent les guerres de la féodalité, la constance de leurs sympathies et de leur fidélité pour les rois de France explique plus naturellement encore la généreuse reconnaissance des monarques pour l'Église. Chaque succès de la royauté est signalé par la fondation de quelque établissement religieux ; Charlemagne et Hugues Capet avaient payé leur tribut après les deux grandes abbayes si souvent citées par nous, celle d'Argenteuil avait été fondée en 665, celle de Chelles en 656, celle de Néauphle-le-Vieux et de Saint-Mellon à Pontoise vers 899, et, quelques années plus tard, celles de Saint-Spire à Corbeil et de Saint-Nicaise à Meulan.
La consolidation définitive de la dynastie capétienne eut pour l'Église de non moins précieux résultats. Elle lui doit, au XIe siècle, la collégiale d'Étampes, le prieuré de Saint-Germaïn-en-Laye, l'abbaye de Morigny, près d'Étampes, le prieuré de Notre-Dame de Longpont ; les abbayes de Saint-Martin de Poissy et de Saint-Martin de Pontoise au XIIe ; l'abbaye de Juziers, de Saint-Corentin-sur-Septeuil, des Vaux-de-Cernay, de Gif, de Port-Royal, et enfin l'abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, en 1236 ; les dominicains de Poissy en 1304 ; les célestins de Limay en 1376, ceux de Marcoussis en 1409.
Toutes ces fondations indiquent une longue période de prospérité et de paix qui nous conduit jusqu'aux premières guerres des Anglais. Sous la conduite du roi Édouard, nous les voyons suivre la même route que les Normands, leurs ancêtres ; ils remontent le cours de la Seine, et jusqu'à Poissy tout est mis à feu et à sang sur leur passage.
La triste histoire du roi Jean, celle de Charles V, la démence de Charles VI, la minorité de Charles VII rappellent les désastres de la patrie, encore présents à toutes les mémoires ; la France entière fut frappée, mais aucune de nos provinces ne le fut aussi cruellement que l'Ile-de-France ; les invasions anglaises étaient périodiques, et quand cette malheureuse contrée avait par hasard échappé aux dévastations de leur arrivée, elle avait à subir leurs exactions ou leur vengeance au retour ; l'histoire de chaque année est la même et peut se résumer dans les mêmes mots : sac, pillage, incendie.
« Après l'invasion de 1360, de Mantes à Paris, dit un chroniqueur contemporain, il n'y avait plus un seul habitant ; » celle de 1370, commandée par le routier Robert Knolles, amena les Anglais jusqu'aux portes de Paris ; de son hôtel Saint-Paul, le roi pouvait voir les flammes allumées par l'ennemi. Un libérateur inespéré, Du Guesclin, sauva cette fois Paris et la France ; la rude leçon que le brave connétable breton avait donnée aux bandes de Robert Knolles les eût peut-être empêchées de songer de longtemps à de nouvelles attaques, si l'Anglais n'eût bientôt retrouvé dans nos discordes un encouragement à de nouvelles tentatives Armagnacs et Bourguignons se disputaient l'héritage de Charles VI vivant encore ; dans sa haine contre le dauphin, la reine Isabeau appela elle-même l'étranger ; le traité de Troyes livra la France à l'Angleterre.
La miraculeuse délivrance de la patrie, les combats, les victoires de Jeanne d'Arc, la vierge inspirée, cette épopée nationale appartient à d'autres pages de notre ouvrage ; nous sommes heureux cependant de pouvoir rattacher à ce grand événement de notre histoire la délivrance du pays de Seine-et-Oise. Charles VII avait été sacra ; à Reims en 1429, Paris avait été repris en 1436, les garnisons anglaises évacuèrent Pontoise en 1441 et Mantes en 1449.
Avant ces miraculeux succès, l'affaiblissement de la monarchie avait réveillé les prétentions des grands vassaux de la couronne ; il ne s'agissait plus des sires de Montmorency ou des comtes de Meulan, mais de ces grandes maisons enrichies par les alliances royales et à la tête desquelles marchaient les ducs de Bourgogne, de Berry et de Bretagne. Louis XI, malgré les ruses de sa politique, n'avait pu dissimuler son projet d'asseoir le trône de France sur la ruine de tous ces grands fiefs, éléments éternels de discorde et d'anarchie ; ses ennemis menacés prirent l'offensive et formèrent une ligue qu'ils appelèrent Ligue du bien public.
Le drame se dénoua encore dans le pays de Seine-et-Oise : le comte de Charolais, à la tête de 15 000 Flamands, rejoignit l'armée des ducs près de Montlhéry ; l'issue de la bataille fut incertaine, chacun des partis s'attribua la victoire ; Louis XI, selon son habitude, parut céder pour attendre une occasion meilleure ; le traité signé à Conflans donna Étampes et Montfort au duc de Bretagne, et au duc de Nemours le gouvernement de Paris et de l'Ile-de-France. Par mariages, alliances, extinctions de races, ou de haute lutte, et par confiscation sous Richelieu et Louis XIV, la monarchie devait bientôt rentrer en possession de ce qu'elle semblait alors abandonner ; nous suivrons, dans l'histoire particulière des villes, les progrès de ces revendications.
Les guerres religieuses du XVIe siècle, les troubles de la Fronde, les prétentions des Guises firent jaillir quelques étincelles des cendres de la féodalité ; mais désormais il n'y avait plus d'incendie sérieux a redouter pour la province de I'Ile-de-France, sur laquelle le roi de France régna sans interruption et sans conteste, même alors que Paris était au pouvoir des rebelles, grâce à quelques surprises qui n'eurent ni résultat ni durée.
Ce n'est point dire que le pays fût désormais à l'abri des agitations dont la France fut troublée ; plus, au contraire, son administration se rattachait directement et étroitement à la couronne, plus il ressentait vivement les secousses dont la royauté était atteinte. Nous constatons seulement son annexion définitive, à une époque où la possession de la plupart de nos provinces était encore incertaine et précaire. Au règne de Charles VIII se rattache le retour à la couronne du comté de Montfort-l'Amaury, qui fut une conséquence du mariage du roi avec Anne de Bretagne.