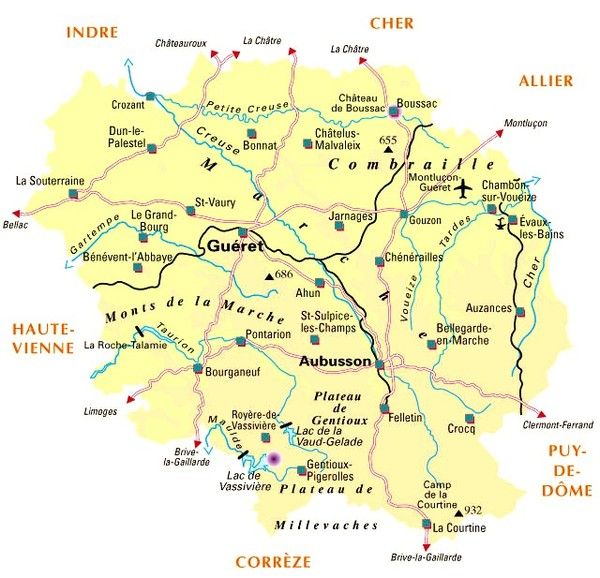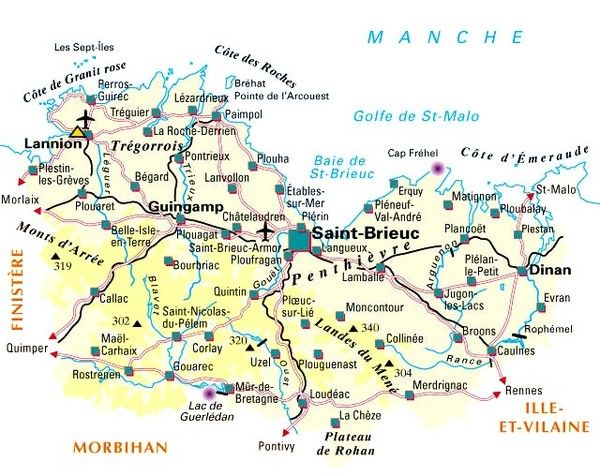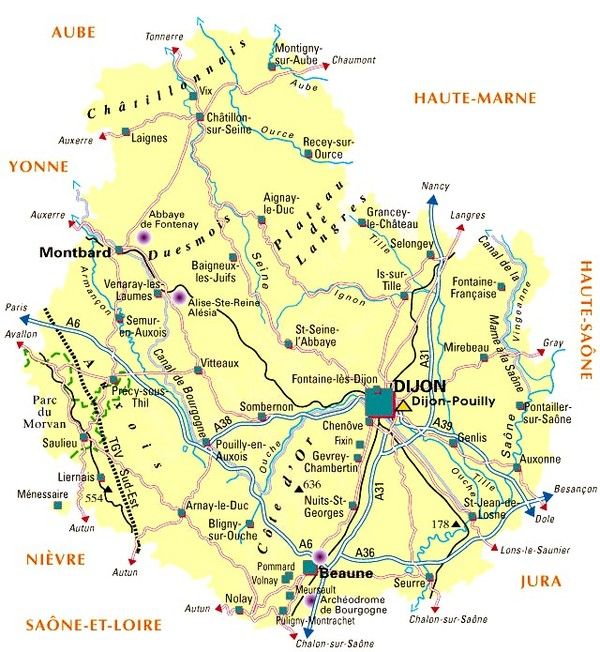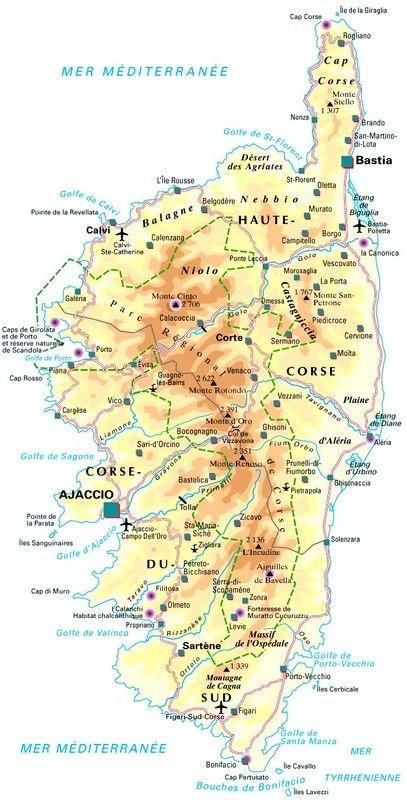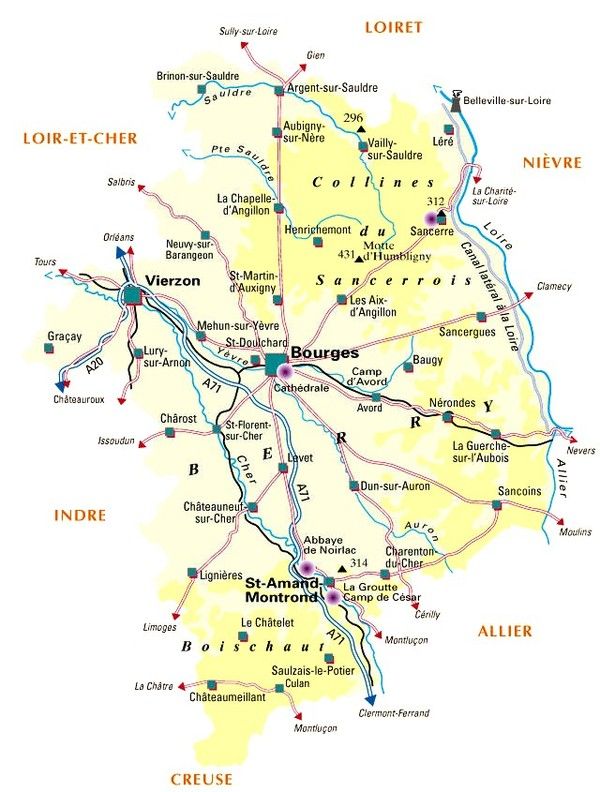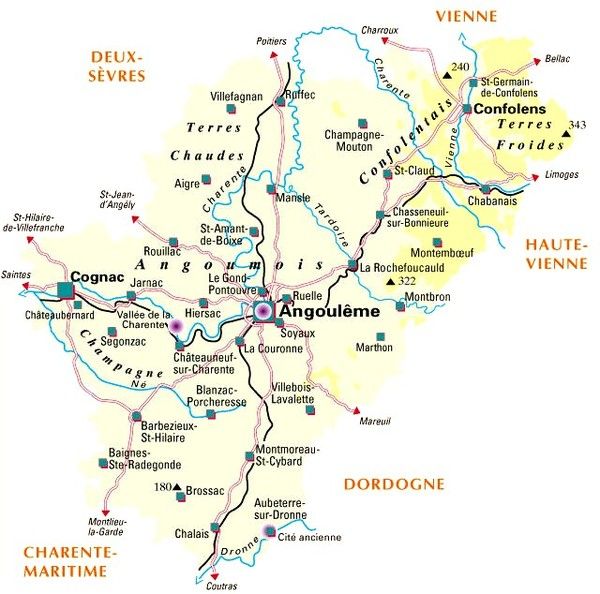Départements animaux années 50 antiquité aquariophilie eau douce arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
- · le symbolisme dans le roman la rose des vents
- · passage obligé minarik
- · les bienfaits et les mefaits des invertebres
- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman
- · valerie maurice est elle mariee
- · les bienfaits des invertebres
- · turfvoyance@yahoo.fr
- · gouran tchad
- · bamwisho muhiya jean
- · royauxnorvegiens
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Les départements-(histoire)- La Creuse - 23 -
(Région Limousin)
Le département de la Creuse, formé d'une grande partie de l'ancienne province de la Marche et de quelques petits pays du Limousin, du Berry et de l'Auvergne, dépendait, avant la conquête romaine, du pays des Lemovices, et il dut à sa position sur les frontières du pays occupé par ce peuple le nom de Marchia Lemovicina. Plus lard, la Marche s'agrandit du pays de Combraille (pays des Cambiovicenses, Combraliae pagus). Elle fit partie de l'Aquitaine première, et passa sous la domination des Wisigoths, lorsqu'ils fondèrent le royaume de Toulouse (419). Elle suivit la fortune du Limousin et reconnut l'autorité des Francs après la victoire de Clovis à Vouillé (507).
En 571, les habitants furent, comme ceux de l'Auvergne, décimés par une horrible contagion dont Grégoire de Tours signal e les ravages. Desiderius, duc de Toulouse, et Bladaste, duc de Bordeaux, dans leur expédition contre le Berry, suivirent la grande voie romaine qui conduisait de Limoges à Bourges. Ils traversèrent la Marche et s'arrêtèrent peut-être dans les murs d'Ahun (583). Pendant la lutte de Pépin contre l'Aquitaine, Remistan ravagea toute la contrée et s'avança jusque dans le bas Berry, en 767.
Dans le démembrement de l'empire carlovingien, la Marche, à l'exemple de toutes les provinces de France, se morcela en un grand nombre de seigneuries. Elle ne put échapper aux ravages des Sarrasins et des Normands. En 846, ils dévastèrent le Limousin et s'avancèrent jusqu'aux limites du Berry et de l'Auvergne. En 930, ils reparurent ; mais, cette fois, ils furent battus et repoussés par le roi Raoul. Les Hongrois vinrent achever la ruine des provinces françaises. Ils pénétrèrent, en 937, jusqu'aux frontières de la Marche, et revinrent, en 951, désoler toute l'Aquitaine.
La France n'avait plus de gouvernement, plus d'armée ; elle était tombée dans la plus désastreuse anarchie. C'est au milieu de cette société en dissolution et dans l'effort tenté pour la reconstituer sous la forme féodale que se fonda, vers 968, le comté de la Marche. Les grands fiefs étaient autant de souverainetés indépendantes, et leurs possesseurs reconnaissaient à peine la suprématie nominale du roi. C'est ainsi que, malgré les menaces de Hugues Capet, Adalbert Talleyrand, comte de la Marche et de Périgord, s'allie avec Foulques Nerra, duc d'Anjou, contre Conan, comte de Rennes.
Tandis que Foulques s'empare de Nantes, Adalbert assiège la ville de Tours. Le roi marche au secours de cette place (992) . Il somme son vassal de se retirer. « Qui t'a fait comte ? » lui dit-il. Adalbert répond : « Qui t'a fait roi ? » Ce mot célèbre du comte de la Marche caractérise bien la politique féodale au Xe siècle. L'autorité royale baissa encore sous les successeurs de Hugues Capet. Un moment resserrée dans Paris par la féodalité, elle ne fut presque plus qu'une ombre. On trouve, en effet, en 1095, avant les croisades, plus de quatre-vingts grands fiefs qui avaient des souverains héréditaires et une véritable indépendance.
C'étaient quatre-vingts rois qu'il y avait en France, et parmi eux on compte plusieurs des anciens vassaux du duc de France qui ne lui obéissaient plus. Philippe Ier ne possédait réellement que les comtés de Paris, d'Étampes, de Melun, d'Orléans, de Dreux et de Sens, et, en montrant à son fils le château du seigneur de Montlhéry aux portes de Paris, il lui disait : « Beau fils Louis, garde bien cette tour qui tant de fois m'a travaillé, et en qui combattre et assaillir je me suis presque tout enseveli, et par la déloyauté de laquelle je ne puis avoir bonne paix ni bonne sûreté ; en tout le royaume n'étoient maux faits ni trahisons sans leur assent et sans leur aide, et si grande confusion étoit entre ceux de Paris et ceux d'Orléans que l'on ne pouvoit aller en terre de l'autre pour marchandise ni pour autre chose sans la volonté à ces traîtres, si ce n'étoit de grandes forces de gens » (Chroniques de Saint-Denys).
Au XIe siècle, l'ombre même d'un gouvernement central, d'une nation générale semble avoir disparu. « Comment se fait-il, dit M. Guizot, que la civilisation et l'histoire vraiment française commencent précisément au moment où il est presque impossible de découvrir une France ? C'est que, dans la vie du peuple, l'unité extérieure, visible, l'unité de nom et de gouvernement, bien qu'importante, n'est pas la première, la plus réelle, celle qui constitue vraiment une nation. Il y a une unité plus profonde, plus puissante : c'est celle qui résulte, non pas de l'identité de gouvernement et de destinée, mais de la similitude des éléments sociaux, de la similitude des institutions, des moeurs, des idées, des sentiments, des langues ; l'unité qui réside dans les hommes mêmes que la société réunit, et non dans les formes de leur rapprochement ; l'unité morale enfin, très supérieure à l'unité, politique et qui peut seule la fonder solidement. A la fin du Xe siècle et au commencement du XIe, il n'y a point d'unité politique pareille à celle de Charlemagne ; mais les races commencent à s'amalgamer ; la diversité des lois, selon l'origine, n'est plus le principe de toute la législation. Les situations sociales ont acquis quelque fixité ; des institutions, non pas les mêmes, mais partout analogues, les institutions féodales ont prévalu, ou à peu près, sur tout le territoire. Au lieu de la diversité radicale, impérissable, de la langue latine et des langues germaniques, deux langues commencent à se former, la langue romane du Midi et la langue romane du Nord, différentes sans doute, cependant de même origine, de même caractère, et destinées à s'amalgamer un jour. Dans l'âme des hommes, dans leur existence morale, la diversité commence aussi à s'effacer.
« Le Germain est moins adonné à ses traditions, à ses habitudes germaniques ; il se détache peu à peu de son passé pour appartenir à sa situation présente. Il en arrive autant du Romain ; il se souvient moins de l'ancien. empire et de sa chute, et des sentiments qui en naissaient pour lui. Sur les vainqueurs et sur les vaincus, les faits nouveaux, actuels, qui leur sont communs, exercent chaque jour plus d'empire. En un mot, l'unité politique est à peu près nulle, la diversité réelle encore très grande ; cependant il y a au fond plus d'unité véritable qu'il n'y en a eu depuis cinq siècles. On commence à entrevoir les éléments d'une nation ; et la preuve c'est que, depuis cette époque, la tendance de tous ces éléments sociaux à se rapprocher, à s'assimiler, à se former en grandes masses, c'est-à-dire la tendance vers l'unité nationale, et par là vers l'unité politique, devient le caractère dominant de l'histoire de la civilisation française. »
Dès le règne de Philippe le Gros commence, contre la féodalité, la guerre qui, par l'alliance de la royauté et des communes, doit aboutir au triomphe du principe moderne de la centralisation. Le fils de Philippe Ier ne reste pas, comme son père, emprisonné dans le domaine des ducs de France. Il cherche à étendre au loin son influence et son action. En 1121, nous le voyons s'avancer jusqu'aux confins de la Marche et diriger une expédition contre le comte d'Auvergne. Cinq ans plus tard, il intervient de nouveau en faveur de l'évêque de Clermont et force le comte à se soumettre au jugement -de la cour du roi (1126). Le comté de la Marche passa, vers ce temps, à la famille des Montgomery, dont un des membres, Adalbert IV, partant pour la terre sainte en 1177, vendit son domaine, pour cinq mille mires d'argent. à Henri II, roi d'Angleterre. Cette vente fut annulée sur la demande des seigneurs de Lusignan, qui, depuis longtemps, avaient des prétentions sur la Marche. Henri Il rendit ce comté à Hugues de Lusignan.
Vers la fin du XIe siècle, des bandes de routiers se levèrent dans le Berry et mirent toute la contrée au pillage. Ils prenaient le nom de Cottereaux. Les seigneurs des pays voisins, de la Marche, de l'Auvergne, formèrent contre eux l'association des Capuchons, et les taillèrent en pièces dans plusieurs rencontres (1184). Pendant les guerres de Philippe-Auguste et de Jean sans Terre, le comté de la Marche, situé à la limite des possessions anglaises et françaises, se trouva exposé aux ravages des gens d'armes.
Le comte Hugues le Brun suivit le parti du roi de France. Il était animé contre le roi d'Angleterre par des griefs personnels. Jean lui avait enlevé quelques châteaux et sa fiancée, fille du comte d'Angoulême (1201). En 1206, les deux rois signèrent une trêve de deux ans ; Hugues le Brun fut un des garants de Philippe-Auguste (Chroniques de Rigord). Philippe, poursuivant l'oeuvre de Louis le Gros et prenant au sérieux son titre de roi, était pour les grands vassaux un maître incommode. Hugues de Lusignan ne lui resta pas longtemps fidèle. Il se ligua en 1213 avec Jean sans Terre, son ancien ennemi. Mais la paix fut bientôt rétablie. On nomma des arbitres pour les infractions commises dans le Berry, l'Auvergne, le comté de la Marche et le Limousin ; ils se réunirent entre Aigurande et Cuzon, châteaux du comté de la Marche.
Pendant la minorité de Louis IX, la maison de Lusignan s'associa à la réaction féodale tentée contre la régente, Blanche de Castille. Le comte de la Marche prit les armes comme le duc de Bretagne et le comte de Champagne ; mais, comme eux, il fut obligé de se soumettre (1227). Ses successeurs régnèrent sans éclat jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En 1308, Gui de Lusignan, mourant sans enfants, légua le comté de la Marche à Philippe le Bel.
Le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Creuse fut alors presque tout entier réuni au domaine royal, sauf la terre de Combraille, qui appartenait à la maison d'Auvergne. Le comté de la Marche fut érigé en pairie par lettres patentes données à Paris, au mois de mars 1316, en faveur de Charles de France, comte de la Marche. Charles succéda à son frère Philippe le Long (1322), et ainsi cette pairie fut éteinte. Mais, comme le même roi donna le comté de la Marche à Louis de Bourbon en échange du comté de Clermont en Beauvoisis, il fut érigé de nouveau en pairie par lettres patentes du mois de décembre 1327.
Il passa dans la maison d'Armagnac par le mariage d'Éléonore, fille de Jacques de Bourbon, avec Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac et de Castres. Leur fils, Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, comte de la Marche, de Pardiac, de Castres et de Beaufort, vi-comte de Murat, seigneur de Leuze, de Condé et de Montagne-en-Combraille, fut l'ennemi et la victime de Louis XI. Il périt par la main du bourreau (août 1477). Le roi confisqua ses biens, et donna le comté de la Marche à Pierre II de Bourbon, sire de Beaujeu, qui avait épousé Anne de France. Suzanne de Bourbon, leur fille, porta ce domaine en dot au connétable Charles de Bourbon. Celui-ci était déjà comte de Montpensier et dauphin d'Auvergne, duc de Bourbon, d'Auvergne et de Châtellerault, comte de Clermont en Beauvoisis, de Forez, de Gien vicomte de Carlat et de murat, seigneur de Beaujolais, de Combraille, de Mercoeur, d'Annonay, de La Roche-en-Régnier et de Bourbon-Lancy.
La trahison du connétable anéantit cette puissance redoutable de la maison de Bourbon. Ses biens furent confisqués en 1523. Le comté de la Marche passa à Louise de Savoie, mère de François Ier ; après la mort de cette princesse, il rentra dans le domaine de la couronne. François Ier le donna, par lettres du 12 juin 1540, à son troisième fils, Charles de France, pour le tenir en pairie ; mais ce prince mourut le 9 septembre 1545. Depuis lors, la Marche ne fut plus détachée de l'unité nationale. La féodalité s'était transformée en noblesse. Au XVIIIe siècle, le comté de la Marche fut le titre des fils aînés des princes de Conti.
L'histoire de la province n'est pas riche en détails intéressants. Durant les désastres de la guerre de Cent ans, les villes et les seigneurs ne trahirent pas la cause de la France. Le sire de Boussac, chambellan de Charles VII, le servit jusqu'au crime. Lorsque la guerre civile vint se mêler à la guerre étrangère, et que le dauphin souleva la Praguerie, Charles VII traversa la Marche en poursuivant son fils rebelle (1440). On a retrouvé au British Museum (m. 11, 542) des lettres royales du 4 décembre 1545, par lesquelles sont institués, dans la sénéchaussée de la Marche, cinq commissaires, à l'effet de percevoir, d'après un nouveau mode, un aide pour la solde des gens d'armes. Ce sont « nos amis et féaulx conseillers et chambellans, le sire de Culant, maître Jehau Tudert, maistre des requêtes ordinaires de notre hôtel, les sénéchal et chancelier de la Marche, et Pyon de Bar, notre valet de chambre. »
Il existe au cabinet des titres de la Bibliothèque nationale des quittances de ce Pyon de Bar. Le 1er décembre 1445, il avait reçu de Jacques de la Ville la somme de 100 livres à titre de commissaire ordonné pour asseoir au comté de la Marche la portion à l'aide de 300 000 francs, mis sus par le roi sur les pays de Languedoc au mois de janvier précédent. « Vous mandons et commettons que les gens d'armes qui sont du pays et ressort de la comté de la Marche soient dorénavant payés, selon l'ordonnance que nous avons de présent faite, à commencer le premier jour de janvier prochain venant. C'est assavoir : en argent 21 livres tournois par lance fournie de six personnes et six chevaux ; plus pour 10 livres tournois en nature. Et voulons toutes manières de gens être à ce contribuables, excepté gens d'Église, nobles vivant noblement, et autres qui, par nos dernières ordonnances, en étoient exemptés. » (Lettres du 3 août 1445, Ordonn. des rois de France, tome XIII, page 442 et pass.) « Et avec ce... mettez sus, audit pays et ressort de la Marche, avec les frais raisonnables ci-après déclarés, et outre le fait et payement desdits gens d'armes, la somme de 5 000 livres tournois, 500 livres tournois pour les frais. Laquelle somme est pour et au lieu de l'aide de 200 000 livres tournois que de nécessité étions contraint mettre sus en notre pays comme l'année passée. Mais, considéré la pauvreté de notredit peuple et la charge qu'ils ont desdits gens d'armes, nous avons modéré ledit, pays, pour sa portion dudit aide, à ladite somme de 5,000 livres tournois, et 500 livres tournois pour les frais. » (Biblioth. de l'école des Chartes, déc. 1846.)
Sous Louis XI, les états de la haute et basse Marche demandèrent à se réunir pour une imposition commune, et le roi les y autorisa (1478). Les états de cette province cessèrent de s'assembler au XVIIe siècle, après la victoire de Mazarin sur la Fronde et le triomphe de l'absolutisme. En 1531, la province fut affligée par les inondations et par la famine. La Creuse et la Gartempe débordèrent. « Estoit en ladite saison grand'cherté de blés et de vins ; car le setier de froment se vendoit 50 sols, le setier de seigle 40 sols et plus, etc. » C'est l'année où le comté de la Marche fut réuni à la couronne. Bientôt après se tinrent à Poitiers les Grands-Jours, « qui jugèrent deux cents causes en deux mois et condamnèrent un grand nombre de gentilshommes d'Anjou, Touraine, Maine, Aunis, Angoumois et Marche. »
En 1553, « les droits que les habitants prennent sur le sel furent vendus par le roi Henri II aux habitants du pays de Poitou, Saintonge, ville et -gouvernement de La Rochelle, Angoulême haut et bas Limousin, haute et basse Marche, qu'on appelle à cause de cela pays de franc-salé. » Sous le règne de Henri III, la Réforme pénétra dans la Marche, mais elle n'y fit pas de progrès. Pendant les guerres religieuses, « le sieur de Saint Marc était commandant pour l'Union au pays de la Marche. » (Palma Cayet.) Il périt en allant au secours de Randan, chef des ligueurs en Auvergne (1590). Les paysans de la Marche prirent part à la révolte des Croquants, en 1594.
Aux états de 1484 avaient paru les députés du comté de la Marche. Il n'en vint aucun à ceux de 1593. En 1614, la sénéchaussée de la haute Marche envoya aux états généraux Georges de La Roche-Aymon, sieur de Saint-Maixent ; Gabriel, sieur de Malité, et Jean Vallenet, lieutenant particulier à Guéret.
Les Grands-Jours, tenus à Limoges en 1605, n'avaient pas plus épargné les nobles brigands de la Marche que ceux du Limousin ; mais l'esprit féodal n'était pas encore détruit dans ces provinces presque sauvages. La royauté devait longtemps encore y rencontrer des ennemis. « Le 17 mars 1617, dit le Mercure françois le prince de Joinville partit de Paris pour aller en son gouvernement d'Auvergne, y lever des troupes et avoir l'œil sur les pratiques qui se faisoient au pays de la Marche, bas Limousin et provinces voisines, par M. de Bouillon, qui sollicitoit une assemblée générale de ceux de la religion réformée pour les exciter à se soulever et prendre les armes. » Vingt ans après reparaissent les Croquants. « On dit qu'en Limousin, la Marche, l'Auvergne et le Poitou, sont élevées plusieurs troupes de gens, sous le nom de Croquants, lesquels font une guerre aux partisans, et qu'on parle en deçà d'envoyer vers eux pour les apaiser. » (Lettre de Gui Patin, 26 mai 1637.)
Au commencement de la guerre de la Fronde, le marquis d'Effiat était gouverneur de la haute et basse Marche (1649). Aubusson et Guéret figurent dans la liste générale des villes où furent envoyées, le 2 août 1652, les lettres circulaires de la ville de Paris invoquant l'appui des autres cités du royaume. Aubusson et Guéret ne répondirent pas. La Marche était alors un pays perdu au milieu de la France. Qu'on en juge par les impressions de voyage du célèbre comte de Forbin, qui la traversa en 1684. « Comme le service du roi ne demandoit pas ma présence à Rochefort, car la saison étoit déjà fort avancée, mon oncle me conseilla d'aller en Provence, pour régler quelques affaires que j'y avois ; il m'ordonna en même temps de passer par Lyon et de parler à un homme qui lui devoit quelque argent. La route que j'avois à suivre étoit par le Périgord, le Limousin et l'Auvergne. La quantité de neige dont le pays étoit couvert le rendoit impraticable à un homme qui n'en avoit d'ailleurs aucune connoissance. Pour obvier à cet iriconvénient, je me joignis aux muletiers qui partent deux fois la semaine de Limoges pour Clermont. Leur marche étoit si lente et si ennuyeuse que je me trouvois bien malheureux d'être obligé de m'y conformer. Après les avoir ainsi suivis pendant quatre jours, nous arrivâmes à un cabaret en rase campagne. J'étois auprès du feu à causer avec l'hôtesse, lorsque je vis entrer six hommes qui ressembloient bien mieux à des bandits qu'à toute autre chose. Je demandai quels hommes c'étoient : Ce sont, me répondit la maîtresse du logis, des marchands de Saint-Étienne en Forez, qui reviennent de la foire de Bordeaux ; nous les voyons repasser ici toutes les années. Ravi de cette nouvelle, je leur fis civilité ; nous soupâmes ensemble et je m'associai avec eux pour tout le reste du voyage. Il tomba dans la nuit une si grande quantité de neige que les chemins en furent entièrement couverts. Mais ces marchands les avoient si fort pratiqués que, se conduisant d'un arbre à l'autre, ils ne s'égarèrent jamais. Comme nous marchions, un geai vint se percher devant nous à la portée d'un fusil. Un de mes compagnons de voyage qui avoit un bâton, ou quelque chose qui paroissait tel, fit arrêter la troupe ; et ayant ajouté à ce prétendu bâton quelques ressorts qu'il renfermoit sans qu'il y parût, il en fit un fusil complet, tira sur l'oiseau et le tua... Nous devions nous séparer à Thiers, etc. » (Mémoires du comte de Forbin, p. 302.)
Dans cette contrée presque sauvage, une seule ville, par son industrie et son commerce, méritait d'arrêter l'attention du voyageur. Aubusson comptait environ 12,000 habitants, presque le double de sa population actuelle. La fabrication de ses tapis, déjà célèbres, occupait un très grand nombre (Louvriers. La plupart étaient protestants. La révocation de l'édit de Nantes (1685) les força de s'expatrier. ils émigrèrent en Suisse et en Allemagne.
Ainsi la Marche subit, comme les provinces de l'Ouest, les effets désastreux de l'intolérance. Colbert n'était plus ; Louvois dominait dans les conseils de Louis XIV ; et le travail national, un moment ranimé sous l'administration d'un homme d'État qui comprenait les vrais intérêts de la France, allait être sacrifié désormais aux fantaisies de l'ambition et de l'orgueil. La France n'a guère traversé de périodes plus douloureuses que la fin du règne de Louis le Grand. Elle perdit même, pendant la guerre de la succession d'Espagne, les consolations de la gloire ; et, la fortune épuisant contre nous toutes ses rigueurs, le froid et la famine se coalisant avec l'Europe, la nation expia cruellement les prétentions de son maître à la monarchie universelle. La Marche ne put échapper aux adversités de la patrie ; mais, du moins, grâce à sa position centrale, elle ne fut pas atteinte par le fléau de l'invasion. Grâce au caractère de ses habitants, elle évita les maux de la guerre civile ; les fils des Croquants ne suivirent point l'exemple des Camisards.
La haute Marche faisait partie, ainsi que le pays de Combraille, de la généralité de Moulins, mais elle n'en partageait point toutes les charges ; plus heureuse que le Bourbonnais et le Nivernais, provinces de grandes gabelles, elle était comprise dans le pays rédimé de l'impôt du sel. Le pays rédimé ne payait qu'un droit modique perçu sous les noms de convoi, de traite, de charente, etc., sur tous les sels extraits des marais salants pour l'approvisionnement des habitants. « Le commerce du sel étant libre dans cette partie de la France, on ne petit pas, dit Necker, en connaître la consommation avec autant de certitude que dans les parties du royaume où le privilège exclusif du débit est entre les mains du roi. Il y a lieu de l'évaluer à environ 830 000 quintaux ; et cette quantité, rapportée à une population de 4 025 000 âmes, ferait environ dix-huit livres pesant par tête d'habitant de tout sexe et de tout âge. La valeur courante varie depuis six jusqu'à dix et douze francs. »
Necker les portait, pour les provinces de grandes gabelles, à 62 livres par quintal ; pour celles de petites gabelles, à 33 livres 10 sous. La Marche, voisine du Berry et du Bourbonnais, leur fournissait en contrebande des quantités considérables de sel, et ses faux sauniers faisaient une rude guerre aux gens du roi. Enfin, la Révolution de 1789 abolit les douanes intérieures et répartit également les charges publiques entre tous les départements de la France. Les contrebandiers, abandonnant les provinces du centre, durent renoncer à leur commerce ou changer le théâtre de leurs exploits. Ils n'avaient plus rien à faire dans la Marche.
Pendant la période révolutionnaire, le département de la Creuse n'eut pas à souffrir des tourmentes politiques. La Terreur n'y fit point couler le sang. Les nobles, peu nombreux, émigrèrent ou se soumirent ; la vente des biens du clergé eut lieu sans scandales et sans bruit, et la guerre civile ne trouva point d'armée sur cette terre qui ne porte point le fanatisme. La Creuse ne fournit de soldats que pour combattre les ennemis de la France. Ses volontaires servirent avec honneur sous les drapeaux de la République. Un de leurs bataillons (Joullieton atteste ce fait dans son Histoire de la Marche) reconnut les petits-fils des proscrits de 1685 dans un village des bords du Rhin où s'était conservé le patois marchais.
Les départements-(histoire)- Cotes d'Armor - 22 -
(Région Bretagne)
Le département des Côtes-d'Armor occupe, avec celui du Morbihan, le milieu de la péninsule armoricaine, dont les départements d'Ille-et-Vilaine et du Finistère forment les extrémités. Il doit à cette situation la variété de caractères qui le distingue et qui peut, permettre de le diviser en trois régions différentes : le pays de Saint-Brieuc appartient à la haute Bretagne, celui de Lannion et de Tréguier à la basse, et l'on donne le nom de Bretagne moyenne au pays qui environne Dinan.
A mesure qu'on traverse le département de l'est à l'ouest, on sent que l'on approche du Finistère ; on le reconnaît à l'extérieur des habitants, à leurs mœurs, à leur langage. Suivant les expressions de M. Pitre-Chevalier, une ligne tracée de l'embouchure de la Vilaine à Châtelaudren (entre Saint-Brieuc et Guingamp) peut être considérée comme la muraille chinoise de l'idiome breton, et les brèches faites à ce rempart par le commerce et la civilisation n'ont guère enlevé au vieux langage que les villes, les ports et les endroits fréquentés de la côte.
La circonscription départementale des Côtes-d'Armor n'a donc d'autre unité que l'unité administrative. Aux temps les plus anciens, avant l'occupation romaine, plusieurs peuples s'en partageaient le territoire. C'étaient les Curiosolites, les Lexobiens, les Ambiliates, les Osismiens. Les Curiosolites avaient pour capitale une ville quia conservé la trace de leur nom dans le sien : c'est Corseul, dont nous aurons occasion de reparler dans un article spécial. Le domaine des Curiosolites s'étendait, selon d'Anville, jusqu'au pays d'Yffiniac, dont le nom aurait la même signification que ce terme latin ad fines, employé si souvent par les anciens géographes pour marquer des bornes et des limites. Les antiquités mégalithiques sont moins nombreuses dans le département des Côtes-d'Armor que dans ceux du Finistère et du Morbihan. Néanmoins, on y rencontre aussi des peulvens, des dolmens, des pierres branlantes, dont la plus remarquable est celle de l'île de Bréhat, et des tumulus, parmi lesquels on cite celui de Lancerf.
L'époque romaine a laissé plus de traces. Nous ne reviendrons pas ici sur la conquête de Jules César. Les Osismiens, les Curiosolites tes prirent leur part à la résistance générale de l'Armorique, et succombèrent dans la défaite commune. Incorporé dans l'empire romain, leur territoire fit partie de la troisième Lyonnaise. En revanche, ils eurent des édifices, des voies romaines. La disposition de ces voies, telle qu'on peut l'observer par leurs débris, indique clairement que Corseul fut considérée, sous l'empiré romain aussi bien qu'auparavant, comme le centre de la contrée ; c'est de ce point qu'elles rayonnent dans des directions différentes.
L'une se dirigeait vers Vannes et traversait les étangs de Jugon. Elle n'avait pas moins de 20 ou 24 pieds de largeur et était élevée de 4 ou 5 pieds au-dessus du sol environnant. Une autre conduisait à Quintin. Deux autres, enfin, à Dinan et à Dinart. D'autres souvenirs romains se rencontrent à Pordic, où l'on montre un camp de César, de forme triangulaire, situé sur de hautes falaises et flanqué, d'un côté, par la mer, de l'autre, par un profond vallon où coule la rivière d'Ik. À l'un des angles se voient les ruines d'u ne tour. Quoique César ne paraisse pas avoir passé en personne par le pays qui nous occupe, néanmoins il est fort possible, comme on l'a conjecturé, que son lieutenant Titurius Sabinus, qu'il envoya avec trois légions pour tenir en respect les Curiosolites et les Lexobiens, ait pris un campement dans le lieu auquel s'est attaché, par la suite, le nom immortel du conquérant.
C'est avec moins de vraisemblance qu'on a prétendu voir dans la petite ville de Binie le Portus Iccius où César s'embarqua pour passer dans la Grande-Bretagne, et que l'on place aujourd'hui, sans contestation, à Wissant, dans le département du Pas-de-Calais. On ne saurait nier, du reste, que Binic n'ait eu jadis une importance qu'elle a perdue depuis. A deux reprises, en 1808 et en 1824, la mer a laissé à découvert les ruines d'un vaste édifice, qui semblait sortir des flots pour en faire foi. Cet édifice avait 80 pieds de longueur sur 40 de largeur, et ses murs, que quelques savants croient de construction antique, recelaient 200 médailles d'empereurs romains et des pièces espagnoles à l'effigie de Charles-Quint. Corseul, Erquy nous ramèneront encore à l'époque romaine.
C'est sur ce rivage, où nous venons de signaler des débris de la puissance romaine, que mirent le pied les Bretons insulaires fugitifs qui vinrent s'établir, au IVe et au Ve siècle, dans l'Armorique. L'un d'eux, du nom de Fracan ou Fragan, qui faisait partie de la suite de Conan dit Mériadec, s'arrêta en 418 sur les bords du Gouët, petite rivière du département, dont le nom tragique semble cacher quelque mystérieuse horreur des temps inconnus à l'histoire. Gouët ou Gouat, en effet, dans la langue celtique veut dire sang, et le pays arrosé par cette rivière s'appelle Gouetlod où Gouello (Goëllo), c'est-à-dire Pays du sang.
C'est donc dans des lieux que s'établit Fragan avec ses compagnons, et l'endroit qu'il choisit pour sa résidence porte encore aujourd'hui le nom de Ploufragan, peuple de Fragan, plou ou plé ayant cette signification dans la langue bretonne. Ce lieu et ce personnage intéressent toute la Bretagne, qui leur doit un de ses saints les plus vénérés, le fameux saint Guignolé. C'est là, en effet, que Guen, femme de Fragan, mit au monde trois fils et une fille, qui eurent tous l'insigne honneur d'être inscrits au catalogue des saints. Les fils avaient nom Guignolé, Jacut et Guétenoc ; la fille, Creirvie. Mis fort jeune sous la conduite d'un saint homme appelé Ludoc, Guignolé y fit les progrès les plus rapides dans les voies de la sainteté, et, à son tour, eut des disciples. Sa renommée le rit choisir par le roi Gradlon pour diriger le fameux monastère de Landevenec, que ce prince venait de fonder. Saint Guignolé y établit une règle austère, qui paraît être la même que celle suivie à cette époque en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Saint Jactit, frère de Guignolé, fonda de son côté un monastère qui porta son nom. Ce sont les deux plus anciens qui aient été fondés en Bretagne.
Nous parlerons ailleurs d'Audren, chef puissant, qui résida dans la contrée vers la fin du Ve siècle. Vers la même époque se fondaient le monastère et la ville de Saint-Brieuc. Les autres chefs du pays qui se succédèrent vers ce temps nous apparaissent dans les légendes et les romans comme les compagnons de gloire d'Arthur et de Hoël le Grand. Quelquefois ils portaient le titre de roi, et l'on vit souvent les prétendants à la couronne de Bretagne obligés de traiter avec eux. A la mort du roi Salomon (874), les comtes de Goëllo, se prétendant issus des anciens souverains de Bretagne, prirent les armes pour soutenir leurs prétentions ; mais ils échouèrent, et la victoire demeura aux comtes de Vannes, leurs concurrents.
Un peu plus tard (939), on vit l'un d'eux contribuer puissamment an gain de la bataille livrée aux Normands près de Saint-Brieuc par Alain Barbe-Torte. C'étaient de puissants seigneurs qui gouvernaient presque en souverains une grande étendue de terre et de nombreux vassaux. L'usement de Goëllo, qui subsista jusque dans le XVIIIe siècle, est une preuve de l'indépendance dont ils jouissaient. Toutefois, leur puissance ne tarda pas à s'éclipser. Leur comté fut réuni à celui de Rennes, puis détaché, ainsi que Penthièvre, en faveur des cadets des comtes de Rennes. Son histoire se confondit dès lors avec celle de Penthièvre jusqu'en 1480, que le duc François Il le donna à François légitimé de Bretagne, comte de Vertus. En 1746, il passa par héritage au prince de Soubise.
La puissance déchue des comtes de Goëllo fut remplacée par la puissance naissante de la maison de Penthièvre. Cette ambitieuse maison date du XIe siècle. Le duc Geoffroy était mort en 1008, laissant deux fils, Alain qui lui succéda, et Eudon qui devint la tige de la branche cadette de la famille ducale, sous le nom de comte de Penthièvre. Eudon ne tarda pas à dévoiler les vues ambitieuses qu'il devait transmettre à ses descendants, et qui furent si longtemps une malheureuse cause de guerres civiles en Bretagne. Il fit la guerre à son frère, Alain V. Après la mort de ce dernier, au lieu d'exercer fidèlement la tutelle dont il avait été chargé sur son neveu, il l'emprisonna, et prit le titre de comte de Bretagne.
Cette maison de Penthièvre tirait son nom de la situation même de ses domaines entre le Leff et le Treff ou Trieux et de la position de son château principal au confluent de ces deux rivières. Ce château s'appelait Pontreff ou Pontreo (Pontrieux). Qu'on ne s'étonne plus de trouver quelquefois au nom de Penthièvre la variante Ponthièvre. Le pays s'appelait Penthévrie ou Ponthévrie. Ce comté comprenait la ville de Saint-Brieuc, où Eudon et son fils Étienne résidèrent et furent inhumés. Plus tard, il s'étendit encore et comprit, outre le diocèse de Saint-Brieuc, une partie de celui de Tréguier ; en un mot, près d'un tiers de la Bretagne. C'était comme une petite province à part, qui avait ses coutumes, ses princes particuliers ; ceux-ci, presque absolus, faisaient à leur gré la paix ou la guerre, levaient des tailles ou des aides, exerçaient plusieurs autres droits régaliens, tenaient une cour brillante et donnaient aux principaux d'entre leurs vassaux le nom pompeux de barons.
Le petit-fils d'Eudon, Alain le Noir, en épousant Berthe, héritière du duché de Bretagne, plaça le sang de Penthièvre sur le trône ducal, mais sans opérer la réunion des domaines de sa. famille qui demeurèrent à son frère aîné, Geoffroy Botherel. Cette alliance, qui eût semblé réconcilier la maison de Penthièvre et celle des ducs, ne fit qu'offrir de nouveaux motifs à la discorde. En effet, l'héritage des Penthièvre ayant passé plus tard à une branche collatérale, celle qui portait la couronne ducale se crut lésée, et Alix, héritière du duché, se sentit disposée à disputer ces riches domaines à celui qui les possédait, Henri d'Avaugour. La sage idée d'un mariage qui eût confondu les droits et terminé le différend avait été quelque temps adoptée, et même des fiançailles avaient eu lieu.
Mais le roi de France, alors très puissant (on était au XIIIe siècle), s'opposa à une alliance qui devait donner trop de puissance aux souverains bretons, Son influence fit rompre les fiançailles, et Alix épousa un prince français, Pierre de Dreux, surnommé Mauclerc. Les deux partis prirent aussitôt les armes : Henri pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, Pierre Mauclerc pour- faire valoir les prétentions de sa femme. La guerre se fit à l'avantage de ce dernier, qui s'empara des terres de Tréguier, Guingamp, Saint-Brieuc, Lamballe, et réduisit Henri à se contenter du titre d'Avaugour qu'il transmit à sa postérité dépouillé de tous les autres. Mauclerc fit don de Penthièvre à sa fille, Yolande de Bretagne (1236) ; plus tard, Jean III le donna en apanage à son frère Gui de Bretagne, mais avec des restrictions importantes : par exemple, il se réserva le fort château de Jugon, situé sur une hauteur appelée autrefois Jugum par les Romains ; telle est l'origine de ce nom, qui s'applique non seulement à la montagne, mais aussi aux vastes marais qui en défendent les approches, et qui sont formés par un épanchement des eaux de l'Arguenon. Jean III se réserva, outre le droit de bris, les émoluments de l'amirauté et la garde des églises ; par cette réserve, les églises cathédrales et les abbayes qui étaient dans l'apanage de Gui de Bretagne turent soustraites à sa juridiction et demeurèrent toujours dans la suite exemptes de la juridiction des Penthièvre.
Gui de Bretagne n'eut qu'une fille, et ce fut cette fameuse Jeanne la Boiteuse qui épousa Charles de Blois et lui porta deux magnifiques héritages : celui du comté de Penthièvre, qu'elle tenait de son père, et celui du duché de Bretagne, qui lui revint de plein droit à la mort de Jean III, mort sans postérité. Malheureusement, un autre prétendant saisit l'occasion de cette interruption de la ligne masculine sur le trône ducal pour se jeter à la traverse et faire valoir des droits que les coutumes féodales rendaient illégitimes.
C'était Jean de Montfort, et de ce moment commença, entre lui et Charles de Blois, cette lutte acharnée à laquelle Jeanne prit une part si active et si glorieuse. Montfort l'emporta, et Jeanne la Boiteuse, dont les enfants étaient retenus prisonniers en Angleterre, dut souscrire au traité de Guérande (1365), qui ne lui laissait que le comté de Penthièvre. Du moins, ce comté avait été constamment défendu avec succès contre l'allié des Anglais ; le château de Jugon avait même été repris et rattaché au comté. Comme il n'y avait pas de communes en Penthièvre, Montfort, qui partout ailleurs s'appuyait sur elles, n'avait là aucun parti et aucune prise.
Les Penthièvre trouvèrent bientôt un allié puissant. Le connétable de Clisson, ennemi mortel de Montfort, devenu Jean IV, usa de son influence pour faire mettre en liberté les enfants de Jeanne la Boiteuse, et Jean de Blois, l'un d'eux, épousa sa fille. Ce mariage important, qui réunit contre les nouveaux ducs de Bretagne les forces éloignées des deux plus puissantes maisons du duché, fut célébré à Moncontour en Penthièvre, en présence des plus illustres seigneurs de Bretagne, les sires de Laval, de Léon, de Derval, de Rochefort, de Beaumanoir et de Rostrenen. Jean IV ne pardonna pas à Clisson une alliance dont le but était si évident, et nous avons raconté ailleurs (Morbihan) comment il l'attira au château de l'Hermine pour le faire périr. N'ayant pas eu le courage de consommer son forfait, il eut à soutenir une guerre terrible dont le comté de Penthièvre fut le principal théâtre.
Tout le comté s'était soulevé. à l'instigation de la belle et vindicative Marguerite de Clisson, qui ne rêvait pour elle-même et pour ses enfants que cette couronne ducale injustement enlevée aux Penthièvre. Elle se lassa moins vite que son père et, tandis qu'il faisait la paix avec Jean IV, elle continua de soulever le pays, et s'efforça de l'entraîner lui-même dans de nouvelles entreprises ; elle ne craignait point de l'exhorter même à l'assassinat. Le connétable repoussa ces coin lots avec indignation ; mais il mourut, et Marguerite, dégagée d'une dépendance qui pesait à sa vengeance et à son ambition, prit les allures d'une souveraine, leva des impôts dans son comté, malgré les défenses du duc et des états de Bretagne, et refusa constamment d'acquiescer aux conditions d'arrangement négociées entre son fils Olivier et le duc.
Douze sergents lui furent envoyés pour l'ajourner à comparaître devant ce dernier. Plusieurs ayant eu l'audace de porter la main sur elle, elle les fit tuer sur-le-champ. Jean IV demanda des secours aux Anglais, qui débarquèrent dans l'île de Bréhat et la ravagèrent ; plusieurs places de Penthièvre tombèrent en son pouvoir. Marguerite céda, mais pour commencer aussitôt un autre genre de guerre, une guerre de perfidie et de guet-apens. Il ne fut point difficile à celle que les vieux historiens appellent la méchante Margot de feindre une réconciliation sincère et même un vif attachement pour les enfants de Jean IV. C'est par ces moyens odieux qu'elle réussit à attirer la duc au guet-apens de Chantoceaux et à se rendre maîtresse de sa personne. Mais c'était trop d'audace et de duplicité.
La Bretagne, lasse des troubles qu'excitait sans cesse une ambition avilie par les moyens mêmes qu'elle employait, s'indigna du forfait et comprit qu'il valait cent fois mieux conserver Jean IV que de s'exposer à tomber sous le joug de Marguerite. Les seigneurs prirent tous les armes. Le comté de Penthièvre fut envahi, la plupart des châteaux rasés, et les Penthièvre, dépouillés de tous leurs biens, allèrent porter en France leur orgueil humilié et leurs opiniâtres projets de vengeance (1420). Un accommodement ménagé par le connétable de Richemont rendit le comté de Penthièvre à Jean, frère d'Olivier et fils de Marguerite. Jean mourut sans enfants. Nicole de Bretagne, sa nièce et son héritière, porta le comté de Penthièvre à son mari, Jean de Brosse, vicomte de Boussac et maréchal de France.
Ce nouveau comte de Penthièvre, moins peut-être par les motifs de haine qui avaient animé les anciens comtes que par attachement à la couronne de France, se déclara pour le roi dans la guerre du Bien publie, et se fit ainsi dépouiller à son tour par le duc François Il. Le comté de Penthièvre passa successivement à plusieurs maîtres différents, et ne revint aux de Brosse qu'après la réunion définitive de la Bretagne à la France. En 1535, François Ier céda à Jean de Brosse, quatrième du nom, tout ce qu'il tenait du comté de Penthièvre, et ce seigneur abandonna au roi tous les droits qu'il pouvait avoir sur le duché par représentation de Nicole de Bretagne, sa bisaÏeule. Le comté de Penthièvre avait été diminué des châtellenies de Châtelaudren, Lanvollon, Painipol, érigées par le duc en baronnie sous le nom d'Avaugour.
En 1569, Charles IX, pour récompenser la fidélité des comtes de Penthièvre, érigea leur fief en duché-pairie, litre glorieux, mais qui ne rendait pas aux Penthièvre la puissance des anciens comtes. Peu de temps après, une alliance porta ce fief à Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, celui que la ligue de Bretagne a rendu si célèbre. Cela fut cause que le territoire de Penthièvre fut un des théâtres des guerres de religion. Nous dirons ailleurs comment Lanoue périt au siège de Lamballe. Françoise de Lorraine, fille et unique héritière de Mercoeur, épousa César, duc de Vendôme, fils légitimé de Henri IV.
C'est Louis-Joseph, fils de César, qui s'illustra, sous le nom de Vendôme, par tant de victoires vers la fin du règne de Louis XIV. N'ayant pas d'enfants, et d'ailleurs grand dissipateur, il vendit son duché de Penthièvre à la princesse de Conti, qui, à son tour, le revendit à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (1696). Enfin, au XVIIIe siècle, la petite-fille du comte de Toulouse le porta dans la maison d'Orléans par son mariage avec le duc de Chartres.
A cette époque, malgré tant de démembrements, le duché de Penthièvre formait encore une des plus belles seigneuries du royaume. Il s'étendait depuis les portes de Saint-Malo jusqu'à celles de Morlaix, moins quelques enclaves, et contenait environ trois journées de chemin de longueur et une de largeur. Il avait pour bornes, à l'est, l'évêché de Saint-Malo ; au sud, le duché de Rohan à l'ouest, le comté de Goëllo et la baronnie d'Avaugour, qui étaient des juveigneuries de Penthièvre. Plus de deux mille gentilshommes relevaient de ce duché, dont l'histoire, comme on en peut juger, est assez exactement celle du département des Côtes-d'Armor.
Nous y ajouterons cependant la mention d'une descente opérée sur la côte de Saint-Cast par les Anglais en 1758, descente qui ne tourna pas à l'avantage des envahisseurs. La duc d'Aiguillon les battit le 11 septembre de la même année, et les obligea de se rembarquer huit jours après leur débarquement. Une médaille fut frappée en mémoire de cet événement ; on y voyait, entre autres figures, celle d'un guerrier armé de la foudre avec cette légende : Virtus nobilitatis et populi Armorici. Pendant la Révolution, les Côtes-d'Armor ne prirent qu'une faible part à la guerre civile ; elles n'en furent troublées qu'à l'époque de l'expédition de Quiberon (1795). C'est sur ce territoire que fut défaite une division de cette armée rouge qui s'était recrutée de paysans bretons revêtus de l'uniforme anglais. Le chevalier de Tinteniac, qui commandait cette troupe, fut tué dans l'action.
Les départements-(histoire)- Cote d'Or - 21 -
Dijon
Partie 2
Cette alliance ajoutait à ses États les comtés de Bourgogne, d'Artois, de Flandre, de Rethel, de Nevers, et en faisait un des souverains les plus redoutables de l'Europe. Le roi de France eut recours à lui contre les attaques des Anglais et du roi de Navarre, Charles le Mauvais. Philippe sut arrêter et contenir l'ennemi ; il triompha de, la patriotique révolte des Gantois, commandés par l'héroïque Artevelde. Il reçut, à Dijon, le roi Charles VI avec une magnificence qui devint traditionnelle à la cour de Bourgogne. Il acquit le Charolais, en 1390, au prix de soixante mille écus d'or. Il envoya son fils aîné, Jean, comte de Nevers, avec une armée au secours de Sigismond, roi de Hongrie, menacé par les musulmans. Pendant la maladie de Charles VI, il avait été choisi par les états généraux, en 1392, pour gouverner le royaume Cette préférence, en excitant la jalousie de la maison d'Orléans, devint la source d'une haine irréconciliable qu'en mourant il légua, héritage funeste, à son fils Jean sans Peur. Ce prince succéda à son père en 1406 ; il avait épousé, en 1385, Marguerite de Bavière, dont la dot grossissait ses États de trois comtés : le Hainaut, la Hollande et la Zélande. Ses premiers actes furent ceux d'un prince habile, mais peu scrupuleux.
Après avoir remis un pou d'ordre dans les finances, compromises par les prodigalités de son père, il donna satisfaction à la haine qui couvait dans son cœur. Le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans, en sortant de l'hôtel Barbette, à Paris, où il avait soupé avec la reine Isabeau de Bavière, tombait, rue Vieille-du-Temple, sous les coups d'un gentilhomme normand, Raoul d'Octonville, écuyer du duc Jean.
La justice étant impuissante en face d'un si grand criminel, la guerre éclata entre Armagnac et Bourgogne ; le fils du duc d'Orléans avait épousé la fille du comte d'Armagnac, et celui-ci se posa en vengeur du duc d'Orléans La durée de cette triste guerre ne fut interrompue que par les périls extrêmes de la France et la désastreuse campagne qui aboutit à la journée d'Azincourt.
Ce jour-là les deux familles rivales combattirent encore sous le même drapeau ; mais la haine étouffa bientôt ce qui restait de patriotisme et de loyauté. Jean, par un traité secret signé en 1416, s'allia aux Anglais, et l'abandon de Rouen fut le gage de sa trahison. Une sédition payée (celle de Périnet-Leclerc, 1418) et un massacre lui ouvrirent même les portes de Paris, où il entra en triomphateur, salué par les acclamations du peuple égaré, qui criait sur son passage : Noël ! vive le duc de Bourgogne, qui abolit les impôts !
Mais ce triomphe fut de courte durée ; le crime appelait la vengeance ; elle fut digne du coupable, digne des mœurs du temps. Un projet de paix et de réconciliation générale fut proposé, une entrevue avec le dauphin fut convenue, et le rendez-vous fixé, pour le 10 septembre 1419, sur le pont de Montereau. L'entourage intime de Jean avait été gagné ; il partit donc sans défiance ; mais quand il se fut avancé sur le pont, escorté de dix chevaliers seulement, les complices du duc d'Orléans, Tanneguy du Châtel et le sire de Barbazan à leur tête, se précipitèrent sur les Bourguignons et percèrent Jean de leurs coups. Les assassins voulaient jeter son corps dans la Seine, mais le curé de Montereau obtint qu'il lui fût remis ; il le garda jusqu'à minuit, le fit alors porter dans un moulin voisin et le lendemain à l'hôpital, où on l'ensevelit dans la bière des pauvres.
La mort de Jean sans Peur mit Philippe, dit le Bon, en possession de ses États à l'âge de vingt-trois an§. Il était à Gand lorsqu'il apprit la fin tragique de son père. Brûlant du désir de le venger, il convoqua à Arras une assemblée de grands seigneurs,. à laquelle il invita le roi d'Angleterre, qui était à Rouen. C'est là que fut préparé, pour être conclu à Troyes en 1420, le monstrueux traité qui, de complicité avec Isabeau, épouse et mère dénaturée, déshéritait, au profit de l'étranger, le dauphin Charles VII, du vivant de son père en démence.
Les événements de cette période sont trop connus et d'un intérêt trop général pour que nous entrions ici dans leur récit détaillé. Philippe, qui par la fin de son règne racheta les fautes du commencement, fut alors le complice de tout ce qui se trama et s'exécuta contre la France. Son excuse est dans le souvenir encore récent du meurtre de son père ; mais on ne petit même pas lui faire un mérite de son repentir, car son retour à la. cause française fut déterminé surtout par les outrages dont les Anglais l'abreuvèrent dès qu'ils crurent ne plu s avoir besoin de lui.
C'est en 1434, et par l'intervention de Charles, duc de Bourbon, que furent posés les préliminaires d'une réconciliation trop tardive et cimentée définitivement par le traité d'Arras, le 21 septembre de l'année suivante. L'insolence des termes prouve à quel point la royauté de France était humble et faible devant ce vassal que dédaignaient les Anglais. Charles désavoue le meurtre de Jean, et Philippe, après l'énoncé des dédommagements qui lui sont accordés, s'exprime ainsi : A ces conditions, pour révérence de Dieu et pour la compassion du pauvre peuple, duc par la grâce de Dieu, je reconnais le roi Charles de France pour mon souverain. Hâtons-nous d'ajouter que jamais parole donnée ne fut mieux tenue, et qu'à dater de cette époque la conduite de Philippe fut aussi irréprochable qu'elle avait été jusque-là criminelle.
La prospérité de ses peuples, le développement des bienfaits de la paix devint son unique préoccupation. L'union des deux maisons de France et de Bourgogne fut resserrée par le mariage du comte de Charolais, héritier de Philippe, avec Catherine de France, fille de Charles VII. Lorsque Louis XI, dauphin, quitta la cour de son père, Philippe lui refusa un asile en Bourgogne, où ses intrigues pouvaient être un danger pour la couronne et lui offrit à Geneppe, dans ses terres de Flandre, une hospitalité digne de son rang. Lors de la sédition qu'occasionna, parmi les chefs de l'armée, la désorganisation de l'ancien système militaire, il intervint entre les rois et les rebelles, et obtint d'eux qu'ils renonçassent à leurs projets de guerre civile.
Quoique l'insubordination de ses sujets flamands le tînt le plus souvent éloigné de la Bourgogne, il y entretint toujours une administration éclairée et paternelle. Son règne fut l'apogée des prospérités de la province. « Il mit ses pays, dit Saint-Julien de Baleure, en si haute paix et heureuse tranquillité qu'il n'y avoit si petite maison bourgeoise en ses villes où on ne bût en vaisselle d'argent ». Ce témoignage naïf est un plus éclatant hommage à sa mémoire que toutes les splendeurs de sa cour et les magnificences de l'ordre de la Toison d'or, dont on sait qu'il fut le fondateur. Il mourut à Bruges d'une esquinancie, en 1467, à l'âge de soixante et onze ans ; son corps fut transporté plus tard aux Chartreux de Dijon. Peu de princes furent aussi profondément et aussi justement regrettés.
Charles le Téméraire, quoique son règne n'ait commencé qu'en 1467, suivait depuis plusieurs années une ligne de conduite indépendante et souvent même opposée aux intentions pacifiques de son père. Sa participation à la ligue du Bien public, ses violents démêlés avec Louis XI étaient certainement peu dans les vues de Philippe, déjà vieux et ami de la paix.
Aux qualités héréditaires de sa race, courage, franchise, générosité, Charles joignait des défauts qui lui étaient personnels et qui rendaient bien périlleuse la lutte engagée avec Louis, le plus habile politique de son temps. Charles était arrogant, présomptueux, plein de fougue et d'obstination, incapable de pressentir les pièges qui lui étaient tendus, plus incapable encore de tourner une difficulté ou de recourir à l'adresse pour sortir d'un mauvais pas. Il épuisa toute son énergie, toutes les ressources de sa puissance à lutter contre les embarras que lui suscitait le roi de France sans paraître soupçonner de quelle main parlaient les coups qui lui étaient portés.
Les révoltes de Gand et de Liège, victorieusement, mais trop cruellement réprimées, lui aliénaient les populations et ne lui laissaient pas la libre disposition de ses forces. Il eut en son pouvoir, à Péronne, son rival, convaincu de complicité avec les Liégeois rebelles, et au bout de trois jours il lui rendit sa liberté, se contentant d'une promesse de neutralité qu'il fut le seul à prendre au sérieux. Il s'empara des comtés de Ferrette et de Brisgau, sans se soucier de la rupture avec la Suisse, qui en était la conséquence inévitable ; l'hostilité de ce voisinage l'entraîna dans une guerre dont il n'entrevit pas un seul instant la portée. Battu à Granson, il lui fallut à tout prix une revanche, et la journée de Morat changea en désastre ce qui pouvait n'être qu'un échec. L'importance qu'il avait toujours donnée aux prestiges de l'apparat, aux formes extérieures de la puissance, devait rendre mortel l'affront que ses armes avaient reçu ; il le comprit bien, et on le vit périr de mélancolie et de chagrin plus encore que de sa dernière défaite sous les murs de Nancy.
Il avait été mortellement frappé le 5 janvier 1477 ; son corps, à demi engagé dans un étang glacé, ne fut reconnu que deux jours après à la longueur de ses ongles et à une cicatrice résultant d'une blessure qu'il avait reçue à la bataille de Montlhéry, en 1465. Avec lui finit le duché héréditaire de Bourgogne, dont les possesseurs avaient cinq duchés à hauts fleurons, quinze comtés d'ancienne érection et un nombre infini d'autres seigneuries, marchaient immédiatement après les rois, comme premiers ducs de la chrétienté, et recevaient des princes étrangers le titre de grands-ducs d'Occident.
Charles laissait pour unique héritière une fille, la princesse Marie. Louis XI s'en fit d'abord donner la tutelle ; puis, à force de séductions et de promesses, il obtint du parlement de Dijon la réunion du duché à la couronne de France. Une alliance du dauphin avec Marie aurait légitimé cette usurpation. Louis ne voulut pas y consentir ; c'est la faute la plus capitale qu'on puisse reprocher à sa politique ; d'ailleurs ce mariage eût été trop disproportionné, le jeune dauphin ayant à peine huit ans et Marie de Bourgogne étant dans sa vingt et unième année. L'archiduc Maximilien, étant devenu l'époux de la fille de Charles le Téméraire, revendiqua les droits de sa femme et- remit en question l'unité française, qu'il eût été si facile de constituer.
Mais ce qui échappa à la perspicacité des politiques, l'instinct public le comprit et la force des choses l'amena ; le lien qui venait de rattacher la Bourgogne à la France, quelque irrégulier qu'il fût, ne devait plus être rompu. Malgré les alternatives d'une longue lutte, malgré le péril qu'entretenait pour les frontières de la province le voisinage de la Comté demeurée en la possession de l'étranger, malgré l'espèce de consécration que donnait aux droits de Maximilien sa domination sur les Flandres, la Bourgogne demeura française, et ses destinées restent dès lors indissolublement unies à celles de la patrie commune. Le titre de duc de Bourgogne reste attaché à l'héritier direct de la couronne, et chaque jour, malgré la fidélité des souvenirs aux traditions de l'histoire provinciale, la similitude de langage, l'affinité des mœurs, la communauté des intérêts. rend plus complète la fusion des deux États.
La lutte de François Ier et de Charles-Quint, les guerres religieuses et les troubles de la Fronde sont les épisodes les plus marquants qui se rattachent à la période française des annales bourguignonne s. Les populations furent admirables de dévouement et d'héroïsme pendant la première de ces crises, luttant à la fois contre les Espagnols, l'Autriche et les Comtois, donnant par souscriptions volontaires des sommes considérables, outre celles votées par les états pour la rançon de l'illustre prisonnier de Pavie, et refusant d'accéder à la condition du traité de Madrid, qui cédait la Bourgogne à Charles-Quint, représentant à ce sujet qu'ayant par les droits de la couronne et par leur choix des maîtres nécessaires, il ne dépendait pas de la volonté du monarque de les céder ainsi. La noblesse ajouta que si le roi l'abandonnait, elfe prendrait le parti extrême de se défendre et de s'affranchir de toutes sortes de domination, et qu'elle répandrait pour ce dessein jusqu'à la dernière goutte de son sang.
La fierté de ces sentiments, puisés dans les glorieux souvenirs du passé, arrêta longtemps les progrès du protestantisme ; la Bourgogne voulait être la dernière à souffrir sur son sol une nouvelle religion, puisqu'elle avait été chrétienne avant tous les Français, qui ne l'étaient devenus que par le mariage de leur princesse Clotilde avec le fondateur de la monarchie française. Les fléaux que déchaîna le fanatisme sur tant d'autres provinces furent évités jusqu'à la déplorable organisation des ligues catholiques, et, grâce à l'intervention du digne président Jeannin, le plus grand nombre des villes de Bourgogne ne fut pas ensanglanté par les massacres de la Saint-Barthélemy. Cependant l'obstination de Mayenne prolongea jusqu'en 1595 les calamités de la guerre civile, à laquelle mit fin seulement la victoire remportée par Henri IV sur les Espagnols à Fontaine-Française. Le 6 juin de cette année, ce monarque fit son entrée à Dijon ; il assista à l'élection du maire, jura de respecter les privilèges de la ville, et se contenta de changer quelques magistrats municipaux et de faire fermer le collège des jésuites.
Les dernières épreuves que la Bourgogne eut à traverser furent, sous Louis XIII, une révolte des vignerons, qui se réunissaient au refrain, Lanturlu, d'une vieille chanson, ce qui fit désigner cette révolte, qui, d'ailleurs, fut bientôt apaisée, sous le nom de Révolte des Lanturlus. Puis vint l'invasion des Impériaux amenée par les révoltes de la noblesse contre Richelieu et le. siège mémorable de Saint-Jean-de-Losne, les agitations de la Fronde, auxquelles l'influence des Condé dans la province donna une certaine importance, mais auxquelles manqua, presque partout l'appui des populations.
Dans les époques plus récentes, la Bourgogne prit sa part de tous les événements heureux on funestes dont la France fut le théâtre. La Révolution de 1789 y fut accueillie comme' une ère réparatrice, qui devait faire disparaître les tristes abus financiers des derniers règnes, et assurer à chacun les libertés que l'on réclamait depuis longtemps. Les gardes nationales s'y organisèrent avec une rapidité merveilleuse, et, oubliant les vieilles rivalités qui les divisaient sous l'ancien régime, elles s'unirent à celles de la Franche-Comté et demandèrent à marcher ensemble les. premières contre l'ennemi.
Le département de la Côte-d'Or fournit donc un large contingent aux phalanges républicaines qui, après avoir refoulé l'ennemi, promenèrent le drapeau national dans toutes les capitales de l'Europe ; et lorsque, moins heureux, les soldats de Napoléon jar expièrent par les désastres de 1814 et 1815 les triomphes passés, nulle part ils ne trouvèrent un plus vaillant appui et de plus patriotiques sympathies que dans les populations de la Bourgogne. Depuis que les luttes de l'industrie et des arts ont remplacé dans la vie des peuples modernes les vicissitudes des champs de bataille, la Côte-d'Or, grâce au génie de ses habitants et aux richesses de son sol, a su conquérir une importance et une prospérité qui lui permettent de ne rien regretter des gloires et des grandeurs de l'ancienne Bourgogne.
Pendant la néfaste guerre de 1870-71, le département de la Côte-d'Or eut d'autant plus à souffrir de l'invasion allemande que Dijon fut successivement pris pour centre d'opérations et par les Français et par les Allemands. À la nouvelle que le passage des Vosges avait été forcé par l'ennemi et que la ligne de défense de Vesoul à Lure venait d'être abandonnée par le général Cambriels qui s'était retiré à Besançon, la résistance s'organisa à Dijon sous la direction du docteur Lavalle, membre du conseil général, tandis que Garibaldi, autorisé par le gouvernement de la défense nationale, formait un corps d'armée composé de quatre brigades dont il confiait le commandement à Bossack, Marie, Menotti et Ricciotti. Le général de Werder, commandant du 4e corps allemand, marchait sur Dijon et, le 27 octobre 1870, repoussait, à Talmay, les troupes françaises commandées par Lavalle, qui ne se composaient guère que de quelques bataillons de mobiles et de gardes nationaux.
Pendant ce temps, Garibaldi se portait sur la droite du côté de Poutailler pour essayer de rejoindre les troupes du général Cambriels. L'ennemi, ayant passé la Saône à Gray, se porta sur Dijon ; les troupes qui s'opposaient à sa marche furent repoussées à la bifurcation des routes de Gray à Dijon et à Auxonne. À la suite d'un nouveau combat livré à Saint-Apollinaire le 30 octobre, les Allemands entrèrent à Dijon. Garibaldi qui avait en vain essayé d'accourir à la défense de la ville, ce qu'il ne put faire, parce que le pont de Pontailler avait été rompu, voulut du moins protéger les autres grandes villes de la Côte-d'Or ; il fit occuper Saint-Jean-de-Losne et Seurre et lui-même revint à Dôle. Le 2 novembre l'ennemi, maître de Dijon, marchait sur Beaune et Chagny. Les troupes de Garibaldi gardèrent les rives de l'Oignon et de la Saône ; le 5 novembre, elles repoussèrent l'ennemi près de Saint-Jean-de-Losne.
A la suite de cet échec, les Allemands revinrent à Dijon pour s'y reformer et firent de cette ville le centre de leurs opérations dans l'Est. Ils reprirent bientôt l'offensive et repoussèrent d'abord, le 30 novembre, les troupes de Garibaldi ; mais le 3 décembre, celui-ci, appuyé parle général Cremer, les battit complètement à Arnay-le-Duc et à Bligny-sur-Ouche, les rejetant presque sous les murs de Dijon. Cette double victoire, qui empêchait l'ennemi de dépasser Chagny, sauva le reste du département et peut-être même Lyon. Le général de Werder revint une fois encore à Dijon pour reposer ses troupes et les reformer ; mais les événements avaient marché Au nord-est ; il dut envoyer ses troupes sous les murs de Belfort qui se défendait avec acharnement, et il ne laissa à Dijon que le général Glumer avec deux bataillons et à Semur une brigade badoise. Ces troupes furent ellesmêmes bientôt rappelées et, le 6 janvier 1871, Garibaldi rentrait à Dijon, y organisait de nouveau la défense ; il était temps, car une armée de 70 000 AIlemands s'avançait pour empêcher Bourbaki de se porter à la défense de Belfort.
Trois corps de cette armée furent successivement attaqués et battus dans les journées des 21, 22 et 23 janvier, par le général Pélissier et Garibaldi, d'abord à Fontaine et à Talant, puis à Plombières, à Daix, à Hauteville et au Val-de-Suzon. D'habiles dispositions permettaient d'espérer des succès plus décisifs lorsque, le 29 janvier, on apprit la capitulation de Paris et la notification de l'armistice. Par une fatalité encore mal expliquée, les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura n'étaient pas compris dans cet armistice ; l'armée de l'Est était refoulée vers la Suisse, la continuation de la lutte devenait impossible, il fallut se résigner à abandonner Dijon qui ne fut évacué par l'ennemi qu'après la signature des préliminaires de paix. Quant à Garibaldi, qui le 28 janvier était parvenu à réunir à Dijon près de 50 000 hommes et 90 canons, il avait agi si habilement et avec tant de promptitude qu'il put opérer sa retraite sans rien perdre de son matériel. L'invasion allemande avait coûté au département de la Côte-d'Or 14 464 427 fr. 29.
Les départements-(histoire)-Cote d'Or - 21 -
Région Bourgogne
(PARTIE 1)
Par sa position géographique, la richesse et l'étendue de son territoire, l'importance de ses villes, le département de la Côte-d'Or est celui dans lequel se caractérise le plus la physionomie historique de l'ancienne Bourgogne. Avant la conquête romaine et l'invasion des Burgondes, qui ont laissé leur nom à la province où ils s'installèrent, cette contrée, comprise dans la Gaule celtiques était habitée par les Lingons, tribu vaillante, fort ancienne, et qui se partageait avec les Séquanais et les Éduens toute la région orientale de la France actuelle.
La religion, les mœurs des Lingons étaient celles des autres peuples de la Gaule ; ils croyaient à l'unité de Dieu et à l'immortalité de l'âme ; ils avaient une espèce de royauté élective et responsable, dont le pouvoir civil, judiciaire et militaire, était, en beaucoup de cas subordonné à l'autorité religieuse du grand prêtre, chef des druides. L'esprit belliqueux et entreprenant de ces populations les avait souvent entraînées dans de lointaines expéditions. Longtemps ils furent conquérants avant d'être conquis à leur tour. 590 ans avant l'ère chrétienne, Sigovèse avait établi des colonies dans la Bohème et la Bavière, et Bellovèse avait fondé plusieurs villes dans le nord et l'est de l'Italie. Brennus avait pris Rome. Deux autres chefs gaulois, Léonoius et Lutarius, avaient pénétré jusqu'à Delphes, en Asie, et y avaient constitué la tétrarchie des Galates. Les Linons avaient figuré dans toutes ces entreprises, et on leur attribuait spécialement la fondation des villes d'Imola et de Budrio.
Lorsque l'invasion des Helvètes les menaces d `Arioviste, chef des Suèves, et la rivalité entre les Êduens et les Arvernes eurent amené sur les bords de la Saône les Romains déjà maîtres de la Gaule Narbonnaise, les Lingons furent un des premiers peuples auxquels ils offrirent leur amitié. Le respect qu'ils professèrent dans les premiers temps pour les coutumes et l'indépendance de leurs nouveaux alliés établit entre les deux nations l'union la plus cordiale et la plus sympathique. Des volontaires lingons se joignirent aux Éduens, qui voulurent accompagner César dans sa descente en Grande-Bretagne. Dans la guerre même de l'indépendance, guerre dont Vercingétorix fut le héros et la victime, les Lingons restèrent fidèles à la foi promise, malgré l'exemple que leur donnaient les Éduens, ces vieux alliés de Rome, qui se repentaient, mais trop tard, d'avoir été les premiers à accepter le patronage de tels voisins.
Les Lingons s'attachèrent plus étroitement à la fortune du conquérant des Gaules, qui sut avec tant d'habileté recruter ses légions parmi ceux qu'il venait de vaincre. Ils combattirent pour lui à Pharsale ; et si les trésors de la Gaule, si Vercingétorix enchaîné, figurèrent dans le cortège du triomphateur, on vit aussi plus d'un Gaulois quitter ses braies pour revêtir la toge du sénateur. C'est par les séductions de la paix que César voulait achever l'oeuvre de ses victoires. Les provinces gauloises furent administrées sous son règne avec la plus grande douceur. On n'enleva aux populations ni leurs terres ni leurs droits municipaux. Les grands furent dédommagés, par des titres et par des honneurs nouveaux, des dignités qu'ils avaient perdues. L'agriculture fut exercée dans les mêmes conditions qu'en Italie ; la navigation était libre sur le Rhône, la Saône, la Loire, même sur l'Océan.
Aussi les luttes du second triumvirat n'eurent-elles aucun retentissement dans la Gaule épuisée et assoupie. Auguste continua la politique de César. il fit plusieurs voyages et de longs séjours dans la Gaule, défendit ses frontières contre les Germains, y appela de nombreuses colonies, embellit les villes, en fonda de nouvelles, couvrit le pays de larges et magnifiques routes, imposa, enfin, sa domination avec tant d'habileté qu'à sa mort les vaincus avaient adopté les mœurs, les habillements, la religion et les lois des vainqueurs. La tyrannie, les exactions de Tibère et de Néron suscitèrent les révoltes promptement comprimées de Sacrovir et de Vindex. Le vieux sang gaulois était appauvri et vicié ; pour le rajeunir, il fallait d'autres éléments que l'influence d'une civilisation corruptrice et le contact des races abâtardies de la Rome des Césars.
Le seul épisode qui mérite d'arrêter les regards dans cette longue période de servitude et d'abjection est l'audacieuse tentative de Sabinus et le dévouement héroïque d'Éponine, son épouse. L'incendie du Capitole, qui avait marqué la mort de Vitellius, était représenté par quelques vieux druides comme un présage de ruine pour la puissance romaine. Les Lingons prirent les armes et choisirent pour chef Sabinus, leur compatriote, qu'on prétendait issu de Jules César. Ceux de Trèves se joignirent à eux ; mais les Séquanais et les Autunois, dont Sabinus avait autrefois pris d'assaut la capitale, marchèrent contre les révoltés et les défirent. Les Lingons se réconcilièrent avec Domitien en lui envoyant un secours de 70 000 hommes contre les barbares qui menaçaient les frontières romaines.
C'est vers cette époque, au moment même où l'oeuvre de dissolution semble accomplie, que commencent à apparaître les premiers symptômes de régénération. On fait remonter à la fin du ne siècle les premières prédications de l'Évangile en Bourgogne. La tradition la plus probable et la plus répandue donne à cette province pour premiers apôtres les disciples de saint Polycarpe, évêque de Smyrne, qui, après avoir pénétré dans la Gaule par le Vivarais, et ayant trouvé l'Église de Lyon déjà florissante, grâce aux prédications de Pothin et d'Irénée, s'avancèrent jusqu'à Autun, et de là se partagèrent la gloire et les périls de la conversion du pays Autun eut pour martyr un des premiers néophytes, le jeune Symphorien. Andoche et Thyrse, ses maîtres dans la foi, périrent à Saulieu, et Bénigne, leur compagnon, à Dijon, vers 178, sous le règne de Marc Aurèle. Le sang des victimes fut une semence féconde de chrétiens, et lorsque, en 311, Constantin donna la paix à l'Église, chaque ville, après avoir eu son martyr, avait enfin son pasteur.
Pendant que ces germes de salut se développaient, pendant que cette force inconnue grandissait dans l'ombre, rien ne saurait donner une idée de l'horrible confusion au milieu de laquelle agonisait le vieil empire romain séditions des légions nommant chacune leur empereur, guerres civiles, déchirement des provinces, pestes, famines, exactions. Le vieux monde se précipitait dans le christianisme comme dans un, refuge ; mais ce monde était trop usé, trop fini, trop bien mort pour apporter à la foi nouvelle la force d'expansion nécessaire à la reconstitution d'une autre société ; c'est alors qu'arrivent les barbares.
Alains, Vandales, Suèves, Gépides franchissent le Rhin, descendent des Alpes, pénètrent jusqu'en Espagne, jusqu'en Afrique, sans que la Saône ou le Rhône les arrêtent, sans laisser d'autres traces de leur passage que des monceaux de ruines. Derrière eux s'avance lentement une lourde armée de géants ; c'étaient les Burgondes. Pline en fait la principale tribu des Vandales ; Procope et Zosime les disent également Germains d'origine et de nation vandale. Voici le tableau qu'en a tracé le savant et consciencieux historien de la Bourgogne, Courtépée :
« Ces peuples, nés au milieu des forêts, étaient ennemis de la contrainte ; la liberté faisait tout leur bonheur, la chasse leur occupation, les troupeaux et les esclaves leurs richesses. Sans patrie et sans demeure fixe, ils ne redoutaient que la servitude. Ils n'avaient aucun art agréable ; mais ils pratiquaient l'hospitalité et toutes les vertus des peuples sauvages. Ils n'avaient pour arme que la framée, espèce de lance ou de halle- barde, la fronde, l'épieu, la hache, qui servaient également pour attaquer, pour se défendre et pour bâtir leurs maisons. Ils marchaient toujours armés, usage qu'ils conservèrent après leur conquête.
« On dit qu'ils portaient la figure d'un chat sur leurs boucliers, emblème de la liberté qu'ils voulaient conserver partout. Ils avaient des chefs, mais ils n'avaient point de maîtres. Ces chefs, qui prenaient le titre de hendin, furent d'abord électifs. Leur autorité n'avait d'autre terme que celui du bonheur de la nation. Ils n'étaient pas seule ment comptables de leurs fautes personnelles, ils l'étaient aussi des caprices de la fortune ou des fléaux de la nature. On les déposait lorsqu'ils avaient perdu une bataille ou mal réussi dans leurs entreprises, ou dans un temps de stérilité. Leurs prêtres étaient traités bien plus favorablement. Le pontife, nommé sinist, était perpétuel ; son pouvoir surpassait celui du hendin, et s'étendait au droit de punir les coupables : le respect des peuples le mettait lui-même à l'abri de toute révolution. »
Tel était le peuple qui devait conquérir une partie si importante de la Gaule. Des bords de la Vistule et de l'Oder il arriva, vers 275, sur les bords du Rhin, fit plusieurs tentatives infructueuses pour le franchir, et s'établit sur la rive droite, où il demeura jusqu'en 407. C'est pendant les dernières années de ce séjour que la religion du Christ pénétra chez les Burgondes ; ils avaient entendu parler d'un Dieu puissant dont le culte s'était nouvellement établi dans les Gaules. Ils envoyèrent des députés aux évêques voisins pour se faire instruire ; et ceux-ci, ayant été baptisés, rapportèrent la foi à leurs compatriotes.
Quoiqu'on ignore la date précise de leur conversion, elle est généralement attribuée aux prédications de saint Sévère, évêque de Trèves en 401. Quelques années après, Stilicon, général des armées romaines, Vandale d'origine, devenu tuteur d'Honorius, fit alliance avec les Alains, les Suèves, les Vandales, et les appela dans les Gaules pour l'aider à placer sur le trône impérial son propre fils Euchérius. Les Burgondes franchirent alors le Rhin à la suite des autres barbares ; ils se rendirent maîtres, presque sans obstacle, des pays situées entre le haut Rhin, le Rhône et là Saône Impuissant à leur résister, le patrice Constance, général d'Honorius, fit avec eux un traité solennel, qui leur assurait à titre d'hôtes et de confédérés la possession de presque tout le territoire dont ils s'étaient emparés.
Ils élurent alors un roi ; leur choix tomba sur Gondicaire, le même sans doute qui était hendin lors du passage du Rhin en 407, et qu'on peut regarder comme le fondateur de la première monarchie bourguignonne. Trois nations différentes vivaient donc alors sur le même sol - les Gaulois, les Romains et ces nouveaux conquérants, les Burgondes. C'est de la fusion de ces éléments divers que se forma la race régénérée.
Gondicaire justifia par sa conduite habile le choix de ses compatriotes. Sa capitale et sa résidence fut d'abord Genève, qui était alors au centre de ses États ; plus tard, ayant soumis toute la province lyonnaise, il transféra à Vienne, en Dauphiné, le siège de la monarchie, se rendit maître d'Autun et de toute la Séquanaise, porta ses armes jusque dans la Belgique et le pays de Metz, et ne fut arrêté dans ses conquêtes que par le patrice Aétius, qui, justement alarmé des envahissements de ses anciens alliés, leur déclara la guerre et les défit dans une sanglante bataille, en 435.
Vainqueurs et vaincus se réunirent bientôt contre un ennemi qui les menaçait tous ; les Huns se montraient de nouveau sur le Rhin ; Gondicaire avait été tué avec vingt mille des siens en s'opposant à leur passage ; Gondioc, son fils et son successeur, associa ses efforts à ceux d'Aétius pour combattre Attila, et partagea la gloire de la fameuse journée des plaines catalauniques. Fidèle aux traditions paternelles, il utilisa habilement les années de paix qui suivirent celte rude secousse.
C'est de ce règne que date la répartition territoriale et cette législation bourguignonne si profondément enracinée dans les moeurs du pays que, dans plusieurs de ses parties, elle a continué à régir la province jusqu'à la Révolution. de 1789. Gondioc se rit nommer patrice par les Romains, et obtint du souverain pontife le titre de fils. Il réunit à sa couronne le pays des Lingons, celui des Éduens, le Nivernais, le reste de la Lyonnaise et une partie de la Narbonnaise, de sorte que son empire avait au midi la Méditerranée pour limite. Il mourut à Vienne vers 470, laissant quatre fils qui se partagèrent ses vastes États.
La Bourgogne et la Comté échurent à Gondebaud, patrice et maître de la milice dès 473, arbitre des destinées à de l'empire qu'il fit donner à Glycérius, et, en 476, souverain indépendant lors de la ruine de la puissance romaine sous Augustule. Le bien qu'on pouvait attendre de la position ainsi simplifiée fut considérablement atténué par les dissensions qui éclatèrent entre Gondebaud et ses frères. Celui-ci, après avoir triomphé de toutes les agressions, ensanglante ses victoires par des violences que la barbarie du temps peut expliquer, mais que ne saurait justifier l'histoire.
Les représailles, au reste, ne se firent pas attendre. Clotilde, seconde fille de Chilpéric, un des frères de Gondebaud, qui avait eu en partage Genève, la Savoie et une partie de la Provence, après avoir échappé au' massacre de sa famille vaincue et dépossédée, était devenue la femme de Clovis, chef des Francs. Cette princesse poursuivit avec une persévérance infatigable l'œuvre de vengeance qu'elle semblait s'être imposée, usant de toute l'influence qu'elle exerçait sur son époux pour l'armer contre son oncle, suscitant les scrupules du clergé de Bourgogne contre l'arianisme qu'avait embrassé Gondebaud, éveillant toutes les convoitises, envenimant toutes les haines contre celui dont elle s'était promis la perte. Gondebaud déjoua toutes les intrigues, repoussa toutes les attaques et lassa pour un temps cette implacable hostilité.
L'histoire de son règne peut se diviser en deux parties : la période belliqueuse, toute remplie des luttes dont nous venons d'énoncer l'origine et les résultats ; la période pacifique, consacrée à l'organisation administrative et judiciaire du royaume de Bourgogne. C'est dans cette dernière surtout qu'il faut chercher les titres de Gondebaud aux souvenirs de l'histoire ; il compléta, dans un esprit remarquable de justice et d'humanité, l'oeuvre commencée par son père ; il réunit ses ordonnances modifiées et les édits nombreux qu'il rendit lui-même dans une espèce de code devenu célèbre sous le nom de Loi Gombette. Ce règne, pendant lequel l'agriculture fut puissamment encouragée, les ruines des villes relevées, d'innombrables établissements ecclésiastiques fondés, marque l'apogée de la monarchie de Gondicaire.
Gondebaud mourut à Genève en 516 ; il eut encore deux successeurs, Sigismond et Gondemar ; mais l'inaction de l'un et la faiblesse de l'autre rendirent la tâche facile à la vengeance inassouvie de Clotilde et à l'ardeur conquérante des Francs. En 534, Clotaire et Childebert rassemblèrent leurs forces et envahirent la Bourgogne ; une seule bataille leur livra le pays. Gondemar alla s'enfermer dans Autun, où il tenta de résister aux fils de Clotilde ; mais ce dernier effort fut si peu vigoureux, si peu retentissant, qu'en enregistrant sa défaite, l'histoire reste muette sur les destinées du vaincu. En lui, s'éteignit la race de Gondicaire ; avec lui finit le royaume de Bourgogne, qui avait duré 120 ans.
Les princes francs se partagèrent les dépouilles de Gondemari Théodebert, roi de Metz, eut Besançon, Langres, Châlon, Genève et Viviers et Childebert, roi de Paris, et Clotaire, roi de Soissons, eurent le reste jusqu'au moment où ce dernier réunit sous son sceptre les États de ses frères. Un nouveau partage, qui eut lieu à sa mort en 562, constitua un second royaume de Bourgogne au bénéfice de son second fils, Gontran, possesseur en outre d'Orléans et du territoire de Sens.
Rien de plus lugubre à la fois et de plus confus que les annales de cette dynastie mérovingienne des rois de Bourgogne. La seule figure de Gontran repose le regard épouvanté de toutes les horreurs qui signalent la longue et sanglante rivalité de Frédégonde et de Brunehaut. Le peuple l'aimait, disent les chroniques du temps ; quand il approchait d'une ville, les habitants allaient au-devant de lui avec des bannières en criant : Noël ! Après sa mort,' il fut mis au nombre des saints ; et, cependant, on rapporte que la dernière de ses trois femmes, la belle Austrégide, lui ayant demandé comme grâce en mourant de faire périr ses deux médecins, parce qu'ils n'avaient pas eu l'habileté de la guérir, il eut la faiblesse d'accomplir ce vœu barbare ; ajoutons que c'est le premier prince qui se soit fait entourer de gardes.
Childebert, sans changer son titre de roi d'Austrasie, hérita de la plus grande partie de la haute Bourgogne, qu'il conserva seulement trois ans et quelques mois. Thierry, son second fils, est le deuxième prince mérovingien qui soit désigné sous le nom de roi de Bourgogne et d'Orléans ; il se laisse diriger par Brunehaut, son aïeule ; l'histoire de son règne n'est qu'un tissu de trahisons, de massacres et d'atrocités de tout genre. Il meurt subitement à Metz d'un flux de sang, à l'âge de vingt-six ans, après en avoir régné dix-huit, et précédant. de quelques mois seulement dans le tombeau sa terrible aïeule, dont fait justice à son tour Clotaire II, fils de Frédégonde.
La première apparition des maires du palais à la cour de Bourgogne se rattache au règne de Thierry ; et ce sont les intrigues de Varnachaire II, revêtu de cette dignité, qui livrent Brunehaut à Clotaire et facilitent à ce prince, par la défaite des fils de Thierry, la réunion de la Bourgogne à la France. Les deux royaumes sont régis par le même sceptre et suivent les mêmes destinées jusqu'à la fin du IXe siècle, époque de la constitution des grands établissements féodaux sous les successeurs de Charlemagne.
Charles le Chauve avait trouvé dans la fidélité de la noblesse bourguignonne un précieux appui contre les attaques de Louis le Germanique ; mais toutes les leçons de l'expérience étaient perdues pour ce prince incapable. Son fils, Louis le Bègue, ne comprit pas davantage la nécessité. de réunir en faisceau les forces éparses de la monarchie défaillante. Sous son règne, la confusion et l'anarchie augmentèrent encore, le morcellement du territoire ne rencontra plus d'obstacle. Trois nouveaux royaumes furent formés avec les débris de l'ancien royaume de Bourgogne : celui de Provence ou de Bourgogne cisjurane, par Boson, élu roi au concile de Mantaille, en 879 ; celui de Bourgogne transjurane, par Rodolphe, couronné à Saint-Maurice, en Valais, en 888 ; et celui d'Arles, composé des deux premiers, en 930. Quant à la Bourgogne proprement dite, elle resta sous le gouvernement des ducs héréditaires, dont nous avons ici principalement à nous occuper.
L'origine des premiers ducs de Bourgogne était illustre, et ce qui vaut mieux encore, nous retrouvons là, comme à la souche de presque toutes les grandes dynasties féodales, un de ces hommes auxquels il n'a manqué qu'un autre théâtre pour que l'histoire les mette au rang de ses héros. Richard le Justicier, comte d'Autun, était fils de Beuves, comte d'Ardenne, frère de Boson, roi de Provence, et sa soeur Richilde avait épousé Charles le Chauve en 870.
Sans vouloir nier ce que ces hautes alliances durent ajouter à son crédit, on peut dire qu'il fut surtout le fils de ses œuvres. Sincèrement et loyalement dévoué au roi son bienfaiteur, il le défendit contre les entreprises de sa propre famille. Il battit, en 880, les troupes de son frère Boson près de la Saône, mit garnison dans Mâcon au nom des rois Louis et Carloman, et donna le gouvernement de cette ville à Bernard, dit Plantevelue, tige des comtes héréditaires de Mâcon. Après s'être emparé de Lyon, il assiégea Vienne, dont il chassa Boson, et emmena prisonnière à Autun sa femme Hermangarde avec ses enfants, en 882. Il secourut Charles le Simple contre Eudes, comte de Paris, défit une première fois, en 888, dans les plaines de Saint-Florentin, les Normands, qui avaient pénétré dans la Bourgogne et dévasté Bèze ; remporta de nouvelles victoires sur eux, avec l'aide des, Auxerrois conduits par leur évêque Géran, gagna, contre le fameux chef Rollon, une bataille décisive auprès de Chartres, et fit lever le siège de cette ville en 911.
Étant à l'agonie, et les évêques l'exhortant à demander pardon à Dieu d'avoir versé tant de sang humain : Quand j'ai fait mourir un brigand, répondit-il, j'ai sauvé la vie aux honnêtes gens, la mort d'un seul ayant empêché ses complices de faire plus de mal. Il mourut à Auxerre en 921, laissant de sa femme Adélaïde soeur de Rodolphe Ier roi de la Bourgogne transjurane, trois fils : Raoul, son successeur, qui devint ensuite roi de France, Hugues le Noir et Boson.
Les ducs bénéficiaires de Bourgogne furent au nombre de sept, et régnèrent, de 880 à 1032, dans, l'ordre suivant : après Richard, Raoul le Noble, qui fut roi pendant la captivité de Charles le Simple à Péronne ; il eut pour successeur son beau-frère, Gilbert de Vergy, qui maria sa fille aînée à Othon, fils de Hugues le Grand ; Hugues le Noir, second fils de Richard, occupa pendant quelque temps le duché à la mort de Gilbert, plutôt comme usurpateur que comme héritier ; il en fut dépossédé par Louis d'Outre-mer au profit de Hugues le Blanc ou le Grand, cinquième duc.
On connaît la haute fortune de cette maison : pendant que Hugues Capet mettait la couronne de France sur sa tête, ses deux frères, Othon et Henri, possédaient successivement le duché de Bourgogne. La mort du septième et dernier duc Henri fut le signal de violentes contestations, de luttes sanglantes et d'une nouvelle répartition territoriale. Il avait laissé un fils adoptif, Othe-Guillaume, qui, soutenu par une partie des populations et les sympathies de la noblesse, prétendait à la succession de Henri ; le roi Robert, neveu paternel du duc, revendiquait de son côté l'héritage comme étant son plus proche parent ; la guerre éclata ; enfin, après treize ans d'une lutte indécise et ruineuse, l'intervention de l'évêque d'Auxerre amena un arrangement en vertu duquel le duché de Bourgogne était restitué à Robert, tandis que Othe conservait viagèrement le comté de Dijon.
Par une singulière coïncidence, à peu près à la même époque où le duché bénéficiaire prenait fin par sa réunion au domaine de la couronne, le second royaume de Bourgogne s'éteignait, après cent cinquante ans de durée, dans la personne d'Eudes, comte de Troyes, tué dans sa lutte contre Conrad II. Des débris de ce royaume furent formés les comtés de Provence, de Savoie, de Viennois, de Bourgogne ou Franche-Comté ; le reste fut réuni par Conrad à l'Empire. Ce comté de Bourgogne fut donné aux descendants de Othe en échange du comté de Dijon, et Lambert, évêque de Langres, ayant remis au roi Robert tous les droits qu'il possédait sur cette ville, ce prince en fit, au préjudice d'Autun, la capitale du duché qu'il donna à son fils Henri.
Le règne de Robert forme donc une des époques les plus importantes de l'histoire de Bourgogne : démembrement et fin du second royaume de Bourgogne ; formation d'un comté et transformation du duché bénéficiaire fondé par Richard le Justicier en un duché héréditaire qui va devenir l'apanage des princes du sang royal. Tels sont les faits essentiels qui se rapportent à cette date.
Henri Ier, fils aîné de Robert, nommé duc de Bourgogne en 1015, et devenu roi de France en 1031, céda son duché à son frère Robert, tige d'une dynastie de douze ducs, qui possédèrent la province de 1032 à 1361. Les termes de la charte d'octroi portent que le duché est donné pour en jouir en pleine propriété et passer à ses héritiers. Robert Ier, premier duc de la première race royale, usa assez tyranniquement de sa souveraineté ; son règne fut tout rempli de violents démêlés avec les Auxerrois ; il mourut à FIeurey-sur-Ouche, en 1075, après un règne de quarante-trois. ans, d'un accident tragique et honteux que l'histoire n'explique pas.
Son petit-fils, Hugues Ier, s'appliqua, par la sagesse et la douceur de son administration, à faire oublier les violences de son aïeul ; il prêta volontairement serment de maintenir les droits et privilèges de la province, et commit à six barons l'autorité de réprimer, même par les armes, les empiétements de ses successeurs. Après avoir remis son duché à Eudes Ier, son frère, il se retira, en 1078, à Cluny, sous la discipline de saint Hugues, son grand-oncle. Le plus éloquent éloge des vertus de ce prince est dans les phrases suivantes d'une lettre que le pape Grégoire VII écrivait à l'abbé de Cluny, pour lui reprocher d'avoir encouragé la résolution de Hugues : « Vous avez enlevé le duc à la Bourgogne, et par là vous ôtez à cent mille chrétiens leur unique protecteur. Si vous ne vouliez pas exécuter mes ordres qui vous le défendaient, au moins eussiez-vous dû être sensible et céder aux gémissements des pauvres, aux larmes des veuves et aux cris des orphelins. »
Les ravages d'une peste horrible, qu'on appela le feu sacré, et la fondation de l'ordre des chartreux par saint Bruno sont les événements les plus importants qui se rattachent à ce règne. Eudes se croisa et alla mourir à Tarse, en Cilicie, en 1102. Hugues II, son fils, mérita le surnom de Pacifique. Il fut l'ami de saint Bernard et s'occupa beaucoup de pieuses fondations.
L'aîné de ses fils et son successeur, Eudes II, hérita de ses vertus. Quoiqu'il se soit décidé deux fois à faire la guerre, d'abord pour consacrer ses droits de suzeraineté sur Saint-Germain d'Auxerre, Saint-Florentin et le comté de Troyes, que lui contestait Thibaut, son beau-père, et ensuite pour aller délivrer des Sarrasins son cousin Alphonse de Portugal, il prouva qu'il estimait les bienfaits de la paix à. leur juste valeur en refusant de céder au grand entraÎnement qui poussait vers la terre sainte les rois, princes et seigneurs de son temps. Il préféra le bonheur de ses sujets à une gloire incertaine, s'appliqua à faire régner l'union et la prospérité autour de lui, et paya sa dette à la religion en fondant de nouveaux monastères, en dotant ceux qui existaient déjà, en achevant les constructions commencées, et notamment la cathédrale d'Autun.
Hugues III, son fils, dont le règne commença en 1168, sut moins bien résister à la contagion des exemples ; il guerroya contre les grands vassaux ses voisins, prit la croix en 1178. Rejeté en France par une violente tempête, il revint bâtir la Sainte-Chapelle de Dijon, en accomplissement d'un vœu qu'il avait fait au moment du danger. En 1190, il repartit avec Philippe-Auguste et assista à la prise de Saint-Jean-d'Acre, puis mourut à Tyr en 1192. Avant de quitter la Bourgogne, il avait constitué la commune de Dijon.
Hugues Ill semble revivre dans son fils Eudes III. Aventures lointaines, exploits guerriers, affranchissement des communes caractérisent ce règne comme le précédent. La participation à l'expédition qui plaça Baudouin sur le trône de Constantinople, la croisade contre les Albigeois avec Simon de Montfort, la glorieuse journée de Bouvines en sont les dates les plus éclatantes. Le règne de Hugues IV fut heureusement préparé par l'habile régence de sa mère, Alix de Vergy. Dès qu'il fut majeur, le prince confirma la commune de Dijon ; figura comme un des douze pairs au sacre de Louis IX, ajouta à ses domaines le comté d'Auxonne et fit reconnaître sa suzeraineté sur celui de Mâcon.
Hugues fut un des plus fidèles compagnons de saint Louis ; il partagea ses périls et sa captivité dans la première croisade. Le roi, de son côté, visita plusieurs fois la Bourgogne ; il y laissa de profonds souvenirs de sa sainteté et de sa justice. Hugues, après avoir refusé au pape Innocent IV fugitif un asile dans ses États, eut la faiblesse d'y accueillir, en qualité de. grand inquisiteur, un cordelier, Robert, fanatique et apostat, qui traînait avec lui une femme perdue ; ce ne fut qu'après de nombreuses exécutions et beaucoup de sang répandu que les impostures de ce misérable furent dévoilées. Cet épisode est une tache regrettable dans l'histoire de Hugues IV.
Robert II, troisième fils de Hugues, ne dut la tranquille possession du duché qu'à Philippe le Hardi, qui l'en déclara seul et légitime héritier, contre les prétentions de ses beaux-frères. Jamais liens plus étroits ne rattachèrent la maison de Bourgogne à celle de France. Robert avait épousé Agnès, fille de saint Louis, et il eut pour gendre Philippe de Valois, marié à Jeanne, sa fille, en 1315. L'intimité de ces alliances donnèrent à Robert une grande influence dans la direction des affaires de l'État. Après le mas sacre de s Vêpres siciliennes, il fat chargé d'aller secourir Charles de Naples. Philippe le Bel le nomma grand chambrier de France, gouverneur du Lyonnais, gardien du comté de Bourgogne, et, mission plus délicate, son principal intermédiaire dans ses démêlés avec Boniface VIII.
Quoique chargé de si graves intérêts, Robert ne négligea pas ceux de son duché ; un remaniement des monnaies et d'importants accroissements de territoire classent son règne parmi les plus glorieux de sa dynastie. Il eut neuf enfants, dont plusieurs moururent avant lui ; Hugues V, l'aîné des survivants, eut pour régente, pendant sa minorité, sa mère, Agnès. A peine majeur, il mourut, ne laissant de son règne si court que le souvenir de sa brillante réception comme chevalier, et comme date sanglante, la condamnation des templiers.
Eudes IV, son frère, prit aussitôt possession du duché. Agnès obtint qu'il transigeât avec les prétentions de Louis, son dernier frère, en lui abandonnant le château de Douesme avec une rente de 4 000 livres. A la mort de Louis le Hutin, Eudes, à défaut d'héritier mâle, voulut faire valoir les droits de Jeanne, sa nièce, fille du roi défunt. L'application de la loi salique, réclamée par Philippe le Long, régent du royaume, rendait vaines ses réclamations ; pour le dédommager, Philippe lui donna en mariage, avec 100 000 livres de dot, sa fille aînée, héritière par sa mère des comtés de Bourgogne et d'Artois. L'accord se rétablit, et la confiance royale valut dans la suite à Eudes une influence qu'il justifia par sa sagesse et sa capacité. Il mourut dans cette désastreuse année de laquelle un versificateur du temps a dit :
En trois cent quarante-neuf,
De cent ne demeuroient que neuf.
Son fils aîné était mort trois ans auparavant d'une chute de cheval au siège d'Aiguillon, laissant pour héritier unique son fils, Philippe de Rouvres, âgé de cinq ans. La tutelle fut confiée d'abord à Jeanne de Boulogne, mère du jeune duc, et ensuite au roi Jean, qui épousa la noble veuve. Jean vint à Dijon, en 1350, et il jura publiquement, dans l'église de Saint-Bénigne, de conserver et maintenir les franchises, immunités et privilèges de la province.
Cette période est tout entière remplie par les calamités entraînaient pour la France les envahissements des Anglais ; la Bourgogne n'était pas plus épargnée Châtillon avait été brûlé, Tonnerre pillé, Flavigny était devenu la place d'armes de l'ennemi ; tout le pays étant ou envahi ou menacé, les trois ordres -des deux Bourgognes s'assemblèrent à Beaune, et on vota 200 000 moutons d'or, c'est-à-dire plus de 2 000 000 de livres, somme énorme pour le temps, comme rançon de la province. Ce fut au milieu de ces calamités que Philippe, ayant atteint l'âge fixé pour sa majorité (quinze ans), prit, en 1360, le gouvernement du duché. A peine venait-il de contracter avec Marguerite de Flandre l'union arrêtée depuis longtemps et de ramener son épouse dans son château de Rouvres, près de Dijon, qu'un accident, une chute, mit fin à ses jours, en 1361. Beaucoup d'espérances reposaient sur cette jeune tête ; son coeur semblait animé des plus nobles sentiments : « Il vécut peu, a dit un historien du temps, et fut longtemps regretté ».
Il fut le douzième et dernier duc de-la première race royale, qui avait régné trois cent vingt-neuf ans. Dès que le roi Jean apprit sa mort, il prit possession de ses États, non comme roi de France, mais comme plus proche parent du duc : Ratione proximitatis, non coronae nostrae, hommage éclatant rendu à l'indépendance de la Bourgogne comme État. Après le traité de Brétigny, il se rendit à Dijon, et là, solennellement et officiellement, il unit et incorpora, le duché à la couronne.
Cette annexion, but d'une ambition à courte vue, ne devait point encore être définitive, la pensée de constituer l'unité française était alors encore loin des meilleurs esprits ; le roi Jean, qui avait une prédilection marquée pour Philippe, son quatrième fils, lequel d'ailleurs l'avait vaillamment défendu à la bataille de Poitiers en 1356, et avait partagé sa captivité en Angleterre, lui donna le duché de Bourgogne à titre d'apanage, réversible à la couronne faute d'hoirs mâles, l'institua premier pair de France, dignité dont s'étaient prévalus dans plusieurs occasions les ducs d'Aquitaine et de Normandie.
Philippe, surnommé le Hardi, inaugura donc, en 1363, la seconde dynastie royale des ducs de Bourgogne. Après avoir, selon l'usage, prêté serment de respecter les privilèges provinciaux, il prit possession de ses vastes domaines. Les temps étaient critiques, mais l'occasion de se poser en libérateur n'en était que plus favorable pour quiconque parviendrait à calmer l'orage et à éloigner le péril. Philippe, aidé de Du Guesclin, débuta par purger le pays des bandes indisciplinées de routiers, écorcheurs et malandrins, qui le dévastaient ; il dompta ensuite la terrible Jacquerie, et, déjà renommé par ses exploits militaires, il consolida et agrandit sa puissance par son mariage avec Marguerite de Flandre.
Les départements-(histoire)-Corse - 20 -
Région Corse)
L'histoire de la Corse remonte à la plus haute antiquité. On ne sait pas au juste quels furent ses premiers peuples : les uns ont prétendu que ce furent les Phéniciens ; d'autres, et avec raison selon nous, ont pensé que les premières colonies vinrent des côtes de la Toscane. Quoi qu'il en soit, l'arrivée des Phéniciens en Corse parait être mise hors de doute. On pense même que la ville d'Aléria, Ville très ancienne et dont Hérodote parle, dut être fondée ou agrandie par eux. Plus tard, les Phocéens, accueillis par Harpagus, un des lieutenants de Cyrus, allèrent établir leur domination dans l'île. Mais, au bout de quelques années, ils en furent chassés par les Étrusques qui bâtirent en Corse une ville appelée Nicéa et qui existait encore du temps de Diodore de Sicile.
En 494 de la fondation de Rome, après la conquête de la Sicile, les Romains essayèrent une descente en Corse, ayant à leur tête Cornélius Scipion. Ils s'emparèrent de la ville d'Aléria, mais ils en furent expulsés quelque temps après. Depuis cette époque, les insulaires purent jouir pendant une vingtaine d'années de leur indépendance.
Vers la fin de la seconde décade du VIe siècle de Rome, sous le consulat de C. Licinius Varus et de P. Cornélius Lentulus Claudinus, une guerre nouvelle fut résolue contre la Corse. Marius Claudius, lieutenant de Licinius, partit et ne tarda pas à prendre terre dans l'île. Là, se voyant à la tète d'une armée respectable, il se croit en état de soumettre les insulaires avec lesquels il ne tarda pas à engager le combat. La victoire ne demeura pas longtemps incertaine, et les troupes de Claudinus, assaillies de toutes parts, étaient au moment d'être taillées en pièces, lorsque la présence de Licinius vint mettre la victoire du côté des Romains.
Plus tard, Rome se vit obligée d'entreprendre de nouvelles expéditions contre cette île. Prévoyant que les Corses parviendraient tôt ou tard à secouer le joug de l'étranger et lui feraient toujours subir des pertes considérables, le sénat ordonna, en 590, l'envoi d'une armée consulaire pour les réduire à jamais. Le consul, M. Tarentius Talno, fut placé à la tête de l'expédition. La victoire resta aux Romains, et Talno mérita les honneurs du triomphe. A la suite de cette longue et pénible lutte, la paix g fut enfin conclue, et la Corse cessa d'être indépendante. Marins et Sylla y fondèrent des colonies, et le premier fit bâtir, à l'embouchure du Golo, une ville q ni fut appelée Mariana du nom de son fondateur. Cette époque (de 660 à 673) apparaît comme une des plus brillantes de l'histoire de la Corse.
La Corse, bien que soumise, jouit d'une certaine liberté tant que Rome fut libre ; mais, depuis la dictature de Jules César, elle perdit, comme le reste du monde, le droit de s'administrer elle-même. Elle reçut aussi un préteur ou préside qui représentait le despote de la métropole. Sous l'empire, elle partagea le sort commun. Pendant la domination de Claude, Sénèque le philosophe exilé en Corses fut confiné sur la pointe du Cap-Corse, où il paraît avoir habité une tour qui a conservé son nom. Lors de l'affaiblissement de l'empire et de la résolution de Dioclétien de le partager avec Maximien, l'île de Corse resta sous le gouvernement du premier (202). Elle servit ensuite d'asile, avec la Sicile et la Sardaigne, aux Romains qui fuyaient devant les Goths conduits par Radagaise, et tomba en 457 sous la puissance redoutable de Genséric. Les Vandales exercèrent dans cette île toutes sortes d'atrocités. Ils en furent chassés après une domination de soixante-dix-sept ans. Les Grecs leur succédèrent ; mais ceux-ci furent contraints d'abandonner à leur tour le pays à Totila.
Les exploits de Narsès, qui détruisit la puissance des Goths, firent rentrer la Corse sous la domination impériale. Les habitants furent très malheureux à cette époque. Il y eut un moment où la tyrannie des agents impériaux n'eut plus de bornes. Les insulaires ne pouvaient et ne savaient plus se soustraire aux vexations auxquelles ils étaient en butte qu'en fuyant sur une terre étrangère. Saint Grégoire nous apprend que les Corses, abandonnant en foule leur pays natal, cherchaient un asile sur le continent et demandaient aide et appui aux ducs lombards. Les charges que leur imposaient les Grecs étaient. si énormes qu'ils étaient obligés de vendre leurs enfants pour y satisfaire. Les Sarrasins eurent leur tour en Corse ; mais leur empire ne fut que de courte durée, et c'est ainsi que l'île se trouva comprise dans les stipulations que Pépin fit à l'autorité papale en 754.
Dans la suite, les successeurs de Charlemagne firent donation de l'île à la famille de Boniface, baron de, Toscane. A la mort de l'empereur Hugues, devenu marquis de Toscane par la mort de Lambert, dernier rejeton de la famille illustre de Boniface (928), tous les petits barons ou seigneurs des provinces de l'île devinrent autant de souverains en Corse. Chaque seigneur féodal eut son gouvernement. Le peuple applaudit d'abord à cette mutation dans le pouvoir. Ses illusions et ses espérances le rendirent complice d'une foule d'usurpations qui allaient se commettre en son nom.
En effet, les comtes du pays ne tardèrent pas à s'attaquer réciproquement, chacun nourrissant l'espoir de joindre à son État les possessions de son voisin. Le pays entier fut bientôt en combustion. Tous les liens sociaux se trouvèrent brisés ; la loi n'était plus qu'un vain mot. En cet état de choses, le comte de Cinarca, le plus puissant des seigneurs insulaires, entra en campagne à la tête d'une armée considérable. Il avait conçu le projet d'assujettir tous les barons et de se rendre unique souverain du pays. Au milieu de ces circonstances désastreuses, le peuple fatigué de souffrir prit les armes pour son compte. Il mit à sa tête un homme de génie, Sambacuccio, qui le réunit dans la vallée de Morosaglia, où il fut investi d'une espèce de dictature (en 1005).
Le résultat de cette grande et solennelle assemblée du peuple fut immense. Le chef de la nation corse fit rentrer tout le monde dans l'ordre, proclama l'indépendance des communes et anéantit la féodalité. Sous l'influence de cette révolution, une organisation remarquable se développa dans l'île. Chaque commune ou paroisse nommait un certain nombre de conseillers qui, sous le nom de Pères de commune, étaient chargés de l'administration de la justice sous la direction d'un podestat qui en était comme le président. Les podestats des communes de chacun des États ou districts affranchis élisaient un membre du suprême conseil chargé de faire les lois et règlements. Ce fut le conseil appelé des Douze, du nombre des districts qui concouraient à sa nomination. Enfin, dans chaque État ou district, les pères de commune élisaient un magistrat qui, sous le nom de Caporale, avait mission de défendre les intérêts des pauvres et des faibles et de leur faire rendre justice contre les puissants et les riches.
Cependant cette organisation puissante et libérale ne put préserver les insulaires du joug de l'étranger. Sambacuccio étant mort vers l'année 1012, la discorde divisa de nouveau le pays et répandit partout la perturbation. Le comte de Cinarca profita de ces circonstances pour recommencer ses armements contre les États voisins. Le peuple, en présence d'éventualités aussi terribles se mit sous la protection d'un prince ou seigneur étranger capable de le défendre contre les ennemis. Son choix se porta sur Guillaume, marquis de Massa et de Lunigiana. Guillaume accueillit avec faveur l'offre du peuple corse et, sans perdre de temps, il s'embarqua pour l'île, où il réduisit le comte de Cinarca. Au marquis Guillaume succéda le marquis Hugues, son fils, vers l'année 1020.
Rome qui, depuis Pépin et Charlemagne, avait obtenu la cession de l'île, ne l'avait cependant jamais possédée. A la fin, le saint-siège songea à faire valoir ses droits. On envoya en conséquence un évêque de Pise, nommé Landolphe. C'était sous la pontificat de Grégoire III. Du temps d'Urbain II, l'Église céda à la métropole de Pise, moyennant une redevance annuelle, la souveraineté de la Corse. De cette manière les Pisans devinrent les maîtres. Cette nouvelle domination ne dura pas longtemps, grâce à la haine des Génois pour le gouvernement de Pise.
Après bien des embarras et des tracas suscités par Gênes à la république toscane, l'établissement des Génois en Corse eut lieu d'une manière définitive. Cette défaite éveilla chez les Pisans la plus grande animosité contre les Liguriens. Ils parvinrent à mettre dans leurs intérêts Giudice de Cinarca, qui rétablit leur puissance pour de longues années, mais qui ne put la maintenir contre la trahison. Gênes ayant gagné un des lieutenants de Giudice, devenu aveugle, le malheureux vieillard fut impitoyablement livré à ses ennemis, et Pise perdit en lui le plus grand défenseur de son autorité en Corse.
La souveraineté de l'île revint donc à Gênes en 1347. La possession de la république ligurienne fut inquiétée par deux enfants naturels du comte de Cinarca, André, celui que nous venons de voir mourir aveugle. Guillaume de La Rocca, esprit entreprenant et audacieux, ne manqua pas d'obtenir quelques succès.
Cependant, malgré mille vicissitudes diverses, les Génois ne perdirent pas un instant de vue la Corse. Lorsque le gouvernement de la république fut impuissant à contenir les insulaires, des compagnies songèrent à conquérir l'île pour leur propre compte. C'est ainsi que se succédèrent les deux sociétés de la Maona et de Saint-Georges. Mais les empiétements despotiques des gouverneurs envoyés par ces sociétés, et principalement par celle de Saint-Georges, épuisèrent le pays sous tous les rapports. La cruauté des agents de cette société alla si loin, que les particuliers ne pouvaient plus obtenir réparation d'aucune espèce. La justice se vendait au poids de l'or. De là, l'exercice de cette justice privée qu'on doit souvent excuser, sinon justifier par l'absence de toute justice générale. La terrible vendetta (vengeance) se naturalisa dans l'île et fut considérée par les familles comme l'unique moyen de leur conservation.
Une révolution se fit alors dans les moeurs. Toutes ces iniquités excitèrent dans l'âme noble et élevée de Sampiero, au service de la France sous Henri Il, une haine implacable contre Gênes. Aussi Sampiero profita des faveurs dont il fut l'objet à la cour de ce roi, à la suite de ses glorieux exploits, pour pousser la France à entreprendre la conquête de l'île. Henri II y consentit ; et, en 1547, après les efforts du général de Thermes et de l'héroïque Sampiero, la Corse était reconnue comme possession française. Mais le 7 novembre 1559, François II retira de l'île les forces de la France, malgré les preuves d'attachement qu'avaient données les Corses à leurs nouveaux maîtres.
Sampiero ne perdit pas de vue la cause de sa malheureuse patrie. Ayant foi en sa valeur et en celle de ses compatriotes, il reprit la lutte contre la société de Saint-Georges. Gênes ne tarda pas à ressentir les effets de la présence de Sampiero dans l'île. Étienne Doria fut défait, et les troupes espagnoles venues au secours de la république ne ralentirent en aucune manière les exploits du héros. Et déjà le grand citoyen touchait au terme de sa glorieuse entreprise, lorsque la balle d'un traître vint enlever à la Corse un défenseur illustre et un père bien-aimé.
La peste et la famine suivirent de près ce désastre, et les soldats de Sampiero, privés de leur général, se virent contraints d'aller de- mander l'hospitalité à la cour de France, à la cour de Rome et à la cour d'Espagne. Partout ils trouvèrent bon accueil : Henri IV, principalement, ayant été bien servi par quelques-uns d'entre eux, leur accorda le titre et les droits de citoyen ainsi qu'à tous les Corses qui seraient forcés de chercher un refuge en France. Pendant ce temps, Gênes n'arrêtait pas ses rigueurs. Au contraire, les défaites qu'elle avait éprouvées en combattant contre les Corses, au lieu de ramener le sénat à des sentiments plus doux, à une politique conciliante, avaient si bien exaspéré la république, que les insulaires se voyaient tyrannisés de plus en plus.
Dans cette terrible situation, réduits à l'impuissance par l'épuisement de toutes leurs forces, les habitants de file cherchèrent leur salut... dans un aventurier ! Théodore-Antoine, baron de Newkoff, du comtat de La Marck en Westphalie, ayant promis des secours, les Corses consentirent à l'avoir pour roi, sous le nom de Théodore Ier. Ce personnage, un peu romanesque, ne doit pourtant pas être calomnié. Il avait de l'instruction et appartenait à une famille distinguée dont les membres ont tenu rang dans diverses cours ; il était en outre, courageux, entreprenant, ambitieux, et par là capable de se rendre utile dans la lutte qui se poursuivait entre, les Corses et les Génois.
Théodore établit le siège de son modeste gouvernement à Corte. Il fut aimé de son peuple et se- condé par lui. Mais il eut bientôt à combattre la jalousie des nobles et à lutter contre Gènes, toujours acharnée contre sa proie. Théodore avait fait des promesses : il en put tenir quelques-unes, et les autres exigeaient du temps, entraînaient des lenteurs. Cependant le temps pressait : Gènes tour- mentait de plus en plus les populations avides de sécurité et de repos. Cette situation provoqua, de la part de Théodore, un voyage sur le continent. Afin de mieux garantir les libertés et l'indépendance de son peuple, il alla demander à toutes les puissances et entre autres à la Hollande, les munitions de guerre nécessaires pour délivrer la Corse de la souveraineté de Gênes.
Cette absence un peu trop prolongée éveilla bien des craintes dans l'île ; et les plus chauds partisans de Théodore finirent par porter les vœux douleurs compatriotes un peu partout. Sur ces entrefaites, Gênes venait d'obtenir du cabinet de Versailles une espèce de médiation armée confiée aux soins du comte de Boissieux. La présence de l'envoyé de France fut agréable aux insulaires, persuadés, en général, que le roi leur serait conservé, ou du moins, que les armes françaises n'avaient point pour but de les assujettir de nouveau à la république génoise. Mais les choses changèrent de face, le jour où le comte de Boissieux prit ouvertement parti pour Gènes. La lutte s'engagea presque aussitôt entre les Corses et les Français, et nous devons à la vérité de dire que ceux-ci furent mis par les braves montagnards dans une complète déroute.
La nouvelle de ce désastre inattendu irrita Louis XV. Le comte de Boissieux étant mort, le marquis de Maillebois y fut envoyé pour le remplacer, et on mit sous ses ordres une force armée assez considérable. Maillebois fut plus heureux que son prédécesseur : secondé par un certain nombre de chefs corses et surtout par Hyacinthe Paoli, il soumit enfin l'île. Quoique cette nouvelle domination eût été imposée par la victoire à des patriotes malheureux et épuisés, le gouvernement français aurait été aimé par la très grande majorité des insulaires ; mais la cour de Versailles ne jugea pas à propos de profiter et de jouir de son triomphe. Soit faiblesse, soit complication des affaires extérieures, à la suite de la mort de l'empereur Charles VI, l'ordre fut donné à Maillebois d'évacuer immédiate- ment l'île et de l'abandonner aux Génois (1741). Il en résulta une nouvelle prise de possession de la part de Gènes, représentée par Spinola, et une nouvelle. insurrection de la part des Corses.
Alors un grand homme venait d'arriver en Corse, c'était Pascal Paoli, fils d'Hyacinthe. Simple officier au service du roi de Naples, il résolut d'aller délivrer sa patrie de la tyrannie. Arrivé en Corse, on le proclama général de toutes les forces de la nation. A ce titre, il réunit dans les premiers jours de juillet 1755 une consulte générale, il organisa le gouvernement de l'île et se prépara à la défense. Paoli se montra dès ses premiers actes à la hauteur des circonstances : son génie politique pacifia l'île en quelques années, anéantit la vendetta, unit les chefs des anciens États et éloigna pour toujours du centre de la Corse la maudite domination génoise.
Chose remarquable, le philosophe de Ferney, qui n'a pas toujours été juste pour les Corses, a parlé de Paoli avec admiration : « L'Europe, a-t-il dit, le regardait comme le législateur et le vengeur de sa patrie. Les Corses, ajoute-t-il sur le même sujet, étaient saisis d'un violent enthousiasme pour la liberté, et leur, général avait redoublé cette passion si naturelle, devenue en eux une espèce de fureur. » Nous manquerions à la mémoire de Paoli, si nous ne citions de lui les paroles suivantes : « Il faut que notre administration ressemble à une maison de cristal où chacun puisse voir ce qui s'y passe. Toute obscurité mystérieuse favorise l'arbitraire du pouvoir et entretient la méfiance du peuple. Avec le système que nous suivons, il faudra bien que le mérite se fasse jour, car il est presque impossible que l'intrigue résiste à l'action épurative de nos élections multiples, générales, fréquentes. »
Ces belles paroles montrent bien quel était l'homme qui présidait aux destinées de la Corse vers l'année 1767. Nous devons signaler à cette époque un fait sans importance par rapport à l'histoire générale de la Corse, mais qui mérite d'être remarqué, parce qu'il ne contribua pas peu à la fortune de la famille Bonaparte. En 1767, Charles Bonaparte était secrétaire de Paoli ; il épousa Laetitia Ramolino qui donna le jour deux années après à Napoléon, dont Paoli fut le parrain.
A l'époque de Paoli, l'Europe entière admirait les prodiges de son génie. Le grand Frédéric lui envoya une épée d'honneur dont la lame portait pour inscription : Patria, Libertas ! J.-J. Rousseau écrivait sur l'avenir de cette île célèbre la plus noble prophétie que jamais peuple ait vu réaliser à son profit. Le monde entier avait les yeux sur ce berceau de héros et de grands hommes. Mais que faisait Gênes en ce temps-là ? Expulsée tout à fait de la Corse, menacée presque dans ses murs, grâce aux efforts prodigieux de Paoli, qui non seulement voulut améliorer le pays, mais qui songea à lui créer des forces maritimes, elle supplia la cour de Versailles de venir à son secours ; mais trompée dans son espoir de ce côté, puis humiliée des mille défaites qu'elle avait subies coup sur coup, elle céda enfin à la France ses droits sur une contrée qu'elle ne pouvait plus asservir.
L'offre de Gênes fut acceptée en 1768 (15 mai), et le comte de Marbeuf parut avec une armée sur les côtes d'Ajaccio, pour soumettre tout le pays. La soumission eut lieu, mais non pas sans beaucoup de sang répandu de part et d'autre. Paoli, quoique réduit à des forces très peu considérables et à l'occupation de quelques petits forts sans importance, sut résister au marquis de Chauvelin, qui avait remplacé M. de Marbeuf. M. de Vaux succéda au marquis de Chauvelin ; une action générale fut engagée près de Ponte-Nuovo, et Paoli, poursuivi de près, écrasé par le nombre, ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval. Il se réfugia en Angleterre, royaume auquel il avait voulu soumettre sa patrie.
La Corse reconnut, dès lors, la souveraineté de la France. Paoli parvint, il est vrai, sous la Terreur, à délivrer l'île d'une domination qu'il jugeait nuisible aux intérêts de ses compatriotes, et à la soumettre aux Anglais. Mais ceux-ci furent chassés de l'île, lors de l'invasion de l'Italie par les armées de la République. Telle est, en résumé, l'histoire de la Corse, peuplée encore aujourd'hui par une race d'hommes braves, courageux, intelligents et qui conservent à un très haut degré l'amour de la patrie.
Au nombre des Corses qui furent les premiers à reconnaître les nouveaux dominateurs était un jeune avocat de vingt-trois ans, Charles Bonaparte, descendant d'une famille d'hommes de loi anoblis, d'origine toscane, qui s'étaient établis à Ajaccio, au commencement du XVIIe siècle. Charles Bonaparte était un homme de mœurs douces qui avait épousé une femme célèbre par sa beauté, Laetitia Ramolino. Ils eurent pour fils Napoléon.
Les départements-(histoire)- Corrèze - 19 -
(Région Limousin)
Les peuples qui, avant la conquête romaine, habitaient le territoire dont se compose aujourd'hui le département de la Corrèze étaient les Lemovices ; le nord était cependant Occupé par quelques tribus des Arvernes, tandis qu'au midi les dernières familles des Lémovices se confondaient avec les Petrocorii. Ces tribus vivaient indépendantes sous la direction religieuse des druides, et l'on trouve encore dans la Corrèze des traces de leur ancien culte ; ce sont des peulvens, des dolmens, des tombelles, des pierres branlantes. Le dolmen de Clairrfage est un des plus curieux de ces monuments ; les noms des communes de Pierrefite et de Peyrelevade constatent l'existence d'anciens peulvens.
Lorsque, en l'an 50, les Romains, sous la conduite de Jules César, firent la conquête des Gaules après dix années de combats acharnés, les tribus limousines de la race des Arvernes furent les dernières qui. combattirent pour l'indépendance nationale ; elles ne se soumirent qu'après la défaite et la mort de Vercingétorix le héros de ces contrées, auquel elles avaient envoyé un contingent de dix mille hommes à Alésia. Le pays des Lémovices et celui des Arvernes furent, en effet, ceux dans lesquels les Gaulois purent le mieux défendre leur liberté ; âpres montagnes, torrents, gorges inaccessibles, vastes forêts, tout s'y rencontrait pour en faire un pays admirablement approprié au genre de guerre que les Gaulois faisaient alors ; guerre de surprise et d'embuscade, où ils opposèrent le plus souvent la ruse et l'agilité au nombre et à la tactique.
D'ailleurs, les Lémovices possédaient des forteresses retranchées, et ces oppida sont nombreuses dans le département. Situées pour la plupart sur des sommets élevés, entourées d'un ou de plusieurs fossés et formées d'énormes quartiers de roches brutes disposées en murailles perpendiculaires, elles devaient offrir une retraite assurée contre un ennemi qui ne connaissait que très imparfaitement le pays. La plus curieuse de toutes est celle de Roc-de-Vic, placée sur le cône tronqué d'un mamelon isolé, d'où l'on petit découvrir tous les plateaux à dix lieues à la ronde. Sur des puys secondaires existent autour de l'horizon. des forts plus petits, disposés de façon à communiquer, soit par des feux, soit par d'autres signaux, avec la forteresse principale : on en compte ainsi huit, qui sont : Puy-Chastellux, Puy-de-Fourches, Puy-Chameil,Puy-Sarjani, Puy-de-las-Flours, Puy-Pauliac, Puy-du-Sault et Puy-Bernère.
Une fois maîtres du pays, les Romains ne s'y établirent pas d'abord aussi complètement que dans les riches plaines de la Loire, de la Seine et du Rhône ; ils se contentèrent de l'occuper militairement à l'aide de quelques postes fortifiés et de camps retranchés, dont on reconnaît encore les traces, et peut-être ne firent-ils qu'occuper, en perfectionnant les moyens de défense, les anciens ouvrages fortifiés des vaincus.
Quelques-unes de ces positions militaires, plus favorablement placées sur les voies romaines qui couvrirent bientôt le pays de leur réseau, ou dans leur voisinage, devinrent parla suite des centres de population ; telle fut, par exemple, l'origine de Masseret, d'Uzerche, d'Yssandon, d'Ussel et de Tintigtnac. Le savant Baluze a cru reconnaître dans cette dernière la Rastiatum de Ptolémée. Il paraît certain que ce lieu a été une station romaine. Les noms des villages environnants sont latins : Césarin, Bach, Montjove, etc. Baluze reconnaît de son temps, à Tintignac, l'existence de ruines ayant. l'apparence d'un ancien amphithéâtre, et, dans le pays, le lieu où il les vit se nomme encore les Arènes. Si à ces traces du séjour des Romains nous ajoutons deux ou trois tours ruinées, des restes de voies militaires, des aqueducs souterrains, quelques bustes mutilés, des tronçons de statues, un aigle colossal en granit, des vases, des urnes, des médailles, etc., nous aurons complété le catalogue des antiquités romaines du département de la Corrèze.
Les Romains avaient compris le pays dans la première Aquitaine ; ils y dominèrent pendant cinq siècles ; l'événement le plus important pendant cette longue période fut la prédication de l'Évangile, qui vint consoler les populations vaincues et leur donner la patience et l'espérance d'un avenir meilleur. Si nous en croyons les écrivains ecclésiastiques, ce serait saint Martial qui aurait été l'apôtre du Limousin. Une ancienne tradition veut même qu'il ait séjourné à Uzerche, à La Grafouillère, à Tulle, et il aurait fait dans cette dernière ville plusieurs conversions et des miracles.
Le séjour de saint Martial à Tulle est, pour les historiens du pays, un fait au moins douteux : « Tulle, disent ils, n'existait pas encore et ne fut fondée qu'à une époque bien plus éloignée » (Marvaud, Histoire du bas Limousin). Peut-être doit-on concilier l'histoire avec la tradition, en rapportant à Tintignac ou Rastiatum, lieu voisin de Tulle, les faits que la légende religieuse place à Tulle.
Quoi qu'il en soit, après la mission de saint Martial, le nombre des chrétiens alfa toujours en augmentant, malgré les persécutions ordonnées par les empereurs romains et pendant lesquelles eut lieu le martyre de saint Ferréol, évêques de Limoges ; de sainte Fortunée, qui, selon la tradition, a donné son nom au bourg de Sainte-Fortunade, où elle reçut la mort. Vers le ive siècle, saint Martin parcourut aussi le bas Limousin ; il prêcha le christianisme à Brive, qui était déjà une ville importante, et il y reçut la palme du martyre. Les premières églises qui furent élevées dans le pays furent consacrées à saint Martial et à saint Martin, que l'on regardait comme les apôtres de la contrée.
Lors de l'invasion, des barbares, les Vandales et les Alains ravagèrent le pays, brûlant les' églises et les villes. Après eux vinrent les Wisigoths ; ceux-ci s'emparèrent de l'Aquitaine, et leur domination s'étendit sur la région. qui forme aujourd'hui le département de la Corrèze ; elle fat assez douce pour les Gallo-Romains, qui s'inquiétèrent peu d'abord de voir les lourds impôts dont on les accablait passer des mains des empereurs à celles d'un maître barbare. Mais les Wisigoths étaient ariens ; ils persécutèrent donc l'Église d'Aquitaine. Les prêtres du bas Limousin joignirent sans doute leurs prières à celles des évêques auprès de Clovis, et celui-ci, à la suite de la grande victoire de Vouillé, en 507, mit un terme à leurs exactions en s'emparant de la contrée. Les Francs s'avancèrent dans l'Aquitaine en trois colonnes ; l'une d'elles, qui était commandée par Thierry, fils aîné de Clovis, et qui fut dirigée vers Narbonne et la Septimanie, traversa le pays dont nous esquissons ici l'histoire.
A l'époque du partage de la monarchie franque, le pays de la Corrèze fil partie du royaume de Paris, qui eut Caribert pour roi ; puis, à la mort de celui-ci, il passa sous la domination de Childéric, roi de Soissons. Quelque temps après, le Limousin fit cause commune avec le reste du Midi, qui voulut se donner pour roi un fils naturel de Clotaire Ier, nommé Gondowald. Ce fut, dit-on, à Brive même que ses soldats l'élevèrent sur. le pavois, en 584. Mais, quelque temps après, il fut assassiné près de Saint-Bertrand-de-Comminges. Ses soldats n'avaient pas respecté l'église de Saint-Martin, et y avaient mis le feu, Ce malheureux pays du bas Limousin fut encore ravagé une première fois par les Sarrasins et pendant la guerre d'indépendance de l'Aquitaine que Hunald et Waïfre, les descendants de Caribert, fils de Dagobert, soutinrent de 760 à 770 contre Pépin le Bref et Charlemagne ; plusieurs combats furent même livrés dans les environs d'Yssandon, d'Allassac et de Turenne.
Charlemagne, vainqueur de Waïfre, établit dans le Limousin des comtes ou gouverneurs, tige des grandes maisons féodales, des vicomtes de Ségur, de Tulle, de Turenne, de Comborn et de Ventadour. La Corrèze fit à cette époque partie du royaume d'Aquitaine, que constitua pour son fils l'illustre fondateur de la dynastie carlovingienne. Il avait encore traversé le pays en se rendant sur les frontières d'Espagne, en 774, et, témoin des désastres qu'avaient occasionnés les guerres précédentes, il s'efforça de cicatriser les plaies et de relever les ruines. L'église d'Uzerche conserve encore deux reliquaires qu'on attribue à la munificence de ce prince.
La tradition veut aussi que son neveu, le célèbre Roland, ait donné à la chapelle de Notre-Dame-de-Rocamadour une somme d'argent d'un poids égal à celui de son invincible épée. Cette arme terrible y fuit, dit-on, déposée après sa mort, contrairement à la poétique légende qui représente Roland brisant avant d'expirer la fameuse Durandal, au milieu des rochers de Roncevaux. La tradition locale explique par un hasard des guerres suivantes la porte de la précieuse relique et son remplacement par cette misse de fer qu'on montre aux pèlerins sous le nom de sabre de Roland.
On raconte encore que Charlemagne, dans une des tournées d'exploration qu'il fit pour établir dans les pays d'outre-Loire une administration vigilante et réparatrice, s'arrêta dans sa résidence royale de Jucundiacum, Joac, près de Limoges, et vint, dit le cartulaire de Charroux, chercher une distraction à ses grands travaux dans une villa du comte Roger. Il y rencontra un gentil homme breton qui rapportait de Jérusalem un morceau de la vraie croix. Le pèlerin consentit, sur la demande du monarque, à déposer dans ce même lieu cette relique sainte.
Charles y fit construire aussitôt un monastère qu'il affranchit de toute juridiction épiscopale et laïque, suivant des lettres patentes approuvées et confirmées par le pape Léon III. Le comte de Limoges plaça dans le nouvel établissement douze religieux sous la direction de David, qui en fut le premier abbé, et leur donna, par testament, plusieurs terres ainsi que le château et le couvent de Saint-Angel. Ce dernier cloître, situé à huit kilo mètres d'Ussel, dans le bas Limousin, avait été fondé vers 798 par Roger et son épouse Euphrasie, qui lui donnèrent les châtellenies de Saint-Angel et de Nontron, et y établirent douze moines avec un prieur qui devait comparaître en personne au chapitre général de Charroux. Le couvent de Saint-Angel demeura, jusqu'au XIIIe siècle, sous la protection des seigneurs de Mirabel, qui transmirent leurs biens et leurs privilèges aux seigneurs de Champiers. Ceux-ci les léguèrent à Guérin de Valon, à la charge par lui de prendre les titres et armes des maisons de Champiers et du Boucheron, qui avaient une origine commune. Les seigneurs de Champiers et leurs héritiers rendirent jusqu'au XVIe siècle foi et hommage à l'abbé de Charroux, pour le château de Saint-Angel, situé à quelque distance de l'abbaye de ce nom. En 1616, l'évêque de Limoges, François de La Fayette, céda an cardinal de Bouillon le prieuré de Saint-Angel, qui fut réuni quelque temps après à la congrégation des bénédictins de Saint-Maur.
Grand nombre de nobles personnages des environs furent inhumés dans ce monastère ou lui léguèrent de pieuses fondations. De ce nombre furent Ebles de Ventadour, Bernard, abbé de Tulle ; Guillaume de Lastours, Aymeric Gilbert ; Jourdain, abbé de Charroux ; Isabelle de Correlas, dame de Châteauvert, Charlotte de Rochefort, Aymeric et Geoffroy de Rochefort, Albon de La Châtre et plusieurs seigneurs de Champiers.
Parmi les donations que firent les comtes de Limoges à l'abbaye de Charroux, on cite le prieuré de Colonges (Leolenum), auquel les seigneurs de Turenne, de Curemonte, firent de grandes concessions, soit pour participer aux revenus de ce monastère, soit aussi pour affaiblir les droits de suzeraineté des comtes de Limoges, dont ils supportaient difficilement l'autorité.
Cependant l'ordre rétabli par la main puissante de Charlemagne ne tarda pas, après sa mort, à être troublé de nouveau. L'établissement d'une nationalité indépendante était une chimère que poursuivaient les Aquitains avec une persévérance déplorable. Pépin Il, leur roi, recommença la lutte. Charles le Chauve fut obligé de venir le combattre ; il assiégea le château de Turenne et s'en empara. Ces dissensions amenèrent dans le pays titi ennemi plus redoutable encore ; les Normands envahirent et ravagèrent le Limousin, y détruisirent plusieurs établissements religieux et tic se retirèrent qu'après une sanglante bataille gagnée sur eux par Raoul de Bourgogne, dans les environs de Beaulieu. Au milieu de ces déchirements, Eudes, le célèbre comte de Paris, essaya pour le bas Limousin d'une organisation nouvelle ; il créa un vicomte chargé d'administrer le pays et d'y rendre la justice et revêtit de cet emploi Adhémar d'Escals, qui résidait le plus ordinairement à Tulle.
A peine délivré par Raoul de Bourgogne des pillages et des ravages des Normands, le pays de la Corrèze fut en proie à de nouveaux troubles, à l'avènement des Capétiens ; le couronnement de la féodalité dans la personne de Hugues devait être, en effet, un fatal exemple pour les grands vassaux d'Aquitaine. Les comtes de Toulouse et de Poitiers, ayant des droits égaux, se crurent appelés aux mêmes destinées que les comtes de Paris ; ils associèrent à leurs ambitieuses menées les vicomtes de Turenne, de Combora et de Ventadour, les seigneurs de Gimel, de La Roche-Canillac et tous ceux qui avaient quelque force ou quelque influence dans la contrée.
L'autorité royale y demeura complètement méconnue jusqu'au mariage d'Éléonore avec Louis le Jeune. Le Limousin faisait partie de la dot de la riche héritière ; on sait quelles funestes conséquences entraînèrent son divorce avec le roi de France et son second mariage avec un prince anglais. Le Limousin fut une des provinces où la lutte fut le plus acharnée. La grande guerre entre les rois de France et d'Angleterre s'y compliqua souvent de déchirements intérieurs, de séditions pour des causes locales ; c'est ainsi que la sédition du guerrier troubadour Bertrand de Born, seigneur de Hautefort, et la révolte des fils de Henri contre leur père se détachent comme de sanglants épisodes sur le tableau déjà si sombre de cette époque. Le peuple payait les fautes des seigneurs ; Henri II et Richard Coeur de Lion, qui lui était resté fidèle et soumis, ravagèrent impitoyablement les campagnes où les rebelles avaient trouvé ressources et assistance ; d'autres calamités naquirent de celles-là.
Les bandes de mercenaires amenées dans le pays par les princes, les routiers, les Brabançons, finirent par vouloir faire pour leur propre compte le métier que leurs nobles maîtres leur avaient enseigné ; ils se mirent à saccager villes et bourgs, à piller églises et châteaux, à tuer ou rançonner prêtres, bourgeois et vilains. Yssandon, Ussel et Treignac furent les principaux théâtres de leurs exploits. Il fallut que le pays se levât en masse pour se délivrer de ce fléau. L'évêque Gérard se mit à la tête des citoyens d'Uzerche et de Brive ; sous lui marchaient Adhémar, vicomte de Limoges, Archambaud V de Comborn, Olivier de Lastours. Ils attaquèrent les routiers dans les plaines de Malemort et leur tuèrent 2 500 hommes dans un combat qui dura six heures. Après cette rude épreuve, le Limousin eut quelques années de paix. L'ardeur de sa noblesse se tourna vers les croisades. Ce fuit une nouvelle source de gloire et d'illustration pour les maisons de Turenne, de Noailles, de Ségur, de Lastours, de Curemonte, de Gimel, etc.
Sous le règne de Philippe de Valois, la guerre se ranima contre les Anglais et prit, dans le Limousin, un caractère de nationalité qu'elle n'avait point eu jusqu'alors. Le roi de France visita Brive en 1335 ; il veilla par lui-même à ce que les murailles des villes fussent mises en bon état de défense. C'est à cette époque que se rattachent la délivrance de Tulle par le comte d'Armagnac et l'institution de la cérémonie commémorative connue sous le nom de fête de Saint-Léger. La bataille de Poitiers et le traité de Brétigny replacèrent le Limousin sous la domination anglaise ; mais l'acharnement de la dernière lutte pouvait déjà faire pressentir l'expulsion prochaine de l'étranger. Un seul chef anglais nommé Lebret avait été obligé d'assiéger et de prendre quatre fois Ussel, qui parvenait toujours à se délivrer de ses vainqueurs.
Sous Charles V, Du Guesclin vint attaquer les Anglais dans le Limousin ; il les tint assiégés à leur tour dans Ussel, les chassa de la vicomté de Ségur et aida la population de Tulle à se débarrasser, en 1371, de la garnison que le prince de Galles avait mise dans cette ville ; mais, en 1374, Brive rouvrit ses portes aux Anglais. Assiégée et prise par le duc d'Anjou, elle expia sa trahison par le supplice de ses principaux magistrats, près de la porte même qui avait livré passage à l'ennemi. Brive ne tarda pas à se réhabiliter, en chassant les détachements anglais qui occupaient les châteaux de Bar, de Saint-Jal, d'Affieux et de Saint-Bonnet.
Malgré les vicissitudes du triste règne de Charles VI, l'Anglais n'eut plus que des succès précaires en Limousin ; Charles VII leur enleva sans grande peine toutes leurs positions ; la dernière fut le château de Saint-Exupéry, près d'Ussel. Le monarque victorieux vint visiter le Limousin en 1441 ; il passa à Tulle les fêtes de Pâques de celle année. L'importance toute nouvelle que prit alors le pou voir royal rattacha plus étroitement les provinces délivrées à la patrie commune et amoindrit l'influence de cette noblesse limousine, dont les dissensions et les rivalités avaient tant aggravé les maux des siècles précédents.
La ligue du Bien public, effort suprême de la féodalité mourante, ne trouva pas d'adhérents parmi les seigneurs du Limousin. Louis XI s'était montré dans le pays ; il y avait organisé les assises et avait séjourné à Rocamadour, à Brive, à Donzenac et à Uzerche. Plusieurs invasions de la peste signalent seules les règnes de Charles VIII et de François Ier. C'est sous Henri Il que se révèlent les premiers symptômes de la crise religieuse. Les rigueurs de M. de Lestang, lieutenant général au siège de Brive, déterminèrent l'explosion. La guerre civile éclata ; les protestants trouvèrent surtout des adeptes dans la vicomté de Turenne, à Arcrentat et à Beaulieu. Les chefs les plus illustrés se mirent à la tête des révoltés. Henri de La Tour, duc de Bouillon et vicomte de Turenne, dont l'influence était souveraine dans la province, y attira Biron, Coligny et Henri IV.
Après la bataille de Jarnac, l'armée protestante vint prendre ses campements en Limousin ; une partie occupa Lubersac, Juillac et Saint-Bonnet ; une autre partie, Faye-la-Vincuse et les environs d'Ussel. Les hostilités partielles, les rencontres continuelles de partisans dupèrent pendant tout le règne de HenriIII. Le repos ne fut rendu à cette malheureuse contrée qu'après l'avènement de Henri IV au trône de France et après la réunion de la vicomté de Limoges à la couronne. Les luttes religieuses et la guerre civile du XVIe siècle avaient réveillé les prétentions féodales. Les agitations de la Ligue étaient à peine apaisées qu'une nouvelle levée de boucliers se préparait en Limousin au commencement du règne de Louis XIII. Le protestantisme servit encore de prétexte à la noblesse mécontente ; une révolte éclata à Beaulieu. en 1628, et les religieux de l'abbaye furent chassés. Richelieu comprima cette impuissante tentative ; mais à sa mort, pendant la minorité de Louis XIV, c'est encore dans le Limousin que se nouèrent les premières intrigues de la Fronde.
La femme du prince de Condé réunit à Turenne, en 1648, les partisans des princes, et le duc de Bouillon chercha à s'emparer de Brive. Il échoua comme ses complices ailleurs ; Louis XIV grandit, et ce fut pour achever la ruine de la féodalité. Il semblait que, sous ce rapport, rien ne restât à faire à son successeur ; Louis XV porta cependant encore un dernier coup, plus sanglant peut-être quo tous les autres, au prestige de la noblesse limousine. Après avoir acheté et réuni à la couronne cette vieille et glorieuse vicomté de Turenne, il obtint du duc de Choiseul, en 1751, en échange de la baronnie d'Amboise, la terre de Pompadour, et il la donna à Antoinette Poisson, sa maîtresse, qui prit le titre de marquise de Pompadour. Triste et cruelle façon de combler les vides faits dans les rangs des Turenne. des Noailles, des Curemonte et des Lastours.
Le manoir des anciens barons, devenu le palais d'une favorite, est aujourd'hui titi haras, un dépôt d'étalons destinés à l'amélioration de la race chevaline en Limousin. Au moins, dans sa nouvelle destination, est-il encore utile au pays en y attirant le commerce, la spéculation, les affaires. Une autre création du XVIIe siècle fait, comme celle-ci, vivre aujourd'hui bien des familles en même temps qu'elle est l'objet d'un légitime orgueil pour Tulle et pour le département de la Corrèze ; c'est la fabrique d'armes que les frères Pamphile établirent à Souillac, près de Tulle, et qui fut érigée en manufacture royale sous le règne de Louis XVI, en 1778.
Les événements de la Révolution n'eurent pas de grand retentissement au milieu des montagnes et des sauvages vallées de la Corrèze ; le décret qui organisait le département et faisait de Tulle le chef-lieu du département excita bien un instant la jalousie de Brive, qui se croyait des droits à la représentation du bas Limousin. Depuis, ni les révolutions de 1830 et de 1848, ni la fatale guerre de 1870 et de 1871 ne sont venues distraire les laborieux et patients habitants du département de la Corrèze des travaux d'agriculture qui forment leur principale source de richesse et de bien-être.
Le département de la Corrèze a eu l'honneur de donner à l'Église catholique plusieurs papes : Pierre Roger, pape d'Avignon de 1342 à 1352, sous le nom de Clément VI ; Étienne Aubert, élu pape en 1352, sous le nom d'Innocent VI, et le neveu de Clément VI, intronisé en 1370, sous le nom de Grégoire XI ; c'est de ce même département que les familles de Comborn, Lévi, Ventadour, Noailles, Ségur et Turenne, que nous trouvons citées à chacune des pages de nos annales, tirent leur origine. C'est aussi la patrie d'un grand nombre d'hommes distingués à divers titres, parmi lesquels nous citerons : le savant Étienne Baluze ; les littérateurs Marmontel, Cabanis et Féletz ; les jurisconsultes Treilhard et Sirey ; le savant agronome de Lasteyrie ; le naturaliste Latreille ; l'infortuné maréchal Brune ; et cet homme que poursuivra toujours l'inexorable justice de l'histoire, le cardinal Dubois.
Les départements-(histoire)- Cher - 18 -
Partie 2
Lorsque la funeste rivalité des Armagnacs et des Bourguignons eut éclaté au commencement du XVe siècle, le haut Berry, qui compose le département du Cher, fut le théâtre de grands événements. Jean, duc de Berry, alors fort âgé, ayant pris parti pour le duc d'Orléans, concentra à Bourges toutes ses forces militaires, et tint garnison dans toutes les places fortes du pays. Alors Jean sans Peur, duc de Bourgogne, sous prétexte de faire respecter l'autorité royale, amena l'infortuné Charles VI à la tête d'une armée considérable pour soumettre le duché.
Après avoir pris les villes de Montfaucon et de Dun-le-Roi, les châteaux de Beaugy, de Fontenay et plusieurs autres, il arriva devant Bourges en juin 1412 et en fit le siège, qui dura jusqu'au mois d'octobre suivant. Alors les deux partis s'accordèrent, au grand déplaisir des Anglais, qui comptaient profiter de cette triste rivalité pour s'emparer de la province. Le duc Jean étant mort sans enfants mâles en 1416, le Berry retourna à la couronne, mais non pour longtemps ; Charles VI le donna d'abord au troisième de ses fils et ensuite au quatrième, qui fut depuis le roi Charles VII. Ce prince fit de Bourges son séjour ordinaire et conserva même, étant dauphin, le Berry, qui fut son asile et le centre de ses possessions. A la mort de son père, en 1422, le roi de Bourges, comme l'appelaient par dérision les Anglais, se mit en devoir de recouvrer l'héritage de ses aïeux. Les barons du Berry demeurèrent, en cette occasion, loyalement dans son parti et contribuèrent puissamment au rétablissement de son autorité.
Charles VII affectionna toujours le Berry et y mourut en 1461, au château de Mehun-sur-Yèvre, sa résidence favorite, des soucis que lui causait la mauvaise conduite de son fils, le dauphin Louis. L'année même de sa mort, il l'avait donné le Berry en apanage à son second fils Charles. Ce prince, qui, à l'avènement de Louis XI, avait à peine seize ans, était d'une grande faiblesse de caractère ; il s'ennuyait à la cour de son frère, sérieuse et économe, de laquelle avaient disparu les somptueux banquets, les bals et les tournois qui, au temps du roi Charles VII, répandaient la richesse et la joie dans les campagnes du Berry ; il se laissa entraîner dans la révolte que les princes et seigneurs ourdirent contre Louis XI, sous prétexte du bien public.
Louis déploya beaucoup d'activité dans ce moment critique et vint lui-même en Berry à la tète d'une vingtaine de mille hommes ; il soumit successivement les villes et les châteaux du pays, mais il échoua devant Bourges et ne put s'emparer de la Grosse-Tour. On sait comment se termina cette ligue du Bien publie les traités de Saint-Maur et Conflans, qui, en 1465, suivirent la bataille de Montlhéry, satisfirent momentanément l'ambition et la rapacité des seigneurs. Charles reçut un autre apanage, et le Berry rentra encore une fois aux mains de la royauté, à laquelle il fut fidèle. Louis XI constitua cependant cette province tour à tour en apanage pour François son troisième fils, qui mourut jeune, et pour sa seconde fille, Jeanne, qu'il avait mariée à Louis d'Orléans. Lorsque ce dernier parvint à la couronne sous le nom de Louis XII, en 1498, il répudia Jeanne et dut lui restituer son domaine du Berry, où elle se retira, pratiquant les bonnes œuvres et répandant autour d'elle les bienfaits de la charité la plus sincère ; elle mourut en 1504, après avoir fondé l'ordre des religieuses Annonciades. Elle fut dans la suite béatifiée sous le nom de sainte Jeanne de Valois. Elle était petite, contrefaite, niais d'une grande douceur de caractère et d'une éducation aussi solide que variée.
Après la mort de cette princesse, le duché de Berry étant encore retourné à la couronne, le roi François Ier en donna l'usufruit, l'an 1527, à sa soeur Marguerite de Valois, épouse de Philibert-Emmanuel de Savoie, et qui mourut en 1574. Cette femme célèbre, l'un des plus beaux esprits de son siècle, et que son frère chérissait et qualifiait de Marguerite des Marguerites, fut la protectrice de Calvin, qui étudiait alors dans la célèbre université que le saint roi Louis IX avait créée à Bourges. A l'aide de la faveur dont il jouissait, il essaya, avec succès, de répandre ses idées réformatrices dans le village d'Asnières et dans la petite ville de Lignières ; enhardi bientôt par le succès, il s'avança jusqu'à Sancerre et essaya de gagner à la cause dont il se faisait l'apôtre les habitants de cette importante cité ; cette fois, le clergé s'émut, de vives remontrances furent faites aux magistrats, et bientôt il fallut que Calvin quittât la province ; il laissait derrière lui des germes nombreux de sa doctrine.
Ce ne fut qu'en 1561 que, pour la première fois, un prêche fut ouvert à Bourges ; les protestants n'y étaient pas encore les plus forts ; en mai 1561, lorsque le massacre de Vassy eut donné le funèbre signal de ces guerres civiles, dites de religion, les calvinistes, réunis en nombre dans les villes voisines, marchèrent sur Bourges, sous la conduite du comte de Montgomery s'emparèrent de la ville et la saccagèrent. Alors furent commises bien des profanations sacrilèges ; les églises et les monastères furent pillés, on dispersa les prêtres et les moines, et, lorsque les victimes humaines vinrent à manquer, les fanatiques s'en prirent aux tombeaux : les cendres de saint Ursin, l'apôtre du Berry, furent jetées au vent, ainsi que celles de sainte Jeanne de France.
Maîtres de Bourges, les calvinistes se répandirent dans les campagnes, ravageant les prieurés et les monastères, pillant les églises et incendiant les châteaux de la noblesse catholique. Il fallut que le duc de Guise en personne et le maréchal de Saint-André accourussent protéger le haut Berry. Bourges fut assiégée, tint quinze jours et se rendit. Rappelé sur les bords de la Loire, le duc de Guise abandonna le pays, et bientôt la guerre civile recommença avec toutes ses misères et ses excès.
Le Berry et plus particulièrement les pays qui composent le département du Cher se partagèrent en deux camps : Bourges fut le centre des catholiques, Sancerre devint la principale place d'armes des protestants. Cette guerre impie dura pendant les règnes de Charles IX et de Henri III (de 1560 à 1589). La Saint-Barthélemy eut, en août 1572, un funeste retentissement à Bourges ; malgré les efforts des catholiques les plus modérés, de grands massacres eurent lieu ; mais, proportion gardée, ils ne furent pas aussi multipliés que ceux qui avaient ensanglanté Paris. Quelques victimes purent s'échapper ; entre autres les jurisconsultes Hugues Doneau et François Hotman, qui parvinrent à gagner Genève.
Dès l'an 1568, et à l'imitation de la ville de Péronne et des autres villes du nord de la France, une ligue catholique s'était formée à Bourges pour défendre la religion catholique ; l'archevêque en fut le chef. Dès que la but de cette association fui connu, de toutes parts les communes et les bourgs du Berry voulurent s'y associer ; cependant quelques-uns restèrent fidèles aux prêches calvinistes ; d'autres furent tenus dans l'indécision par la conduite irrésolue et cauteleuse de Henri III. Mais lorsque ce malheureux prince fut tombé, en 1589, sous le couteau de Jacques Clément, le Berry se partagea en deux camps bien distincts : le sire de La Châtre, gouverneur de la province, tint pour la Ligue, ainsi que les villes de Bourges, de Dun-le-Roi, de Mehun-sur-Yèvre et de Vierzon ; tandis que le comte de La Grange-Montigny, les seigneurs de Gamaches, d'Arquian, de Marcilly et autres prirent le parti de Henri IV, ainsi que les villes de Sancerre et d'Issoudun, où ils se fortifièrent.
Pendant cinq années, le pays fut complètement ravagé ; les barons assouvirent les uns contre les autres leurs haines réciproques, détruisant les récoltes des fiefs de leurs rivaux, brûlaient les villages et ruinant les châteaux. C'est surtout de cette époque que date la destruction des forteresses féodales dont les ruines couronnent d'une manière si pittoresque les coltines, ou qui se cachent au fond des plaines, mirant leurs débris moussus et couverts de lierre dans les eaux qui jadis en défendaient les approches. Le jeune duc de Guise, fils du Balafré, vint en 1591 chercher un asile dans le Berry, après s'être échappé de prison ; le baron de La Châtre le reçut magnifiquement, et sa présence, qui dura plus d'un mois, servit à fortifier son parti.
Cependant l'archevêque Regnault, que l'on avait forcé de jurer fidélité à la Ligue, était parvenu à s'évader ; il rejoignit Henri IV, lui fit sa soumission, et ses sages conseils contribuèrent puissamment à faire rentrer le roi dans le giron de l'Église catholique. Ce fut entre ses mains qu'en 1594 Henri IV fit son abjuration à Saint-Denis. Cet événement dut nécessairement modifier la position des partis dans les pays qui composent le département du Cher, et la plupart des barons se soumirent individuellement à Henri IV. Le sire de La Châtre, qui était à la fois gouverneur de Bourges et d'Orléans pour la Ligue, traita avec le roi et lui remit les clefs de ces villes, moyennant huit cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents livres.
Sous la sage administration de ce prince, le Berry jouit d'un repos dont il avait bien besoin. Henri IV affecta les revenus de cette province à l'entretien de Louise de Lorraine, veuve de Henri III. A la mort de cette princesse, en 1601, le Berry fit de nouveau retour à la couronne, et le roi en donna le gouvernement à Henri de Bourbon, prince de Condé. Le sage et intègre Sully contribua, à cette époque, à cicatriser les plaies de la guerre civile dans ce beau pays ; il y possédait les terres de Mont-Rond, de Montfaucon et d'Henrichemont ; il fit accorder quelques indemnités à ceux des habitants des campagnes qui avaient le plus souffert.
Les troubles de la minorité de Louis XIII devaient replonger le Berry dans l'anarchie. La reine mère, Marie de Médicis, avant fait arrêter Condé au Louvre, une certaine agitation se manifesta dans la province où ce prince était fort aimé. Le sire de La Grange-Montigny, le vieux capitaine ligueur, que l'on venait de récompenser en lui donnant le bâton de maréchal, fut chargé de reprendre successivement, à la tête d'une armée royale, les places qui tenaient pour le prince ; il en vint à bout presque sans coup férir ; cependant la Grosse-Tour de Bourges, qui avait bonne garnison dévouée au prince de Condé, résista d'abord ; mais ce fut en vain ; le Berry resta définitivement dans l'obéissance royale.
Après quelques années d'une prospérité que rien ne vint troubler, sous la sévère administration de Richelieu, ce pays vit, sous la Fronde, se renouveler ces cruelles alternatives de misère et de désolation que la guerre civile faisait peser sur lui. Le grand Condé, ancien élève du collège de Bourges, avait succédé à son père dans le gouvernement du Berry ; il devint suspect à la reine mère Anne d'Autriche, et à Mazarin, qui, au nom de Louis XIV, enfant, régnait sur la France ; il fallut l'arrêter. Les troupes royales entrèrent à cette occasion dans la province, pour y tenir en respect la noblesse, à cause de son attachement à la maison de Bourbon. Il se forma alors deux partis qui se tinrent en échec dans le pays. Le prince de Condé, à sa sortie de prison, chercha à ressaisir son gouvernement ; il leva des troupes dans quelques cantons du Berry ; n'ayant pu détacher Bourges du parti du roi, il établit ses ligues depuis le château de Mont-Rond, dont il avait fait sa place d'armes, jusqu'à Sancerre. La guerre, qui du reste ne se fit que par surprises et escarmouches, ne dura que quelques mois ; force resta à l'autorité royale.
C'est alors que furent détruites les forteresses féodales qui étaient restées debout après les guerres de religion ; les châteaux de Mont-Rond, de Beaugy furent démantelés ; la Grosse-Tour de Bourges, l'orgueil de celte vieille cité, fut rasée et ses matériaux employés à la construction d'un hôpital Sous l'administration éclairée de Colbert, les campagnes du Cher redevinrent calmes et prospères mais les habitants eurent plus d'une fois à gémir des taxes et des impôts extraordinaires que nécessitaient les grandes guerres de Louis XIV.
Colbert avait acquis dans le pays les terres de Lignières, de Bois-sire-Aimé et de Châteauneuf. Louis XIV et les rois qui lui succédèrent donnèrent plusieurs fois le Berry en apanage à des princes de la famille royale ; mais cette province n'eut aucun rapport avec ces différents princes apanagistes, qui n'en portèrent que le nom ; elle fat administrée jusqu'en 1789 par des gouverneurs royaux. Bien qu'ils changeassent trop souvent pour le bonheur et la tranquillité des campagnes, cependant rien d'important ne signala leur administration. Louis XVI, qui méditait d'utiles réformes, choisit, en 1778, cette paisible province pour y faire l'essai d'une administration provinciale, qui fut appliquée en grand à toutes les provinces de la France en 1787. La direction des affaires de la contrée fut confiée à une assemblée provinciale, composée de quarante huit membres, douze de la noblesse, douze du clergé et vingt-quatre du tiers état. Sous cette administration d'essai, d'utiles réformes, que la marche des idées avait rendues nécessaires, furent entreprises. En 1790, un nouveau changement eut lieu, et les administrations provinciales furent remplacées par les administrations départementales.
Le département du Cher fut alors formé du haut Berry (690 410 hectares) et de quelques portions du Bourbonnais (29 333 hectares). Pendant la Révolution, il fut entraîné dans le mouvement général ; cependant les anciennes populations du Berry, fidèles et religieuses, ne se laissèrent pas gagner aux excès qui signalèrent cette époque de notre histoire ; il y eut bien, en 1196, une tentative de chouannerie ; Phélippeaux et quelques royalistes cherchèrent à soulever les départements du Centre, la Loiret, l'Indre, la Nièvre et le Cher ; mais le Directoire envoya sur les lieux les généraux Desanfants et Chezin, (lui eurent bientôt rétabli la tranquillité. Avec elle, le département du Cher vit, pendant le Consulat et l'Empire, son antique prospérité renaître ; quelques grands travaux d'utilité publique furent entrepris, et pour la première fois des voies de communication s'ouvrirent au centre de ces contrées, que quelque temps auparavant Mirabeau avait qualifiées de Sibérie de la France.
A la suite des désastres de 1814 et de 1815, les armées étrangères pénètrent en France ; le département du Cher fut préservé des maux de l'invasion par sa position centrale. C'est sur son territoire que furent licenciés en partie les débris de cette armée héroïque qui avait parcouru l'Europe avec ses aigles victorieuses. Le département du Cher n'eut heureusement pas à souffrir de la guerre de 1870-1871 ses forges, ses fonderies contribuèrent pour une large part à la défense nationale, et les mobiles du Cher se signalèrent par leur bravoure au combat de Toury et à la défense de Paris.
Les départements-(histoire)- Cher - 18 -
(partie 1)
(Région Centre)
Le département du Cher a été formé de la plus grande partie de l'ancienne province du Berry ; son histoire est donc celle de cette province, et naturellement elle remonte à celle des Bituriges, qui lui ont donné son nom. Les Bituriges étaient l'une des plus anciennes et des plus puissantes tribus gauloises ; ils habitaient sur les bords du Cher (Carus) et obéissaient s à un roi qui résidait à Avaricum (Bourges).
Au VIIe siècle avant J.-C., à l'époque où Tarquin l'Ancien régnait à Rome, ils avaient la souveraine puissance sur le pays des Celtes. Leur roi Ambigat, vieillard que recommandaient ses vertus et ses richesses, voyant que son peuple était devenu trop considérable, et que le sol, malgré sa fertilité proverbiale, menaçait de devenir insuffisant, engagea Sigovèse et Bellovèse, ses neveux, jeunes guerriers ennemis du repos, à aller chercher un autre séjour dans les contrées que les dieux leur indiqueraient par les augures, leur permettant d'emmener avec eux autant d'hommes qu'ils voudraient, afin que nulle nation ne pût repousser les nouveaux venus. Bellovèse s'établit dans cette partie de l'Italie que les Romains appelèrent dans la suite la Gaule cisalpine, et Sigovèse dans là Norique, pays qui forme aujourd'hui la Bohême et la Bavière. Les Bituriges envoyèrent dans la suite de nouvelles colonies en Italie, et il est probable que leur chant de guerre se fit entendre jusque sur le bords du Tibre, lorsque les Gaulois, conduits par Brennus, vinrent, en 390, brûler Rome naissante.
Quelques siècles plus tard, lorsque César voulut passer dans les Gaules, il prit avec lui des Gaulois cisalpins et les ramena dans leur ancienne patrie. Ces braves soldats l'aidèrent à vaincre Vercingétorix, que le général romain poursuivit à travers le pays des Arvernes, et jusque dans celui des Bituriges, où il forma le siège d'Avaricum. César lui-même, dans le septième livre de ses Commentaires, fait voir par la manière dont il décrit ce siège combien il fut meurtrier. La ville fut enfin prise et ruinée par les Romains. La plupart des Bituriges quittèrent le pays, qui était dévasté, et allèrent. s'établir dans d'autres contrées.
Les traces de la civilisation naissante de ces temps reculés sont très rares aujourd'hui dans la département ; quelques tombelles ou tumuli, aux environs de Bourges, aux lieux dits : la Butte-Barral, la Butte-des-Prés-Fichaux et celle des Vignes-du-Château ; les menhirs ou pierres levées de Graçay, que l'on nomme dans le pays les Pierres folles ; quelques tumuli à Pierrefitte, dont le nom lui-même est l'indice de monuments mégalithiques, tels sont les seuls témoins muets de ces temps éloignés. Les Bituriges avaient vaillamment résisté à l'invasion romaine ; ils succombèrent et restèrent fidèlement soumis à leurs vainqueurs. Sous la domination romaine, leur pays fit partie de l'Aquitaine, et, sous Auguste, leur ville, qui avait été rebâtie et s'était considérablement agrandie, fut la métropole de cette province et servit constamment de résidence au préfet romain ; c'est alors que cette capitale perdit son nom d'Avaricum ; elle obtint le droit de cité, accordé aux villes privilégiées, et fut désignée sous le nom civitas Biturigensium, puis simplement de Bituriges. Lors de la division de l'Aquitaine en trois parties, sous Honorius, le Berry forma la première Aquitaine, et Bourges en fut toujours la capitale. C'est à peu près vers le milieu du IIIe siècle que le christianisme fut prêché dans le pays qui nous occupe ; son premier apôtre fut, dit-on, saint Ursin ; il fut favorablement accueilli par la population, et le sénateur Léocadius lui donna une des salles de son palais pour établir une église.
La période gallo-romaine a laissé quelques traces dans le département du Cher ; la vieille enceinte de Bourges est encore visible, et cette ville dut, ainsi que les grandes cités de l'empire posséder un cirque, des naumachies, des palais et des portes triomphales. Le cirque occupait l'emplacement de l'ancien couvent des Ursulines, et l'on voit encore dans les caves de cet établissement les restes des loges qui renfermaient les animaux féroces. On trouve aux environs de Bourges les ruines d'un aqueduc souterrain qui, probablement, conduisait les eaux de quelque source éloignée à la ville.
A Alichamps, lieu autrefois considérable, où venaient se croiser trois voies romaines, des fouilles ont fait découvrir des inscriptions, des colonnes miliaires, des vases, etc. A Drevant, sur le Cher, on montre l'emplacement d'un théâtre : on y a trouvé, en outre, des fragments de statues, des tombeaux, des pierres sculptées, des chambres pavées ou revêtues de marbre. A Alléan, près de Bau-, on voit encore les vestiges d'un camp ; à Maubranches, à Soye, à Celle-sur-Cher, on a trouvé des inscriptions, des poteries. Mais nous nous garderons bien d'attribuer à Vercingétorix les restes d'un vieux camp que l'on rencontre entre Maubranches et Nohant ; l'antiquaire doit être très sobre de ces pompeuses attributions, basées sur des témoignages trop légers, et dont la fragilité n'a servi que trop souvent à battre en brèche la science qu'il chérit.
Lors de la chute de l'empire romain et de l'invasion des barbares, les plaines de la fertile et plantureuse Aquitaine tombèrent au pouvoir des Wisigoths ;. Euric, leur roi, en rit la conquête vers l'an 475 ; ce ne fut pas sans résistance de la part des Bituriges, car il n'entra. dans leur capitale qu'après avoir échoué dans un premier siège. Mais les Wisigoths se rendirent bientôt odieux aux populations chrétiennes de la première Aquitaine par les persécutions de toute nature qu'ils leur firent endurer ; ils étaient ariens, c'est-à-dire qu'ils niaient la divinité de Jésus-Christ ; ils dévastèrent donc les églises et les monastères, en haine des chrétiens.
Aussi, lorsque Clovis eut, en 511, battu et tué Alaric Il, fils d'Euric, à la bataille de Vouillé, les évêques des villes d'Aquitaine ouvrirent-ils avec empressement les portes de leurs cités à ce prince, qui venait de reconnaître le Dieu de Clotilde et d'être baptisé par l'archevêque de Reims saint Remi. Dans les partages que firent entre eux les descendants de Clovis, le pays qui nous occupe fit toujours partie du royaume d'Orléans, et il fut gouverné par un comte qui résidait à Bourges. Les ducs d'Aquitaine s'en emparèrent vers la fin de la première race ; mais ils en furent chassés par Charles Martel . Bourges s'étant de nouveau déclarée pour les Aquitains et leur duc Waïfre, qui lui avait donné Cunibert pour comte, Pépin accourut et, après un siège de peu de durée, s'empara de la ville, la ruina et jeta Cunibert dans un cloître. Charlemagne établit dans le Berry des gouverneurs ou comtes, qui, dans la suite, rendirent leur gouvernement héréditaire, comme la plupart de ceux des autres grandes villes.
Le premier de ces comtes de Berry ou de Bourges fut Humbert, nommé en 778. Depuis cette époque jusqu'en 926, on en compte dix-huit, parmi lesquels on cite Gérard, qui régnait dès l'an 838. Dépouillé de son comté par Charles le Chauve en 867, il fut momentanément remplacé par Egfried ; mais ses hommes mirent le feu à la maison où était le nouveau comte, lui coupèrent la tète et jetèrent son corps dans les flammes. Gérard rentra ainsi en possession de son comté, malgré la volonté royale, frappée alors d'impuissance par la turbulence des comtes et les invasions incessantes des Normands. Il était encore comte de Bourges en 872, époque à laquelle il fut remplacé dans sa dignité par le duc Boson, beau-frère de Charles le Chauve et grand chambellan de Louis le Bègue, roi d'Aquitaine.
Louis le Bègue ayant succédé à son père, Charles le Chauve, au trône de France, Boson crut le moment favorable pour se déclarer indépendant ; mais il fut renversé, en 878, par Bernard Ier marquis de Septimanie. Celui-ci, parent de cet Egrried tué par Gérard en 867, réclama son héritage ; il fut appuyé par le comte du Maine et Gozlin, évêque de Paris, son oncle, et parvint à s'emparer du comté de Bourges. Mais bientôt il en chassa l'évêque Frotaire, s'empara des biens de l'Église et exigea des habitants un serment de fidélité contraire à celui qu'il devait lui-même au roi ; aussi fut-il excommunié par le concile de Troyes et attaqué, en 879, par une armée que Louis le Bègue avait donnée à Boson, son oncle, rentré en grâce auprès de lui. Boson, maître de Bourges, le fut bientôt de tout le pays. Dans la suite, il fit la paix avec Bernard et lui donna un fief.
A sa mort, arrivée en 886, il eut pour successeur Guillaume Ier le pieux qui était déjà comte d'Auvergne. Guillaume II, qui succéda à ce dernier, fut souvent en guerre avec la roi Raoul ; ce dernier lui enleva même son comté et le lui rendit en 927, après l'avoir forcé à lui rendre hommage. Après la mort de Guillaume Il, arrivée en 926, .le roi Raoul supprima le titre de comte de Berry, donna la propriété de Bourges au vicomte de cette ville et décida qu'à l'avenir ce vicomte, le seigneur de Bourbon, le prince de Déols et les autres barons du Berry relèveraient immédiatement de la couronne.
Geoffroy, dit Papabas, que quelques historiens font fils de Guillaume II, fut le premier vicomte de Bourges. C'est pendant son gouvernement que la France fut envahie et dévastée par les Hongrois, dont les contemporains nous ont fait un portrait si effroyable que le souvenir s'en est conservé dans la tradition de l'Ogre, terreur de notre enfance. Geoffroy eut trois successeurs du même nom que lui : Geoffroy II, dit Bosebebas ; Geoffroy III, le Noble ; Geoffroy IV, le Meschin ; tous prirent part aux grands événements qui signalèrent l'enfantement de la monarchie capétienne.
Étienne, fils de Geoffroy IV, était vicomte de Bourges en 1061 et mourut sans postérité. Eudes Herpin ou Arpin lui succéda dans la vicomté de Bourges ; il avait épousé Mahaud de Sully, fille et héritière d'Étienne ; d'ailleurs, il prétendait lui-même descendre de Guillaume Ier, le Pieux. Ce sixième et dernier vicomte de Bourges vivait en 1090, lors de la ferveur des premières croisades. En 1101, se disposant à partir pour la terre sainte avec le duc d'Aquitaine, il vendit au roi Philippe Ier sa vicomté pour soixante mille sous d'or. Il se distingua pendant la croisade, fut pris à la bataille de Rama, le 27 mai 1102, et eut beaucoup de peine à se racheter. Enfin il revint en France et se fit moine dans la célèbre abbaye de Cluny, fondée par Guillaume Ier environ 180 ans auparavant ; il n'y mourut qu'en 1109 et y fut enterré. Le Berry fut la première province réunie au domaine de la couronne.
A l'époque où la vicomté de Bourges rentrait ainsi au domaine royal, sa juridiction ne s'étendait pas sur tout le Berry ; les possesseurs des grands fiefs du pays s'étaient rendus indépendants, et l'on avait vu s'élever les seigneurs de Sancerre, de Montfaucon, de Charenton, de Germigny, de Vierzon, de Mehun, etc. Les maîtres de ces fiefs, suzerains eux mêmes d'un grand nombre de vassaux, couvrirent le pays d'un réseau de forteresses, destinées à la fois à protéger les campagnes et à les maintenir dans l'obéissance. Les rois, devenus maîtres du Berry, durent forcer ces fiers barons à rentrer dans le devoir et à leur prêter hommage.
En 1140, le diocèse de Bourges fut violemment troublé à la mort de l'archevêque Albéric. Dès le temps de Charlemagne, les évêques de Bourges avaient pris le titre d'archevêques et de primats d'Aquitaine, ce qui leur donnait des droits sur les quatre archevêchés de Bordeaux, d'Auch, de Narbonne et de Toulouse. Les chanoines du grand chapitre, dont l'institution remontait à Charlemagne, ayant demandé au roi la permission d'élire un nouvel archevêque, celui-ci les y autorisa, à condition qu'ils ne nommeraient pas Pierre de La Châtre, neveu du chancelier de l'Église romaine ; mais le pape Innocent II investit lui-même ce prélat du pallium, prétendant qu'il fallait « accoutumer ce jeune homme (le roi de France) à ne pas prendre la licence de se mêler ainsi des choses de l'Église. »
Louis VII, furieux, jura que, tant qu'il porterait la couronne, Pierre ne posséderait l'église de Bourges ni autre en son royaume. Il ordonna la confiscation du temporel de l'archevêché et mit garnison dans le château de Saint-Palais et dans plusieurs autres places. Pierre de La Châtre, à son retour de Rome, se vit donc refuser l'entrée de Bourges par les gens du roi et fut obligé de se retirer sur les terres que possédait en Berry le vieux comte de Champagne Thibaut, grand ami du clergé et brouillé alors avec le roi. Le pape, de son côté, fulmina une bulle contre Louis le Jeune et mit en interdit tous les lieux habités par ce prince, qui, de même que son aïeul Philippe Ier, ne put, trois ans durant, mettre le pied dans une ville ou dans une bourgade sans que le service divin y fût à l'instant suspendu.
Louis VII, pour se venger, dévasta la Champagne, prit d'assaut la forte place de Vitry et l'incendia ; plus de treize cents personnes qui s'étaient retirées dans la principale église périrent alors dans les flammes. Cependant, après trois ans de résistance, le roi se soumit et rétablit lui-même Pierre de La Châtre dans son siège. Depuis ce temps, ils vécurent en bonne intelligence, et le roi abolit même en sa faveur une coutume des temps barbares, qui permettait de piller la maison de l'archevêque après sa mort et d'en emporter les meubles. Les guerres suscitées entre Louis VII et Henri Il d'Angleterre, à la suite de la répudiation d'Éléonore de Guyenne, eurent des suites sanglantes pour les pays du Cher, qui alors limitaient les possessions françaises et anglaises. Les citadelles furent souvent prises et reprises, les villes et les villages livrés aux flammes, les campagnes ravagées. Des bandes de pillards, connues sous les noms de cottereaux, routiers, brabançons, parcouraient le pays, dévastant et tuant sans pitié. Les seigneurs du Berry, effrayés, prirent les armes pour les repousser et les mirent complètement en déroute près de Dun-le-Roi, en juillet 1183. Au XIVe siècle, les combats recommencèrent avec les Anglais. Le Prince Noir, fils d'Édouard III, 'traversa le Berry, brûla les faubourgs de Bourges. Mais le duc Jean, dont nous allons parler, aidé par le comte de Sancerre et Du Guesclin, les chassa du pays.
Le Berry, rentré sous le gouvernement royal, demeura pour toujours partie intégrante de la France ; les rois le firent administrer par des baillis, des prévôts et des gouverneurs ; Bourges conserva cependant quelques privilèges de son ancienne juridiction municipale jusqu'en 1474, époque à laquelle le Berry fut assigné comme apanage par le roi Jean à son troisième fils, Jean, après avoir été érigé en duché-pairie. Il y eut alors à Bourges deux juridictions : celle du duc, qui était exercée par son sénéchal et ses autres officiers, et celle du roi, qui était représentée par le bailli de Saint-Pierre-le-Moutiers, qualifié juge des exemptions du Berry, et qui siégeait pour cela à Sancoins. Les causes d'exemption concernaient les cas royaux et les procès des principales églises et monastères du diocèse de Bourges.
Jean Ier, duc de Berry, était né en 1340. Ce jeune prince s'était trouvé à la désastreuse bataille de .Poitiers, n'y avait pas été fait prisonnier, mais avait été donné en otage pour son père. Il resta neuf ans en Angleterre et n'en revint qu'en 1365, après la mort du roi Jean. Pendant tout le cours du règne de Charles V, son frère, il combattit les Anglais en Guyenne comme lieutenant du brave Du Guesclin. Sous Charles VI, il fut gouverneur du Languedoc, et il exerça de grandes vexations dans cette province et dans quelques autres qui n'étaient pas de son apanage ; mais il ménagea toujours le Berry comme son patrimoine et y rit même beaucoup de bien en le dotant de grands établissements et de bâtiments considérables. C'est à lui que la ville de Bourges fut redevable d'une Sainte-Chapelle, bâtie, dit-on, sur le modèle de celle de Paris, et d'un palais magnifique dont il ne reste plus de, traces. Pendant les premiers accès de la terrible maladie de Charles VI, son neveu, il gouverna absolument le royaume.
Les départements-(histoire)-Carente Maritime - 17 -
(Région Poitou-Charentes)
Les deux provinces d'Aunis et de Saintonge, dont a été formé le département de la Charente-Maritime, faisaient partie, avant l'invasion romaine, du pays habité par les Santones. Les Santons possédaient une capitale, Mediolanum, aujourd'hui Saintes, et un port très fréquenté, portus Santonum, sur l'emplacement duquel les géographes ne sont pas plus d'accord que les historiens.
Jules César trouva le pays occupé par les Kymris, qui avaient refoulé la nation des Galls derrière la grande chaîne de montagnes qui se prolonge diagonalement des Vosges à l'Auvergne. L'illustre conquérant entreprit d'asseoir la domination romaine parmi ces populations qu'il défendit contre deux invasions des Helvétiens et des Teutons.
Mais rien ne put désarmer la haine des vaincus pour les vainqueurs. Punis de leur complicité dans la révolte des peuples de l'Armorique par la perte d'une partie de leur flotte, dont César employa les vaisseaux contre les Vénètes, les Santons s'associèrent aux patriotiques efforts de Vercingétorix et lui fournirent un contingent de 12 000 soldats. La sanglante journée d'Alésia ne les découragea point encore ; sous l'empereur Auguste, nouvelle révolte ; nouvelle victoire des Romains commandés par Messala Corvinus. D'autres insurrections ayant succédé à ces tentatives, le gouvernement impérial essaya d'y mettre obstacle en détachant le territoire des Santons de la province lyonnaise et en l'enclavant dans l'Aquitaine seconde.
Les Romains eurent à peine le temps d'apprécier les résultats de cette combinaison ; les Wisigoths et les Saxons vinrent leur disputer leur conquête ; le général Nommatius, qui, pour surveiller le pays, avait établi ses cantonnements dans l'île d'Oléron, était sans cesse harcelé par ces pirates qui, en 419, restèrent maîtres du terrain. Ils le gardèrent moins d'un siècle ; en 507, Alaric, leur chef, fut vaincu à Vouillé par Clovis, qui le poursuivit jusqu'aux Pyrénées et ajouta cette contrée au nouveau royaume des Francs.
L'établissement du christianisme dans ce pays avait précédé la conquête franque. A la fin du ler siècle, saint Eutrope, premier évêque des Saintongeois, envoyé par saint Clément, avait subi le martyre près de Mediolanum ; l'Angoumois avait eu aussi son apôtre dans la personne de saint Aune, qu'il ne faut pas confondre avec le poète son homonyme ; sous Constantin, les vieilles idolâtries aient presque complètement disparu, et, en 379, Grégoire de Tours nous apprend qu'Angoulême était un siège épiscopal occupé par Dynamius. Sous les princes de la première race, l'ancienne province s Santons, incorporée au duché d'Aquitaine, passa successivement des rois d'Orléans aux rois Soissons, des rois de Metz aux rois de Paris et aux rois de Bourgogne.
Aucun fait d'un intérêt général ne se rattache à cette époque pleine de confusion. Nous devons noter seulement, comme épisode local, l'usurpation de l'aventurier Gondebaud, qui, profitant, des divisions suscitées par la lutte des deux reines Frédégonde et Brunehaut, se fit proclamer roi de plusieurs provinces, au nombre desquelles étaient l'Aunis et la Saintonge. Le gouvernement de ces contrées était alors confié à des comtes ou ducs, dont les noms mêmes ne sont pas parvenus jusqu'à nous, à l'exception cependant de celui d'un certain Waddon, qui doit sa célébrité à sa complicité dans les méfaits de Gondebaud.
L'établissement de la dynastie carolingienne fui signalé par les invasions des Sarrasins, refoulés par Charles Martel et par Charlemagne. Dans le partage de l'empire, en 835, la Saintonge et l'Angoumois échurent à Pépin, roi d'Aquitaine, fils de Louis le Débonnaire ; Landry fut nommé par lui comte de Saintes ; le poste était périlleux : car à peine les derniers débris de l'armée de l'émir Abd-eI-Raman étaient-ils dispersés, que le pays fut envahi par les Danois et les Normands, qui remontèrent la Charente jusqu'à l'ancien Mediolonum et ravagèrent l'Aunis, la Saintonge et l'Angoumois.
L'histoire a gardé le souvenir des exploits du comte d'Angoulême Turpion, qui défendit la contrée avec habileté et courage contre les ennemis du nord ; c'est à lui probablement que le comté d'Angoulême dut une prépondérance qu'il garda, pendant plus de deux siècles, sur les provinces environnantes.
Vers le milieu du Xe siècle, c'est un comte de Poitiers, Guillaume Tête d'Étoupe, qui reconstitue le duché héréditaire d'Aquitaine, dans lequel sont enclavés l'Aunis et la Saintonge ; cette dynastie se continue sans événements importants jusqu'au mariage de la princesse Éléonore, fille de Guillaume X, en 1137, avec Louis le Jeune, roi de France. L'héritière des ducs d'Aquitaine apportait en dota la monarchie l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois, le Poitou, le Limousin, la Marche, l'Auvergne, le Périgord, le Bordelais, l'Agenais et la Gascogne. Elle conserva toujours une vive affection pour la Saintonge, où elle avait été élevée. La France doit à l'esprit éclairé de cette princesse et à son amour pour son pays natal la rédaction de son premier code maritime. Il est connu sous le titre de Rôles ou Lois d'Oleron ; ces lois existaient depuis longtemps en Saintonge, mais elles n'avaient jamais été rédigées et réunies.
Ce code, qui de la Saintonge passa en Angleterre, puis dans d'autres pays, devint le droit commun de la navigation sur l'Océan, la mer Baltique et la Méditerranée il avait été précédé de l'abolition, sur toutes les côtes d'Aquitaine, du droit de bris, d'aubaine et d'épave, exercé si cruellement jusqu'alors sur les malheureux naufragés ; et quand on considère qu'aujourd'hui, en Angleterre et en Bretagne, la civilisation moderne n'a pas toujours raison de la barbarie de ce vieil usage, on doit concevoir une haute estime pour le caractère d'une femme qui sut imposer une pareille réforme, et compter à nos provinces d'Aunis et de Saintonge, comme un de, leurs principaux titres de gloire, le mérite d'avoir été les premières à la pratiquer.
Mais là ne devait pas se borner l'influence d'Éléonore sur les provinces qui nous occupent. Répudiée par le roi de France, la fille de Guillaume épousa Henri Plantagenêt, duc de Normandie, comte d'Anjou et plus tard roi d'Angleterre sous le nom de Henri II. Cette union mettait l'Anglais au cœur de la France ; c'est donc aussi d'Éléonore que nous devons dater cette domination étrangère de trois siècles sur toute la partie sud-ouest de notre pays ; dès lors La Rochelle et Royan furent des ports ouverts au débarquement des troupes ennemies ; l'Aunis et la Saintonge devinrent les cantonnements d'où les armées pouvaient s'élancer sur tous les points du territoire français, qu'un affaiblissement momentané ou la trahison d'un grand vassal désignait aux envahissements de l'Angleterre. Toutefois, le joug angIo-normand, aussi lourd que honteux pour nos malheureuses populations, ne fut point accepté sans de sanglantes protestations. Éléonore elle-même ne vit pas sans douleur et sans indignation les exactions des officiers fiscaux de son nouvel époux ; elle réclama ; on prétendit même qu'elle voulut mettre ses propres fils à la tête de la révolte. Henri s'en vengea Par des supplices, des amendes, la destruction des châteaux des barons suspects, enfin par l'emprisonnement de sa femme, Éléonore.
Ce fut le signal d'un soulèvement général ; toute l'Aquitaine prit les armes, et Richard, fils du roi, se mit à la tète des mécontents. Mais les princes de sang royal sont des guides peu sûrs pour un peuple en révolte. Richard capitula, et la Saintonge paya le prix du pardon qu'il obtint. De nouvelles ligues vinrent témoigner encore du désespoir des habitants, mais sans apporter aucun remède à leurs maux. Ce même Richard, devenu à son tour roi d'Angleterre et célèbre sous son surnom de Coeur de Lion, vint aussi châtier ses anciens complices devenus pour lui des sujets rebelles, que Io seigneur de Taillebourg avait soulevés, comptant sur l'appui de Philippe Auguste et d'Aimar, comte d'Angoulême. Après huit mois d'attente, le roi de, France avait enfin tenu sa promesse et rencontrait l'armée anglaise près du Petit-Niort, lorsqu'au moment d'engager l'action Philippe s'aperçut qu'il ne. devait pas compter sur ses vassaux de la province de Champagne, séduits par l'or de Richard ; il se hâta donc d'offrir une trêve dont la durée fut fixée d'un commun accord à dix années.
Cette trêve fut pour l'Aunis et la Saintonge une ère de paix et de prospérité. Richard avait rendu la liberté à sa mère ; il la remit en possession de ses domaines paternels. Éléonore les administra avec sagesse et libéralité. C'est à dette époque que remonte la concession des premières franchises communales auxquelles les villes de ces provinces, et La Rochelle entre autres, durent plus tard leur grandeur et leur importance. Pendant le règne de Jean sans Terre, l'influence française prédomina.
Au retour de la bataille de Bouvines, Philippe-Auguste obligea l'Anglais à regagner sa flotte, reprit la ville de La Rochelle et se fit payer au poids de l'or une trêve de cinq ans. Ces succès, suivis, vingt-sept ans plus tard, de la victoire de Taillebourg, remportée par Louis IX sur Henri III d'Angleterre, ligué avec le comte d'Angoulême Hugues de Lusignan, auraient du consolider d'une manière, définitive la domination française, si le traité n'eût pas restitué à l'ennemi une partie de ce que sa défaite lui avait fait perdre. L'Anglais conserva en effet le duché de, Guyenne et le sud de la Saintonge, qui eut deux capitales : Saintes, pour le territoire anglais, et Saint-Jean-d'Angély pour la partie qui demeura française. Au reste, il faut que ce partage du sol français avec nos voisins d'outre-Manche fût accepté à cette époque comme une bien inévitable nécessité ; car, après cinquante ans de paix, nous voyons Philippe le Bel, prince d'une politique assez peu scrupuleuse, enlever par un coup de main hardi la Guyenne et la Saintonge à Édouard Ier, et les lui rendre presque sans compensation, après une occupation de quelques années.
L'acceptation du joug anglais, par une partie des populations de l'Aquitaine, donna dans l'Aunis et la Saintonge, aux luttes des XIVe et XVe siècles, le double caractère de guerres étrangères et de guerres civiles ; pendant deux siècles, ces deux malheureuses provinces furent un vaste champ de bataille où se heurtaient sans cesse les armées des deux nations ; pas de prince, pas d'homme de guerre de cette époque, qui ne soit venu là acquérir ou justifier sa réputation de cruauté, d'habileté ou de courage. Nous voyons figurer tour à tour y les rois de France Jean Ier et Charles VII, les rois d'Angleterre Édouard Ier et Richard II ; tous les princes de leur sang, les ducs de Bourbon, de Bourgogne et de Berry ; le prince Noir, duc d'Aquitaine ; le comte de Lancastre et Jean, comte de Pembroke ; puis le roi de Castille, Jean, allié maritime de la France ; Du Guesclin, Olivier de Clisson, les maréchaux de Boucicaut et de Sancerre, le captal de Buch, le comte de Derby, Arundel, Robert Knolles et Chandos.
Cependant, au milieu de cette mêlée confuse, dans cette alternative de succès et de revers, un fait important se dégage : c'est l'attachement toujours plus prononcé de la Saintonge à la fortune de la France ; et, tandis qu'Angoulême devient en quelque sorte la capitale des possessions anglaises et le séjour ordinaire du prince Noir, La Rochelle ouvre ses portes et garde dans ses murs le dauphin Charles, après le désastre, d'Azincourt.
L'expulsion définitive de l'Anglais et la réunion des provinces de l'ouest à la couronne fut, comme on le sait, l'oeuvre glorieuse de Charles VII. Entre cette époque et les guerres de religion, qui prirent un caractère si sérieux dans ces contrées, la paix fut troublée à diverses reprises : en 1462, par une tentative des Anglais sur La Rochelle, et, quelques années plus tard, par les révoltes de Charles de Valois, que Louis XI fut obligé de venir combattre et soumettre en 1472, et par celle de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, qui céda, en 1487, aux armes de Charles VIII, venu en Saintonge accompagné de Mme de Beaujeu, sa soeur.
Louis XI, comprenant la nécessité de s'assurer l'attachement de populations si souvent et si longtemps soustraites à la domination française, avait profité de son voyage pour gagner l'affection de la bourgeoisie. Il avait confirmé et étendu les privilèges et libertés communales de La Rochelle, Saintes et Saint-Jean-d'Angély ; Charles VIII était resté fidèle à cette politique. ; mais François Ier crut pouvoir établir impunément, dans les pays maritimes de l'ouest, l'impôt de la gabelle, charge ruineuse et impopulaire. Un mécontentement sourd, mais profond, après avoir couvé six ans, éclata en 1548 par une terrible émeute populaire à Jonzac.
Un gentilhomme du pays de Barbezieux, Puymoreau, se mit à la tête des insurgés, dont le nombre s'éleva bientôt à seize mille. Proclamé couronnal de Saintonge, il s'empara de Saintes, assiégea Taillebourg, recruta son armée de toutes les bandes d'insurgés formées dans l'Angoumois, le Périgord, l'Agenais et le Bordelais, se vit à la tète d'une armée de cinquante mille hommes et, pendant quelque temps, maître de la Guyenne. On dirigea contre cette formidable insurrection le vieux connétable Anne de Montmorency, qui parvint à l'étouffer, mais dont la conduite impitoyable attisa les premiers feux d'un autre incendie bien autrement redoutable que celui qu'il venait d'éteindre.
C'est au milieu de cités ravagées par les troupes de Montmorency, parmi les ruines des hôtels de ville démolis, sur la cendre des chartes communales brûlées, qu'apparurent les premiers propagateurs de la réforme religieuse. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de la faveur avec laquelle la nouvelle doctrine fut tout d'abord accueillie ; sans parler de ceux qui croyaient sincèrement voir en elle un remède aux abus, tels étaient les habitants des côtes pressurés par la gabelle, pour beaucoup c'était leur vengeance a satisfaire, leur liberté à conquérir. La foi protestante s'enflamma donc de toutes les passions politiques ; la guerre fut ouvertement déclarée, les églises furent pillées et profanées.
C'est surtout dans l'histoire particulière des villes que nous suivrons les péripéties de ces luttes acharnées qui, de 1550 à 1619, se prolongèrent sous les règnes de Henri Il, François II, Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII, jusqu'à la prise de La Rochelle par Richelieu. Ce que nous avons dit plus haut de l'espèce de rendez-vous que s'étaient donné, dans les plaines de l'Aunis et de la Saintonge, toutes les illustrations politiques ou militaires des XIVe et XVe siècles, pendant la lutte de l'Angleterre et de la France, nous pourrions le répéter pour le XVIe siècle, à l'occasion des guerres religieuses.
A chaque page des annales de ces provinces pendant cette période, nous voyons d'un côté, à la tête des protestants ou des ligueurs, les La Rochefoucauld, les Châtillon, les Duras, les Condé, les La Trémouille, les Rohan, les d'Aubigné, et en face d'eux les Guise, les Matignon, les d'Épernon et de Joyeuse. Un rapprochement historique, dont il ne faudrait pas s'exagérer la portée, mais qu'il ne nous semble pas permis de regarder comme un jeu du hasard, peut donner une idée du fanatisme qui s'était emparé des esprits dans ces contrées : La Renaudie, l'agent le plus actif de la conjuration d'Amboise ; Poltrot, l'assassin du duc de Guise, et Ravaillac étaient tous les trois de l'Angoumois ou des confins de la Saintonge.
Si, à ces longues et rudes épreuves, nous ajoutons les agitations de la Fronde, qui, par la présence de Condé eut, sur le littoral de la Charente, un caractère plus sérieux que partout ailleurs ; si nous rappelons. les désastreux effets de la révocation de l'édit de Nantes, sous Louis XIV, dans une contrée si passionnément attachée au culte réformé ; le commerce ruiné, les terres en friche, les villes désertes et les tentatives de l'Angleterre pour exploiter toutes ces misères à son profit, nous nous expliquerons l'enthousiasme avec lequel fut salué dans la Saintonge et dans l'Aunis l'avènement de la Révolution de 1789. Haines religieuses et rivalités locales s'effacèrent devant la grandeur des circonstances. Les deux provinces fournirent un continent de vingt mille soldats pour la défense de nos frontières menacées, et, malgré le voisinage du' foyer royaliste vendéen, leur dévouement à la République ne se démentit pas un seul instant. C'est même la Charente-Maritime qui opposa sa barrière au débordement de l'insurrection royaliste et empêcha la Vendée de donner la main à Bordeaux et au Midi.
En 1809, sous l'Empire, la flotte française fut incendiée par les Anglais devant l'île d'Aix. Six ans plus tard, le Bellérophon quittait cette même rade de Rochefort, emportant vers Sainte-Hélène le grand vaincu de Waterloo.
Dans le singulier mélange de scepticisme et de naïveté qui constitue le caractère du Charentais du XIXe siècle, peut-être serait-il permis de reconnaître à la fois et la dernière empreinte du génie des anciens Santones et l'influence de toutes les crises par lesquelles ont passé ces malheureuses provinces ; au fanatisme religieux a succédé une indifférence assez générale dans les villes, et il n'en est resté dans les campagnes qu'un fonds de croyance trop disposé à se rattacher à de superstitieuses légendes ou à de puériles traditions.
Les ports de la Charente ont résisté bien moins encore que Nantes et Bordeaux aux conséquences de la révolution commerciale produite par la perte ou la décadence de nos colonies et la concentration des affaires dans les villes qui communiquent plus directement avec les États-Unis d'Amérique. Comme port militaire, la position de Rochefort a été jugée moins favorable que celles de Brest et de Cherbourg, places auxquelles il a été sacrifié. C'est donc au XIXe siècle, surtout dans les travaux de l'agriculture et dans les arts industriels que trouve à s'exercer l'activité de l'habitant des Charentes. Le Charentais de cette époque n'a aucune ambition ; il n'émigre pas pour aller chercher fortune en dehors de son pays ; il se contente d'un petit bien-être et ne croit qu'à la fortune territoriale. Pays de propriétés divisées à l'infini, chacun possède en Saintonge et il y a peu de grands propriétaires.
Les Départements -(Histoire)- La Charente - 16 -
(Région Poitou-Charentes)
On croit que la contrée dont se compose le département de la Charente fut habitée originairement par les Agesinates, tribu de la grande confédération des Santones. Ils firent sans doute partie de l'antique expédition des Celtes en Italie et durent contribuer aussi à la fondation de Mediolanum, Milan. Toutefois, malgré plusieurs dolmens encore debout dans le pays, il n'y a rien de bien certain ni de bien authentique dans les faits antérieurs à la conquête romaine.
A dater de cette époque, les documents se présentent plus clairs et plus précis. Jules César et ses successeurs firent d'inutiles efforts pour conquérir l'affection des Santones vaincus ; c'est en vain que leur territoire fut préservé par les armes romaines d'une double invasion des Helvètes et des Teutons ; c'est en vain que les villes furent embellies, les arts encouragés, le commerce protégé, la circulation facilitée par la création de routes nouvelles ; rien ne put désarmer les rancunes obstinées de l'esprit national. Sans parler de plusieurs séditions locales, les Santones, qui avaient fourni un contingent de 12 000 hommes à Vercingétorix ne se laissèrent pas décourager par leurs constantes défaites ; on les vit encore sous Auguste livrer à Messala Corvinus une sanglante bataille non loin de l'Océan. Pour chercher à déraciner cette nationalité tenace, la politique des empereurs eut recours à son moyen habituel : elle changea les divisions territoriales ; de la Celtique Lyonnaise, le pays des Santones passa dans la seconde Aquitaine. La trêve fut de courte durée ; un siècle à peine s'écoula entre l'apaisement des révoltes du peuple conquis et les premières apparitions des barbares, ses nouveaux maîtres.
Dès les commencements du IVe siècle, les pirates saxons apparaissent sur les rivages de la mer et à l'embouchure des rivières ; les Francs, dont l'heure, n'est pas encore venue, menacent déjà le Nord ; les Wisigoths disputent aux Romains les régions occidentales et méridionales, dont ils finissent par rester maÎtres. C'est au milieu de ces symptômes de dissolution et de transformation que le christianisme pénètre et s'implante dans le pays. Il dut trouver les cœurs des Agésinates disposés à la foi nouvelle, puisque l'Angoumois, qui avait eu pour premier apôtre saint Martial, et pour premier évêque saint Ausone, qu'il ne faut pas confondre avec le poète, possédait, en 379, un siège épiscopal occupé alors, selon Grégoire de Tours, par Dynamius.
On sait quels ravages les doctrines d'Arius, encouragées par les princes wisigoths, exerçaient dans leurs possessions ; les évêques se liguèrent avec les chefs francs, qui étaient restés orthodoxes. Clovis exploita habilement l'alliance qui lui était offerte. Le succès de ses armes et l'éclatante victoire de Vouillé couronnèrent l'œuvre préparée par sa politique, et l'Aquitaine, dont notre province faisait partie, fut incorporée dans le nouvel empire franc. L'existence de l'Angoumois, comme province distincte, est constatée à cette époque par la création de comtes qui y représentaient le pouvoir dit roi et par l'acte de partage qui suivit la mort de Clotaire. L'Angoumois entrait dans l'héritage de Sigebert, roi de Metz, tandis que la Saintonge et l'Aunis étaient affectés à Caribert, roi de Paris.
L'Angoumois fut mêlé à toutes ces guerres ; mais le fanatisme, les traditions et l'intérêt, qui poussèrent si avant Toulouse et Bordeaux dans cette querelle, eurent moins d'action sur les habitants de la province qui nous occupe ; nous n'avons pas guerre aux Francs, disaient-ils, et, trop désireux peut-être de voir la paix rétablie, ou, du moins, trop peu scrupuleux sur les moyens d'y parvenir, ils mirent à mort le malheureux Waïfre, le dernier et intrépide descendant des ducs, qui, vaincu et fugitif, était venu chercher un asile auprès d'eux.
Malgré la garantie que semblait offrir cette attitude, il paraît que Charlemagne ne regardait pas comme sans danger le pouvoir provincial aux mains des hommes du pays ; il les remplaça tous par des seigneurs francs dans le voyage qu'il fit en Aquitaine pour y organiser sa dernière expédition d'Espagne, dans laquelle périt Roland. C'est à Angoulême qu'il rassembla son armée, et parmi ses plus illustres compagnons, l'histoire a conservé les noms des membres de trois familles de l'Angoumois, qui s'acquirent un grand renom de vaillance dans les guerres de cette époque ; c'étaient les Achard, les Tison et les Voisin.
Lors du partage de l'empire entre les fils de Louis le Débonnaire, Pépin, roi d'Aquitaine, institue, en 839, des comtes pour gouverner les provinces de son royaume ; il met à la tête de l'Angoumois un seigneur d'un rare mérite et d'une valeur éclatante, Turpion, qui devient la souche des comtes d'Angoulême, si puissants pendant une grande partie de la période féodale. Turpion, comme tous les fondateurs de dynastie à cette époque, établit sa réputation et son crédit par son zèle à défendre sa province contre les agressions étrangères et par ses exploits contre les Normands.
Pendant trois siècles, ses successeurs maintiennent et agrandissent, la puissance de leur maison ; guerroyant contre leurs voisins les comtes de Saintes et de La Marche, contre les seigneurs d'Archiac et de Bouteville ; étendant leurs domaines aux dépens des ducs d'Aquitaine, comme les seigneurs d'un rang plus élevé le faisaient. eux-mêmes aux dépens de la royauté ; expiant leurs méfaits trop criants, leurs usurpations trop flagrantes par quelques voyages en Palestine et couronnant enfin l'ambition traditionnelle de leur famille, par le mariage du comte Geoffroy, surnommé Taillefer, avec Pétronille d'Archiac et de Bouteville, la plus riche héritière de la Saintonge et de l'Angoumois, en 1148. La reconstitution sérieuse du duché d'Aquitaine par Guillaume Tête-d'Étoupe, comte de Poitiers, la réunion d'immenses domaines aux mains d'Éléonore, son héritière, l'union de cette princesse avec Louis VII le Jeune, son divorce, puis son second mariage avec Henri Plantagenêt, ouvrent une nouvelle phase de l'histoire de l'Angoumois.
Rien de plus confus, de plus variable que la politique des seigneurs de nos provinces occidentales pendant cette lutte longue et désastreuse de la France et de l'Angleterre, qui commence à Louis le Jeune et ne finit qu'à Charles VII ; les intérêts aquitains s'effacent, le sentiment de la nationalité française n'existe pas encore ; les princes anglais, par leurs alliances, par leur origine, par les traités, avaient des droits trop oublies par l'histoire, mais qui durent ne pas être sans valeur aux yeux des contemporains ; en outre, leur valeur dans les combats, le libéralisme de leur administration purent souvent faire illusion sur la légitimité de leurs prétentions. On comprend donc, sans pouvoir l'excuser absolument, que dans ce chaos, au milieu de toutes ces incertitudes, l'intérêt ait été le guide le plus habituel des barons aquitains. La difficulté de la situation rend d'autant plus méritoire la conduite des comtes d'Angoulême, qui, sauf quelques circonstances exceptionnelles, restèrent fidèles à la cause nationale.
En 1168 et 1175, Guillaume IV prit part à la lutte des grands vassaux ligués contre Henri II d'Angleterre. En 1194, Aymar Taillefer s'allie à Geoffroy de Rancon pour recommencer la guerre contre Richard Cœur de Lion, et, quelques années plus tard, il refuse à Jean sans Terre la main de sa fille et unique héritière, Isabelle, pour la marier à Hugues de Lusignan, comte de La Marche. Puis, lorsque le célèbre arrêt de confiscation est prononcé contre le monarque anglais, pour le punir d'avoir dépouillé son neveu, Arthur de Bretagne, Aymar, quoique déjà vieux, se met à la tète des seigneurs disposés à assister Philippe-Auguste dans l'exécution de la sentence.
Les descendants de cet ennemi acharné de l'Anglais furent moins belliqueux que leur ancêtre, mais ils semblent avoir hérité de ses sympathies pour la monarchie française. Le second mariage d'Isabelle avait réuni dans les mains des Lusignan les deux comtés de la Marche et de l'Angoumois. Hugues XIII, qui n'avait point d'enfants, engagea la Marche à Philippe le Bel, en 1 301, pour une somme d'argent considérable et assura au roi tant d'avantages par bon testament, qu'à sa mort le prince put écarter sans peine les prétentions des collatéraux et réunir à la couronne les deux provinces, en 1303.
Ce fut donc dans la personne de Hugues XIII et de Guy de Lusignan que s'éteignit la dynastie des comtes féodaux de l'Angoumois. Les princes qui, depuis, portèrent ce titre ne le possédèrent que comme apanage. C'est ainsi que Charles IV le Bel le conféra à sa nièce, Jeanne de Navarre, et que plus tard, de 1322 à 1496, nous en voyons successivement revêtus Charles d'Espagne, favori de Jean le Bon, le duc de Berry et le duc d'Orléans, frère et second fils de Charles V, puis Jean et Charles d'Orléans, héritiers du duc. Le retour de l'Angoumois au domaine royal ne l'avait pas mis à l'abri des chances de la guerre, qui continuait plus calamiteuse et plus acharnée ; l'épée de Du Guesclin avait bien maintenu pendant quelque temps la domination française dans nos provinces ; mais de cruels désastres avaient succédé à ces jours de gloire.
Pendant la captivité du roi Jean, l'Angoumois était tombé au pouvoir des Anglais ; le traité de Brétigny avait ratifié cette conquête ; Angoulême devint la capitale et le séjour habituel du Prince Noir Cette possession fut vivement disputée pendant le règne suivant. Mais c'est à Charles VII qu'appartient la gloire d'avoir enfin rendu l'Angoumois à la France.
Nous n'aurons plus à compter maintenant avec l'étranger ; ce sont des discordes civiles et les guerres de religion qui agiteront le pays. Elles, ne se firent malheureusement pas attendre ; à la révolte de Charles de Valois, que Louis XI, son frère, avait placé à la tête des gouvernements de la Guyenne, de l'Aunis et de la Saintonge, succède, sous Charles VIII, en 1487, la conjuration de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, contre lequel le roi fut obligé de marcher à la tête d'une armée, accompagné de sa soeur, Anne de Beaujeu. Le duc fit sa soumission : on lui pardonna. Il venait d'épouser Louise de Savoie, et de cette union naquit, au château de Cognac, en 1494, François, qui, avant de régner sous le nom de François Ier, porta comme son père le titre de comte d'Angoulême. C'est en considération de ce souvenir qu'en 1515 il érigea en duché-pairie le comté dont il avait été titulaire, et il en fit hommage à sa mère, qui fut la première duchesse d'Angoulême.
Les nombreux témoignages de bienveillance et d'affection que François Ier donna aux habitants de l'Angoumois, soit par l'amélioration de la navigation de la Charente, soit par l'établissement d'une université dans la capitale de la province, retardèrent ou rendirent inoffensifs les premiers progrès de la réforme religieuse ; il est même permis de supposer que la lutte eût été beaucoup moins acharnée et moins sanglante dans cette contrée, si les haines n'avaient eu leur principal aliment et la guerre son point de départ dans la malheureuse insurrection dite de la gabelle. Un impôt fort impopulaire, frappé dans les circonstances les plus défavorables, détermina un soulèvement presque général dans les campagnes.
La révolte trouva pour la diriger un gentilhomme d'une rare capacité, qui réunit sous ses ordres jusqu'à 50 000 hommes et fut pendant quelque temps maître de l'ancienne Aquitaine. C'était, sans doute, une immense calamité ; mais ce qui fut plus malheureux encore, ce fut de confier le soin de la répression à un homme aussi inflexible dans son caractère, aussi implacable dans sa sévérité que l'était le connétable de Montmorency. Il usa envers les insurgés vaincus de si terribles représailles ; il rendit si odieux le gouvernement au nom duquel il prétendait agir, que les populations se jetèrent avec une espèce de frénésie dans les voies d'opposition qui s'ouvrirent devant elles, et que le souvenir des atrocités dont le pays avait été le théâtre et la victime exerça une déplorable influence sur le caractère des habitants.
Le calvinisme, à dater de ce moment, prit des développements formidables ; la noblesse, jalouse de la fortune inouÏe de la maison de Lorraine, fournit des chefs à l'insurrection qui se préparait. La Renaudie, l'âme et le héros de la conjuration d'Amboise, était un gentilhomme de l'Angoumois ; les comtes de La Rochefoucauld, les barons de Duras furent des premiers à courir aux armes quand les religionnaires crurent venu le moment favorable de prendre l'offensive. C'est par la dévastation, le pillage, le meurtre et le sacrilège, que leurs premiers succès furent signalés ; on se vengeait du connétable ; les insurgés de la gabelle prenaient leur revanche.
Les catholiques s'abandonnaient aux mêmes excès quand ils étaient vainqueurs ; les trêves, les traités de paix ne servaient qu'à masquer de nouveau pièges et de nouvelles trahisons. L'état normal, c'était la guerre, et la guerre des grandes batailles, comme Jarnac et Moncontour, des sièges héroïques, comme ceux de Saint-Jean-d'Angely et de La Rochelle, des grands capitaines, comme Condé, Coligny, Rohan, d'Aubigné, d'Anjou, La Trémouille, Matignon et les Guises. Les massacres de la Saint-Barthélemy vinrent mettre le comble à l'exaspération, et lorsque l'épuisement des deux partis, la mort de leurs principaux chefs, la politique conciliatrice de Henri IV, l'administration paternelle et éclairée de Sully ont partout ailleurs ramené le calme dans les esprits, le poignard d'un Angoumoisin, de Ravaillac, vient attester l'invincible obstination des haines et du fanatisme de sa province.
C'est dans ces ferments de discorde toujours prêts à éclater, dans ces amas de rancunes toujours ardentes, que trouvèrent leur principal point d'appui et qu'établirent leur base d'opération les ambitions qui agitèrent les premières années du règne de Louis XIII. C'est l'Angoumois et la, Saintonge que soulèvent Rohan et Soubise, à la nouvelle de l'union projetée entre le roi et l'infante d'Autriche. C'est sur les bords de la Charente que se rencontrent le maréchal de Bois-Dauphin et le prince de Condé, commandants en chef des deux armées. Quatre ails plus tard, lors- que, dans un accès de dépit, Marie de Médicis quitte la cour, c'est à Angoulême qu'elle se réfugie, et c'est là que Richelieu vient négocier sa réconciliation avec son fils. La Fronde elle-même, enfin, si futile dans ses causes, inoffensive sur tant de points, d'une stérilité quasi ridicule presque partout, prend dans l'Angoumois les proportions d'une guerre sérieuse et aboutit à une sanglante bataille, perdue par le prince de Condé sous les murs de Cognac en 1651.
Des agitations si continuelles et si profondes avaient depuis longtemps paralysé l'essor du commerce dans l'Angoumois ; la révocation de l'édit de Nantes acheva de l'anéantir. Le règne pacifique de Louis XV, les commencements de celui de Louis XVI avaient été impuissants à réparer tant de maux. La révolution de 1789 fut accueillie dans l'Angoumois avec un enthousiasme universel et saluée comme l'aurore d'une ère réparatrice. Toutes les rivalités locales s'effacèrent, les dissentiments religieux eux-mêmes furent oubliés. Les orages mêmes qui survinrent bientôt ne découragèrent pas les espérances des habitants ; il existe plusieurs rapports des commissaires de la Convention, envoyés en mission dans le département de la Charente ils sont unanimes dans l'éloge qu'ils font de l'esprit patriotique des habitants.
Au temps des Romains, la confédération des Santones avait, comme nous l'avons dit, fourni 12 000 combattants à l'armé de Vercingétorix ; en 1793, le seul département de la Charente leva 10 000 hommes pour la défense de la République menacée. Depuis lors, le département n'a plus eu qu'un rôle passif dans les événements de l'histoire nationale.
L'amélioration de sa culture, le réveil de son commerce sont des bienfaits qu'elle doit à l'organisation moderne ; l'aspect général du pays s'est déjà notablement modifié. On sent qu'une vie nouvelle circule dans ce corps rajeuni ; l'application de la vapeur a transformé, agrandi les anciennes industries et en a créé de nouvelles. A côté des papeteries de l'Angoumois, renommées depuis si longtemps, s'élèvent de puissantes usines pour la distillerie et la fabrication du fer et de l'acier. Le nombre des filatures et des ateliers de tissage augmente de jour en jour ; le commerce, à son tour, par son activité, par l'abondance des capitaux, et grâce au perfectionnement des voies de communication et. des moyens de transport, étend d'année en année le rayon des débouchés de tous ces produits.
Ce progrès, tout sensible qu'il soit, n'est à nos yeux que le début d'une véritable renaissance. Les longues misères du passé avaient placé le département de la Charente dans une infériorité relative contre laquelle protestent et les ressources de son sol et le génie de ses habitants. Cette surexcitation que nous avons indiquée, cette marche accélérée vers les conquêtes de l'avenir, ne s'arrêtera que quand la Charente aura repris sa place parmi les plus avancés et les plus favorisés des départements de la France.
Le caractère des habitants se dépouille petit à petit de tout ce qui pourrait faire obstacle à la réalisation de nos espérances ; cette paresse contemplative, jointe à une grande instabilité dans les goûts et à un vif amour des plaisirs, ces tendances superstitieuses s'alliant à un scepticisme religieux, toutes ces inconséquences signalées par les vieux auteurs n'existent plus guère dans les villes, si elles se manifestent encore au fond de quelques campagnes ; partout on semble avoir conscience de l'avenir, et l'homme s'harmonise avec la nature qu'il embellit et qu'il féconde.