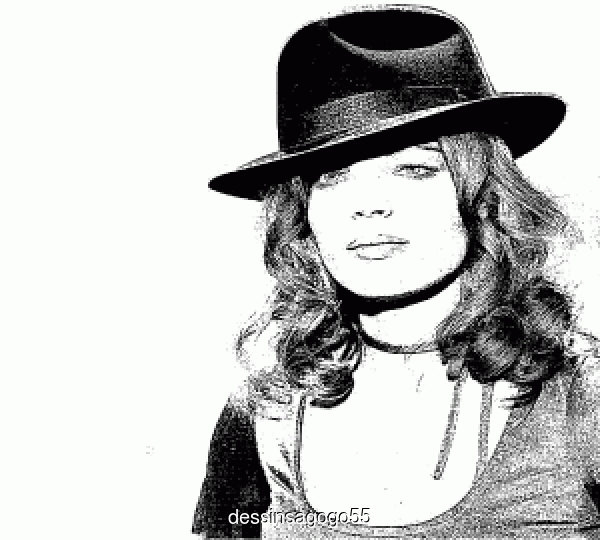Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Monde : France (3307)
· Musique (371)
· Calendrier : Événements (333)
· Monde : Etats Unis (1156)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
Thèmes
air amour annonce argent art article background base belle blogs cadre center
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Monde : Allemagne
Romy Schneider
| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Romy Schneider
| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Porsche 911
La Porsche 911 est une voiture de sport haut de gamme fabriquée par la firme allemande Porsche. La première génération est commercialisée en 1964, intégralement conçue par la firme de Stuttgart. Cinquante ans plus tard, le modèle emblématique de Porsche en conserve l'esthétique et le nom. La 911 est toujours produite et commercialisée dans sa dernière version en date, la 992. L'architecture du moteur est restée inchangée jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit du 6-cylindres à plat (flat-six), disposé en porte-à-faux arrière.
La 911 est le modèle le plus célèbre de Porsche. Huit générations se sont succédé. Les anciens modèles font aujourd’hui partie des voitures de sport les plus recherchées par les collectionneurs. Le 11 mai 2017, Porsche a célébré le millionième exemplaire de Porsche 911 produit par la marque.
15e armée (Allemagne)
La 15e armée a été mise en place le 15 janvier 1941 en France, et confié au général Curt Haase. Dans un premier temps, compte tenu des accords avec la France, elle est affectée à la protection des côtes de la Manche contre une éventuelle invasion alliée.
Il s'agit de la plus importante armée allemande du front Ouest, comptant jusqu'à 230 000 hommes, au maximum de son effectif. Le quartier général s'installe à Tourcoing, où les autorités allemandes vont construire une série de bunkers.
Elle combat avec succès au cours de l'opération Market Garden, mais elle essuie une défaite contre la 1re armée canadienne à la bataille de l'Escaut, puis contre la 2e armée britannique, lors de l'Opération Blackcock.
La 15e armée allemande a également été engagée dans la bataille des Ardennes.
Pendant la manœuvre préparatoire allemande à l'offensive des Ardennes, la 25. Armee prend le nom de couverture de 15. Armee pendant la période du 16 novembre au 16 décembre 1944. Parallèlement, la 15. Armee réelle, est transféré vers les Pays-Bas et occupe le secteur de Aachen en remplacement de la 5. Panzerarmee, avec le nom de couverture de Armeegruppe Manteuffel. La 5. Panzerarmee, transférée à l'est de la Roer, adopte le nom de couverture de Feldjägerkommando zbV.
La 15e armée se rend finalement du côté de la Ruhr le 16 avril 1945 (le général von Zangen, après avoir perdu le contrôle de ses unités subordonnées, se rendt avec son personnel le 13 avril 1945 à la 7e division blindée américaine).
Commandants successifs
| Date | Grade | Commandant |
|---|---|---|
| 15 janvier 1941 - 30 novembre 1941 | Generaloberst | Curt Haase |
| 1er décembre 1941 - 7 août 1943 | Generaloberst | Heinrich von Vietinghoff |
| 8 août 1943 - 24 août 1944 | Generaloberst | Hans von Salmuth |
| 25 août 1944 - 18 avril 1945 | General der Infanterie | Gustav-Adolf von Zangen |
Chefs d'état-major
| Date | Grade | Commandant |
|---|---|---|
| 15 janvier 1941 - 21 novembre 1941 | Oberst | Maximilian Grimmeiß |
| 9 décembre 1941 - 1er avril 1942 | Generalmajor | Heinz Ziegler |
| 1er avril 1942 - 30 avril 1942 | Generalmajor | Rolf Wuthmann |
| 1er mai 1942 -6 novembre 1944 | Generalleutnant | Rudolf Hofmann (en) |
| 6 novembre 1944 - 10 mars 1945 | Oberst | Wolf von Kahlden (en) |
| 15 mars 1945 - 13 avril 1945 | Oberst | Walter Reinhard |
Romy Schneider
| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
| RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
| SOMMAIRE | Romy Schneider (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
| CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||
| NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
| DECES | |||||||||||||||||||||||||||
| MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Romy Schneider
| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Romy Schneider
| Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
| Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
| Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
| Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Remagen
Remagen est une ville allemande de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement d'Ahrweiler sur la rive occidentale du Rhin, juste au sud de la ville de Bonn. Il s'y trouve une statue représentant une Vierge noire
Elle est bâtie sur les ruines d'un castellum romain des Limes du Rhin.
Une légende locale dit qu'un navire transportant diverses reliques de Milan à Cologne a été arrêté dans le fleuve en 1164. Il était incapable de bouger, malgré le courant, jusqu'à ce qu'il touche la rive. Les restes de Saint-Apollinaire ont ainsi été débarqués, et le navire a ensuite été en mesure de naviguer plus en avant. Ces restes ont été inhumés dans une chapelle qui avait fait partie de la forteresse romaine, et qui devint la base pour une église qui portait son nom. Celle-ci a été reconstruite à plusieurs reprises au fil des siècles.
La ville est surtout connue car s'y trouvait le dernier pont intact traversant le Rhin, le pont Ludendorff, souvent appelé pont de Remagen lors de la phase finale sur le front de l'Ouest lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands échouèrent à le détruire et les Alliés le prirent le 7 mars 1945, changeant la stratégie alliée dans ces dernières semaines du conflit et accélérant l'invasion de l'Allemagne
Appartenances historiques
Comté de Berg 1248-1425
Duché de Berg 1380-1425
Duché de Berg/ Électorat de Cologne 1425-1452
Électorat de Cologne 1452-1554
Duché de Berg/ Électorat de Cologne 1554-1560
Duché de Berg 1560-1797
République cisrhénane (Rhin-et-Moselle) 1797-1802
République française (Rhin-et-Moselle) 1802-1804
Empire français (Rhin-et-Moselle) 1804-1813
Royaume de Prusse (Grand-duché du Bas-Rhin) 1815-1822
Royaume de Prusse (Province de Rhénanie) 1822-1918
République de Weimar 1918-1933
Reich allemand 1933-1945
Allemagne occupée 1945-1949
Allemagne 1949-présent
De par sa longue histoire, la ville se distingue par la présence de nombreux monuments.
Les principaux en sont :
L'église saint-Apollinaire
L'église saint-Pierre et Paul
Le château de Marienfels
Le château d'Ernich
Le musée d'art contemporain de Rolandseck
Personnalités nées à Remagen
Adolf Galland (1912-1996) aviateur allemand
Rudolf Caracciola (1901-1959) : triple champion d'Europe des pilotes et triple champion d'Europe de la montagne.
Forêt-Noire
La Forêt-Noire (en allemand : Schwarzwald, prononcé [ ʃvaːrtsvalt]) est un massif montagneux situé dans le Sud-Ouest de l'Allemagne, dans le Land de Bade-Wurtemberg. Elle résulte de l'effondrement du graben avorté du fossé rhénan, qu'emprunte le Rhin en coulant vers le nord, lequel fleuve constitue en cet endroit la frontière entre la France et l’Allemagne. La Forêt-Noire à l'est de la plaine rhénane est le pendant géologique des Vosges à l'ouest. Elle dévoile sur ses hauteurs des paysages variés : au nord, les épicéas bordent des routes escarpées ; au centre, les vignes des coteaux cèdent la place aux pâturages et à de riches fermes-auberges ; au sud, les lacs alternent avec les hauts sommets. Le massif, distant d'environ 25 km de Strasbourg, est visible de la ville.
Toponymie
Le nom antique du massif forestier est Abnoba mons ou Abnoba silva (silva vient du latin qui veut dire « forêt »). Abnoba, la « sylve noire », est une divinité topique celte de la faune. Elle est similaire à Arduinna, latinisée en Diana Arduenna, et à Vosegus, qui président respectivement aux massifs forestiers des Ardennes et des Vosges.
Géographie
Relief
La Forêt-Noire est séparée par le fossé rhénan du massif des Vosges dont elle reprend la forme triangulaire et le type de relief, plus élevé au sud. Le plus haut sommet est le Feldberg, qui culmine à 1 493 mètres. Les autres sommets notables sont :
le Seebuck (1 448 m) ;
le Herzogenhorn (1 415 m) ;
le Belchen (1 414 m) ;
le Schauinsland (1 284 m) ;
le Kandel (1 241 m) ;
le Hinterwaldkopf (1 198 m) ;
le Blauen (1 165 m) ;
et le Hornisgrinde (1 164 m), plus haut sommet du Nord de la Forêt-Noire.
Hydrographie
Région bien irriguée, la Forêt-Noire est traversée dans sa partie centrale/est (entre Donaueschingen et Schwenningen) par la ligne de partage des eaux entre la mer du Nord et la mer Noire :
le Rhin se dirige vers la mer du Nord en contournant le massif par le sud puis par l'ouest, recevant pour affluents le Kinzig, le Murg et, à Mannheim seulement, le Neckar, qui traverse le massif en direction du nord avec ses affluents, l'Enz et le Nagold ;
le Danube se dirige vers la mer Noire à l'est et résulte, à sa source, du confluent de la Breg et de la Brigach.
La Forêt-Noire borde le plateau de la Baar au sud-est.
Histoire
Durant la guerre des Six Deniers au xve siècle, les Mulhousiens et leurs alliés mirent à feu et à sang toute l'Alsace ainsi que la Forêt-Noire.
Économie
L'économie se concentre surtout dans les vallées. La vie agricole associe l'élevage et la culture de céréales. L'industrie travaille notamment le bois issu des nombreuses forêts d'épicéas. Les industries textiles et l'horlogerie cèdent progressivement la place au tourisme. Un climat privilégié et d'importantes sources thermales lui assurent une forte fréquentation touristique. Les sources thermales aux propriétés cicatrisantes étaient déjà connues des Romains.
Les villes principales de Forêt-Noire sont Fribourg-en-Brisgau, Offenbourg, Lörrach, Baden-Baden, Villingen-Schwenningen, Furtwangen, Freudenstadt et Schramberg.
Randonnée
La Forêt-Noire est le point de passage de nombreux chemins de randonnées (23 000 km de sentiers pédestres et notamment du sentier européen E1 : le Westweg (littéralement le chemin de l'ouest) conduit les randonneurs de Pforzheim à Bâle sur 285 kilomètres en passant par le Schliffkopf et forme un tronçon du parcours E1, lequel va de la Suède à l’Italie.
Chemin de fer
Le Schwarzwaldbahn (« chemin de fer de la Forêt-Noire ») relie Offenbourg à Singen, près du lac de Constance, en deux heures. La ligne franchit un dénivelé de 670 mètres selon un tracé qui a évité la construction de ponts. Malgré les 39 tunnels, il est possible de profiter de la variété des paysages. Le tronçon le plus intéressant se situe entre Hornberg et Sankt Georgen
Réserve de biosphère
Depuis juin 2017, la Forêt-Noire est reconnue réserve de biosphère par l'Unesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt-Noire
Château d'Eltz
Le château d'Eltz (Burg Eltz) est un château médiéval niché dans les collines bordant la vallée de la Moselle, en Allemagne (arrondissement de Mayen-Coblence). Il est construit sur un promontoire rocheux surplombant la rivière Elzbach, dans le massif de l'Eifel.
La première référence historique est un acte de donation du domaine en 1157, de Frédéric Barberousse à Rudolf zu Eltz. Depuis cette époque, le château a subi de nombreuses modifications, mais il n'a jamais été détruit et reste la propriété de la même famille, pendant 33 générations. Dès le Moyen Âge, trois héritiers se sont partagé le domaine. Chaque lignée a ensuite procédé à de nouvelles constructions, ce qui explique le foisonnement actuel de tourelles et de logis.
De nos jours, la visite du château permet de découvrir ses plafonds de bois, ses fresques murales et un mobilier cossu. Une salle à part est consacrée au trésor du château.
Importance stratégique
Il semble que l'intérêt stratégique de cet emplacement sur le cours inférieur de l'Elz (ou Eltz), affluent de la Moselle, ait été un facteur déterminant pour la construction de ce premier château-fort qui fut ainsi élevé tout près de la Moselle – de tout temps l'une des voies commerciales les plus importantes – et en un lieu d'où l'accès au fertile Maifeld était des plus faciles. L'emplacement permettait de surveiller sur deux côtés l'accès à la vallée de l'Eltz ainsi que la voie reliant le Maifeld à la Moselle. Le piton rocheux de forme elliptique, 70 m en son point le plus élevé, baigné sur trois côtés par les eaux de l'Eltz, forme les fondations de l'ensemble du château qui – obéissant aux données naturelles – est construit sur un plan ovale.
Moyen Âge
Avant 1268, les frères Elias, Wilhelm et Theoderich procèdent à un ganerbinat, c'est-à-dire au partage du château et des domaines qui en dépendent. C'est alors qu'apparaissent trois lignées principales de la maison Eltz, lesquelles prennent le nom de leurs blasons Eltz du Lion d'Or, Eltz du Lion d'Argent et Eltz des Cornes de Buffle. Dès lors, le château d'Eltz fut, typologiquement, un château détenu par les cohéritiers, où vivaient ensemble plusieurs lignées de la maison d'Eltz dans une communauté d'héritage et d'habitat. Des «lettres de paix du château» assuraient une cohabitation paisible entre les cohéritiers, fixant leurs droits et leurs devoirs ainsi que les modalités d'administration et d'entretien du château. La plus ancienne de ces lettres, qui ait été conservée, date de l'année 1323. Les cohéritiers («Ganerben», en ancien allemand «ganarpeo») sont membres d'une communauté d'héritiers qui cohabitent sur un bien hérité divisé. La communauté « de pot et de rôt » n'était pas de règle. Les cohéritiers vivaient séparément sur la base du partage de l'usufruit.
Dans toute l'histoire du château d'Eltz, cette guerre d'Eltz resta la seule affaire militaire importante.
Dans la diversité architecturale qui frappe le visiteur dès son entrée dans la cour intérieure, on remarque tout particulièrement la façade de la maison Rübenach donnant sur cette cour : les tourelles en pans de bois et au plan polygonal, l'avant-corps en encorbellement, restauré, de ligne dépouillée et sévère, reposant sur deux colonnes de basalte et surmontant la porte d'entrée de la maison et, surtout, le charme du style fin du gothique de l'encorbellement abritant une chapelle.
Renaissance
L'entrée principale des maisons Kempenich est abritée par un porche portant, à l'étage supérieur, une salle en encorbellement soutenue par deux piliers octogonaux en basalte. Sur les arcs en plein cintre reliant les piliers, on trouve les inscriptions BORGTORN ELTZ 1604 et ELTZ-MERCY qui nous renseignent sur le début de la construction et sur les initiateurs de la construction de ces maisons. Mais les travaux ne prirent de l'ampleur et ne furent achevés que sous Hans Jacob von Eltz et son épouse Anna Elisa¬beth von Metzenhausen, fait commémoré par les clefs de la voûte en arête surmontant le porche (1651), clefs de voûte portant les armes d'Eltz et de Metzenhausen que l'on retrouve, sous forme de splendides armes d'alliance baroques, sculptées dans le grès, au-dessous de la fenêtre centrale de l'encorbellement datant de 1661. Ces mêmes armes ornent également les corbeilles de fenêtres en fer forgé, dans la salle du rez-de-chaussée de la maison Kempenich, ainsi qu'un blason sur la grille de la cour.
Les Eltz
La lignée des von und zu Eltz a bien mérité des électorats de Mayence et de Trèves et elle a produit, en la personne de Jacob von Eltz (1510-1581), l'un des princes électeurs les plus importants dans l'histoire de l'archevêché de Trèves. Il fit ses études à Louvain, devint en 1564, entre autres, recteur de l'Université de Trèves, et fut élu prince électeur par le chapitre de la cathédrale réuni dans l'église Saint-Florin de Coblence, le 7 avril 1567. À l'encontre de bon nombre de ses prédécesseurs et d'autres princes ecclésiastiques, Jacob avait été consacré prêtre bien avant d'entrer en fonction. Il devint l'un des principaux chefs de la Contre-Réforme et fit de l'ordre des Jésuites son principal allié dans la poursuite de ses desseins.
Autre membre de la famille des Eltz ayant occupé des fonctions importantes dans l'électorat de Trèves, Hans Jacob von Eltz se vit confier par le prince électeur de Trèves, le 15 juin 1624, le maréchalat héréditaire et, ainsi, le commandement sur le corps des chevaliers et le commandement en chef en temps de guerre.
Les Eltz jouèrent un rôle de premier plan et eurent accès au pouvoir non seulement à Trèves mais aussi à Mayence. Le 9 juin 1732, Philipp Karl fut élu prince électeur à l'unanimité par le chapitre de la cathédrale de Mayence. Ces fonctions faisaient de lui le chef spirituel et le prince ecclésiastique le plus puissant au nord des Alpes. Premier personnage de l'Église allemande, il venait tout de suite après le pape par son rang. En qualité de grand chancelier de l'Empire, il présida la diète de Ratisbonne où il était le personnage le plus important après l'empereur. À Francfort, Philipp Karl appela les huit autres princes électeurs à émettre leur suffrage avant de donner lui-même sa voix, la neuvième décidant du vote.
Les propriétés de la maison des Eltz étaient très importantes, en particulier dans les électorats de Trèves et de Mayence. Les domaines des Eltz près de Coblence, Trèves, Boppard, Wurtzbourg, Mayence, Eltville, indiquent les points de concentration des intérêts des Eltz. En 1736, la famille fit l'acquisition, pour 175 000 florins rhénans, de la seigneurie de Vukovar, non loin de Belgrade. De loin la propriété la plus importante de la famille, cette seigneurie fut, du milieu du xixe siècle jusqu'à l'expulsion violente de 1944, le domicile principal de la branche des Eltz du Lion d'Or qui, depuis la Seconde Guerre mondiale vit dans le Eltzer Hof à Eltville sur le Rhin (depuis le xvie siècle, cette ligne principale de la maison Eltz porte également le nom Eltz-Kempenich).
En 1733, à Vienne, l'empereur Charles VI décerna à la ligne du Lion d'Or le titre de comte de l'Empire en raison des services rendus pendant l'époque troublée de la Réforme et dans les guerres contre les Turcs. En outre, il leur accordait le privilège d'anoblir au nom de l'empereur, de nommer des notaires, de légitimer les enfants naturels, d'accorder des armes avec écu et cimier, de nommer greffiers et juges, d'affranchir les serfs, etc.
Le château d'Eltz est l'un des rares burgs rhénans jamais détruits par la violence. Grâce à une diplomatie habile, pratiquée en particulier par la maison des Eltz-Bliescastel-Braunschweig, la seule ligne protestante, il fut possible de traverser sans dommage les troubles de la guerre de Trente Ans. Pendant la guerre de Succession du Palatinat (1688 - 1689), au cours de laquelle un grand nombre de burgs rhénans furent détruits, Johann-Anton von Eltz-Uettingen, officier des armées françaises, parvint à préserver le château d'Eltz de la destruction.
Lors de l'occupation des pays rhénans par les Français (1795 -1815), considéré comme émigrant, le comte Hugo Philipp se vit confisquer ses domaines sur le Rhin et dans l'électorat de Trèves. Lui-même s'entendait appeler « citoyen comte Eltz ». Le château d'Eltz, et toutes ses dépendances, fut placé sous la dépendance de la place de Coblence. Par la suite, il s'avéra toutefois que le comte Hugo Philipp n'avait pas émigré mais était resté à Mayence et, en 1797, il recouvra la jouissance de ses biens et de ses rentes. En 1815, ayant acquis la maison Rübenach et les propriétés foncières du baron d'Eltz-Rübenach, le comte Hugo Philipp devint le seul propriétaire du château. En effet, la ligne Eltz-Rodendorf s'étant éteinte en 1786, son héritage était déjà revenu aux Eltz-Kempenich.
Au xixe siècle, enfin, dans le contexte du romantisme et de l'intérêt croissant pour le Moyen Âge, le comte Charles s'employa habilement à la restauration du château familial. Ces travaux se prolongèrent pendant une période allant de 1845 à 1888 environ et engloutirent 184 000 marks. Le comte Charles fit élaborer une Histoire des seigneurs et comtes d'Eltz par F. w. E. Roth, ouvrage publié en deux volumes, en 1890, à Mayence. Au xixe siècle, après achèvement des travaux de restauration mais auparavant également, des personnalités de premier plan ont visité le château d'Eltz et rendu hommage aux efforts du comte Charles : nous mentionnerons seulement l'empereur Guillaume II et Victor Hugo.
Depuis 800 ans, le château d'Eltz est la propriété de la famille du même nom, l'actuel propriétaire du château étant le comte Jakob von und zu Eltz-Kempenich. Faust von Stromberg vit à Eltville sur le Rhin où la famille possède depuis le milieu du xviiie siècle une résidence et un vignoble de réputation internationale. Depuis cette époque, le château est habité par des administrateurs qui ont porté, selon les époques, des titres comme gouverneurs ou intendants du château.
Le château actuel
La visite guidée du château permet de visiter la plupart des pièces principales .
La maison Rübenach : terminée en 1472 par Wihelm von Eltz et son épouse Katarina, elle comporte huit étages. Rübenach est un territoire de la région de Coblence acquis par les Eltz du Lion d'Argent au xiiie siècle.
La salle d'armes : à l'origine salle de réception de la maison Rübenach, on y conserve, depuis le xixe siècle une collection d'armes anciennes : arquebuses, hallebardes, canon, fusils... dont les plus anciennes datent du siège de 1333.
La salle de séjour des Rübenach est typiquement une salle de séjour d'un châtelain au xvie siècle avec son plafond à solives, sa grande cheminée et ses tapisseries flamandes. Elle est décorée de panneaux peints, en bois. Une peinture de Lucas Cranach l'Ancien représente la « Madone à la grappe de raisin ».
La chambre à coucher des Rübenach était la chambre principale de la maison pendant des siècles. L'encorbellement contient une petite chapelle. Cette chambre possède une des 20 latrines du château.
La maison Rodenhof comporte 10 étages et fut construite en 1470 par Philippe d'Eltz. Elle doit son nom aux terres que la famille possédait en Lorraine.
La salle des Princes-électeurs : deux membres de la famille Eltz sont devenus princes-électeurs : Jakob III, archevêque de Trèves (1567-1581) et Philippe-Karl, archevêque de Mayence.
La salle des Chevaliers était la salle des fêtes du château, utilisée lors des réunions familiales. On y expose aujourd'hui des armes et des armures dont une, très imposante, date de l'époque de Maximilien Ier du Saint-Empire.
La chambre des comtesses était probablement de la chambre des enfants de la famille. Le lit exposé (1525) est un des plus anciens conservés en Allemagne.
La salle des bannières fut utilisée pendant des siècles comme salle à manger mais un certain nombre d'indices (son orientation, la disposition de l'encorbellement) font penser qu'il s'agit à l'origine d'une chapelle.
La cuisine fut construite au début du xvie siècle et a été conservée dans son état initial, à peu de chose près.
La salle du trésor présente quelque 500 objets : orfèvrerie, argenterie, bijoux, sculptures sur ivoire, armes, etc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Eltz