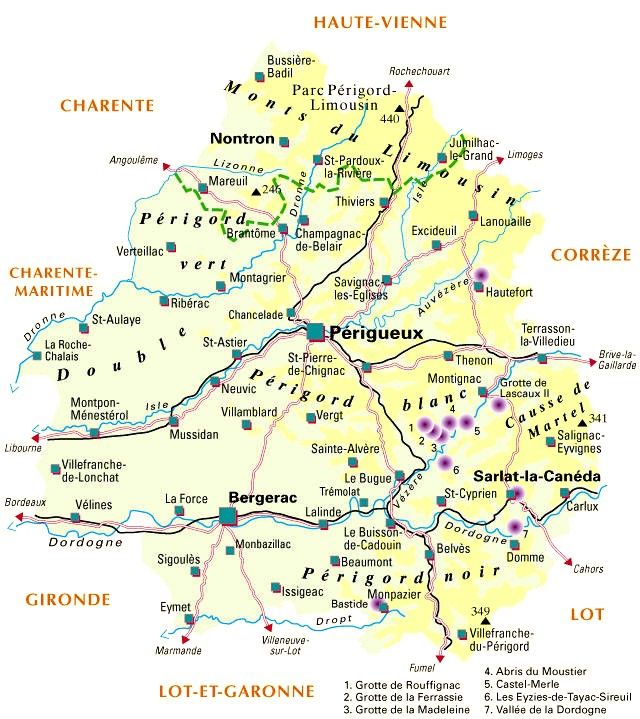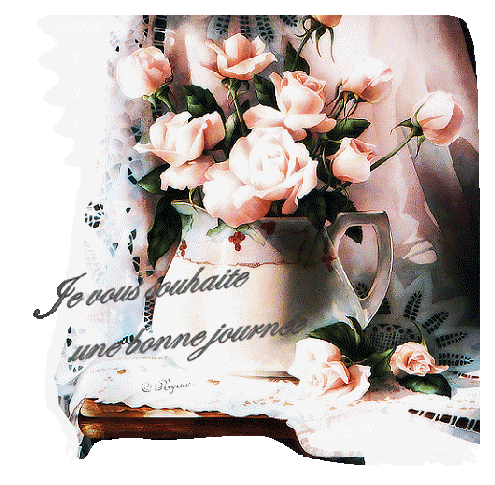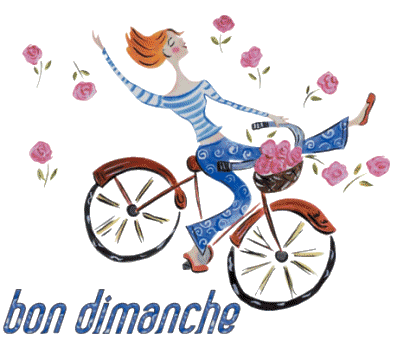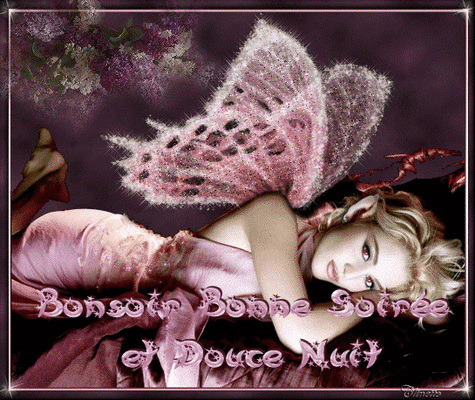Thèmes
animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
Recherchez aussi :
Statistiques
- · le symbolisme dans le roman la rose des vents
- · passage obligé minarik
- · les bienfaits et les mefaits des invertebres
- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman
- · valerie maurice est elle mariee
- · les bienfaits des invertebres
- · turfvoyance@yahoo.fr
- · gouran tchad
- · bamwisho muhiya jean
- · royauxnorvegiens
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Les départements - Le Doubs - 25 - (premiere partie)
Publié à 14:18 par acoeuretacris
(Région Franche-Comté)
Le département du Doubs fut, dans la période gauloise, habité par une partie de la nation puissante des Séquanais. On ignore à quelle époque ce peuple envahit la Gaule ; mais il paraît certain qu'il fut parmi les Celtes un des premiers qui s'y fixèrent. La tradition disait qu'ils étaient venus des bords du Pont-Euxin. Lorsque les neveux, du roi Ambigat, Bellovèse et Sigovèse, franchirent les Alpes 600 ans avant Jésus-Christ, les Séquanais furent au nombre des barbares qui portèrent pour la première fois en Italie les armes gauloises.
Ce fut à l'époque où la domination romaine commença à s'étendre par delà les hautes montagnes qui séparent l'Italie de la Gaule que les Séquanais acquirent une grande importance historique. On sait que Rome accordait sa protection aux Éduens : cette vaste confédération mit à profit la suprématie qu'elle devait au titre de « soeur et alliée du peuple romain » pour tyranniser ses voisins les Arvernes et les Séquanais. Jaloux de cette puissance, les Séquanais cherchèrent à leur tour des alliés au dehors ; ils attirèrent en Gaule, par l'appât d'une forte solde, 15 000 mercenaires germains conduits par Arioviste, le chef le plus renommé des Suèves, vaste confédération teutonique qui dominait dans la Germanie.
Grâce à ce secours, les Séquanais furent vainqueurs et les Éduens se reconnurent leurs clients ; mais bientôt ils furent plus malheureux que les vaincus ; Arioviste, qu'était venue rejoindre une multitude de barbares, exigea des Séquanais un tiers de leur territoire ; il prit la partie la plus rapprochée de la Germanie, celle qui aujourd'hui forme le département du Doubs ; puis, jugeant ce lot insuffisant, il exigea un autre tiers. Les Séquanais, indignés, se réconcilièrent alors avec les Éduens ; il y eut une grande bataille où l'armée gauloise fut taillée en pièces. Nous parlerons, dans la notice sur la Haute-Saône, de cette sanglante défaite de Magetobriga. Arioviste fut alors maître de tout ce pays, « le meilleur de la Gaule », dit César au livre Ier de ses Commentaires.
Mais la conquête du chef suève avait encouragé d'autres barbares à envahir les Gaules ; on connaît ce grand mouvement des Helvètes qui détermina l'intervention de Rome et de Jules César. L'an 58, le proconsul, après avoir fait alliance avec Arioviste, quitta la province, marcha sur Genève avec une seule légion, coupa le pont du Rhône, retourna à Rome chercher son armée et revint, par une de ces marches rapides qui lui frirent depuis familières, accabler les Helvètes. Vainqueur de ces premiers ennemis, César se tourna contre Arioviste et lui enjoignit de quitter le pays des Éduens et des Séquanais. « Que César vienne contre moi, répondit le Suève, il apprendra ce que peuvent d'invincibles Germains qui depuis quatorze ans n'ont pas couché sous un toit. » Le Proconsul entra aussitôt en Séquanaise, gagna son ennemi de vitesse et s'empara de la capitale du pays, Vesontio, où il établit sa place d'armes et ses magasins.
La bataille, dans laquelle la discipline romaine triompha du nombre et de l'impétuosité des barbares, se livra à trois journées de Besançon, vers le nord-est. Les Séquanais furent délivrés de leurs oppresseurs germains ; mais' ils ne firent que changer de maîtres : les Romains occupèrent militairement leur pays, y envoyèrent des administrateurs et des agents ; la domination romaine savante, policée et durable s'établit au mi-lieu d'eux. Ceux des Séquanais qui regrettaient les temps de l'indépendance gauloise quittèrent leur patrie et remontèrent vers le nord, afin d'exciter contre leurs oppresseurs les peuples belges ; ces Gaulois intrépides et sauvages se prêtèrent facile-ment à ce dessein ; leurs attaques furent pour César l'occasion et le prétexte de la conquête des Gaules ; il était à Besançon quand commencèrent les hostilités.
L'indépendance de toute la Gaule, et en particulier celle des Séquanais, fut perdue sans retour par la soumission de Vercingétorix. A partir de ce moment, ils restèrent fidèles aux traités et servirent avec loyauté dans les armées romaines. Lucain fait un grand éloge de la cavalerie séquanaise et nous représente la légion vésontine marchant au combat avec sa vieille enseigne : un globe d'or dans un cercle rouge. Auguste avait compris la Gaule transalpine dans les provinces impériales et classé la Séquanaise dans la Belgique (28 ans av. J.-C.) ; cette province prit le nom de Maxima Sequanorum à l'époque de la division administrative de Dioclétien et eut pour capitale Besançon (292).
Au IIe et au IIIe siècle, une, grande partie de la Séquanaise était chrétienne. De Lyon, la foi nouvelle remonta, vers le nord de la Gaule ; en 180, deux jeunes Athéniens, disciples de l'évêque Irénée, Ferréol et Ferjeux, portèrent la foi évangélique chez les Séquanais ; ils firent un si grand nombre de prosélytes, que Besançon ne tarda pas à devenir le siège d'une nouvelle église dont Ferréol fut le premier évêque. Mais les deux disciples de saint Irénée payèrent de leur sang leur généreuse propagande : ils firent mis à mort en 211. Saint Lin, saint Germain et les autres successeurs de saint Ferréol étendirent la foi chrétienne malgré les persécutions, et, au temps de Dioclétien, la Séquanaise entière était convertie au christianisme.
A cette époque, les provinces de la Gaule qui confinaient à la Germanie n'avaient pas de repos ; elles étaient sans cesse menacées par les barbares. Avant les invasions définitives des Burgondes et des Francs, les habitants de la Séquanaise eurent à souffrir d'un grand nombre d'incursions passagères. Lorsque Julien, alors césar, se rendit à Besançon, après ses victoires sur les Francs et les Allemands. dans les années 358 et 359, il trouva toute la province dont cette ville est la capitale ravagée et, à Besançon même, il ne vit que des traces de dévastation : « Cette petite ville, écrit-il au philosophe Maxime, maintenant renversée, était autrefois étendue et superbe, ornée. de temples magnifiques et entourée de murailles très fortes, ainsi que la rivière du Doubs qui lui sert de défense. Elle est semblable à un rocher élevé qu'on voit dans la mer et presque inaccessible aux oiseaux mêmes, si ce n'est dans les endroits qui servent de rivage au Doubs. »
Avant de se jeter sur l'Espagne, les Vandales laissèrent aussi en Séquanaise des traces de leur passage. Ce fut enfin en 410 que l'une des invasions définitives qui se fixèrent sur le sol et lui donnèrent pendant longtemps son nom, celle des Burgondes, se répandit dans la Séquanaise. Les nouveaux maîtres, de mœurs paisibles et douces, ne furent pas des oppresseurs ; ils se contentèrent de s'approprier une partie du sol sans établir des impôts onéreux et vexatoires ; ils laissèrent à leurs sujets leurs lois romaines, leur administration municipale et vécurent avec eux dans une égalité parfaite, chacun selon ses lois. Le patrice Aétius chassa momentanément les Burgondes de la Séquanaise, de 435 à 443 environ. Aux ravages occasionnés par cette guerre s'en ajoutèrent de bien plus terribles. Attila, battu à Châlons-sur-Marne (451), fit sa retraite par l'orient de la Gaule, et Besançon fut tellement ruinée par les Huns que pendant cinquante ans elle resta déserte.
L'établissement définitif des Bourguignons dans les pays éduen et séquanais, qui devinrent les deux Bourgognes, date de l'année 456. Le Suève Ricimer, héritier des dignités d'Aétius qui venait d'être mis à mort par Valentinien III, partagea ces pays entre les chefs burgondes Hilpéric et Gondioc, avec lesquels il avait formé une alliance de famille. Gondioc laissa en mourant le territoire de Besançon et cette ville à l'un de ses quatre fils, Godeghisel, uni à Gondebaud et devenu maître de toute la Séquanaise par le meurtre de deux de ses frères. Godeghisel fit secrètement alliance avec le roi des Francs Clovis et abandonna son frère dans la bataille qui eut lieu sur les bords de l'Ouche en 500. Gondebaud tira vengeance de cette trahison : lorsqu'il eut obtenu la paix de Clovis, il tourna ses armes contre son frère, le battit et le fit massacrer. Gondebaud fut alors maître du territoire séquanais et y imposa son code, la célèbre loi Gombette, jusqu'au moment où les fils de Clovis prirent aux enfants de Gondebaud tout leur héritage et s'emparèrent de la Bourgogne (534).
Lorsque la monarchie franque fut partagée entre les quatre fils de Clotaire Ier, le pays dont nous nous occupons échut avec toute la Bourgogne à Gontran (561-593). Grâce à son éloignement des champs de bataille, il traversa sans trop de vicissitudes cette période de la domination des Francs. Ses nouveaux maîtres étaient cependant de mœurs moins douces que les paisibles Bourguignons ; Besançon commençait à se relever des ruines et des désastres des invasions précédentes, quand survinrent les Sarrasins. En 722, les hordes d'Abd-el-Rhaman passent la Loire, remontent la Saône, se divisent vers Autun en deux bandes : l'une se dirige vers l'ouest, tandis que la seconde livre aux flammes Besançon et tout le pagus de Warasch ou Varasque, qui se composait alors du territoire aujourd'hui compris dans le département du Doubs. Tandis que la Bourgogne citérieure ou en deçà de la Saône commençait à former ses divisions féodales et à se diviser en comtés, la Bourgogne ultérieure ou Franche-Comté conservait les divisions barbares qui avaient pris naissance avec les Burgondes et s'appelaient pagi.
Pépin le Bref laissa à sa mort (768) les deux Bourgognes à son fils Carloman ; on sait que ce prince n'en jouit pas longtemps ; se retirant dans un monastère, il laissa ses États à des enfants en bas âge qui furent dépossédés par leur oncle Charlemagne. L'histoire du département du Doubs se confond avec celle du vaste empire du héros germain ; on sait seulement que les Bourgognes profitèrent de la réforme administrative à laquelle il soumit tous ses États ; mais ce ne fut pas pour longtemps ; les troubles du règne de Louis le Débonnaire survinrent, puis les discordes de ses fils lui survécurent.
Après la bataille de Fontanet (841) et le traité de Verdun (843), les deux Bourgognes furent séparées pour la première fois. La Bourgogne éduenne échut à Charles le Chauve et la Bourgogne séquanaise à Lothaire. Cet empereur mourut en 855. La haute Bourgogne ou Bourgogne cisjurane entra dans la part du plus jeune de ses trois fils, Charles, roi de Provence. A la mort de ce prince (863), ses frères Louis II et Lothaire II firent deux parts de son royaume ; la haute Bourgogne fut scindée, la plus grande partie du territoire qui forme le département du Doubs échut avec Besançon à Lothaire II.
Lothaire ne survécut que de six ans à son frère Charles. Le roi de France, Charles le Chauve, profita des embarras et des guerres dans lesquels son neveu, Louis II, était engagé en Italie pour se saisir des États de Lothaire II ; il se fit proclamer roi de Lorraine à Metz ; mais Louis II protesta, et un nouveau partage plus bizarre que tous les précédents eut lieu. La haute Bourgogne fut complètement démembrée, le pagus de Varasque, qui. avait pris le nom de Comté, échut à Louis, depuis Besançon jusqu'à Pontarlier, tandis que Besançon même était concédée à Charles le Chauve par un traité conclu au mois d'août 870.
Pour se reconnaître dans cette multiplicité de partages où l'historien lui-même, s'il veut ne pas se perdre, a besoin d'apporter une attention soutenue, il faut bien songer que les noms de haute Bourgogne, Bourgogne ultérieure et Bourgogne cisjurane s'appliquent tous également à cet ancien pays des Séquanais que nous n'avons pas encore le droit d'appeler du nom de Franche-Comté. Tant de dislocations et de changements nuisaient aux relations et aux intérêts des localités et faisaient périr tous les éléments d'unité et de pouvoir. La partie de la haute Bourgogne qui échut a Charles le Chauve protesta contre le partage de 870 ; Gérard de Roussillon, ce héros du premier temps féodal, gouverneur de Provence et de Bourgogne, s'opposa par les armes à son exécution ; ce fut aux environs de Pontarlier que se livra la bataille qui décida en faveur du roi de France :
Entre le Doubs et le Drugeon
Périt Gérard de Roussillon
dit une vieille tradition. Gérard ne périt pas, mais fut chassé et cessa de contester à Charles l'occupation du pays. Nous retrouvons deux fois le prince à Besançon ; la première à la suite de sa victoire,, la seconde lorsque, après la mort de son neveu Lothaire II (875), il descendit en Italie pour s'y faire couronner empereur. On sait que, l'année même de sa mort (877), Charles le Chauve ratifia, par le fameux capitulaire de Kiersy-sur-Oise, les usurpations de la féodalité.
Le gouverneur des Bourgognes et de la Provence, Boson, n'avait pas attendu la sanction royale pour se rendre indépendant dans les pays qui lui étaient confiés ; mais ce fut seulement en 879, à la mort de Louis le Bègue, qu'il tint à Mantaille une diète générale où, entre autres personnages influents, nous voyons figurer l'archevêque de Besançon. Il se fit donner le titre de roi de Bourgogne. L'année qui suivit sa mort (888), les Normands ravagèrent la haute Bourgogne ; son successeur, en bas âge, Louis, était incapable de défendre les États de son père ; il fut dépossédé du comté de Bourgogne ou Bourgogne cisjurane par son oncle Rodolphe, qui avait séduit Thierry Ier, archevêque de Besançon, en lui offrant le titre de grand chancelier de Bourgogne.
Ce ne fut cependant pas sans opposition de la part d'Arnoul, que les Germains s'étaient donné pour roi après avoir déposé le lâche empereur Charles le Gros à la diète de Tribur (887), et de la part du jeune Louis de Provence, héritier légitime de cette contrée. Mais Arnoul céda devant la résistance obstinée de Rodolphe, Louis fut vaincu et le prince usurpateur régna paisiblement jusqu'à sa mort, arrivée en 911.
Cette période de guerres et de ravages fut pour la comté de Bourgogne l'une des plus malheureuses qu'elle vit jamais ; les brigandages, tous les excès impunis, dix pestes, treize famines ravagèrent toute cette contrée : c'était le prélude du Xe siècle, « le siècle de fer. » Sous le règne de Rodolphe II, qui succéda sans opposition à son père, en 937, un nouveau fléau apparut dans la contrée : les Hongrois, plus féroces encore que les Normands, s'y précipitèrent, mettant tout à feu et à sang sur leur passage ; devant eux les populations fuyaient épouvantées vers les montagnes et dans les lieux fortifiés ; les barbares s'abattirent sur Besançon. La ville ne put pas résister à leur fureur et fut prise d'assaut, pillée, réduite en cendres. L'église Saint-Étienne s'écroula dans les flammes. Le feu, poussé par un vent violent, gagna le sommet du mont Calius et dévora tout, églises, édifices et demeures.
C'était pour la quatrième fois depuis la conquête romaine que l'antique capitale des Séquanais passait par de semblables épreuves. Rodolphe II mourut, l'année même de ce désastre, laissant un jeune fils, Conrad, qui, sans jamais exercer la royauté, porta pendant un demi-siècle le titre de roi. Les véritables maîtres de la Bourgogne cisjurane et transjurane furent l'empereur d'Allemagne Othon, qui s'empara du jeune Conrad et exerça une grande influence dans ses États, et le premier comte propriétaire de ce pays, selon le savant dom Plancher, Hugues le Noir, deuxième fils de Richard le Justicier. Vers cette époque apparut sur les bords de la Saône un étranger qui fit dans le pays de Bourgogne une rapide fortune. Albéric de Narbonne s'enrichit par l'exploitation des salines, puis il gagna la confiance du roi Conrad, qui le combla de bienfaits.
A sa mort (945), il était comte de Mâcon, baron de Scodingue et du Varasque ; la fortune de sa famille ne périt pas avec lui ; de ses deux fils, l'un, Albéric, comme son père, commença la série des sires de Salins que nous verrons à l'histoire du département du Jura ; l'autre, Letalde, fut la tige des comtes héréditaires de Bourgogne. Il hérita de ce comté à la mort de Gislebert, successeur, dans ce titre, de lingues le Noir, mort en 951 sans postérité. Letalde, à l'exemple de Hugues le Noir, prit le titre d'archicomte. Sa race directe s'éteignit en 995, et la partie de la Bourgogne qu'il avait possédée revint à Othe Guillaume, qui fut le premier comte héréditaire de cette province.
Fils du roi lombard Adalbert, l'un des seigneurs les plus renommés des deux Bourgognes, audacieux et entreprenant, Othe Guillaume fut un véritable souverain. Irrité de l'influence qu'exerçaient dans le pays les abbés, l'évêque et les vassaux intermédiaires, il s'arrogea le droit de nommer les uns et supprima les autres. Ce fut ainsi que disparurent les anciens comtés de Varasque, Scodingue, Besançon, etc. Sur ces entrefaites, la monarchie carlovingienne avait été renversée par les ducs de France, qui avaient usurpé le titre de roi.
Robert, fils de Hugues Capet, héritait du duché de Bourgogne à la mort de Henri Ier (1002). Othe osa élever des prétentions contraires et disputer cette province au roi de France ; il ne réussit pas à joindre à ses États cette vaste possession ; mais, par le traité de 1016, il acquit les comtés de Mâcon et de Dijon. Le comte de Bourgogne mourut dans cette dernière ville en 1027. Son fils Rainaud Ier lui succéda ; il refusa d'abord de reconnaître la suzeraineté de l'empereur de Germanie, Henri III, fils de Conrad. prenant part à la première croisade. On sait que la fin du XIe siècle fut l'un des moments où l'esprit de foi et de piété anima le plus le moyen âge. Pendant que des seigneurs allaient en pèlerinage au tombeau de Jésus-Christ, d'autres enrichissaient les monastères et les comblaient des marques de leur munificence.
Le département du Doubs fut, dans la période gauloise, habité par une partie de la nation puissante des Séquanais. On ignore à quelle époque ce peuple envahit la Gaule ; mais il paraît certain qu'il fut parmi les Celtes un des premiers qui s'y fixèrent. La tradition disait qu'ils étaient venus des bords du Pont-Euxin. Lorsque les neveux, du roi Ambigat, Bellovèse et Sigovèse, franchirent les Alpes 600 ans avant Jésus-Christ, les Séquanais furent au nombre des barbares qui portèrent pour la première fois en Italie les armes gauloises.
Ce fut à l'époque où la domination romaine commença à s'étendre par delà les hautes montagnes qui séparent l'Italie de la Gaule que les Séquanais acquirent une grande importance historique. On sait que Rome accordait sa protection aux Éduens : cette vaste confédération mit à profit la suprématie qu'elle devait au titre de « soeur et alliée du peuple romain » pour tyranniser ses voisins les Arvernes et les Séquanais. Jaloux de cette puissance, les Séquanais cherchèrent à leur tour des alliés au dehors ; ils attirèrent en Gaule, par l'appât d'une forte solde, 15 000 mercenaires germains conduits par Arioviste, le chef le plus renommé des Suèves, vaste confédération teutonique qui dominait dans la Germanie.
Grâce à ce secours, les Séquanais furent vainqueurs et les Éduens se reconnurent leurs clients ; mais bientôt ils furent plus malheureux que les vaincus ; Arioviste, qu'était venue rejoindre une multitude de barbares, exigea des Séquanais un tiers de leur territoire ; il prit la partie la plus rapprochée de la Germanie, celle qui aujourd'hui forme le département du Doubs ; puis, jugeant ce lot insuffisant, il exigea un autre tiers. Les Séquanais, indignés, se réconcilièrent alors avec les Éduens ; il y eut une grande bataille où l'armée gauloise fut taillée en pièces. Nous parlerons, dans la notice sur la Haute-Saône, de cette sanglante défaite de Magetobriga. Arioviste fut alors maître de tout ce pays, « le meilleur de la Gaule », dit César au livre Ier de ses Commentaires.
Mais la conquête du chef suève avait encouragé d'autres barbares à envahir les Gaules ; on connaît ce grand mouvement des Helvètes qui détermina l'intervention de Rome et de Jules César. L'an 58, le proconsul, après avoir fait alliance avec Arioviste, quitta la province, marcha sur Genève avec une seule légion, coupa le pont du Rhône, retourna à Rome chercher son armée et revint, par une de ces marches rapides qui lui frirent depuis familières, accabler les Helvètes. Vainqueur de ces premiers ennemis, César se tourna contre Arioviste et lui enjoignit de quitter le pays des Éduens et des Séquanais. « Que César vienne contre moi, répondit le Suève, il apprendra ce que peuvent d'invincibles Germains qui depuis quatorze ans n'ont pas couché sous un toit. » Le Proconsul entra aussitôt en Séquanaise, gagna son ennemi de vitesse et s'empara de la capitale du pays, Vesontio, où il établit sa place d'armes et ses magasins.
La bataille, dans laquelle la discipline romaine triompha du nombre et de l'impétuosité des barbares, se livra à trois journées de Besançon, vers le nord-est. Les Séquanais furent délivrés de leurs oppresseurs germains ; mais' ils ne firent que changer de maîtres : les Romains occupèrent militairement leur pays, y envoyèrent des administrateurs et des agents ; la domination romaine savante, policée et durable s'établit au mi-lieu d'eux. Ceux des Séquanais qui regrettaient les temps de l'indépendance gauloise quittèrent leur patrie et remontèrent vers le nord, afin d'exciter contre leurs oppresseurs les peuples belges ; ces Gaulois intrépides et sauvages se prêtèrent facile-ment à ce dessein ; leurs attaques furent pour César l'occasion et le prétexte de la conquête des Gaules ; il était à Besançon quand commencèrent les hostilités.
L'indépendance de toute la Gaule, et en particulier celle des Séquanais, fut perdue sans retour par la soumission de Vercingétorix. A partir de ce moment, ils restèrent fidèles aux traités et servirent avec loyauté dans les armées romaines. Lucain fait un grand éloge de la cavalerie séquanaise et nous représente la légion vésontine marchant au combat avec sa vieille enseigne : un globe d'or dans un cercle rouge. Auguste avait compris la Gaule transalpine dans les provinces impériales et classé la Séquanaise dans la Belgique (28 ans av. J.-C.) ; cette province prit le nom de Maxima Sequanorum à l'époque de la division administrative de Dioclétien et eut pour capitale Besançon (292).
Au IIe et au IIIe siècle, une, grande partie de la Séquanaise était chrétienne. De Lyon, la foi nouvelle remonta, vers le nord de la Gaule ; en 180, deux jeunes Athéniens, disciples de l'évêque Irénée, Ferréol et Ferjeux, portèrent la foi évangélique chez les Séquanais ; ils firent un si grand nombre de prosélytes, que Besançon ne tarda pas à devenir le siège d'une nouvelle église dont Ferréol fut le premier évêque. Mais les deux disciples de saint Irénée payèrent de leur sang leur généreuse propagande : ils firent mis à mort en 211. Saint Lin, saint Germain et les autres successeurs de saint Ferréol étendirent la foi chrétienne malgré les persécutions, et, au temps de Dioclétien, la Séquanaise entière était convertie au christianisme.
A cette époque, les provinces de la Gaule qui confinaient à la Germanie n'avaient pas de repos ; elles étaient sans cesse menacées par les barbares. Avant les invasions définitives des Burgondes et des Francs, les habitants de la Séquanaise eurent à souffrir d'un grand nombre d'incursions passagères. Lorsque Julien, alors césar, se rendit à Besançon, après ses victoires sur les Francs et les Allemands. dans les années 358 et 359, il trouva toute la province dont cette ville est la capitale ravagée et, à Besançon même, il ne vit que des traces de dévastation : « Cette petite ville, écrit-il au philosophe Maxime, maintenant renversée, était autrefois étendue et superbe, ornée. de temples magnifiques et entourée de murailles très fortes, ainsi que la rivière du Doubs qui lui sert de défense. Elle est semblable à un rocher élevé qu'on voit dans la mer et presque inaccessible aux oiseaux mêmes, si ce n'est dans les endroits qui servent de rivage au Doubs. »
Avant de se jeter sur l'Espagne, les Vandales laissèrent aussi en Séquanaise des traces de leur passage. Ce fut enfin en 410 que l'une des invasions définitives qui se fixèrent sur le sol et lui donnèrent pendant longtemps son nom, celle des Burgondes, se répandit dans la Séquanaise. Les nouveaux maîtres, de mœurs paisibles et douces, ne furent pas des oppresseurs ; ils se contentèrent de s'approprier une partie du sol sans établir des impôts onéreux et vexatoires ; ils laissèrent à leurs sujets leurs lois romaines, leur administration municipale et vécurent avec eux dans une égalité parfaite, chacun selon ses lois. Le patrice Aétius chassa momentanément les Burgondes de la Séquanaise, de 435 à 443 environ. Aux ravages occasionnés par cette guerre s'en ajoutèrent de bien plus terribles. Attila, battu à Châlons-sur-Marne (451), fit sa retraite par l'orient de la Gaule, et Besançon fut tellement ruinée par les Huns que pendant cinquante ans elle resta déserte.
L'établissement définitif des Bourguignons dans les pays éduen et séquanais, qui devinrent les deux Bourgognes, date de l'année 456. Le Suève Ricimer, héritier des dignités d'Aétius qui venait d'être mis à mort par Valentinien III, partagea ces pays entre les chefs burgondes Hilpéric et Gondioc, avec lesquels il avait formé une alliance de famille. Gondioc laissa en mourant le territoire de Besançon et cette ville à l'un de ses quatre fils, Godeghisel, uni à Gondebaud et devenu maître de toute la Séquanaise par le meurtre de deux de ses frères. Godeghisel fit secrètement alliance avec le roi des Francs Clovis et abandonna son frère dans la bataille qui eut lieu sur les bords de l'Ouche en 500. Gondebaud tira vengeance de cette trahison : lorsqu'il eut obtenu la paix de Clovis, il tourna ses armes contre son frère, le battit et le fit massacrer. Gondebaud fut alors maître du territoire séquanais et y imposa son code, la célèbre loi Gombette, jusqu'au moment où les fils de Clovis prirent aux enfants de Gondebaud tout leur héritage et s'emparèrent de la Bourgogne (534).
Lorsque la monarchie franque fut partagée entre les quatre fils de Clotaire Ier, le pays dont nous nous occupons échut avec toute la Bourgogne à Gontran (561-593). Grâce à son éloignement des champs de bataille, il traversa sans trop de vicissitudes cette période de la domination des Francs. Ses nouveaux maîtres étaient cependant de mœurs moins douces que les paisibles Bourguignons ; Besançon commençait à se relever des ruines et des désastres des invasions précédentes, quand survinrent les Sarrasins. En 722, les hordes d'Abd-el-Rhaman passent la Loire, remontent la Saône, se divisent vers Autun en deux bandes : l'une se dirige vers l'ouest, tandis que la seconde livre aux flammes Besançon et tout le pagus de Warasch ou Varasque, qui se composait alors du territoire aujourd'hui compris dans le département du Doubs. Tandis que la Bourgogne citérieure ou en deçà de la Saône commençait à former ses divisions féodales et à se diviser en comtés, la Bourgogne ultérieure ou Franche-Comté conservait les divisions barbares qui avaient pris naissance avec les Burgondes et s'appelaient pagi.
Pépin le Bref laissa à sa mort (768) les deux Bourgognes à son fils Carloman ; on sait que ce prince n'en jouit pas longtemps ; se retirant dans un monastère, il laissa ses États à des enfants en bas âge qui furent dépossédés par leur oncle Charlemagne. L'histoire du département du Doubs se confond avec celle du vaste empire du héros germain ; on sait seulement que les Bourgognes profitèrent de la réforme administrative à laquelle il soumit tous ses États ; mais ce ne fut pas pour longtemps ; les troubles du règne de Louis le Débonnaire survinrent, puis les discordes de ses fils lui survécurent.
Après la bataille de Fontanet (841) et le traité de Verdun (843), les deux Bourgognes furent séparées pour la première fois. La Bourgogne éduenne échut à Charles le Chauve et la Bourgogne séquanaise à Lothaire. Cet empereur mourut en 855. La haute Bourgogne ou Bourgogne cisjurane entra dans la part du plus jeune de ses trois fils, Charles, roi de Provence. A la mort de ce prince (863), ses frères Louis II et Lothaire II firent deux parts de son royaume ; la haute Bourgogne fut scindée, la plus grande partie du territoire qui forme le département du Doubs échut avec Besançon à Lothaire II.
Lothaire ne survécut que de six ans à son frère Charles. Le roi de France, Charles le Chauve, profita des embarras et des guerres dans lesquels son neveu, Louis II, était engagé en Italie pour se saisir des États de Lothaire II ; il se fit proclamer roi de Lorraine à Metz ; mais Louis II protesta, et un nouveau partage plus bizarre que tous les précédents eut lieu. La haute Bourgogne fut complètement démembrée, le pagus de Varasque, qui. avait pris le nom de Comté, échut à Louis, depuis Besançon jusqu'à Pontarlier, tandis que Besançon même était concédée à Charles le Chauve par un traité conclu au mois d'août 870.
Pour se reconnaître dans cette multiplicité de partages où l'historien lui-même, s'il veut ne pas se perdre, a besoin d'apporter une attention soutenue, il faut bien songer que les noms de haute Bourgogne, Bourgogne ultérieure et Bourgogne cisjurane s'appliquent tous également à cet ancien pays des Séquanais que nous n'avons pas encore le droit d'appeler du nom de Franche-Comté. Tant de dislocations et de changements nuisaient aux relations et aux intérêts des localités et faisaient périr tous les éléments d'unité et de pouvoir. La partie de la haute Bourgogne qui échut a Charles le Chauve protesta contre le partage de 870 ; Gérard de Roussillon, ce héros du premier temps féodal, gouverneur de Provence et de Bourgogne, s'opposa par les armes à son exécution ; ce fut aux environs de Pontarlier que se livra la bataille qui décida en faveur du roi de France :
Entre le Doubs et le Drugeon
Périt Gérard de Roussillon
dit une vieille tradition. Gérard ne périt pas, mais fut chassé et cessa de contester à Charles l'occupation du pays. Nous retrouvons deux fois le prince à Besançon ; la première à la suite de sa victoire,, la seconde lorsque, après la mort de son neveu Lothaire II (875), il descendit en Italie pour s'y faire couronner empereur. On sait que, l'année même de sa mort (877), Charles le Chauve ratifia, par le fameux capitulaire de Kiersy-sur-Oise, les usurpations de la féodalité.
Le gouverneur des Bourgognes et de la Provence, Boson, n'avait pas attendu la sanction royale pour se rendre indépendant dans les pays qui lui étaient confiés ; mais ce fut seulement en 879, à la mort de Louis le Bègue, qu'il tint à Mantaille une diète générale où, entre autres personnages influents, nous voyons figurer l'archevêque de Besançon. Il se fit donner le titre de roi de Bourgogne. L'année qui suivit sa mort (888), les Normands ravagèrent la haute Bourgogne ; son successeur, en bas âge, Louis, était incapable de défendre les États de son père ; il fut dépossédé du comté de Bourgogne ou Bourgogne cisjurane par son oncle Rodolphe, qui avait séduit Thierry Ier, archevêque de Besançon, en lui offrant le titre de grand chancelier de Bourgogne.
Ce ne fut cependant pas sans opposition de la part d'Arnoul, que les Germains s'étaient donné pour roi après avoir déposé le lâche empereur Charles le Gros à la diète de Tribur (887), et de la part du jeune Louis de Provence, héritier légitime de cette contrée. Mais Arnoul céda devant la résistance obstinée de Rodolphe, Louis fut vaincu et le prince usurpateur régna paisiblement jusqu'à sa mort, arrivée en 911.
Cette période de guerres et de ravages fut pour la comté de Bourgogne l'une des plus malheureuses qu'elle vit jamais ; les brigandages, tous les excès impunis, dix pestes, treize famines ravagèrent toute cette contrée : c'était le prélude du Xe siècle, « le siècle de fer. » Sous le règne de Rodolphe II, qui succéda sans opposition à son père, en 937, un nouveau fléau apparut dans la contrée : les Hongrois, plus féroces encore que les Normands, s'y précipitèrent, mettant tout à feu et à sang sur leur passage ; devant eux les populations fuyaient épouvantées vers les montagnes et dans les lieux fortifiés ; les barbares s'abattirent sur Besançon. La ville ne put pas résister à leur fureur et fut prise d'assaut, pillée, réduite en cendres. L'église Saint-Étienne s'écroula dans les flammes. Le feu, poussé par un vent violent, gagna le sommet du mont Calius et dévora tout, églises, édifices et demeures.
C'était pour la quatrième fois depuis la conquête romaine que l'antique capitale des Séquanais passait par de semblables épreuves. Rodolphe II mourut, l'année même de ce désastre, laissant un jeune fils, Conrad, qui, sans jamais exercer la royauté, porta pendant un demi-siècle le titre de roi. Les véritables maîtres de la Bourgogne cisjurane et transjurane furent l'empereur d'Allemagne Othon, qui s'empara du jeune Conrad et exerça une grande influence dans ses États, et le premier comte propriétaire de ce pays, selon le savant dom Plancher, Hugues le Noir, deuxième fils de Richard le Justicier. Vers cette époque apparut sur les bords de la Saône un étranger qui fit dans le pays de Bourgogne une rapide fortune. Albéric de Narbonne s'enrichit par l'exploitation des salines, puis il gagna la confiance du roi Conrad, qui le combla de bienfaits.
A sa mort (945), il était comte de Mâcon, baron de Scodingue et du Varasque ; la fortune de sa famille ne périt pas avec lui ; de ses deux fils, l'un, Albéric, comme son père, commença la série des sires de Salins que nous verrons à l'histoire du département du Jura ; l'autre, Letalde, fut la tige des comtes héréditaires de Bourgogne. Il hérita de ce comté à la mort de Gislebert, successeur, dans ce titre, de lingues le Noir, mort en 951 sans postérité. Letalde, à l'exemple de Hugues le Noir, prit le titre d'archicomte. Sa race directe s'éteignit en 995, et la partie de la Bourgogne qu'il avait possédée revint à Othe Guillaume, qui fut le premier comte héréditaire de cette province.
Fils du roi lombard Adalbert, l'un des seigneurs les plus renommés des deux Bourgognes, audacieux et entreprenant, Othe Guillaume fut un véritable souverain. Irrité de l'influence qu'exerçaient dans le pays les abbés, l'évêque et les vassaux intermédiaires, il s'arrogea le droit de nommer les uns et supprima les autres. Ce fut ainsi que disparurent les anciens comtés de Varasque, Scodingue, Besançon, etc. Sur ces entrefaites, la monarchie carlovingienne avait été renversée par les ducs de France, qui avaient usurpé le titre de roi.
Robert, fils de Hugues Capet, héritait du duché de Bourgogne à la mort de Henri Ier (1002). Othe osa élever des prétentions contraires et disputer cette province au roi de France ; il ne réussit pas à joindre à ses États cette vaste possession ; mais, par le traité de 1016, il acquit les comtés de Mâcon et de Dijon. Le comte de Bourgogne mourut dans cette dernière ville en 1027. Son fils Rainaud Ier lui succéda ; il refusa d'abord de reconnaître la suzeraineté de l'empereur de Germanie, Henri III, fils de Conrad. prenant part à la première croisade. On sait que la fin du XIe siècle fut l'un des moments où l'esprit de foi et de piété anima le plus le moyen âge. Pendant que des seigneurs allaient en pèlerinage au tombeau de Jésus-Christ, d'autres enrichissaient les monastères et les comblaient des marques de leur munificence.
Les départements - La Dordogne - 24 -
Publié à 14:13 par acoeuretacris
(Région Aquitaine)
Antérieurement à la division territoriale de 1790, le département actuel de la Dordogne formait l'ancienne province du Périgord. Ce nom lui venait, à travers les modifications apportées par le temps et les variations du langage, des Petrocorii ou Pétrocoriens, tribu gauloise qui habitait la contrée quand les Romains y pénétrèrent.
Ici, comme ailleurs, les documents sur cette première période de notre histoire nationale sont rares et confus. L'origine celtique de ces ancêtres, l'exercice du culte druidique dans le pays, l'influence de ses ministres et l'existence d'une florissante capitale appelée Vesunna sont les principaux faits authentiques, incontestables, qui soient parvenus jusqu'à nous. Malgré le caractère essentiellement belliqueux des Gaulois en général, certains indices tendent à prouver que les Pétrocoriens n'étaient étrangers ni à l'industrie ni au commerce. Les scories qu'on rencontre assez fréquemment sur divers points du département permettent de supposer que les mines de fer, dont le sol est abondamment pourvu, étaient dès lors exploitées et leur produit travaillé dans des forges locales ; une inscription, trouvée sur le tombeau d'un certain Popilius, negotiator artis prosariae, nous révèle que l'art du tissage était connu et pratiqué ; on sait enfin que les Phocéens de Marseille venaient échanger les marchandises du Levant contre des fers, des lins et des étoffes en poil de chèvre.
La domination romaine fut établie dans le Périgord 63 ans avant l'arrivée de Jules César, et sans que cette conquête soit signalée dans l'histoire par aucune lutte sérieuse. C'est seulement après la défaite de Vercingétorix qu'un lieutenant de César est envoyé dans cette province pour y comprimer les élans patriotiques que la lutte héroïque des Arvernes avait réveillés, et à laquelle 5 000 Pétrocoriens avaient pris part. Le pays des Pétrocoriens était alors compris dans la Gaule celtique. Vers la fin du IVe siècle, il fut incorporé dans la seconde Aquitaine.
La révolte de Julius Vindex, dont la famille habitait le Périgord, révolte à laquelle les Pétrocoriens s'associèrent, est le fait capital qui se rattache le plus spécialement aux annales de la contrée. Le gouvernement romain y suivit ses différentes phases sans incidents notables. Dans les premiers temps, respect scrupuleux de la religion, des coutumes et du langage des vaincus ; envahissements successifs du paganisme et de la civilisation romaine pendant le IIe siècle ; apparition du christianisme, apporté, dit-on, dans le Périgord par saint Front, un des disciples du Christ ; dissolution des forces morales et matérielles de l'empire pendant les deux siècles suivants, et enfin au Ve révélation de son impuissance en face des invasions des barbares.
Le Périgord était compris dans les territoires dont les Wisigoths obtinrent l'occupation du faible Honorius.. On sait que ce prétendu accommodement, sur la valeur duquel cherchait à se faire illusion la vanité romaine, cachait une véritable prise de possession. Ce mensonge des mots tomba vite devant la réalité des choses, et l'empire wisigoth fut constitué. Les destinées du Périgord furent liées aux siennes jusqu'à la bataille de Vouillé, qui recula jusqu'aux Pyrénées les limites du royaume des Francs. L'espace était trop vaste, les races trop peu fondues, pour que la France de Clovis pût se constituer d'une façon durable. Ces partages de l'héritage royal, qui amenèrent de si déplorables déchirements, et contre lesquels se soulèvent les raisonnements de la critique moderne, étaient alors une nécessité des temps.
Sous le nom d'Aquitaine, l'empire wisigoth, qui avait ses limites naturelles et une espèce d'unité, cherchait fatalement à se reformer. La création des royaumes de Neustrie et d'Austrasie n'était qu'une satisfaction donnée à ces impérieux instincts ; et quand l'ambition des maires du palais voulut reprendre l'oeuvre de Clovis, la révolte des antipathies de race éclata dans la lutte acharnée que soutinrent les Aquitains pour leurs ducs héréditaires. Cette page de notre histoire appartenant plus spécialement aux annales des deux capitales de l'Aquitaine, Toulouse et Bordeaux, nous nous bornerons ici à en rappeler le souvenir, en constatant que le Périgord fit alors partie intégrante de ce grand-duché et fut mêlé à toutes les vicissitudes qui l'agitèrent.
L'invasion des Sarrasins, dont se compliquèrent les désastres de cette époque, a laissé dans le pays des traces sinistres que le temps n'a pas encore effacées. De nombreuses localités ont gardé des noms qui attestent le passage et la domination de ces farouches étrangers ; telles sont les communes des Sarrazis, de Maurens, de La Maure, de Montmoreau, de Fonmoure, de Mauriac, de Sarrasac et le puits du château de Beynac, désigné encore aujourd'hui sous le nom de puits des Sarrasins. La défaite des infidèles, la reconnaissance des populations et les sympathies du clergé furent les principaux titres qui valurent aux Carlovingiens la couronne de France.
Le héros de cette dynastie, Charlemagne, traversa le Périgord et y laissa des témoignages de son habile administration. Il fonda le prieuré de Trémolat et lui fit présent de la chemise de l'Enfant Jésus ; il dota le monastère de Sarlat d'un morceau de la vraie croix ; il y autorisa, en outre, la translation des reliques de saint Pardoux et de saint Sacerdos ; enfin plusieurs historiens lui attribuent la construction de l'église de Brantôme, gratifiée par lui, entre autres pieux trésors, des restes vénérés de saint Sicaire. Le Périgord fut alors gouverné, comme la plupart de nos provinces, par des comtes qui, dans la pensée de Charlemagne, devaient être des fonctionnaires amovibles, mais qui, sous ses successeurs, se rendirent indépendants et héréditaires.
Le premier fut Widbald ; il administra la contrée de 778 à 838. C'est sous le second de ses successeurs et pendant la durée du règne de Charles le Chauve que l'autorité des comtes se transforma en fief héréditaire. L'apparition des Normands, qui date aussi du milieu du XIe siècle, contribua beaucoup à l'établissement des grandes maisons féodales. C'est comme défenseur du pays que Wulgrin, déjà comte d'Angoulême, s'imposa au Périgord. C'était un vaillant guerrier, qui avait mérité le surnom de Taillefer pour avoir pourfendu d'un seul coup de son épée le casque et la cuirasse d'un chef normand.
Au milieu de l'enfantement de la société féodale, dans le chaos du Moyen Age où la force est le droit, Guillaume Wulgrin est un type assez complet de ces fondateurs de dynastie, rudes figures qui surgissent dans l'histoire bardées de fer, lance au poing et se taillant de petits États dans les dépouilles de la monarchie agonisante. A sa mort, ses deux fils se partagèrent ses domaines ; Guillaume, le cadet, eut le Périgord ; la ligne masculine de cette branche s'éteignit à la seconde génération, en 975, dans la personne d'Arnaud dit Bouratien, dont la soeur et unique héritière épousa le comte de la Marche (Hélie Ier) et apporta le Périgord en dot à son époux. Ce seigneur, souche de la seconde dynastie des comtes de Périgord, prit et laissa à ses descendants le surnom de Talleyrand, qu'illustra pendant quatre siècles cette puissante maison de Périgord. Son indépendance était presque absolue ; elle battait monnaie. C'est un Adalbert de Talleyrand-Périgord qui fit cette réponse devenue fameuse, et dans laquelle se résumait si bien la fierté féodale : « Qui t'a fait comte ? » lui demandait un jour Hugues Capet. « Qui t'a fait roi ? » lui répondit Adalbert. La seule puissance contre laquelle les comtes eussent parfois à lutter était celle des évêques. Ces démêlés se rattachant à l'histoire des villes épiscopales et n'ayant point eu d'ailleurs de sérieuse influence sur les destinées de la province, nous n'avons pas à nous en occuper ici.
Lorsque le mariage de Henri II avec Éléonore de Guyenne plaça le Périgord sous la domination anglaise comme relevant de l'ancien duché d'Aquitaine, les comtes de Périgord s'associèrent à tous les efforts qui furent alors tentés pour arracher le sol français au joug de l'étranger. La fortune ne favorisa point leur honorable résistance ; le pays fut occupé militairement, des garnisons ennemies furent placées dans les forteresses et châteaux, de nouvelles citadelles furent élevées ; mais le patriotisme périgourdin ne se découragea pas, et pendant cette longue et triste période, qui dura depuis Louis le Jeune jusqu'à Charles VII, si trop souvent le pays fut obligé de souffrir le pouvoir de l'Anglais, on peut dire à sa gloire qu'il ne l'accepta jamais.
L'historique des guerres de l'Angleterre et de la France n'entre pas dans le cadre de notre récit ; nous déterminerons seulement par quelques dates l'influence qu'elles exercèrent sur le sort de notre province. Le Périgord, conquis par Henri II Plantagenet, revint à la France en 1224, fut rendu à l'Angleterre en 1258, puis confisqué en 1294 par Philippe le Bel, restitué de nouveau à l'Angleterre en 1303, reconquis par Philippe de Valois, cédé encore une fois par le traité de Brétigny, repris par Charles V, remis sous l'autorité anglaise vers la fin du règne de Charles VI, et enfin acquis définitivement, réuni pour toujours à la couronne de France en 1454.
Dans l'intervalle de ces orages, nous avons à citer un voyage de saint Louis dans le Périgord. Ce prince, avant de partir pour sa seconde croisade, voulut aller s'agenouiller devant le suaire du Christ, précieuse relique sur l'authenticité de laquelle nous nous garderons bien de nous prononcer, conservée dans un monastère de bernardins à Cadouin. Saint Louis traversa le pays, accompagné des seigneurs de sa cour, et, voulant éviter Sarlat, à cause de la mésintelligence qui existait entre l'abbé et les consuls de la ville, il s'arrêta au château de Pelvezis. A la même époque se rattache une certaine extension des franchises municipales, signe précurseur de la chute de la féodalité.
L'état de la France s'était bien modifié sous le coup des dernières crises qu'elle venait de traverser. C'est à la monarchie surtout qu'avait profité cette lutte de deux siècles contre l'étranger, lutte pendant laquelle elle avait si souvent paru près de succomber. L'intelligence de Cette situation nouvelle semble avoir échappé aux comtes de Périgord, qui, se croyant encore au temps des Wulgrin et des Boson, affectaient envers la couronne une indépendance qui n'était plus de saison.
Archambaud V, dit le Vieux, qui vivait dans les dernières années du XIVe siècle, contesta au roi certains droits que la couronne revendiquait sur Périgueux et essaya .de soutenir ses prétentions par les armes ; un premier arrangement arrêta les hostilités ; mais quelque temps après le comte intraitable recommença la guerre. Il fut vaincu ; un arrêt de mort contre le coupable et de confiscation pour le comté avait été rendu ; le roi fit au seigneur rebelle grâce de la vie, ne conserva que Périgueux comme gage de sa victoire et abandonna au fils d'Archambaud tout le reste des domaines paternels.
Mais le fils se montra moins sage encore que son père. Il réclama avec menaces la ville dont il se croyait injustement dépouillé. Cette fois, il n'y eut même plus besoin d'une expédition militaire pour réduire l'incorrigible. Une tentative de rapt sur la fille d'un .bourgeois de Périgueux fit de lui un criminel vulgaire ; on instruisit son procès, et un arrêt du parlement, à la date du 19 juin 1399, le condamna au bannissement et à la confiscation de tous ses biens. En lui s'éteignit la puissance de cette antique famille, qui possédait le Périgord depuis l'an 866, et qui, de Wulgrin à Archambaud VI, comptait une succession de vingt-sept comtes.
Le roi Charles VI donna le comté de Périgord au duc d'Orléans, son oncle. Celui-ci le laissa à Charles, son fils, qui, étant prisonnier en Angleterre, le vendit en 1437 pour seize mille réaux d'or à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. Ce dernier eut pour héritier Guillaume, son frère, qui ne laissa que trois filles. L'aînée épousa Alain, sire d'Albret, dont le fils fut roi de Navarre, et la petite-fille de celui-ci apporta en dot le Périgord, avec ses autres États, à Antoine de Bourbon, qu'elle épousa et qui fut père de Henri IV. Le Périgord faisait donc partie des domaines de ce monarque lorsqu'il monta sur le trône, et il fut alors réuni à la couronne.
L'influence qu'exerçait dans la province la maison d'Albret y facilita les progrès de la réforme religieuse, surtout lorsque la reine Jeanne eut embrassé avec tant d'ardeur la foi nouvelle ; le Périgord devint un des théâtres de l'affreuse guerre qui déchira la patrie à cette époque. Peu de contrées furent éprouvées aussi cruellement. Sanctuaires violés, églises détruites, villes prises d'assaut, partout le sac, le pillage, l'incendie, les massacres, telle est l'oeuvre du fanatisme, tel est le tableau que nous ont laissé les historiens contemporains de cette lamentable période.
La paix eut beaucoup à faire pour cicatriser de pareilles blessures, elle fut, grâce au ciel, rarement troublée pendant les temps qui suivirent ; mais le repos donné par le despotisme ne régénère pas les populations ; l'espèce de sommeil léthargique dans lequel nous voyons le Périgord s'endormir de Henri IV à Louis XV, le silence qui se fait autour de la province pendant la durée de deux siècles ne sont point des indices de prospérité ; le salut devait venir d'ailleurs. Quelque indispensables, cependant, que fussent devenues des réformes réclamées par la monarchie elle-même, ce n'est pas sans une sorte de protestation qu'elles se firent jour sur ce vieux sol de la féodalité. Le Périgord avait do longue date ses états particuliers ou provinciaux ; c'était le sénéchal qui les convoquait en vertu de lettres patentes ; le comte et plus tard le gouverneur y occupaient le premier rang ; les quatre barons du Périgord, qui avaient le privilège de porter le nouvel évêque de Périgueux à son entrée dans la ville, Bourdeilles, Beynac Biron et Mareuil, prenaient place après l'ordre du clergé les maires et consuls marchaient à la tête du tiers état.
Lors de la convocation des derniers états, en mars 1788, M. de Flamarens, évêque de Périgueux, refusa de prêter le serment exigé, et le clergé fut obligé de se nommer un autre président. Cette inoffensive boutade n'entrava pas la marche des événements, et lorsque éclata la Révolution, le Périgord fut l'un des premiers à y adhérer. Il envoya à la Convention nationale les représentants du peuple Romme et Lakanal, mais, si les agitations politiques le troublèrent un moment, il dut à sa position, loin des frontières, d'être préservé des invasions que les fatales années de 1814, dé 1815, de 1870 et de 1871 déchaînèrent sur la France. Aussi ce département n'a-t-il cessé, depuis, de prospérer.
Antérieurement à la division territoriale de 1790, le département actuel de la Dordogne formait l'ancienne province du Périgord. Ce nom lui venait, à travers les modifications apportées par le temps et les variations du langage, des Petrocorii ou Pétrocoriens, tribu gauloise qui habitait la contrée quand les Romains y pénétrèrent.
Ici, comme ailleurs, les documents sur cette première période de notre histoire nationale sont rares et confus. L'origine celtique de ces ancêtres, l'exercice du culte druidique dans le pays, l'influence de ses ministres et l'existence d'une florissante capitale appelée Vesunna sont les principaux faits authentiques, incontestables, qui soient parvenus jusqu'à nous. Malgré le caractère essentiellement belliqueux des Gaulois en général, certains indices tendent à prouver que les Pétrocoriens n'étaient étrangers ni à l'industrie ni au commerce. Les scories qu'on rencontre assez fréquemment sur divers points du département permettent de supposer que les mines de fer, dont le sol est abondamment pourvu, étaient dès lors exploitées et leur produit travaillé dans des forges locales ; une inscription, trouvée sur le tombeau d'un certain Popilius, negotiator artis prosariae, nous révèle que l'art du tissage était connu et pratiqué ; on sait enfin que les Phocéens de Marseille venaient échanger les marchandises du Levant contre des fers, des lins et des étoffes en poil de chèvre.
La domination romaine fut établie dans le Périgord 63 ans avant l'arrivée de Jules César, et sans que cette conquête soit signalée dans l'histoire par aucune lutte sérieuse. C'est seulement après la défaite de Vercingétorix qu'un lieutenant de César est envoyé dans cette province pour y comprimer les élans patriotiques que la lutte héroïque des Arvernes avait réveillés, et à laquelle 5 000 Pétrocoriens avaient pris part. Le pays des Pétrocoriens était alors compris dans la Gaule celtique. Vers la fin du IVe siècle, il fut incorporé dans la seconde Aquitaine.
La révolte de Julius Vindex, dont la famille habitait le Périgord, révolte à laquelle les Pétrocoriens s'associèrent, est le fait capital qui se rattache le plus spécialement aux annales de la contrée. Le gouvernement romain y suivit ses différentes phases sans incidents notables. Dans les premiers temps, respect scrupuleux de la religion, des coutumes et du langage des vaincus ; envahissements successifs du paganisme et de la civilisation romaine pendant le IIe siècle ; apparition du christianisme, apporté, dit-on, dans le Périgord par saint Front, un des disciples du Christ ; dissolution des forces morales et matérielles de l'empire pendant les deux siècles suivants, et enfin au Ve révélation de son impuissance en face des invasions des barbares.
Le Périgord était compris dans les territoires dont les Wisigoths obtinrent l'occupation du faible Honorius.. On sait que ce prétendu accommodement, sur la valeur duquel cherchait à se faire illusion la vanité romaine, cachait une véritable prise de possession. Ce mensonge des mots tomba vite devant la réalité des choses, et l'empire wisigoth fut constitué. Les destinées du Périgord furent liées aux siennes jusqu'à la bataille de Vouillé, qui recula jusqu'aux Pyrénées les limites du royaume des Francs. L'espace était trop vaste, les races trop peu fondues, pour que la France de Clovis pût se constituer d'une façon durable. Ces partages de l'héritage royal, qui amenèrent de si déplorables déchirements, et contre lesquels se soulèvent les raisonnements de la critique moderne, étaient alors une nécessité des temps.
Sous le nom d'Aquitaine, l'empire wisigoth, qui avait ses limites naturelles et une espèce d'unité, cherchait fatalement à se reformer. La création des royaumes de Neustrie et d'Austrasie n'était qu'une satisfaction donnée à ces impérieux instincts ; et quand l'ambition des maires du palais voulut reprendre l'oeuvre de Clovis, la révolte des antipathies de race éclata dans la lutte acharnée que soutinrent les Aquitains pour leurs ducs héréditaires. Cette page de notre histoire appartenant plus spécialement aux annales des deux capitales de l'Aquitaine, Toulouse et Bordeaux, nous nous bornerons ici à en rappeler le souvenir, en constatant que le Périgord fit alors partie intégrante de ce grand-duché et fut mêlé à toutes les vicissitudes qui l'agitèrent.
L'invasion des Sarrasins, dont se compliquèrent les désastres de cette époque, a laissé dans le pays des traces sinistres que le temps n'a pas encore effacées. De nombreuses localités ont gardé des noms qui attestent le passage et la domination de ces farouches étrangers ; telles sont les communes des Sarrazis, de Maurens, de La Maure, de Montmoreau, de Fonmoure, de Mauriac, de Sarrasac et le puits du château de Beynac, désigné encore aujourd'hui sous le nom de puits des Sarrasins. La défaite des infidèles, la reconnaissance des populations et les sympathies du clergé furent les principaux titres qui valurent aux Carlovingiens la couronne de France.
Le héros de cette dynastie, Charlemagne, traversa le Périgord et y laissa des témoignages de son habile administration. Il fonda le prieuré de Trémolat et lui fit présent de la chemise de l'Enfant Jésus ; il dota le monastère de Sarlat d'un morceau de la vraie croix ; il y autorisa, en outre, la translation des reliques de saint Pardoux et de saint Sacerdos ; enfin plusieurs historiens lui attribuent la construction de l'église de Brantôme, gratifiée par lui, entre autres pieux trésors, des restes vénérés de saint Sicaire. Le Périgord fut alors gouverné, comme la plupart de nos provinces, par des comtes qui, dans la pensée de Charlemagne, devaient être des fonctionnaires amovibles, mais qui, sous ses successeurs, se rendirent indépendants et héréditaires.
Le premier fut Widbald ; il administra la contrée de 778 à 838. C'est sous le second de ses successeurs et pendant la durée du règne de Charles le Chauve que l'autorité des comtes se transforma en fief héréditaire. L'apparition des Normands, qui date aussi du milieu du XIe siècle, contribua beaucoup à l'établissement des grandes maisons féodales. C'est comme défenseur du pays que Wulgrin, déjà comte d'Angoulême, s'imposa au Périgord. C'était un vaillant guerrier, qui avait mérité le surnom de Taillefer pour avoir pourfendu d'un seul coup de son épée le casque et la cuirasse d'un chef normand.
Au milieu de l'enfantement de la société féodale, dans le chaos du Moyen Age où la force est le droit, Guillaume Wulgrin est un type assez complet de ces fondateurs de dynastie, rudes figures qui surgissent dans l'histoire bardées de fer, lance au poing et se taillant de petits États dans les dépouilles de la monarchie agonisante. A sa mort, ses deux fils se partagèrent ses domaines ; Guillaume, le cadet, eut le Périgord ; la ligne masculine de cette branche s'éteignit à la seconde génération, en 975, dans la personne d'Arnaud dit Bouratien, dont la soeur et unique héritière épousa le comte de la Marche (Hélie Ier) et apporta le Périgord en dot à son époux. Ce seigneur, souche de la seconde dynastie des comtes de Périgord, prit et laissa à ses descendants le surnom de Talleyrand, qu'illustra pendant quatre siècles cette puissante maison de Périgord. Son indépendance était presque absolue ; elle battait monnaie. C'est un Adalbert de Talleyrand-Périgord qui fit cette réponse devenue fameuse, et dans laquelle se résumait si bien la fierté féodale : « Qui t'a fait comte ? » lui demandait un jour Hugues Capet. « Qui t'a fait roi ? » lui répondit Adalbert. La seule puissance contre laquelle les comtes eussent parfois à lutter était celle des évêques. Ces démêlés se rattachant à l'histoire des villes épiscopales et n'ayant point eu d'ailleurs de sérieuse influence sur les destinées de la province, nous n'avons pas à nous en occuper ici.
Lorsque le mariage de Henri II avec Éléonore de Guyenne plaça le Périgord sous la domination anglaise comme relevant de l'ancien duché d'Aquitaine, les comtes de Périgord s'associèrent à tous les efforts qui furent alors tentés pour arracher le sol français au joug de l'étranger. La fortune ne favorisa point leur honorable résistance ; le pays fut occupé militairement, des garnisons ennemies furent placées dans les forteresses et châteaux, de nouvelles citadelles furent élevées ; mais le patriotisme périgourdin ne se découragea pas, et pendant cette longue et triste période, qui dura depuis Louis le Jeune jusqu'à Charles VII, si trop souvent le pays fut obligé de souffrir le pouvoir de l'Anglais, on peut dire à sa gloire qu'il ne l'accepta jamais.
L'historique des guerres de l'Angleterre et de la France n'entre pas dans le cadre de notre récit ; nous déterminerons seulement par quelques dates l'influence qu'elles exercèrent sur le sort de notre province. Le Périgord, conquis par Henri II Plantagenet, revint à la France en 1224, fut rendu à l'Angleterre en 1258, puis confisqué en 1294 par Philippe le Bel, restitué de nouveau à l'Angleterre en 1303, reconquis par Philippe de Valois, cédé encore une fois par le traité de Brétigny, repris par Charles V, remis sous l'autorité anglaise vers la fin du règne de Charles VI, et enfin acquis définitivement, réuni pour toujours à la couronne de France en 1454.
Dans l'intervalle de ces orages, nous avons à citer un voyage de saint Louis dans le Périgord. Ce prince, avant de partir pour sa seconde croisade, voulut aller s'agenouiller devant le suaire du Christ, précieuse relique sur l'authenticité de laquelle nous nous garderons bien de nous prononcer, conservée dans un monastère de bernardins à Cadouin. Saint Louis traversa le pays, accompagné des seigneurs de sa cour, et, voulant éviter Sarlat, à cause de la mésintelligence qui existait entre l'abbé et les consuls de la ville, il s'arrêta au château de Pelvezis. A la même époque se rattache une certaine extension des franchises municipales, signe précurseur de la chute de la féodalité.
L'état de la France s'était bien modifié sous le coup des dernières crises qu'elle venait de traverser. C'est à la monarchie surtout qu'avait profité cette lutte de deux siècles contre l'étranger, lutte pendant laquelle elle avait si souvent paru près de succomber. L'intelligence de Cette situation nouvelle semble avoir échappé aux comtes de Périgord, qui, se croyant encore au temps des Wulgrin et des Boson, affectaient envers la couronne une indépendance qui n'était plus de saison.
Archambaud V, dit le Vieux, qui vivait dans les dernières années du XIVe siècle, contesta au roi certains droits que la couronne revendiquait sur Périgueux et essaya .de soutenir ses prétentions par les armes ; un premier arrangement arrêta les hostilités ; mais quelque temps après le comte intraitable recommença la guerre. Il fut vaincu ; un arrêt de mort contre le coupable et de confiscation pour le comté avait été rendu ; le roi fit au seigneur rebelle grâce de la vie, ne conserva que Périgueux comme gage de sa victoire et abandonna au fils d'Archambaud tout le reste des domaines paternels.
Mais le fils se montra moins sage encore que son père. Il réclama avec menaces la ville dont il se croyait injustement dépouillé. Cette fois, il n'y eut même plus besoin d'une expédition militaire pour réduire l'incorrigible. Une tentative de rapt sur la fille d'un .bourgeois de Périgueux fit de lui un criminel vulgaire ; on instruisit son procès, et un arrêt du parlement, à la date du 19 juin 1399, le condamna au bannissement et à la confiscation de tous ses biens. En lui s'éteignit la puissance de cette antique famille, qui possédait le Périgord depuis l'an 866, et qui, de Wulgrin à Archambaud VI, comptait une succession de vingt-sept comtes.
Le roi Charles VI donna le comté de Périgord au duc d'Orléans, son oncle. Celui-ci le laissa à Charles, son fils, qui, étant prisonnier en Angleterre, le vendit en 1437 pour seize mille réaux d'or à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. Ce dernier eut pour héritier Guillaume, son frère, qui ne laissa que trois filles. L'aînée épousa Alain, sire d'Albret, dont le fils fut roi de Navarre, et la petite-fille de celui-ci apporta en dot le Périgord, avec ses autres États, à Antoine de Bourbon, qu'elle épousa et qui fut père de Henri IV. Le Périgord faisait donc partie des domaines de ce monarque lorsqu'il monta sur le trône, et il fut alors réuni à la couronne.
L'influence qu'exerçait dans la province la maison d'Albret y facilita les progrès de la réforme religieuse, surtout lorsque la reine Jeanne eut embrassé avec tant d'ardeur la foi nouvelle ; le Périgord devint un des théâtres de l'affreuse guerre qui déchira la patrie à cette époque. Peu de contrées furent éprouvées aussi cruellement. Sanctuaires violés, églises détruites, villes prises d'assaut, partout le sac, le pillage, l'incendie, les massacres, telle est l'oeuvre du fanatisme, tel est le tableau que nous ont laissé les historiens contemporains de cette lamentable période.
La paix eut beaucoup à faire pour cicatriser de pareilles blessures, elle fut, grâce au ciel, rarement troublée pendant les temps qui suivirent ; mais le repos donné par le despotisme ne régénère pas les populations ; l'espèce de sommeil léthargique dans lequel nous voyons le Périgord s'endormir de Henri IV à Louis XV, le silence qui se fait autour de la province pendant la durée de deux siècles ne sont point des indices de prospérité ; le salut devait venir d'ailleurs. Quelque indispensables, cependant, que fussent devenues des réformes réclamées par la monarchie elle-même, ce n'est pas sans une sorte de protestation qu'elles se firent jour sur ce vieux sol de la féodalité. Le Périgord avait do longue date ses états particuliers ou provinciaux ; c'était le sénéchal qui les convoquait en vertu de lettres patentes ; le comte et plus tard le gouverneur y occupaient le premier rang ; les quatre barons du Périgord, qui avaient le privilège de porter le nouvel évêque de Périgueux à son entrée dans la ville, Bourdeilles, Beynac Biron et Mareuil, prenaient place après l'ordre du clergé les maires et consuls marchaient à la tête du tiers état.
Lors de la convocation des derniers états, en mars 1788, M. de Flamarens, évêque de Périgueux, refusa de prêter le serment exigé, et le clergé fut obligé de se nommer un autre président. Cette inoffensive boutade n'entrava pas la marche des événements, et lorsque éclata la Révolution, le Périgord fut l'un des premiers à y adhérer. Il envoya à la Convention nationale les représentants du peuple Romme et Lakanal, mais, si les agitations politiques le troublèrent un moment, il dut à sa position, loin des frontières, d'être préservé des invasions que les fatales années de 1814, dé 1815, de 1870 et de 1871 déchaînèrent sur la France. Aussi ce département n'a-t-il cessé, depuis, de prospérer.
C'est arrivé un jour - Le 15 Juin -
Publié à 10:08 par acoeuretacris
923 : Robert 1er meurt lors de la bataille de Soissons.
1215 : Jean sans Terre signe la Grande Chart, "Magna Carta", imposée par ses barons
Né à Oxford en 1167, Jean sans Terre complota d'abord contre son père Henri II puis contre son frère Richard Coeur de Lion auquel il devait succéder en 1199 au détriment de son neveu, Arthur Ier de Bretagne. Cité par Philippe Auguste devant la cour des pairs de France en 1202 pour l'enlèvement d'Isabelle d'Angoulême, il fut condamné par défaut à la perte de ses fiefs français (Normandie, Maine, Anjou, Touraine et Poitou). C'est alors qu'il reçut le surnom de "sans terre". Un an plus tard, l'assassinat d'Arthur souleva la Bretagne contre lui. Il réussit ensuite à se brouiller avec le Saint-Siège au sujet du titulaire du siège de l'archevêché de Canterbury. Le pape Innocent III jeta l'interdit sur le royaume d'Angleterre en 1208, excommunia le roi en 1209 et autorisa Philippe Auguste à conquérir l'Angleterre en 1213. Devant l'opposition croissante de ses sujets, Jean sans Terre finit par se réconcilier avec le Saint-Siège. Mais après le démantèlement de la coalition qu'il avait suscitée contre la France (il fut battu à La Roche-aux-Moines près d'Angers tandis que ses alliés l'étaient à Bouvines en 1214), il se heurta à la révolte des barons d'Angleterre qui le forcèrent à signer la Grande Charte, le 15 juin 1215 à Runnymede, près de Windsor. Elle garantissait les droits féodaux, les libertés de l'Eglise et des villes contre l'arbitraire royal et instituait le contrôle de l'impôt par le Grand Conseil du royaume ainsi que des garanties judiciaires. Cette Charte, qui sera l’archétype des " Constitutions " européennes, sera le premier monument de la Constitution anglaise. Bien qu’en théorie ils aient été dus à une médiation de l’archevêque de Canterbury, Stephen Langton, entre le roi et ses grands vassaux, ses soixante-trois articles sont imposés à Jean sans Terre par une révolte de barons, soutenus par les principaux prélats de l’Église. Le document est daté du 15 juin "dans la prairie appelée Runnymede, entre Windsor et Staines". Né de la multiplicité des abus royaux, en particulier en matière fiscale et ecclésiastique, le compromis vise à les réformer et à en prévenir le renouvellement : on ne doit pas y rechercher la première mouture d’une "déclaration des droits" ou d’une constitution. Ainsi l’article premier promet de protéger la liberté des élections épiscopales et l’article 2 de garantir son héritage au successeur légitime d’un vassal. Les articles 12 et 14 font dépendre de l’approbation d’un "Conseil du royaume" la levée de taxes extraordinaires ; l’article 39 s’élève contre toute arrestation arbitraire ; l’article 42 garantit la liberté de circulation à l’intérieur et hors du royaume ; l’article 61 semble fonder un véritable "droit à l’insurrection", en disposant que le souverain coupable d’avoir transgressé les franchises de ses sujets devrait être ramené à la raison par un soulèvement de la population conduite par des barons et qui lui "infligerait des épreuves par tous les moyens", à l’exclusion des menaces physiques sur sa personne et sur les membres de sa famille. On soulignera le rôle toujours exclusif des grands vassaux dans le "Conseil" et dans l’"insurrection" : la Grande Charte renforce la féodalité. Néanmoins, ce document reste au sens propre " une limitation " du pouvoir royal au bénéfice de la nation !!! .Jean sans Terre la désavoua en 1216 et les barons élirent roi le futur Louis VIII de France qui débarqua en Angleterre. La mort de Jean sans Terre sauva la dynastie : son fils Henri III lui succéda et confirma la Grande Charte (1265) qui devint le symbole de la lutte contre le pouvoir absolu.
1520 : Le pape Léon X excommunie Martin Luther par la bulle "Exsurge Domine".
Condamnation par le Pape Léon X, au moyen de la Bulle " Exsurge Domine ", de Martin Luther et de son hérésie le Protestantisme. La légende est peut-être plus vraie que l’histoire ! Elle représente Léon X, pape Médicis de la beauté, arrêtant à peine une chasse à courre pour signer, dans une clairière des monts Albins, peu loins de Rome, la condamnation d’un moine déviant inconnu qui perturbe l’Allemagne. Cette bulle, publiée à Rome le 15 juin 1520, a été préparée au cours de l’hiver précédent par une commission de théologiens, issus en majorité des ordres mendiants prédicateurs officiels des indulgences et des aumônes pour la basilique Saint-Pierre. Cette vente des indulgences que justement Luther attaquait ouvertement. Certains théologiens tentaient de nuancer la rédaction, alors que le théologien Jean Eck prônait une condamnation globale et radicale d’un Luther scandaleux et hérétique. Discutée par quatre consistoires de cardinaux de curie, la bulle ménage la personne de Luther — il a soixante jours pour se soumettre — et porte condamnation de quarante et une propositions doctrinales, tirées des œuvres de l’augustin saxon. Inspiré du jugement de la faculté théologique de Louvain du 7 novembre 1519, ce "syllabus", où Jean Eck a fait tout de même passer six articles condamnant Luther comme défenseur hérétique des conciles au détriment de la primauté romaine, constitue le premier condensé de la pensée luthérienne. Telle quelle, dans le climat d’une année marquée par la mort de Maximilien Ier et l’élection difficile de Charles Quint (28 juin 1519), la bulle, instrument juridique, ne peut constituer un moyen efficace de paix. Luther, une première fois, en appelle au concile et au pape mal informé. Le pape étant mieux " informé ", il lance un deuxième un deuxième appel.La réponse romaine vient alors sous la forme d’une nouvelle bulle excommuniant cette fois Luther et ses partisans (Decet romanum pontificem , 3 janv. 1521). Cette bulle ne sera que peu appliquée en Allemagne. Sur le terrain de l’Empire, la publication de la bulle Exsurge Domine ne se fait qu’en Rhénanie et aux Pays-Bas, parce que Charles Quint y appuie le nonce Alexandre. Jean Eck, passionnément anti-luthérien, réussit à en faire des proclamations officielles dans les cathédrales de Brandenburg, Merseburg, Meissen, dont dépend Wittenberg. Mais l’exécution des sanctions prises rencontre une résistance passive ou active quasi générale en terre allemande. Luther a-t-il jeté au feu un exemplaire de la bulle sous les acclamations des étudiants de Wittenberg (10 déc. 1520).En tout cas, elle a été souvent jetée à l’eau et piétiné ; on a peu brûlé les écrits de Luther, et le bannissement par Charles Quint hors de l’Empire du réformateur excommunié n’a jamais été effectif, protégé qu’il était par Frédéric le Sage de Saxe, bien d’autres princes, d’autres laïcs et par le peuple ; Nombre d’évêques allemands même adoptent une attitude "proche du sabotage" (H. Jedin). Cette résistance s’explique par le fait que Rome a mis les évêques hors d’affaire dans une procédure judiciaire qui relève en première instance de leur ressort. Parce que pareille attitude ne donne pas droit aux justes thèses conciliaristes traditionnelles. Parce que la Rome papale de la Renaissance ne se remet pas en cause sous les appels réformistes de Martin Luther, continuant notamment à prélever de lourdes taxes sur l’Église allemande. Parce que l’opinion publique persiste à voir EN Luther un fils de l’Église exerçant la liberté chrétienne, résistant mais non hérétique, dont surtout l’Appel à la noblesse allemande de l’été 1520 constitue un véritable programme de concile de réformation.
1672 : Les Hollandais ouvrent les digues pour empêcher l'armée française de s'emparer d'Amsterdam.
1752 : Benjamin Franklin démontre sa théorie sur la foudre en lancant un cerf-volant au cours d'un orage à Philadelphie.
1785 : La dernière ascension de Pilâtre de Rozier
Depuis que les frères Montgolfier avaient inventé en juin 1783 le principe de l'aérostat -une énorme sphère de toile et de papier gonflée à l'air chaud- de nombreux physiciens tentaient d'en améliorer la technique. L'un d'entre eux, Jean-François Pilâtre de Rozier, parvint, en octobre de la même année 1783, à monter vers le ciel dans la nacelle d'un ballon captif; pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme s'élevait dans les airs, sous les yeux ébahis d'une foule nombreuse massée rue de Montreuil, devant la Manufacture Réveillon. En novembre, il renouvelait l'expérience, mais en ballon libre cette fois. Accompagné du marquis d'Arlandes, il s'éleva jusqu'à mille mètres, resta 25 minutes en l'air et parcourut huit kilomètres de La Muette à la Butte aux Cailles. Encouragé par ce succès, Pilâtre de Rozier voulut aller plus loin et se préparer à traverser la mer. Il conçut un ballon double, l'un gonflé à l'hydrogène suivant un nouveau procédé découvert par le physicien Charles, et l'autre alimenté par un brasier selon le principe traditionnel de la montgolfière. Le 15 juin 1785, il s'envolait de Boulogne avec son ami Romain. Mais, parvenu au-dessus de la Manche, l'appareil fut repoussé vers la côte par un vent violent, l'enveloppe se déchira et le ballon tomba en flammes, entraînant dans la mort les deux aéronautes. Malgré cet échec, les montgolfières continuèrent à être perfectionnées pour arriver au premier "dirigeable" à moteur mécanique, inventé en 1852 par Henri Griffard, et, en 1900, au fameux Zeppelin qui assura dans les années 30 les services aériens au-dessus de l'Atlantique.
1792 : Dumouriez démissionne
Dumouriez devenu très populaire a accepté le 10 mars 1791, le portefeuille de ministre des Affaires étrangères, demande au roi qui, le 12, vient de renvoyer les ministres Roland, Clavière et Servan, de revenir sur son veto aux décrets contre les prêtres réfractaires. Une fois encore, le roi refuse. Dumouriez choisit de démissionner.
1815 : Début de la campagne de Belgique.
La veille, devant Charleroi, face aux troupes prussiennes de Blücher, Napoléon a lancé à ses soldats : " Pour tout Français qui a du coeur, le moment est arrivé de vaincre ou de périr. " En ce 15 juin, le soir, il écrit au maréchal comte Grouchy : " A 10 heures, la bataille était finie et nous nous trouvions maîtres de tout le champ de bataille. "
1843 : Naissance à Bergen ( Norvège ) du compositeur norvégien Edvard Hagerup Grieg (mort en 1907)
D'un père consul britanique d'origine écossaise et de mère norvégienne et musicienne il commence le piano à l'âge de six ans. Son caractère paresseux l'empêche de poursuivre des études normales. Il compose en outre " Peer Gynt ". Il sera surnommé le " Chopin du Nord ".
1862 : Les Turcs bombardent Belgrade à la suite d'un soulèvement serbe.
1904 : Un incendie à bord du vapeur "Général Slocum", près de l'île de Manhattan, fait plus de 1 000 morts.
1914 : Orage mémorable sur la Capitale Paris.
En cette après-midi, un orage mémorable prit des allures de cataclysme, un orage qui avait déjà tué six personnes en Angleterre, causé une collision de trains en Belgique, et qui, passant par Paris, s'engouffra dans le sous-sol ébranlé par les travaux du métro, faisant éclater les égoûts, les conduites de gaz. De l'Opéra à Saint Philippe du Roule, la chaussée s'ouvrit sous les pas des piétons et sous les roues des voitures. On compta douze morts, dont deux enfants et un chauffeur de taxi-auto englouti avec sa passagère, place Saint Augustin, dans une excavation profonde de dix mètres. Et tandis que les badauds viennent voir "les trous", tandis que les députés et les édites s'interpellent à la Chambre et à l'Hôtel de Ville pour demander "A qui la faute ?", on s'occupe d'enterrer les victimes. Et c'est le chauffeur de taxi, Pierre Cloup, père de cinq enfants et militant syndicaliste, qui aura les plus belles funérailles. Non, seulement le préfet de Police et le Préfet de la Seine se feront représenter, mais de son domicile de Levallois-Perret à la gare d'Austerlitz (d'où le cercueil partira pour la Corèze), ses collèges suivent en voiture le corbillard. Combien étaient-ils ? 400 selon le Figaro, 1000 selon le Petit Parisien, 4000 selon l'Excelsior ... Tous s'étaient cotisés pour offrir des couronnes aux inscriptions revendicatrices : "A une victime du devoir professionnel", "A une victime du mauvais état de la voirie"," A une victime de l'incurie administrative", enfin "A une victime du capitalisme", ce qui était plus astucieux, et assez inattendu !
1916 : Naissance du compositeur français Francis Lopez (mort en 1995)
1922 : La Cour Internationale de justice se réunit pour la première fois à La Haye.
1934 : La rencontre d'Hitler et de Mussolini à Venise se solde par un demi-échec, en raison des divergences d'intérêts de l'Allemagne et de l'Italie en ce qui concerne la vallée du Danube.
1934 : Naissance du comédien et fantaisiste français Guy Bedos.
1936 : Naissance du comédien français Claude Brasseur.
1940 : Les Allemands contournent la ligne Maginot et pénètrent en France.
1940 : Fin du gouvernement de Paul Reynaud créé huit jours plus tôt.
1943 : Naissance du chanteur français Johnny Hallyday.
1944 : Les Américains débarquent à Saïpan, dans les Mariannes.
1946 : Naissance de l'actrice française Brigitte Fossey.
1946 : Naissance du chanteur Demis Roussos
1948 : Fondation du plus grand journal Chinois (près de 40 millions de lecteurs), le " Quotidien du Peuple ".
Quotidien du matin tirant à six millions et demi d’exemplaires sur six pages en une seule édition, Le Quotidien du peuple, organe officiel du comité central du Parti communiste chinois, possède une équipe de mille personnes, dont trois cents journalistes ; il n’a aucun correspondant à l’étranger, 90 % de ses acheteurs sont des abonnés. Fondé le 15 juin 1948, Le Quotidien du peuple a eu pour ancêtres Le Guide lors de la première guerre civile révolutionnaire de 1924 à 1927, Le Combat entre 1927 et 1936, Le Quotidien de la nouvelle Chine durant la guerre de résistance antijaponaise de 1936 à 1945, enfin Le Quotidien de la libération entre 1945 et 1948. En tant qu’organe officiel du Parti communiste, Le Quotidien du peuple se voit attribuer des tâches primordiales : propagation de l’idéologie marxiste-léniniste, popularisation de la ligne générale dans les domaines politique, économique et culturel, critique et autocritique de la théorie et de la pratique marxiste-léniniste, éducation des masses laborieuses. Cet ensemble d’impératifs idéologiques passe avant la simple relation des faits et oriente évidemment celle-ci.La direction du journal est assurée par le bureau de la rédaction en chef, siège d’un collectif de sept membres qui comprend cinq sections : politique étrangère (70 journalistes), politique intérieure (60 journalistes), propagation de la théorie, littérature et art, travail des masses.Chaque section est elle-même divisée en sous-sections : la politique internationale est assurée par cinq groupes de spécialistes qui se répartissent continents ou sous-continents ; la politique intérieure a sept services de rubriques : agriculture, industrie, éducation (la plus importante), politique, parti, santé, sports.Parmi les quelque trois cents journalistes, deux cents le sont à plein temps et cent soixante sont véritablement rédacteurs, les autres étant assistants. Seuls une centaine de journalistes résident à Pékin ; les autres sont dispersés en province et comprennent une bonne centaine de politiques issus du prolétariat. Particularité du Quotidien du peuple, les journalistes n’écrivent généralement que des commentaires ou des éditoriaux concernant les nouvelles qui émanent de l’agence de presse Hsin Hua (Chine nouvelle). La justification de ce système repose sur l’idée que le parti doit prendre en main la rédaction des articles et signifie que l’équipe rédactionnelle accomplit un travail d’agenciers, n’effectuant pas de reportages ou d’enquêtes sur le terrain, mais sélectionnant les informations, les discutant en commissions spécialisées et leur donnant enfin la forme la plus idoine à une lecture extensive et éducative. Le rewriting est donc considérable, car la plupart des journalistes aident les personnalités officielles, cadres subalternes et travailleurs à rédiger leurs articles et à relater leurs expériences. Comme l’ensemble de la presse chinoise, Le Quotidien du peuple traite plus qu’il ne fournit l’information. Imprimé dans dix grandes villes en plus de Pékin, le journal voit son très faible tirage compensé par le fait que la plupart des journaux régionaux reprennent in extenso ses articles. Ainsi, par ses " éditions régionales ", l’organe du comité central peut véritablement compter quelque 40 millions de lecteurs. Il est imprimé sur huit pages depuis 1980. Introduite en 1979, la publicité occupe moins de 10 % de la surface totale du journal.
1950 : L'Allemagne Fédérale est admise au sein du Conseil de l'Europe.
1960 : Naissance de Michèle Laroque (actrice française) à Nice.
1964 : Naissance de Courteney Cox (actrice américaine et top-model)
1969 : Election de Georges Pompidou à la présidence de la République française.
Election au deuxième tour de scrutin du Président Français, Georges Pompidou, l’ex-secrétaire du Général de Gaule et l’héritier du Gaulisme, devant Alain Poher.
1969 : Naissance du tennisman français Cédric Pioline.
1970 : La loi martiale est proclamée en Turquie, où ont éclaté de graves émeutes.
1977 : Les Espagnols votent dans les premières élections législatives libres organisées depuis 41 ans dans leur pays.
Dès le 22 juillet 1969, Franco désigne Juan Carlos comme héritier du trône et chef d'État par intérim en cas d'absence ou de maladie. A partir d'octobre 1975, pendant la maladie du Caudillo et jusqu'à sa mort le 20 novembre, le jeune roi exerce le pouvoir resté vacant. Le 27 novembre 1975, Juan Carlos accède officiellement au trône d'Espagne. Il réussit une transition pacifique de la dictature à la démocratie par un régime parlementaire et sous les gouvernements successifs de Carlos Arias Navarro, Adolfo Suàrez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe Gonzalez et José Maria Aznar. Le 15 juin 1977 ont lieu les premières élections démocratiques depuis plus de 50 ans. En 1978, une nouvelle constitution démocratique et libérale est adoptée par référendum : abolition de la peine de mort, liberté syndicale et d'information, législation du divorce. En février 1981, Juan Carlos sauve la jeune démocratie espagnole menacée par un coup d'État. Le lieutenant-colonel de la garde civile Tejero Molina et ses hommes ayant pris les parlementaires en otages. En 1982 l'Espagne adhère à l'OTAN et entre dans la Communauté européenne en 1986.
1982 : Le drapeau britannique flotte à nouveau sur la capitale des Iles Malouines, Port-Stanley, après la reddition des troupes d'occupation argentines.
Fin de la guerre des Malouines entre l’Argentine et l’Angleterre, par la reddition de la garnison argentine de " Port-Stanley " qui reconnaissent le " fait " anglais ! Et tout ça pour une ile ou ne poussent que des moutons (sic !) !
1988 : Attentat de l'IRA à Lisburn (Irlande du Nord) : six militaires britanniques sont tués.
1988 : Le Dalaï-Lama propose à Strasbourg un plan d'association entre la Chine et le Tibet.
1990 : Au Cap d'Agde, pour la première fois en France, une jeune femme accouche, assistée d'une équipe spécialisée, dans les eaux de la mer Méditerranée.
1991 : Au Pendjab, des terroristes sikhs massacrent 126 passagers de deux trains.
1994 : Décès de Manos Hatzidakis, 69 ans, compositeur grec, auteur de thèmes musicaux aussi populaires que "Les enfants du Pirée".
1996 : Décès d'Ella Fitzgerald, 78 ans, chanteuse noire américaine
1997 : Après sept mois d'interruption consécutifs à un incendie à bord d'une navette, le trafic poids-lourds reprend dans le Tunnel sous la Manche.
1997 : La Cour suprême israélienne décide de ne pas poursuivre le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, dans l'affaire de trafic d'influence, dite du "Bibigate".
1998 : Les avions de l'OTAN participent à des manoeuvres aériennes en Albanie et en Macédoine afin de convaincre Slobodan Milosevic de mettre fin à la répression serbe au Kosovo.
1999 : Trois nouveaux charniers sont découverts en bordure d'une route menant à Koronica, dans l'ouest du Kosovo.
1999 : En cinq jours, 37 300 Serbes ont quitté le Kosovo à destination de la République yougoslave du Monténégro et de la Serbie.
1999 : Deux scientifiques israéliens annoncent avoir relevé des traces de plantes et de pollen sur le suaire de Turin, qui prouvent selon eux que le précieux tissu, considéré par de nombreux chrétiens comme celui de Jésus, provient bien du Proche-Orient.
1999 : L'Assemblée nationale adopte en troisième lecture la proposition de loi sur le Pacte civil de solidarité.
1999 : Après la Belgique et le Luxembourg, la France décide de retirer de la vente les produits Coca-Cola, à la suite des intoxications de ces derniers jours. L'embargo sera levé le 24 juin.
1999 : La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement rendu en première instance par le tribunal de Digne ordonnant la destruction de la statue dédiée à Gilbert Bourdin, le gourou décédé de la secte du Mandarom.
1215 : Jean sans Terre signe la Grande Chart, "Magna Carta", imposée par ses barons
Né à Oxford en 1167, Jean sans Terre complota d'abord contre son père Henri II puis contre son frère Richard Coeur de Lion auquel il devait succéder en 1199 au détriment de son neveu, Arthur Ier de Bretagne. Cité par Philippe Auguste devant la cour des pairs de France en 1202 pour l'enlèvement d'Isabelle d'Angoulême, il fut condamné par défaut à la perte de ses fiefs français (Normandie, Maine, Anjou, Touraine et Poitou). C'est alors qu'il reçut le surnom de "sans terre". Un an plus tard, l'assassinat d'Arthur souleva la Bretagne contre lui. Il réussit ensuite à se brouiller avec le Saint-Siège au sujet du titulaire du siège de l'archevêché de Canterbury. Le pape Innocent III jeta l'interdit sur le royaume d'Angleterre en 1208, excommunia le roi en 1209 et autorisa Philippe Auguste à conquérir l'Angleterre en 1213. Devant l'opposition croissante de ses sujets, Jean sans Terre finit par se réconcilier avec le Saint-Siège. Mais après le démantèlement de la coalition qu'il avait suscitée contre la France (il fut battu à La Roche-aux-Moines près d'Angers tandis que ses alliés l'étaient à Bouvines en 1214), il se heurta à la révolte des barons d'Angleterre qui le forcèrent à signer la Grande Charte, le 15 juin 1215 à Runnymede, près de Windsor. Elle garantissait les droits féodaux, les libertés de l'Eglise et des villes contre l'arbitraire royal et instituait le contrôle de l'impôt par le Grand Conseil du royaume ainsi que des garanties judiciaires. Cette Charte, qui sera l’archétype des " Constitutions " européennes, sera le premier monument de la Constitution anglaise. Bien qu’en théorie ils aient été dus à une médiation de l’archevêque de Canterbury, Stephen Langton, entre le roi et ses grands vassaux, ses soixante-trois articles sont imposés à Jean sans Terre par une révolte de barons, soutenus par les principaux prélats de l’Église. Le document est daté du 15 juin "dans la prairie appelée Runnymede, entre Windsor et Staines". Né de la multiplicité des abus royaux, en particulier en matière fiscale et ecclésiastique, le compromis vise à les réformer et à en prévenir le renouvellement : on ne doit pas y rechercher la première mouture d’une "déclaration des droits" ou d’une constitution. Ainsi l’article premier promet de protéger la liberté des élections épiscopales et l’article 2 de garantir son héritage au successeur légitime d’un vassal. Les articles 12 et 14 font dépendre de l’approbation d’un "Conseil du royaume" la levée de taxes extraordinaires ; l’article 39 s’élève contre toute arrestation arbitraire ; l’article 42 garantit la liberté de circulation à l’intérieur et hors du royaume ; l’article 61 semble fonder un véritable "droit à l’insurrection", en disposant que le souverain coupable d’avoir transgressé les franchises de ses sujets devrait être ramené à la raison par un soulèvement de la population conduite par des barons et qui lui "infligerait des épreuves par tous les moyens", à l’exclusion des menaces physiques sur sa personne et sur les membres de sa famille. On soulignera le rôle toujours exclusif des grands vassaux dans le "Conseil" et dans l’"insurrection" : la Grande Charte renforce la féodalité. Néanmoins, ce document reste au sens propre " une limitation " du pouvoir royal au bénéfice de la nation !!! .Jean sans Terre la désavoua en 1216 et les barons élirent roi le futur Louis VIII de France qui débarqua en Angleterre. La mort de Jean sans Terre sauva la dynastie : son fils Henri III lui succéda et confirma la Grande Charte (1265) qui devint le symbole de la lutte contre le pouvoir absolu.
1520 : Le pape Léon X excommunie Martin Luther par la bulle "Exsurge Domine".
Condamnation par le Pape Léon X, au moyen de la Bulle " Exsurge Domine ", de Martin Luther et de son hérésie le Protestantisme. La légende est peut-être plus vraie que l’histoire ! Elle représente Léon X, pape Médicis de la beauté, arrêtant à peine une chasse à courre pour signer, dans une clairière des monts Albins, peu loins de Rome, la condamnation d’un moine déviant inconnu qui perturbe l’Allemagne. Cette bulle, publiée à Rome le 15 juin 1520, a été préparée au cours de l’hiver précédent par une commission de théologiens, issus en majorité des ordres mendiants prédicateurs officiels des indulgences et des aumônes pour la basilique Saint-Pierre. Cette vente des indulgences que justement Luther attaquait ouvertement. Certains théologiens tentaient de nuancer la rédaction, alors que le théologien Jean Eck prônait une condamnation globale et radicale d’un Luther scandaleux et hérétique. Discutée par quatre consistoires de cardinaux de curie, la bulle ménage la personne de Luther — il a soixante jours pour se soumettre — et porte condamnation de quarante et une propositions doctrinales, tirées des œuvres de l’augustin saxon. Inspiré du jugement de la faculté théologique de Louvain du 7 novembre 1519, ce "syllabus", où Jean Eck a fait tout de même passer six articles condamnant Luther comme défenseur hérétique des conciles au détriment de la primauté romaine, constitue le premier condensé de la pensée luthérienne. Telle quelle, dans le climat d’une année marquée par la mort de Maximilien Ier et l’élection difficile de Charles Quint (28 juin 1519), la bulle, instrument juridique, ne peut constituer un moyen efficace de paix. Luther, une première fois, en appelle au concile et au pape mal informé. Le pape étant mieux " informé ", il lance un deuxième un deuxième appel.La réponse romaine vient alors sous la forme d’une nouvelle bulle excommuniant cette fois Luther et ses partisans (Decet romanum pontificem , 3 janv. 1521). Cette bulle ne sera que peu appliquée en Allemagne. Sur le terrain de l’Empire, la publication de la bulle Exsurge Domine ne se fait qu’en Rhénanie et aux Pays-Bas, parce que Charles Quint y appuie le nonce Alexandre. Jean Eck, passionnément anti-luthérien, réussit à en faire des proclamations officielles dans les cathédrales de Brandenburg, Merseburg, Meissen, dont dépend Wittenberg. Mais l’exécution des sanctions prises rencontre une résistance passive ou active quasi générale en terre allemande. Luther a-t-il jeté au feu un exemplaire de la bulle sous les acclamations des étudiants de Wittenberg (10 déc. 1520).En tout cas, elle a été souvent jetée à l’eau et piétiné ; on a peu brûlé les écrits de Luther, et le bannissement par Charles Quint hors de l’Empire du réformateur excommunié n’a jamais été effectif, protégé qu’il était par Frédéric le Sage de Saxe, bien d’autres princes, d’autres laïcs et par le peuple ; Nombre d’évêques allemands même adoptent une attitude "proche du sabotage" (H. Jedin). Cette résistance s’explique par le fait que Rome a mis les évêques hors d’affaire dans une procédure judiciaire qui relève en première instance de leur ressort. Parce que pareille attitude ne donne pas droit aux justes thèses conciliaristes traditionnelles. Parce que la Rome papale de la Renaissance ne se remet pas en cause sous les appels réformistes de Martin Luther, continuant notamment à prélever de lourdes taxes sur l’Église allemande. Parce que l’opinion publique persiste à voir EN Luther un fils de l’Église exerçant la liberté chrétienne, résistant mais non hérétique, dont surtout l’Appel à la noblesse allemande de l’été 1520 constitue un véritable programme de concile de réformation.
1672 : Les Hollandais ouvrent les digues pour empêcher l'armée française de s'emparer d'Amsterdam.
1752 : Benjamin Franklin démontre sa théorie sur la foudre en lancant un cerf-volant au cours d'un orage à Philadelphie.
1785 : La dernière ascension de Pilâtre de Rozier
Depuis que les frères Montgolfier avaient inventé en juin 1783 le principe de l'aérostat -une énorme sphère de toile et de papier gonflée à l'air chaud- de nombreux physiciens tentaient d'en améliorer la technique. L'un d'entre eux, Jean-François Pilâtre de Rozier, parvint, en octobre de la même année 1783, à monter vers le ciel dans la nacelle d'un ballon captif; pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme s'élevait dans les airs, sous les yeux ébahis d'une foule nombreuse massée rue de Montreuil, devant la Manufacture Réveillon. En novembre, il renouvelait l'expérience, mais en ballon libre cette fois. Accompagné du marquis d'Arlandes, il s'éleva jusqu'à mille mètres, resta 25 minutes en l'air et parcourut huit kilomètres de La Muette à la Butte aux Cailles. Encouragé par ce succès, Pilâtre de Rozier voulut aller plus loin et se préparer à traverser la mer. Il conçut un ballon double, l'un gonflé à l'hydrogène suivant un nouveau procédé découvert par le physicien Charles, et l'autre alimenté par un brasier selon le principe traditionnel de la montgolfière. Le 15 juin 1785, il s'envolait de Boulogne avec son ami Romain. Mais, parvenu au-dessus de la Manche, l'appareil fut repoussé vers la côte par un vent violent, l'enveloppe se déchira et le ballon tomba en flammes, entraînant dans la mort les deux aéronautes. Malgré cet échec, les montgolfières continuèrent à être perfectionnées pour arriver au premier "dirigeable" à moteur mécanique, inventé en 1852 par Henri Griffard, et, en 1900, au fameux Zeppelin qui assura dans les années 30 les services aériens au-dessus de l'Atlantique.
1792 : Dumouriez démissionne
Dumouriez devenu très populaire a accepté le 10 mars 1791, le portefeuille de ministre des Affaires étrangères, demande au roi qui, le 12, vient de renvoyer les ministres Roland, Clavière et Servan, de revenir sur son veto aux décrets contre les prêtres réfractaires. Une fois encore, le roi refuse. Dumouriez choisit de démissionner.
1815 : Début de la campagne de Belgique.
La veille, devant Charleroi, face aux troupes prussiennes de Blücher, Napoléon a lancé à ses soldats : " Pour tout Français qui a du coeur, le moment est arrivé de vaincre ou de périr. " En ce 15 juin, le soir, il écrit au maréchal comte Grouchy : " A 10 heures, la bataille était finie et nous nous trouvions maîtres de tout le champ de bataille. "
1843 : Naissance à Bergen ( Norvège ) du compositeur norvégien Edvard Hagerup Grieg (mort en 1907)
D'un père consul britanique d'origine écossaise et de mère norvégienne et musicienne il commence le piano à l'âge de six ans. Son caractère paresseux l'empêche de poursuivre des études normales. Il compose en outre " Peer Gynt ". Il sera surnommé le " Chopin du Nord ".
1862 : Les Turcs bombardent Belgrade à la suite d'un soulèvement serbe.
1904 : Un incendie à bord du vapeur "Général Slocum", près de l'île de Manhattan, fait plus de 1 000 morts.
1914 : Orage mémorable sur la Capitale Paris.
En cette après-midi, un orage mémorable prit des allures de cataclysme, un orage qui avait déjà tué six personnes en Angleterre, causé une collision de trains en Belgique, et qui, passant par Paris, s'engouffra dans le sous-sol ébranlé par les travaux du métro, faisant éclater les égoûts, les conduites de gaz. De l'Opéra à Saint Philippe du Roule, la chaussée s'ouvrit sous les pas des piétons et sous les roues des voitures. On compta douze morts, dont deux enfants et un chauffeur de taxi-auto englouti avec sa passagère, place Saint Augustin, dans une excavation profonde de dix mètres. Et tandis que les badauds viennent voir "les trous", tandis que les députés et les édites s'interpellent à la Chambre et à l'Hôtel de Ville pour demander "A qui la faute ?", on s'occupe d'enterrer les victimes. Et c'est le chauffeur de taxi, Pierre Cloup, père de cinq enfants et militant syndicaliste, qui aura les plus belles funérailles. Non, seulement le préfet de Police et le Préfet de la Seine se feront représenter, mais de son domicile de Levallois-Perret à la gare d'Austerlitz (d'où le cercueil partira pour la Corèze), ses collèges suivent en voiture le corbillard. Combien étaient-ils ? 400 selon le Figaro, 1000 selon le Petit Parisien, 4000 selon l'Excelsior ... Tous s'étaient cotisés pour offrir des couronnes aux inscriptions revendicatrices : "A une victime du devoir professionnel", "A une victime du mauvais état de la voirie"," A une victime de l'incurie administrative", enfin "A une victime du capitalisme", ce qui était plus astucieux, et assez inattendu !
1916 : Naissance du compositeur français Francis Lopez (mort en 1995)
1922 : La Cour Internationale de justice se réunit pour la première fois à La Haye.
1934 : La rencontre d'Hitler et de Mussolini à Venise se solde par un demi-échec, en raison des divergences d'intérêts de l'Allemagne et de l'Italie en ce qui concerne la vallée du Danube.
1934 : Naissance du comédien et fantaisiste français Guy Bedos.
1936 : Naissance du comédien français Claude Brasseur.
1940 : Les Allemands contournent la ligne Maginot et pénètrent en France.
1940 : Fin du gouvernement de Paul Reynaud créé huit jours plus tôt.
1943 : Naissance du chanteur français Johnny Hallyday.
1944 : Les Américains débarquent à Saïpan, dans les Mariannes.
1946 : Naissance de l'actrice française Brigitte Fossey.
1946 : Naissance du chanteur Demis Roussos
1948 : Fondation du plus grand journal Chinois (près de 40 millions de lecteurs), le " Quotidien du Peuple ".
Quotidien du matin tirant à six millions et demi d’exemplaires sur six pages en une seule édition, Le Quotidien du peuple, organe officiel du comité central du Parti communiste chinois, possède une équipe de mille personnes, dont trois cents journalistes ; il n’a aucun correspondant à l’étranger, 90 % de ses acheteurs sont des abonnés. Fondé le 15 juin 1948, Le Quotidien du peuple a eu pour ancêtres Le Guide lors de la première guerre civile révolutionnaire de 1924 à 1927, Le Combat entre 1927 et 1936, Le Quotidien de la nouvelle Chine durant la guerre de résistance antijaponaise de 1936 à 1945, enfin Le Quotidien de la libération entre 1945 et 1948. En tant qu’organe officiel du Parti communiste, Le Quotidien du peuple se voit attribuer des tâches primordiales : propagation de l’idéologie marxiste-léniniste, popularisation de la ligne générale dans les domaines politique, économique et culturel, critique et autocritique de la théorie et de la pratique marxiste-léniniste, éducation des masses laborieuses. Cet ensemble d’impératifs idéologiques passe avant la simple relation des faits et oriente évidemment celle-ci.La direction du journal est assurée par le bureau de la rédaction en chef, siège d’un collectif de sept membres qui comprend cinq sections : politique étrangère (70 journalistes), politique intérieure (60 journalistes), propagation de la théorie, littérature et art, travail des masses.Chaque section est elle-même divisée en sous-sections : la politique internationale est assurée par cinq groupes de spécialistes qui se répartissent continents ou sous-continents ; la politique intérieure a sept services de rubriques : agriculture, industrie, éducation (la plus importante), politique, parti, santé, sports.Parmi les quelque trois cents journalistes, deux cents le sont à plein temps et cent soixante sont véritablement rédacteurs, les autres étant assistants. Seuls une centaine de journalistes résident à Pékin ; les autres sont dispersés en province et comprennent une bonne centaine de politiques issus du prolétariat. Particularité du Quotidien du peuple, les journalistes n’écrivent généralement que des commentaires ou des éditoriaux concernant les nouvelles qui émanent de l’agence de presse Hsin Hua (Chine nouvelle). La justification de ce système repose sur l’idée que le parti doit prendre en main la rédaction des articles et signifie que l’équipe rédactionnelle accomplit un travail d’agenciers, n’effectuant pas de reportages ou d’enquêtes sur le terrain, mais sélectionnant les informations, les discutant en commissions spécialisées et leur donnant enfin la forme la plus idoine à une lecture extensive et éducative. Le rewriting est donc considérable, car la plupart des journalistes aident les personnalités officielles, cadres subalternes et travailleurs à rédiger leurs articles et à relater leurs expériences. Comme l’ensemble de la presse chinoise, Le Quotidien du peuple traite plus qu’il ne fournit l’information. Imprimé dans dix grandes villes en plus de Pékin, le journal voit son très faible tirage compensé par le fait que la plupart des journaux régionaux reprennent in extenso ses articles. Ainsi, par ses " éditions régionales ", l’organe du comité central peut véritablement compter quelque 40 millions de lecteurs. Il est imprimé sur huit pages depuis 1980. Introduite en 1979, la publicité occupe moins de 10 % de la surface totale du journal.
1950 : L'Allemagne Fédérale est admise au sein du Conseil de l'Europe.
1960 : Naissance de Michèle Laroque (actrice française) à Nice.
1964 : Naissance de Courteney Cox (actrice américaine et top-model)
1969 : Election de Georges Pompidou à la présidence de la République française.
Election au deuxième tour de scrutin du Président Français, Georges Pompidou, l’ex-secrétaire du Général de Gaule et l’héritier du Gaulisme, devant Alain Poher.
1969 : Naissance du tennisman français Cédric Pioline.
1970 : La loi martiale est proclamée en Turquie, où ont éclaté de graves émeutes.
1977 : Les Espagnols votent dans les premières élections législatives libres organisées depuis 41 ans dans leur pays.
Dès le 22 juillet 1969, Franco désigne Juan Carlos comme héritier du trône et chef d'État par intérim en cas d'absence ou de maladie. A partir d'octobre 1975, pendant la maladie du Caudillo et jusqu'à sa mort le 20 novembre, le jeune roi exerce le pouvoir resté vacant. Le 27 novembre 1975, Juan Carlos accède officiellement au trône d'Espagne. Il réussit une transition pacifique de la dictature à la démocratie par un régime parlementaire et sous les gouvernements successifs de Carlos Arias Navarro, Adolfo Suàrez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe Gonzalez et José Maria Aznar. Le 15 juin 1977 ont lieu les premières élections démocratiques depuis plus de 50 ans. En 1978, une nouvelle constitution démocratique et libérale est adoptée par référendum : abolition de la peine de mort, liberté syndicale et d'information, législation du divorce. En février 1981, Juan Carlos sauve la jeune démocratie espagnole menacée par un coup d'État. Le lieutenant-colonel de la garde civile Tejero Molina et ses hommes ayant pris les parlementaires en otages. En 1982 l'Espagne adhère à l'OTAN et entre dans la Communauté européenne en 1986.
1982 : Le drapeau britannique flotte à nouveau sur la capitale des Iles Malouines, Port-Stanley, après la reddition des troupes d'occupation argentines.
Fin de la guerre des Malouines entre l’Argentine et l’Angleterre, par la reddition de la garnison argentine de " Port-Stanley " qui reconnaissent le " fait " anglais ! Et tout ça pour une ile ou ne poussent que des moutons (sic !) !
1988 : Attentat de l'IRA à Lisburn (Irlande du Nord) : six militaires britanniques sont tués.
1988 : Le Dalaï-Lama propose à Strasbourg un plan d'association entre la Chine et le Tibet.
1990 : Au Cap d'Agde, pour la première fois en France, une jeune femme accouche, assistée d'une équipe spécialisée, dans les eaux de la mer Méditerranée.
1991 : Au Pendjab, des terroristes sikhs massacrent 126 passagers de deux trains.
1994 : Décès de Manos Hatzidakis, 69 ans, compositeur grec, auteur de thèmes musicaux aussi populaires que "Les enfants du Pirée".
1996 : Décès d'Ella Fitzgerald, 78 ans, chanteuse noire américaine
1997 : Après sept mois d'interruption consécutifs à un incendie à bord d'une navette, le trafic poids-lourds reprend dans le Tunnel sous la Manche.
1997 : La Cour suprême israélienne décide de ne pas poursuivre le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, dans l'affaire de trafic d'influence, dite du "Bibigate".
1998 : Les avions de l'OTAN participent à des manoeuvres aériennes en Albanie et en Macédoine afin de convaincre Slobodan Milosevic de mettre fin à la répression serbe au Kosovo.
1999 : Trois nouveaux charniers sont découverts en bordure d'une route menant à Koronica, dans l'ouest du Kosovo.
1999 : En cinq jours, 37 300 Serbes ont quitté le Kosovo à destination de la République yougoslave du Monténégro et de la Serbie.
1999 : Deux scientifiques israéliens annoncent avoir relevé des traces de plantes et de pollen sur le suaire de Turin, qui prouvent selon eux que le précieux tissu, considéré par de nombreux chrétiens comme celui de Jésus, provient bien du Proche-Orient.
1999 : L'Assemblée nationale adopte en troisième lecture la proposition de loi sur le Pacte civil de solidarité.
1999 : Après la Belgique et le Luxembourg, la France décide de retirer de la vente les produits Coca-Cola, à la suite des intoxications de ces derniers jours. L'embargo sera levé le 24 juin.
1999 : La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement rendu en première instance par le tribunal de Digne ordonnant la destruction de la statue dédiée à Gilbert Bourdin, le gourou décédé de la secte du Mandarom.
Bon début de semaine à tous....
Publié à 09:49 par acoeuretacris
Avec le soleil je vous le souhaite...
pour bien commencer la semaine...
chez nous le parapluie de sortie...
bon lundi à tous....
bisous...
pour bien commencer la semaine...
chez nous le parapluie de sortie...
bon lundi à tous....
bisous...
bonne journée à tous....
Publié à 09:55 par acoeuretacris
Je vous souhaite de passer une excellente journée...
que j'espère sous le soleil....
je vous dit à demain...
Petite pause en famille aujourd'hui....
bisous à tous...
que j'espère sous le soleil....
je vous dit à demain...
Petite pause en famille aujourd'hui....
bisous à tous...
Bisous...
Publié à 20:55 par acoeuretacris
à demain.....
Publié à 20:46 par acoeuretacris
Les départements et ... - La Creuse - 23 -
Publié à 09:22 par acoeuretacris
(Région Limousin)
Le département de la Creuse, formé d'une grande partie de l'ancienne province de la Marche et de quelques petits pays du Limousin, du Berry et de l'Auvergne, dépendait, avant la conquête romaine, du pays des Lemovices, et il dut à sa position sur les frontières du pays occupé par ce peuple le nom de Marchia Lemovicina. Plus lard, la Marche s'agrandit du pays de Combraille (pays des Cambiovicenses, Combraliae pagus). Elle fit partie de l'Aquitaine première, et passa sous la domination des Wisigoths, lorsqu'ils fondèrent le royaume de Toulouse (419). Elle suivit la fortune du Limousin et reconnut l'autorité des Francs après la victoire de Clovis à Vouillé (507).
En 571, les habitants furent, comme ceux de l'Auvergne, décimés par une horrible contagion dont Grégoire de Tours signal e les ravages. Desiderius, duc de Toulouse, et Bladaste, duc de Bordeaux, dans leur expédition contre le Berry, suivirent la grande voie romaine qui conduisait de Limoges à Bourges. Ils traversèrent la Marche et s'arrêtèrent peut-être dans les murs d'Ahun (583). Pendant la lutte de Pépin contre l'Aquitaine, Remistan ravagea toute la contrée et s'avança jusque dans le bas Berry, en 767.
Dans le démembrement de l'empire carlovingien, la Marche, à l'exemple de toutes les provinces de France, se morcela en un grand nombre de seigneuries. Elle ne put échapper aux ravages des Sarrasins et des Normands. En 846, ils dévastèrent le Limousin et s'avancèrent jusqu'aux limites du Berry et de l'Auvergne. En 930, ils reparurent ; mais, cette fois, ils furent battus et repoussés par le roi Raoul. Les Hongrois vinrent achever la ruine des provinces françaises. Ils pénétrèrent, en 937, jusqu'aux frontières de la Marche, et revinrent, en 951, désoler toute l'Aquitaine.
La France n'avait plus de gouvernement, plus d'armée ; elle était tombée dans la plus désastreuse anarchie. C'est au milieu de cette société en dissolution et dans l'effort tenté pour la reconstituer sous la forme féodale que se fonda, vers 968, le comté de la Marche. Les grands fiefs étaient autant de souverainetés indépendantes, et leurs possesseurs reconnaissaient à peine la suprématie nominale du roi. C'est ainsi que, malgré les menaces de Hugues Capet, Adalbert Talleyrand, comte de la Marche et de Périgord, s'allie avec Foulques Nerra, duc d'Anjou, contre Conan, comte de Rennes.
Tandis que Foulques s'empare de Nantes, Adalbert assiège la ville de Tours. Le roi marche au secours de cette place (992) . Il somme son vassal de se retirer. « Qui t'a fait comte ? » lui dit-il. Adalbert répond : « Qui t'a fait roi ? » Ce mot célèbre du comte de la Marche caractérise bien la politique féodale au Xe siècle. L'autorité royale baissa encore sous les successeurs de Hugues Capet. Un moment resserrée dans Paris par la féodalité, elle ne fut presque plus qu'une ombre. On trouve, en effet, en 1095, avant les croisades, plus de quatre-vingts grands fiefs qui avaient des souverains héréditaires et une véritable indépendance.
C'étaient quatre-vingts rois qu'il y avait en France, et parmi eux on compte plusieurs des anciens vassaux du duc de France qui ne lui obéissaient plus. Philippe Ier ne possédait réellement que les comtés de Paris, d'Étampes, de Melun, d'Orléans, de Dreux et de Sens, et, en montrant à son fils le château du seigneur de Montlhéry aux portes de Paris, il lui disait : « Beau fils Louis, garde bien cette tour qui tant de fois m'a travaillé, et en qui combattre et assaillir je me suis presque tout enseveli, et par la déloyauté de laquelle je ne puis avoir bonne paix ni bonne sûreté ; en tout le royaume n'étoient maux faits ni trahisons sans leur assent et sans leur aide, et si grande confusion étoit entre ceux de Paris et ceux d'Orléans que l'on ne pouvoit aller en terre de l'autre pour marchandise ni pour autre chose sans la volonté à ces traîtres, si ce n'étoit de grandes forces de gens » (Chroniques de Saint-Denys).
Au XIe siècle, l'ombre même d'un gouvernement central, d'une nation générale semble avoir disparu. « Comment se fait-il, dit M. Guizot, que la civilisation et l'histoire vraiment française commencent précisément au moment où il est presque impossible de découvrir une France ? C'est que, dans la vie du peuple, l'unité extérieure, visible, l'unité de nom et de gouvernement, bien qu'importante, n'est pas la première, la plus réelle, celle qui constitue vraiment une nation. Il y a une unité plus profonde, plus puissante : c'est celle qui résulte, non pas de l'identité de gouvernement et de destinée, mais de la similitude des éléments sociaux, de la similitude des institutions, des moeurs, des idées, des sentiments, des langues ; l'unité qui réside dans les hommes mêmes que la société réunit, et non dans les formes de leur rapprochement ; l'unité morale enfin, très supérieure à l'unité, politique et qui peut seule la fonder solidement. A la fin du Xe siècle et au commencement du XIe, il n'y a point d'unité politique pareille à celle de Charlemagne ; mais les races commencent à s'amalgamer ; la diversité des lois, selon l'origine, n'est plus le principe de toute la législation. Les situations sociales ont acquis quelque fixité ; des institutions, non pas les mêmes, mais partout analogues, les institutions féodales ont prévalu, ou à peu près, sur tout le territoire. Au lieu de la diversité radicale, impérissable, de la langue latine et des langues germaniques, deux langues commencent à se former, la langue romane du Midi et la langue romane du Nord, différentes sans doute, cependant de même origine, de même caractère, et destinées à s'amalgamer un jour. Dans l'âme des hommes, dans leur existence morale, la diversité commence aussi à s'effacer.
« Le Germain est moins adonné à ses traditions, à ses habitudes germaniques ; il se détache peu à peu de son passé pour appartenir à sa situation présente. Il en arrive autant du Romain ; il se souvient moins de l'ancien. empire et de sa chute, et des sentiments qui en naissaient pour lui. Sur les vainqueurs et sur les vaincus, les faits nouveaux, actuels, qui leur sont communs, exercent chaque jour plus d'empire. En un mot, l'unité politique est à peu près nulle, la diversité réelle encore très grande ; cependant il y a au fond plus d'unité véritable qu'il n'y en a eu depuis cinq siècles. On commence à entrevoir les éléments d'une nation ; et la preuve c'est que, depuis cette époque, la tendance de tous ces éléments sociaux à se rapprocher, à s'assimiler, à se former en grandes masses, c'est-à-dire la tendance vers l'unité nationale, et par là vers l'unité politique, devient le caractère dominant de l'histoire de la civilisation française. »
Dès le règne de Philippe le Gros commence, contre la féodalité, la guerre qui, par l'alliance de la royauté et des communes, doit aboutir au triomphe du principe moderne de la centralisation. Le fils de Philippe Ier ne reste pas, comme son père, emprisonné dans le domaine des ducs de France. Il cherche à étendre au loin son influence et son action. En 1121, nous le voyons s'avancer jusqu'aux confins de la Marche et diriger une expédition contre le comte d'Auvergne. Cinq ans plus tard, il intervient de nouveau en faveur de l'évêque de Clermont et force le comte à se soumettre au jugement -de la cour du roi (1126). Le comté de la Marche passa, vers ce temps, à la famille des Montgomery, dont un des membres, Adalbert IV, partant pour la terre sainte en 1177, vendit son domaine, pour cinq mille mires d'argent. à Henri II, roi d'Angleterre. Cette vente fut annulée sur la demande des seigneurs de Lusignan, qui, depuis longtemps, avaient des prétentions sur la Marche. Henri Il rendit ce comté à Hugues de Lusignan.
Vers la fin du XIe siècle, des bandes de routiers se levèrent dans le Berry et mirent toute la contrée au pillage. Ils prenaient le nom de Cottereaux. Les seigneurs des pays voisins, de la Marche, de l'Auvergne, formèrent contre eux l'association des Capuchons, et les taillèrent en pièces dans plusieurs rencontres (1184). Pendant les guerres de Philippe-Auguste et de Jean sans Terre, le comté de la Marche, situé à la limite des possessions anglaises et françaises, se trouva exposé aux ravages des gens d'armes.
Le comte Hugues le Brun suivit le parti du roi de France. Il était animé contre le roi d'Angleterre par des griefs personnels. Jean lui avait enlevé quelques châteaux et sa fiancée, fille du comte d'Angoulême (1201). En 1206, les deux rois signèrent une trêve de deux ans ; Hugues le Brun fut un des garants de Philippe-Auguste (Chroniques de Rigord). Philippe, poursuivant l'oeuvre de Louis le Gros et prenant au sérieux son titre de roi, était pour les grands vassaux un maître incommode. Hugues de Lusignan ne lui resta pas longtemps fidèle. Il se ligua en 1213 avec Jean sans Terre, son ancien ennemi. Mais la paix fut bientôt rétablie. On nomma des arbitres pour les infractions commises dans le Berry, l'Auvergne, le comté de la Marche et le Limousin ; ils se réunirent entre Aigurande et Cuzon, châteaux du comté de la Marche.
Pendant la minorité de Louis IX, la maison de Lusignan s'associa à la réaction féodale tentée contre la régente, Blanche de Castille. Le comte de la Marche prit les armes comme le duc de Bretagne et le comte de Champagne ; mais, comme eux, il fut obligé de se soumettre (1227). Ses successeurs régnèrent sans éclat jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En 1308, Gui de Lusignan, mourant sans enfants, légua le comté de la Marche à Philippe le Bel.
Le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Creuse fut alors presque tout entier réuni au domaine royal, sauf la terre de Combraille, qui appartenait à la maison d'Auvergne. Le comté de la Marche fut érigé en pairie par lettres patentes données à Paris, au mois de mars 1316, en faveur de Charles de France, comte de la Marche. Charles succéda à son frère Philippe le Long (1322), et ainsi cette pairie fut éteinte. Mais, comme le même roi donna le comté de la Marche à Louis de Bourbon en échange du comté de Clermont en Beauvoisis, il fut érigé de nouveau en pairie par lettres patentes du mois de décembre 1327.
Il passa dans la maison d'Armagnac par le mariage d'Éléonore, fille de Jacques de Bourbon, avec Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac et de Castres. Leur fils, Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, comte de la Marche, de Pardiac, de Castres et de Beaufort, vi-comte de Murat, seigneur de Leuze, de Condé et de Montagne-en-Combraille, fut l'ennemi et la victime de Louis XI. Il périt par la main du bourreau (août 1477). Le roi confisqua ses biens, et donna le comté de la Marche à Pierre II de Bourbon, sire de Beaujeu, qui avait épousé Anne de France. Suzanne de Bourbon, leur fille, porta ce domaine en dot au connétable Charles de Bourbon. Celui-ci était déjà comte de Montpensier et dauphin d'Auvergne, duc de Bourbon, d'Auvergne et de Châtellerault, comte de Clermont en Beauvoisis, de Forez, de Gien vicomte de Carlat et de murat, seigneur de Beaujolais, de Combraille, de Mercoeur, d'Annonay, de La Roche-en-Régnier et de Bourbon-Lancy.
La trahison du connétable anéantit cette puissance redoutable de la maison de Bourbon. Ses biens furent confisqués en 1523. Le comté de la Marche passa à Louise de Savoie, mère de François Ier ; après la mort de cette princesse, il rentra dans le domaine de la couronne. François Ier le donna, par lettres du 12 juin 1540, à son troisième fils, Charles de France, pour le tenir en pairie ; mais ce prince mourut le 9 septembre 1545. Depuis lors, la Marche ne fut plus détachée de l'unité nationale. La féodalité s'était transformée en noblesse. Au XVIIIe siècle, le comté de la Marche fut le titre des fils aînés des princes de Conti.
L'histoire de la province n'est pas riche en détails intéressants. Durant les désastres de la guerre de Cent ans, les villes et les seigneurs ne trahirent pas la cause de la France. Le sire de Boussac, chambellan de Charles VII, le servit jusqu'au crime. Lorsque la guerre civile vint se mêler à la guerre étrangère, et que le dauphin souleva la Praguerie, Charles VII traversa la Marche en poursuivant son fils rebelle (1440). On a retrouvé au British Museum (m. 11, 542) des lettres royales du 4 décembre 1545, par lesquelles sont institués, dans la sénéchaussée de la Marche, cinq commissaires, à l'effet de percevoir, d'après un nouveau mode, un aide pour la solde des gens d'armes. Ce sont « nos amis et féaulx conseillers et chambellans, le sire de Culant, maître Jehau Tudert, maistre des requêtes ordinaires de notre hôtel, les sénéchal et chancelier de la Marche, et Pyon de Bar, notre valet de chambre. »
Il existe au cabinet des titres de la Bibliothèque nationale des quittances de ce Pyon de Bar. Le 1er décembre 1445, il avait reçu de Jacques de la Ville la somme de 100 livres à titre de commissaire ordonné pour asseoir au comté de la Marche la portion à l'aide de 300 000 francs, mis sus par le roi sur les pays de Languedoc au mois de janvier précédent. « Vous mandons et commettons que les gens d'armes qui sont du pays et ressort de la comté de la Marche soient dorénavant payés, selon l'ordonnance que nous avons de présent faite, à commencer le premier jour de janvier prochain venant. C'est assavoir : en argent 21 livres tournois par lance fournie de six personnes et six chevaux ; plus pour 10 livres tournois en nature. Et voulons toutes manières de gens être à ce contribuables, excepté gens d'Église, nobles vivant noblement, et autres qui, par nos dernières ordonnances, en étoient exemptés. » (Lettres du 3 août 1445, Ordonn. des rois de France, tome XIII, page 442 et pass.) « Et avec ce... mettez sus, audit pays et ressort de la Marche, avec les frais raisonnables ci-après déclarés, et outre le fait et payement desdits gens d'armes, la somme de 5 000 livres tournois, 500 livres tournois pour les frais. Laquelle somme est pour et au lieu de l'aide de 200 000 livres tournois que de nécessité étions contraint mettre sus en notre pays comme l'année passée. Mais, considéré la pauvreté de notredit peuple et la charge qu'ils ont desdits gens d'armes, nous avons modéré ledit, pays, pour sa portion dudit aide, à ladite somme de 5,000 livres tournois, et 500 livres tournois pour les frais. » (Biblioth. de l'école des Chartes, déc. 1846.)
Sous Louis XI, les états de la haute et basse Marche demandèrent à se réunir pour une imposition commune, et le roi les y autorisa (1478). Les états de cette province cessèrent de s'assembler au XVIIe siècle, après la victoire de Mazarin sur la Fronde et le triomphe de l'absolutisme. En 1531, la province fut affligée par les inondations et par la famine. La Creuse et la Gartempe débordèrent. « Estoit en ladite saison grand'cherté de blés et de vins ; car le setier de froment se vendoit 50 sols, le setier de seigle 40 sols et plus, etc. » C'est l'année où le comté de la Marche fut réuni à la couronne. Bientôt après se tinrent à Poitiers les Grands-Jours, « qui jugèrent deux cents causes en deux mois et condamnèrent un grand nombre de gentilshommes d'Anjou, Touraine, Maine, Aunis, Angoumois et Marche. »
En 1553, « les droits que les habitants prennent sur le sel furent vendus par le roi Henri II aux habitants du pays de Poitou, Saintonge, ville et -gouvernement de La Rochelle, Angoulême haut et bas Limousin, haute et basse Marche, qu'on appelle à cause de cela pays de franc-salé. » Sous le règne de Henri III, la Réforme pénétra dans la Marche, mais elle n'y fit pas de progrès. Pendant les guerres religieuses, « le sieur de Saint Marc était commandant pour l'Union au pays de la Marche. » (Palma Cayet.) Il périt en allant au secours de Randan, chef des ligueurs en Auvergne (1590). Les paysans de la Marche prirent part à la révolte des Croquants, en 1594.
Aux états de 1484 avaient paru les députés du comté de la Marche. Il n'en vint aucun à ceux de 1593. En 1614, la sénéchaussée de la haute Marche envoya aux états généraux Georges de La Roche-Aymon, sieur de Saint-Maixent ; Gabriel, sieur de Malité, et Jean Vallenet, lieutenant particulier à Guéret.
Les Grands-Jours, tenus à Limoges en 1605, n'avaient pas plus épargné les nobles brigands de la Marche que ceux du Limousin ; mais l'esprit féodal n'était pas encore détruit dans ces provinces presque sauvages. La royauté devait longtemps encore y rencontrer des ennemis. « Le 17 mars 1617, dit le Mercure françois le prince de Joinville partit de Paris pour aller en son gouvernement d'Auvergne, y lever des troupes et avoir l'œil sur les pratiques qui se faisoient au pays de la Marche, bas Limousin et provinces voisines, par M. de Bouillon, qui sollicitoit une assemblée générale de ceux de la religion réformée pour les exciter à se soulever et prendre les armes. » Vingt ans après reparaissent les Croquants. « On dit qu'en Limousin, la Marche, l'Auvergne et le Poitou, sont élevées plusieurs troupes de gens, sous le nom de Croquants, lesquels font une guerre aux partisans, et qu'on parle en deçà d'envoyer vers eux pour les apaiser. » (Lettre de Gui Patin, 26 mai 1637.)
Au commencement de la guerre de la Fronde, le marquis d'Effiat était gouverneur de la haute et basse Marche (1649). Aubusson et Guéret figurent dans la liste générale des villes où furent envoyées, le 2 août 1652, les lettres circulaires de la ville de Paris invoquant l'appui des autres cités du royaume. Aubusson et Guéret ne répondirent pas. La Marche était alors un pays perdu au milieu de la France. Qu'on en juge par les impressions de voyage du célèbre comte de Forbin, qui la traversa en 1684. « Comme le service du roi ne demandoit pas ma présence à Rochefort, car la saison étoit déjà fort avancée, mon oncle me conseilla d'aller en Provence, pour régler quelques affaires que j'y avois ; il m'ordonna en même temps de passer par Lyon et de parler à un homme qui lui devoit quelque argent. La route que j'avois à suivre étoit par le Périgord, le Limousin et l'Auvergne. La quantité de neige dont le pays étoit couvert le rendoit impraticable à un homme qui n'en avoit d'ailleurs aucune connoissance. Pour obvier à cet iriconvénient, je me joignis aux muletiers qui partent deux fois la semaine de Limoges pour Clermont. Leur marche étoit si lente et si ennuyeuse que je me trouvois bien malheureux d'être obligé de m'y conformer. Après les avoir ainsi suivis pendant quatre jours, nous arrivâmes à un cabaret en rase campagne. J'étois auprès du feu à causer avec l'hôtesse, lorsque je vis entrer six hommes qui ressembloient bien mieux à des bandits qu'à toute autre chose. Je demandai quels hommes c'étoient : Ce sont, me répondit la maîtresse du logis, des marchands de Saint-Étienne en Forez, qui reviennent de la foire de Bordeaux ; nous les voyons repasser ici toutes les années. Ravi de cette nouvelle, je leur fis civilité ; nous soupâmes ensemble et je m'associai avec eux pour tout le reste du voyage. Il tomba dans la nuit une si grande quantité de neige que les chemins en furent entièrement couverts. Mais ces marchands les avoient si fort pratiqués que, se conduisant d'un arbre à l'autre, ils ne s'égarèrent jamais. Comme nous marchions, un geai vint se percher devant nous à la portée d'un fusil. Un de mes compagnons de voyage qui avoit un bâton, ou quelque chose qui paroissait tel, fit arrêter la troupe ; et ayant ajouté à ce prétendu bâton quelques ressorts qu'il renfermoit sans qu'il y parût, il en fit un fusil complet, tira sur l'oiseau et le tua... Nous devions nous séparer à Thiers, etc. » (Mémoires du comte de Forbin, p. 302.)
Dans cette contrée presque sauvage, une seule ville, par son industrie et son commerce, méritait d'arrêter l'attention du voyageur. Aubusson comptait environ 12,000 habitants, presque le double de sa population actuelle. La fabrication de ses tapis, déjà célèbres, occupait un très grand nombre (Louvriers. La plupart étaient protestants. La révocation de l'édit de Nantes (1685) les força de s'expatrier. ils émigrèrent en Suisse et en Allemagne.
Ainsi la Marche subit, comme les provinces de l'Ouest, les effets désastreux de l'intolérance. Colbert n'était plus ; Louvois dominait dans les conseils de Louis XIV ; et le travail national, un moment ranimé sous l'administration d'un homme d'État qui comprenait les vrais intérêts de la France, allait être sacrifié désormais aux fantaisies de l'ambition et de l'orgueil. La France n'a guère traversé de périodes plus douloureuses que la fin du règne de Louis le Grand. Elle perdit même, pendant la guerre de la succession d'Espagne, les consolations de la gloire ; et, la fortune épuisant contre nous toutes ses rigueurs, le froid et la famine se coalisant avec l'Europe, la nation expia cruellement les prétentions de son maître à la monarchie universelle. La Marche ne put échapper aux adversités de la patrie ; mais, du moins, grâce à sa position centrale, elle ne fut pas atteinte par le fléau de l'invasion. Grâce au caractère de ses habitants, elle évita les maux de la guerre civile ; les fils des Croquants ne suivirent point l'exemple des Camisards.
La haute Marche faisait partie, ainsi que le pays de Combraille, de la généralité de Moulins, mais elle n'en partageait point toutes les charges ; plus heureuse que le Bourbonnais et le Nivernais, provinces de grandes gabelles, elle était comprise dans le pays rédimé de l'impôt du sel. Le pays rédimé ne payait qu'un droit modique perçu sous les noms de convoi, de traite, de charente, etc., sur tous les sels extraits des marais salants pour l'approvisionnement des habitants. « Le commerce du sel étant libre dans cette partie de la France, on ne petit pas, dit Necker, en connaître la consommation avec autant de certitude que dans les parties du royaume où le privilège exclusif du débit est entre les mains du roi. Il y a lieu de l'évaluer à environ 830 000 quintaux ; et cette quantité, rapportée à une population de 4 025 000 âmes, ferait environ dix-huit livres pesant par tête d'habitant de tout sexe et de tout âge. La valeur courante varie depuis six jusqu'à dix et douze francs. »
Necker les portait, pour les provinces de grandes gabelles, à 62 livres par quintal ; pour celles de petites gabelles, à 33 livres 10 sous. La Marche, voisine du Berry et du Bourbonnais, leur fournissait en contrebande des quantités considérables de sel, et ses faux sauniers faisaient une rude guerre aux gens du roi. Enfin, la Révolution de 1789 abolit les douanes intérieures et répartit également les charges publiques entre tous les départements de la France. Les contrebandiers, abandonnant les provinces du centre, durent renoncer à leur commerce ou changer le théâtre de leurs exploits. Ils n'avaient plus rien à faire dans la Marche.
Pendant la période révolutionnaire, le département de la Creuse n'eut pas à souffrir des tourmentes politiques. La Terreur n'y fit point couler le sang. Les nobles, peu nombreux, émigrèrent ou se soumirent ; la vente des biens du clergé eut lieu sans scandales et sans bruit, et la guerre civile ne trouva point d'armée sur cette terre qui ne porte point le fanatisme. La Creuse ne fournit de soldats que pour combattre les ennemis de la France. Ses volontaires servirent avec honneur sous les drapeaux de la République. Un de leurs bataillons (Joullieton atteste ce fait dans son Histoire de la Marche) reconnut les petits-fils des proscrits de 1685 dans un village des bords du Rhin où s'était conservé le patois marchais.
Le département de la Creuse, formé d'une grande partie de l'ancienne province de la Marche et de quelques petits pays du Limousin, du Berry et de l'Auvergne, dépendait, avant la conquête romaine, du pays des Lemovices, et il dut à sa position sur les frontières du pays occupé par ce peuple le nom de Marchia Lemovicina. Plus lard, la Marche s'agrandit du pays de Combraille (pays des Cambiovicenses, Combraliae pagus). Elle fit partie de l'Aquitaine première, et passa sous la domination des Wisigoths, lorsqu'ils fondèrent le royaume de Toulouse (419). Elle suivit la fortune du Limousin et reconnut l'autorité des Francs après la victoire de Clovis à Vouillé (507).
En 571, les habitants furent, comme ceux de l'Auvergne, décimés par une horrible contagion dont Grégoire de Tours signal e les ravages. Desiderius, duc de Toulouse, et Bladaste, duc de Bordeaux, dans leur expédition contre le Berry, suivirent la grande voie romaine qui conduisait de Limoges à Bourges. Ils traversèrent la Marche et s'arrêtèrent peut-être dans les murs d'Ahun (583). Pendant la lutte de Pépin contre l'Aquitaine, Remistan ravagea toute la contrée et s'avança jusque dans le bas Berry, en 767.
Dans le démembrement de l'empire carlovingien, la Marche, à l'exemple de toutes les provinces de France, se morcela en un grand nombre de seigneuries. Elle ne put échapper aux ravages des Sarrasins et des Normands. En 846, ils dévastèrent le Limousin et s'avancèrent jusqu'aux limites du Berry et de l'Auvergne. En 930, ils reparurent ; mais, cette fois, ils furent battus et repoussés par le roi Raoul. Les Hongrois vinrent achever la ruine des provinces françaises. Ils pénétrèrent, en 937, jusqu'aux frontières de la Marche, et revinrent, en 951, désoler toute l'Aquitaine.
La France n'avait plus de gouvernement, plus d'armée ; elle était tombée dans la plus désastreuse anarchie. C'est au milieu de cette société en dissolution et dans l'effort tenté pour la reconstituer sous la forme féodale que se fonda, vers 968, le comté de la Marche. Les grands fiefs étaient autant de souverainetés indépendantes, et leurs possesseurs reconnaissaient à peine la suprématie nominale du roi. C'est ainsi que, malgré les menaces de Hugues Capet, Adalbert Talleyrand, comte de la Marche et de Périgord, s'allie avec Foulques Nerra, duc d'Anjou, contre Conan, comte de Rennes.
Tandis que Foulques s'empare de Nantes, Adalbert assiège la ville de Tours. Le roi marche au secours de cette place (992) . Il somme son vassal de se retirer. « Qui t'a fait comte ? » lui dit-il. Adalbert répond : « Qui t'a fait roi ? » Ce mot célèbre du comte de la Marche caractérise bien la politique féodale au Xe siècle. L'autorité royale baissa encore sous les successeurs de Hugues Capet. Un moment resserrée dans Paris par la féodalité, elle ne fut presque plus qu'une ombre. On trouve, en effet, en 1095, avant les croisades, plus de quatre-vingts grands fiefs qui avaient des souverains héréditaires et une véritable indépendance.
C'étaient quatre-vingts rois qu'il y avait en France, et parmi eux on compte plusieurs des anciens vassaux du duc de France qui ne lui obéissaient plus. Philippe Ier ne possédait réellement que les comtés de Paris, d'Étampes, de Melun, d'Orléans, de Dreux et de Sens, et, en montrant à son fils le château du seigneur de Montlhéry aux portes de Paris, il lui disait : « Beau fils Louis, garde bien cette tour qui tant de fois m'a travaillé, et en qui combattre et assaillir je me suis presque tout enseveli, et par la déloyauté de laquelle je ne puis avoir bonne paix ni bonne sûreté ; en tout le royaume n'étoient maux faits ni trahisons sans leur assent et sans leur aide, et si grande confusion étoit entre ceux de Paris et ceux d'Orléans que l'on ne pouvoit aller en terre de l'autre pour marchandise ni pour autre chose sans la volonté à ces traîtres, si ce n'étoit de grandes forces de gens » (Chroniques de Saint-Denys).
Au XIe siècle, l'ombre même d'un gouvernement central, d'une nation générale semble avoir disparu. « Comment se fait-il, dit M. Guizot, que la civilisation et l'histoire vraiment française commencent précisément au moment où il est presque impossible de découvrir une France ? C'est que, dans la vie du peuple, l'unité extérieure, visible, l'unité de nom et de gouvernement, bien qu'importante, n'est pas la première, la plus réelle, celle qui constitue vraiment une nation. Il y a une unité plus profonde, plus puissante : c'est celle qui résulte, non pas de l'identité de gouvernement et de destinée, mais de la similitude des éléments sociaux, de la similitude des institutions, des moeurs, des idées, des sentiments, des langues ; l'unité qui réside dans les hommes mêmes que la société réunit, et non dans les formes de leur rapprochement ; l'unité morale enfin, très supérieure à l'unité, politique et qui peut seule la fonder solidement. A la fin du Xe siècle et au commencement du XIe, il n'y a point d'unité politique pareille à celle de Charlemagne ; mais les races commencent à s'amalgamer ; la diversité des lois, selon l'origine, n'est plus le principe de toute la législation. Les situations sociales ont acquis quelque fixité ; des institutions, non pas les mêmes, mais partout analogues, les institutions féodales ont prévalu, ou à peu près, sur tout le territoire. Au lieu de la diversité radicale, impérissable, de la langue latine et des langues germaniques, deux langues commencent à se former, la langue romane du Midi et la langue romane du Nord, différentes sans doute, cependant de même origine, de même caractère, et destinées à s'amalgamer un jour. Dans l'âme des hommes, dans leur existence morale, la diversité commence aussi à s'effacer.
« Le Germain est moins adonné à ses traditions, à ses habitudes germaniques ; il se détache peu à peu de son passé pour appartenir à sa situation présente. Il en arrive autant du Romain ; il se souvient moins de l'ancien. empire et de sa chute, et des sentiments qui en naissaient pour lui. Sur les vainqueurs et sur les vaincus, les faits nouveaux, actuels, qui leur sont communs, exercent chaque jour plus d'empire. En un mot, l'unité politique est à peu près nulle, la diversité réelle encore très grande ; cependant il y a au fond plus d'unité véritable qu'il n'y en a eu depuis cinq siècles. On commence à entrevoir les éléments d'une nation ; et la preuve c'est que, depuis cette époque, la tendance de tous ces éléments sociaux à se rapprocher, à s'assimiler, à se former en grandes masses, c'est-à-dire la tendance vers l'unité nationale, et par là vers l'unité politique, devient le caractère dominant de l'histoire de la civilisation française. »
Dès le règne de Philippe le Gros commence, contre la féodalité, la guerre qui, par l'alliance de la royauté et des communes, doit aboutir au triomphe du principe moderne de la centralisation. Le fils de Philippe Ier ne reste pas, comme son père, emprisonné dans le domaine des ducs de France. Il cherche à étendre au loin son influence et son action. En 1121, nous le voyons s'avancer jusqu'aux confins de la Marche et diriger une expédition contre le comte d'Auvergne. Cinq ans plus tard, il intervient de nouveau en faveur de l'évêque de Clermont et force le comte à se soumettre au jugement -de la cour du roi (1126). Le comté de la Marche passa, vers ce temps, à la famille des Montgomery, dont un des membres, Adalbert IV, partant pour la terre sainte en 1177, vendit son domaine, pour cinq mille mires d'argent. à Henri II, roi d'Angleterre. Cette vente fut annulée sur la demande des seigneurs de Lusignan, qui, depuis longtemps, avaient des prétentions sur la Marche. Henri Il rendit ce comté à Hugues de Lusignan.
Vers la fin du XIe siècle, des bandes de routiers se levèrent dans le Berry et mirent toute la contrée au pillage. Ils prenaient le nom de Cottereaux. Les seigneurs des pays voisins, de la Marche, de l'Auvergne, formèrent contre eux l'association des Capuchons, et les taillèrent en pièces dans plusieurs rencontres (1184). Pendant les guerres de Philippe-Auguste et de Jean sans Terre, le comté de la Marche, situé à la limite des possessions anglaises et françaises, se trouva exposé aux ravages des gens d'armes.
Le comte Hugues le Brun suivit le parti du roi de France. Il était animé contre le roi d'Angleterre par des griefs personnels. Jean lui avait enlevé quelques châteaux et sa fiancée, fille du comte d'Angoulême (1201). En 1206, les deux rois signèrent une trêve de deux ans ; Hugues le Brun fut un des garants de Philippe-Auguste (Chroniques de Rigord). Philippe, poursuivant l'oeuvre de Louis le Gros et prenant au sérieux son titre de roi, était pour les grands vassaux un maître incommode. Hugues de Lusignan ne lui resta pas longtemps fidèle. Il se ligua en 1213 avec Jean sans Terre, son ancien ennemi. Mais la paix fut bientôt rétablie. On nomma des arbitres pour les infractions commises dans le Berry, l'Auvergne, le comté de la Marche et le Limousin ; ils se réunirent entre Aigurande et Cuzon, châteaux du comté de la Marche.
Pendant la minorité de Louis IX, la maison de Lusignan s'associa à la réaction féodale tentée contre la régente, Blanche de Castille. Le comte de la Marche prit les armes comme le duc de Bretagne et le comte de Champagne ; mais, comme eux, il fut obligé de se soumettre (1227). Ses successeurs régnèrent sans éclat jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En 1308, Gui de Lusignan, mourant sans enfants, légua le comté de la Marche à Philippe le Bel.
Le territoire qui forme aujourd'hui le département de la Creuse fut alors presque tout entier réuni au domaine royal, sauf la terre de Combraille, qui appartenait à la maison d'Auvergne. Le comté de la Marche fut érigé en pairie par lettres patentes données à Paris, au mois de mars 1316, en faveur de Charles de France, comte de la Marche. Charles succéda à son frère Philippe le Long (1322), et ainsi cette pairie fut éteinte. Mais, comme le même roi donna le comté de la Marche à Louis de Bourbon en échange du comté de Clermont en Beauvoisis, il fut érigé de nouveau en pairie par lettres patentes du mois de décembre 1327.
Il passa dans la maison d'Armagnac par le mariage d'Éléonore, fille de Jacques de Bourbon, avec Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac et de Castres. Leur fils, Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, comte de la Marche, de Pardiac, de Castres et de Beaufort, vi-comte de Murat, seigneur de Leuze, de Condé et de Montagne-en-Combraille, fut l'ennemi et la victime de Louis XI. Il périt par la main du bourreau (août 1477). Le roi confisqua ses biens, et donna le comté de la Marche à Pierre II de Bourbon, sire de Beaujeu, qui avait épousé Anne de France. Suzanne de Bourbon, leur fille, porta ce domaine en dot au connétable Charles de Bourbon. Celui-ci était déjà comte de Montpensier et dauphin d'Auvergne, duc de Bourbon, d'Auvergne et de Châtellerault, comte de Clermont en Beauvoisis, de Forez, de Gien vicomte de Carlat et de murat, seigneur de Beaujolais, de Combraille, de Mercoeur, d'Annonay, de La Roche-en-Régnier et de Bourbon-Lancy.
La trahison du connétable anéantit cette puissance redoutable de la maison de Bourbon. Ses biens furent confisqués en 1523. Le comté de la Marche passa à Louise de Savoie, mère de François Ier ; après la mort de cette princesse, il rentra dans le domaine de la couronne. François Ier le donna, par lettres du 12 juin 1540, à son troisième fils, Charles de France, pour le tenir en pairie ; mais ce prince mourut le 9 septembre 1545. Depuis lors, la Marche ne fut plus détachée de l'unité nationale. La féodalité s'était transformée en noblesse. Au XVIIIe siècle, le comté de la Marche fut le titre des fils aînés des princes de Conti.
L'histoire de la province n'est pas riche en détails intéressants. Durant les désastres de la guerre de Cent ans, les villes et les seigneurs ne trahirent pas la cause de la France. Le sire de Boussac, chambellan de Charles VII, le servit jusqu'au crime. Lorsque la guerre civile vint se mêler à la guerre étrangère, et que le dauphin souleva la Praguerie, Charles VII traversa la Marche en poursuivant son fils rebelle (1440). On a retrouvé au British Museum (m. 11, 542) des lettres royales du 4 décembre 1545, par lesquelles sont institués, dans la sénéchaussée de la Marche, cinq commissaires, à l'effet de percevoir, d'après un nouveau mode, un aide pour la solde des gens d'armes. Ce sont « nos amis et féaulx conseillers et chambellans, le sire de Culant, maître Jehau Tudert, maistre des requêtes ordinaires de notre hôtel, les sénéchal et chancelier de la Marche, et Pyon de Bar, notre valet de chambre. »
Il existe au cabinet des titres de la Bibliothèque nationale des quittances de ce Pyon de Bar. Le 1er décembre 1445, il avait reçu de Jacques de la Ville la somme de 100 livres à titre de commissaire ordonné pour asseoir au comté de la Marche la portion à l'aide de 300 000 francs, mis sus par le roi sur les pays de Languedoc au mois de janvier précédent. « Vous mandons et commettons que les gens d'armes qui sont du pays et ressort de la comté de la Marche soient dorénavant payés, selon l'ordonnance que nous avons de présent faite, à commencer le premier jour de janvier prochain venant. C'est assavoir : en argent 21 livres tournois par lance fournie de six personnes et six chevaux ; plus pour 10 livres tournois en nature. Et voulons toutes manières de gens être à ce contribuables, excepté gens d'Église, nobles vivant noblement, et autres qui, par nos dernières ordonnances, en étoient exemptés. » (Lettres du 3 août 1445, Ordonn. des rois de France, tome XIII, page 442 et pass.) « Et avec ce... mettez sus, audit pays et ressort de la Marche, avec les frais raisonnables ci-après déclarés, et outre le fait et payement desdits gens d'armes, la somme de 5 000 livres tournois, 500 livres tournois pour les frais. Laquelle somme est pour et au lieu de l'aide de 200 000 livres tournois que de nécessité étions contraint mettre sus en notre pays comme l'année passée. Mais, considéré la pauvreté de notredit peuple et la charge qu'ils ont desdits gens d'armes, nous avons modéré ledit, pays, pour sa portion dudit aide, à ladite somme de 5,000 livres tournois, et 500 livres tournois pour les frais. » (Biblioth. de l'école des Chartes, déc. 1846.)
Sous Louis XI, les états de la haute et basse Marche demandèrent à se réunir pour une imposition commune, et le roi les y autorisa (1478). Les états de cette province cessèrent de s'assembler au XVIIe siècle, après la victoire de Mazarin sur la Fronde et le triomphe de l'absolutisme. En 1531, la province fut affligée par les inondations et par la famine. La Creuse et la Gartempe débordèrent. « Estoit en ladite saison grand'cherté de blés et de vins ; car le setier de froment se vendoit 50 sols, le setier de seigle 40 sols et plus, etc. » C'est l'année où le comté de la Marche fut réuni à la couronne. Bientôt après se tinrent à Poitiers les Grands-Jours, « qui jugèrent deux cents causes en deux mois et condamnèrent un grand nombre de gentilshommes d'Anjou, Touraine, Maine, Aunis, Angoumois et Marche. »
En 1553, « les droits que les habitants prennent sur le sel furent vendus par le roi Henri II aux habitants du pays de Poitou, Saintonge, ville et -gouvernement de La Rochelle, Angoulême haut et bas Limousin, haute et basse Marche, qu'on appelle à cause de cela pays de franc-salé. » Sous le règne de Henri III, la Réforme pénétra dans la Marche, mais elle n'y fit pas de progrès. Pendant les guerres religieuses, « le sieur de Saint Marc était commandant pour l'Union au pays de la Marche. » (Palma Cayet.) Il périt en allant au secours de Randan, chef des ligueurs en Auvergne (1590). Les paysans de la Marche prirent part à la révolte des Croquants, en 1594.
Aux états de 1484 avaient paru les députés du comté de la Marche. Il n'en vint aucun à ceux de 1593. En 1614, la sénéchaussée de la haute Marche envoya aux états généraux Georges de La Roche-Aymon, sieur de Saint-Maixent ; Gabriel, sieur de Malité, et Jean Vallenet, lieutenant particulier à Guéret.
Les Grands-Jours, tenus à Limoges en 1605, n'avaient pas plus épargné les nobles brigands de la Marche que ceux du Limousin ; mais l'esprit féodal n'était pas encore détruit dans ces provinces presque sauvages. La royauté devait longtemps encore y rencontrer des ennemis. « Le 17 mars 1617, dit le Mercure françois le prince de Joinville partit de Paris pour aller en son gouvernement d'Auvergne, y lever des troupes et avoir l'œil sur les pratiques qui se faisoient au pays de la Marche, bas Limousin et provinces voisines, par M. de Bouillon, qui sollicitoit une assemblée générale de ceux de la religion réformée pour les exciter à se soulever et prendre les armes. » Vingt ans après reparaissent les Croquants. « On dit qu'en Limousin, la Marche, l'Auvergne et le Poitou, sont élevées plusieurs troupes de gens, sous le nom de Croquants, lesquels font une guerre aux partisans, et qu'on parle en deçà d'envoyer vers eux pour les apaiser. » (Lettre de Gui Patin, 26 mai 1637.)
Au commencement de la guerre de la Fronde, le marquis d'Effiat était gouverneur de la haute et basse Marche (1649). Aubusson et Guéret figurent dans la liste générale des villes où furent envoyées, le 2 août 1652, les lettres circulaires de la ville de Paris invoquant l'appui des autres cités du royaume. Aubusson et Guéret ne répondirent pas. La Marche était alors un pays perdu au milieu de la France. Qu'on en juge par les impressions de voyage du célèbre comte de Forbin, qui la traversa en 1684. « Comme le service du roi ne demandoit pas ma présence à Rochefort, car la saison étoit déjà fort avancée, mon oncle me conseilla d'aller en Provence, pour régler quelques affaires que j'y avois ; il m'ordonna en même temps de passer par Lyon et de parler à un homme qui lui devoit quelque argent. La route que j'avois à suivre étoit par le Périgord, le Limousin et l'Auvergne. La quantité de neige dont le pays étoit couvert le rendoit impraticable à un homme qui n'en avoit d'ailleurs aucune connoissance. Pour obvier à cet iriconvénient, je me joignis aux muletiers qui partent deux fois la semaine de Limoges pour Clermont. Leur marche étoit si lente et si ennuyeuse que je me trouvois bien malheureux d'être obligé de m'y conformer. Après les avoir ainsi suivis pendant quatre jours, nous arrivâmes à un cabaret en rase campagne. J'étois auprès du feu à causer avec l'hôtesse, lorsque je vis entrer six hommes qui ressembloient bien mieux à des bandits qu'à toute autre chose. Je demandai quels hommes c'étoient : Ce sont, me répondit la maîtresse du logis, des marchands de Saint-Étienne en Forez, qui reviennent de la foire de Bordeaux ; nous les voyons repasser ici toutes les années. Ravi de cette nouvelle, je leur fis civilité ; nous soupâmes ensemble et je m'associai avec eux pour tout le reste du voyage. Il tomba dans la nuit une si grande quantité de neige que les chemins en furent entièrement couverts. Mais ces marchands les avoient si fort pratiqués que, se conduisant d'un arbre à l'autre, ils ne s'égarèrent jamais. Comme nous marchions, un geai vint se percher devant nous à la portée d'un fusil. Un de mes compagnons de voyage qui avoit un bâton, ou quelque chose qui paroissait tel, fit arrêter la troupe ; et ayant ajouté à ce prétendu bâton quelques ressorts qu'il renfermoit sans qu'il y parût, il en fit un fusil complet, tira sur l'oiseau et le tua... Nous devions nous séparer à Thiers, etc. » (Mémoires du comte de Forbin, p. 302.)
Dans cette contrée presque sauvage, une seule ville, par son industrie et son commerce, méritait d'arrêter l'attention du voyageur. Aubusson comptait environ 12,000 habitants, presque le double de sa population actuelle. La fabrication de ses tapis, déjà célèbres, occupait un très grand nombre (Louvriers. La plupart étaient protestants. La révocation de l'édit de Nantes (1685) les força de s'expatrier. ils émigrèrent en Suisse et en Allemagne.
Ainsi la Marche subit, comme les provinces de l'Ouest, les effets désastreux de l'intolérance. Colbert n'était plus ; Louvois dominait dans les conseils de Louis XIV ; et le travail national, un moment ranimé sous l'administration d'un homme d'État qui comprenait les vrais intérêts de la France, allait être sacrifié désormais aux fantaisies de l'ambition et de l'orgueil. La France n'a guère traversé de périodes plus douloureuses que la fin du règne de Louis le Grand. Elle perdit même, pendant la guerre de la succession d'Espagne, les consolations de la gloire ; et, la fortune épuisant contre nous toutes ses rigueurs, le froid et la famine se coalisant avec l'Europe, la nation expia cruellement les prétentions de son maître à la monarchie universelle. La Marche ne put échapper aux adversités de la patrie ; mais, du moins, grâce à sa position centrale, elle ne fut pas atteinte par le fléau de l'invasion. Grâce au caractère de ses habitants, elle évita les maux de la guerre civile ; les fils des Croquants ne suivirent point l'exemple des Camisards.
La haute Marche faisait partie, ainsi que le pays de Combraille, de la généralité de Moulins, mais elle n'en partageait point toutes les charges ; plus heureuse que le Bourbonnais et le Nivernais, provinces de grandes gabelles, elle était comprise dans le pays rédimé de l'impôt du sel. Le pays rédimé ne payait qu'un droit modique perçu sous les noms de convoi, de traite, de charente, etc., sur tous les sels extraits des marais salants pour l'approvisionnement des habitants. « Le commerce du sel étant libre dans cette partie de la France, on ne petit pas, dit Necker, en connaître la consommation avec autant de certitude que dans les parties du royaume où le privilège exclusif du débit est entre les mains du roi. Il y a lieu de l'évaluer à environ 830 000 quintaux ; et cette quantité, rapportée à une population de 4 025 000 âmes, ferait environ dix-huit livres pesant par tête d'habitant de tout sexe et de tout âge. La valeur courante varie depuis six jusqu'à dix et douze francs. »
Necker les portait, pour les provinces de grandes gabelles, à 62 livres par quintal ; pour celles de petites gabelles, à 33 livres 10 sous. La Marche, voisine du Berry et du Bourbonnais, leur fournissait en contrebande des quantités considérables de sel, et ses faux sauniers faisaient une rude guerre aux gens du roi. Enfin, la Révolution de 1789 abolit les douanes intérieures et répartit également les charges publiques entre tous les départements de la France. Les contrebandiers, abandonnant les provinces du centre, durent renoncer à leur commerce ou changer le théâtre de leurs exploits. Ils n'avaient plus rien à faire dans la Marche.
Pendant la période révolutionnaire, le département de la Creuse n'eut pas à souffrir des tourmentes politiques. La Terreur n'y fit point couler le sang. Les nobles, peu nombreux, émigrèrent ou se soumirent ; la vente des biens du clergé eut lieu sans scandales et sans bruit, et la guerre civile ne trouva point d'armée sur cette terre qui ne porte point le fanatisme. La Creuse ne fournit de soldats que pour combattre les ennemis de la France. Ses volontaires servirent avec honneur sous les drapeaux de la République. Un de leurs bataillons (Joullieton atteste ce fait dans son Histoire de la Marche) reconnut les petits-fils des proscrits de 1685 dans un village des bords du Rhin où s'était conservé le patois marchais.
Les départements et... - Les cotes d'Armor - 22 -
Publié à 09:18 par acoeuretacris
(Région Bretagne)
Le département des Côtes-d'Armor occupe, avec celui du Morbihan, le milieu de la péninsule armoricaine, dont les départements d'Ille-et-Vilaine et du Finistère forment les extrémités. Il doit à cette situation la variété de caractères qui le distingue et qui peut, permettre de le diviser en trois régions différentes : le pays de Saint-Brieuc appartient à la haute Bretagne, celui de Lannion et de Tréguier à la basse, et l'on donne le nom de Bretagne moyenne au pays qui environne Dinan.
A mesure qu'on traverse le département de l'est à l'ouest, on sent que l'on approche du Finistère ; on le reconnaît à l'extérieur des habitants, à leurs mœurs, à leur langage. Suivant les expressions de M. Pitre-Chevalier, une ligne tracée de l'embouchure de la Vilaine à Châtelaudren (entre Saint-Brieuc et Guingamp) peut être considérée comme la muraille chinoise de l'idiome breton, et les brèches faites à ce rempart par le commerce et la civilisation n'ont guère enlevé au vieux langage que les villes, les ports et les endroits fréquentés de la côte.
La circonscription départementale des Côtes-d'Armor n'a donc d'autre unité que l'unité administrative. Aux temps les plus anciens, avant l'occupation romaine, plusieurs peuples s'en partageaient le territoire. C'étaient les Curiosolites, les Lexobiens, les Ambiliates, les Osismiens. Les Curiosolites avaient pour capitale une ville quia conservé la trace de leur nom dans le sien : c'est Corseul, dont nous aurons occasion de reparler dans un article spécial. Le domaine des Curiosolites s'étendait, selon d'Anville, jusqu'au pays d'Yffiniac, dont le nom aurait la même signification que ce terme latin ad fines, employé si souvent par les anciens géographes pour marquer des bornes et des limites. Les antiquités mégalithiques sont moins nombreuses dans le département des Côtes-d'Armor que dans ceux du Finistère et du Morbihan. Néanmoins, on y rencontre aussi des peulvens, des dolmens, des pierres branlantes, dont la plus remarquable est celle de l'île de Bréhat, et des tumulus, parmi lesquels on cite celui de Lancerf.
L'époque romaine a laissé plus de traces. Nous ne reviendrons pas ici sur la conquête de Jules César. Les Osismiens, les Curiosolites tes prirent leur part à la résistance générale de l'Armorique, et succombèrent dans la défaite commune. Incorporé dans l'empire romain, leur territoire fit partie de la troisième Lyonnaise. En revanche, ils eurent des édifices, des voies romaines. La disposition de ces voies, telle qu'on peut l'observer par leurs débris, indique clairement que Corseul fut considérée, sous l'empiré romain aussi bien qu'auparavant, comme le centre de la contrée ; c'est de ce point qu'elles rayonnent dans des directions différentes.
L'une se dirigeait vers Vannes et traversait les étangs de Jugon. Elle n'avait pas moins de 20 ou 24 pieds de largeur et était élevée de 4 ou 5 pieds au-dessus du sol environnant. Une autre conduisait à Quintin. Deux autres, enfin, à Dinan et à Dinart. D'autres souvenirs romains se rencontrent à Pordic, où l'on montre un camp de César, de forme triangulaire, situé sur de hautes falaises et flanqué, d'un côté, par la mer, de l'autre, par un profond vallon où coule la rivière d'Ik. À l'un des angles se voient les ruines d'u ne tour. Quoique César ne paraisse pas avoir passé en personne par le pays qui nous occupe, néanmoins il est fort possible, comme on l'a conjecturé, que son lieutenant Titurius Sabinus, qu'il envoya avec trois légions pour tenir en respect les Curiosolites et les Lexobiens, ait pris un campement dans le lieu auquel s'est attaché, par la suite, le nom immortel du conquérant.
C'est avec moins de vraisemblance qu'on a prétendu voir dans la petite ville de Binie le Portus Iccius où César s'embarqua pour passer dans la Grande-Bretagne, et que l'on place aujourd'hui, sans contestation, à Wissant, dans le département du Pas-de-Calais. On ne saurait nier, du reste, que Binic n'ait eu jadis une importance qu'elle a perdue depuis. A deux reprises, en 1808 et en 1824, la mer a laissé à découvert les ruines d'un vaste édifice, qui semblait sortir des flots pour en faire foi. Cet édifice avait 80 pieds de longueur sur 40 de largeur, et ses murs, que quelques savants croient de construction antique, recelaient 200 médailles d'empereurs romains et des pièces espagnoles à l'effigie de Charles-Quint. Corseul, Erquy nous ramèneront encore à l'époque romaine.
C'est sur ce rivage, où nous venons de signaler des débris de la puissance romaine, que mirent le pied les Bretons insulaires fugitifs qui vinrent s'établir, au IVe et au Ve siècle, dans l'Armorique. L'un d'eux, du nom de Fracan ou Fragan, qui faisait partie de la suite de Conan dit Mériadec, s'arrêta en 418 sur les bords du Gouët, petite rivière du département, dont le nom tragique semble cacher quelque mystérieuse horreur des temps inconnus à l'histoire. Gouët ou Gouat, en effet, dans la langue celtique veut dire sang, et le pays arrosé par cette rivière s'appelle Gouetlod où Gouello (Goëllo), c'est-à-dire Pays du sang.
C'est donc dans des lieux que s'établit Fragan avec ses compagnons, et l'endroit qu'il choisit pour sa résidence porte encore aujourd'hui le nom de Ploufragan, peuple de Fragan, plou ou plé ayant cette signification dans la langue bretonne. Ce lieu et ce personnage intéressent toute la Bretagne, qui leur doit un de ses saints les plus vénérés, le fameux saint Guignolé. C'est là, en effet, que Guen, femme de Fragan, mit au monde trois fils et une fille, qui eurent tous l'insigne honneur d'être inscrits au catalogue des saints. Les fils avaient nom Guignolé, Jacut et Guétenoc ; la fille, Creirvie. Mis fort jeune sous la conduite d'un saint homme appelé Ludoc, Guignolé y fit les progrès les plus rapides dans les voies de la sainteté, et, à son tour, eut des disciples. Sa renommée le rit choisir par le roi Gradlon pour diriger le fameux monastère de Landevenec, que ce prince venait de fonder. Saint Guignolé y établit une règle austère, qui paraît être la même que celle suivie à cette époque en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Saint Jactit, frère de Guignolé, fonda de son côté un monastère qui porta son nom. Ce sont les deux plus anciens qui aient été fondés en Bretagne.
Nous parlerons ailleurs d'Audren, chef puissant, qui résida dans la contrée vers la fin du Ve siècle. Vers la même époque se fondaient le monastère et la ville de Saint-Brieuc. Les autres chefs du pays qui se succédèrent vers ce temps nous apparaissent dans les légendes et les romans comme les compagnons de gloire d'Arthur et de Hoël le Grand. Quelquefois ils portaient le titre de roi, et l'on vit souvent les prétendants à la couronne de Bretagne obligés de traiter avec eux. A la mort du roi Salomon (874), les comtes de Goëllo, se prétendant issus des anciens souverains de Bretagne, prirent les armes pour soutenir leurs prétentions ; mais ils échouèrent, et la victoire demeura aux comtes de Vannes, leurs concurrents.
Un peu plus tard (939), on vit l'un d'eux contribuer puissamment an gain de la bataille livrée aux Normands près de Saint-Brieuc par Alain Barbe-Torte. C'étaient de puissants seigneurs qui gouvernaient presque en souverains une grande étendue de terre et de nombreux vassaux. L'usement de Goëllo, qui subsista jusque dans le XVIIIe siècle, est une preuve de l'indépendance dont ils jouissaient. Toutefois, leur puissance ne tarda pas à s'éclipser. Leur comté fut réuni à celui de Rennes, puis détaché, ainsi que Penthièvre, en faveur des cadets des comtes de Rennes. Son histoire se confondit dès lors avec celle de Penthièvre jusqu'en 1480, que le duc François Il le donna à François légitimé de Bretagne, comte de Vertus. En 1746, il passa par héritage au prince de Soubise.
La puissance déchue des comtes de Goëllo fut remplacée par la puissance naissante de la maison de Penthièvre. Cette ambitieuse maison date du XIe siècle. Le duc Geoffroy était mort en 1008, laissant deux fils, Alain qui lui succéda, et Eudon qui devint la tige de la branche cadette de la famille ducale, sous le nom de comte de Penthièvre. Eudon ne tarda pas à dévoiler les vues ambitieuses qu'il devait transmettre à ses descendants, et qui furent si longtemps une malheureuse cause de guerres civiles en Bretagne. Il fit la guerre à son frère, Alain V. Après la mort de ce dernier, au lieu d'exercer fidèlement la tutelle dont il avait été chargé sur son neveu, il l'emprisonna, et prit le titre de comte de Bretagne.
Cette maison de Penthièvre tirait son nom de la situation même de ses domaines entre le Leff et le Treff ou Trieux et de la position de son château principal au confluent de ces deux rivières. Ce château s'appelait Pontreff ou Pontreo (Pontrieux). Qu'on ne s'étonne plus de trouver quelquefois au nom de Penthièvre la variante Ponthièvre. Le pays s'appelait Penthévrie ou Ponthévrie. Ce comté comprenait la ville de Saint-Brieuc, où Eudon et son fils Étienne résidèrent et furent inhumés. Plus tard, il s'étendit encore et comprit, outre le diocèse de Saint-Brieuc, une partie de celui de Tréguier ; en un mot, près d'un tiers de la Bretagne. C'était comme une petite province à part, qui avait ses coutumes, ses princes particuliers ; ceux-ci, presque absolus, faisaient à leur gré la paix ou la guerre, levaient des tailles ou des aides, exerçaient plusieurs autres droits régaliens, tenaient une cour brillante et donnaient aux principaux d'entre leurs vassaux le nom pompeux de barons.
Le petit-fils d'Eudon, Alain le Noir, en épousant Berthe, héritière du duché de Bretagne, plaça le sang de Penthièvre sur le trône ducal, mais sans opérer la réunion des domaines de sa. famille qui demeurèrent à son frère aîné, Geoffroy Botherel. Cette alliance, qui eût semblé réconcilier la maison de Penthièvre et celle des ducs, ne fit qu'offrir de nouveaux motifs à la discorde. En effet, l'héritage des Penthièvre ayant passé plus tard à une branche collatérale, celle qui portait la couronne ducale se crut lésée, et Alix, héritière du duché, se sentit disposée à disputer ces riches domaines à celui qui les possédait, Henri d'Avaugour. La sage idée d'un mariage qui eût confondu les droits et terminé le différend avait été quelque temps adoptée, et même des fiançailles avaient eu lieu.
Mais le roi de France, alors très puissant (on était au XIIIe siècle), s'opposa à une alliance qui devait donner trop de puissance aux souverains bretons, Son influence fit rompre les fiançailles, et Alix épousa un prince français, Pierre de Dreux, surnommé Mauclerc. Les deux partis prirent aussitôt les armes : Henri pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, Pierre Mauclerc pour- faire valoir les prétentions de sa femme. La guerre se fit à l'avantage de ce dernier, qui s'empara des terres de Tréguier, Guingamp, Saint-Brieuc, Lamballe, et réduisit Henri à se contenter du titre d'Avaugour qu'il transmit à sa postérité dépouillé de tous les autres. Mauclerc fit don de Penthièvre à sa fille, Yolande de Bretagne (1236) ; plus tard, Jean III le donna en apanage à son frère Gui de Bretagne, mais avec des restrictions importantes : par exemple, il se réserva le fort château de Jugon, situé sur une hauteur appelée autrefois Jugum par les Romains ; telle est l'origine de ce nom, qui s'applique non seulement à la montagne, mais aussi aux vastes marais qui en défendent les approches, et qui sont formés par un épanchement des eaux de l'Arguenon. Jean III se réserva, outre le droit de bris, les émoluments de l'amirauté et la garde des églises ; par cette réserve, les églises cathédrales et les abbayes qui étaient dans l'apanage de Gui de Bretagne turent soustraites à sa juridiction et demeurèrent toujours dans la suite exemptes de la juridiction des Penthièvre.
Gui de Bretagne n'eut qu'une fille, et ce fut cette fameuse Jeanne la Boiteuse qui épousa Charles de Blois et lui porta deux magnifiques héritages : celui du comté de Penthièvre, qu'elle tenait de son père, et celui du duché de Bretagne, qui lui revint de plein droit à la mort de Jean III, mort sans postérité. Malheureusement, un autre prétendant saisit l'occasion de cette interruption de la ligne masculine sur le trône ducal pour se jeter à la traverse et faire valoir des droits que les coutumes féodales rendaient illégitimes.
C'était Jean de Montfort, et de ce moment commença, entre lui et Charles de Blois, cette lutte acharnée à laquelle Jeanne prit une part si active et si glorieuse. Montfort l'emporta, et Jeanne la Boiteuse, dont les enfants étaient retenus prisonniers en Angleterre, dut souscrire au traité de Guérande (1365), qui ne lui laissait que le comté de Penthièvre. Du moins, ce comté avait été constamment défendu avec succès contre l'allié des Anglais ; le château de Jugon avait même été repris et rattaché au comté. Comme il n'y avait pas de communes en Penthièvre, Montfort, qui partout ailleurs s'appuyait sur elles, n'avait là aucun parti et aucune prise.
Les Penthièvre trouvèrent bientôt un allié puissant. Le connétable de Clisson, ennemi mortel de Montfort, devenu Jean IV, usa de son influence pour faire mettre en liberté les enfants de Jeanne la Boiteuse, et Jean de Blois, l'un d'eux, épousa sa fille. Ce mariage important, qui réunit contre les nouveaux ducs de Bretagne les forces éloignées des deux plus puissantes maisons du duché, fut célébré à Moncontour en Penthièvre, en présence des plus illustres seigneurs de Bretagne, les sires de Laval, de Léon, de Derval, de Rochefort, de Beaumanoir et de Rostrenen. Jean IV ne pardonna pas à Clisson une alliance dont le but était si évident, et nous avons raconté ailleurs (Morbihan) comment il l'attira au château de l'Hermine pour le faire périr. N'ayant pas eu le courage de consommer son forfait, il eut à soutenir une guerre terrible dont le comté de Penthièvre fut le principal théâtre.
Tout le comté s'était soulevé. à l'instigation de la belle et vindicative Marguerite de Clisson, qui ne rêvait pour elle-même et pour ses enfants que cette couronne ducale injustement enlevée aux Penthièvre. Elle se lassa moins vite que son père et, tandis qu'il faisait la paix avec Jean IV, elle continua de soulever le pays, et s'efforça de l'entraîner lui-même dans de nouvelles entreprises ; elle ne craignait point de l'exhorter même à l'assassinat. Le connétable repoussa ces coin lots avec indignation ; mais il mourut, et Marguerite, dégagée d'une dépendance qui pesait à sa vengeance et à son ambition, prit les allures d'une souveraine, leva des impôts dans son comté, malgré les défenses du duc et des états de Bretagne, et refusa constamment d'acquiescer aux conditions d'arrangement négociées entre son fils Olivier et le duc.
Douze sergents lui furent envoyés pour l'ajourner à comparaître devant ce dernier. Plusieurs ayant eu l'audace de porter la main sur elle, elle les fit tuer sur-le-champ. Jean IV demanda des secours aux Anglais, qui débarquèrent dans l'île de Bréhat et la ravagèrent ; plusieurs places de Penthièvre tombèrent en son pouvoir. Marguerite céda, mais pour commencer aussitôt un autre genre de guerre, une guerre de perfidie et de guet-apens. Il ne fut point difficile à celle que les vieux historiens appellent la méchante Margot de feindre une réconciliation sincère et même un vif attachement pour les enfants de Jean IV. C'est par ces moyens odieux qu'elle réussit à attirer la duc au guet-apens de Chantoceaux et à se rendre maîtresse de sa personne. Mais c'était trop d'audace et de duplicité.
La Bretagne, lasse des troubles qu'excitait sans cesse une ambition avilie par les moyens mêmes qu'elle employait, s'indigna du forfait et comprit qu'il valait cent fois mieux conserver Jean IV que de s'exposer à tomber sous le joug de Marguerite. Les seigneurs prirent tous les armes. Le comté de Penthièvre fut envahi, la plupart des châteaux rasés, et les Penthièvre, dépouillés de tous leurs biens, allèrent porter en France leur orgueil humilié et leurs opiniâtres projets de vengeance (1420). Un accommodement ménagé par le connétable de Richemont rendit le comté de Penthièvre à Jean, frère d'Olivier et fils de Marguerite. Jean mourut sans enfants. Nicole de Bretagne, sa nièce et son héritière, porta le comté de Penthièvre à son mari, Jean de Brosse, vicomte de Boussac et maréchal de France.
Ce nouveau comte de Penthièvre, moins peut-être par les motifs de haine qui avaient animé les anciens comtes que par attachement à la couronne de France, se déclara pour le roi dans la guerre du Bien publie, et se fit ainsi dépouiller à son tour par le duc François Il. Le comté de Penthièvre passa successivement à plusieurs maîtres différents, et ne revint aux de Brosse qu'après la réunion définitive de la Bretagne à la France. En 1535, François Ier céda à Jean de Brosse, quatrième du nom, tout ce qu'il tenait du comté de Penthièvre, et ce seigneur abandonna au roi tous les droits qu'il pouvait avoir sur le duché par représentation de Nicole de Bretagne, sa bisaÏeule. Le comté de Penthièvre avait été diminué des châtellenies de Châtelaudren, Lanvollon, Painipol, érigées par le duc en baronnie sous le nom d'Avaugour.
En 1569, Charles IX, pour récompenser la fidélité des comtes de Penthièvre, érigea leur fief en duché-pairie, litre glorieux, mais qui ne rendait pas aux Penthièvre la puissance des anciens comtes. Peu de temps après, une alliance porta ce fief à Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, celui que la ligue de Bretagne a rendu si célèbre. Cela fut cause que le territoire de Penthièvre fut un des théâtres des guerres de religion. Nous dirons ailleurs comment Lanoue périt au siège de Lamballe. Françoise de Lorraine, fille et unique héritière de Mercoeur, épousa César, duc de Vendôme, fils légitimé de Henri IV.
C'est Louis-Joseph, fils de César, qui s'illustra, sous le nom de Vendôme, par tant de victoires vers la fin du règne de Louis XIV. N'ayant pas d'enfants, et d'ailleurs grand dissipateur, il vendit son duché de Penthièvre à la princesse de Conti, qui, à son tour, le revendit à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (1696). Enfin, au XVIIIe siècle, la petite-fille du comte de Toulouse le porta dans la maison d'Orléans par son mariage avec le duc de Chartres.
A cette époque, malgré tant de démembrements, le duché de Penthièvre formait encore une des plus belles seigneuries du royaume. Il s'étendait depuis les portes de Saint-Malo jusqu'à celles de Morlaix, moins quelques enclaves, et contenait environ trois journées de chemin de longueur et une de largeur. Il avait pour bornes, à l'est, l'évêché de Saint-Malo ; au sud, le duché de Rohan à l'ouest, le comté de Goëllo et la baronnie d'Avaugour, qui étaient des juveigneuries de Penthièvre. Plus de deux mille gentilshommes relevaient de ce duché, dont l'histoire, comme on en peut juger, est assez exactement celle du département des Côtes-d'Armor.
Nous y ajouterons cependant la mention d'une descente opérée sur la côte de Saint-Cast par les Anglais en 1758, descente qui ne tourna pas à l'avantage des envahisseurs. La duc d'Aiguillon les battit le 11 septembre de la même année, et les obligea de se rembarquer huit jours après leur débarquement. Une médaille fut frappée en mémoire de cet événement ; on y voyait, entre autres figures, celle d'un guerrier armé de la foudre avec cette légende : Virtus nobilitatis et populi Armorici. Pendant la Révolution, les Côtes-d'Armor ne prirent qu'une faible part à la guerre civile ; elles n'en furent troublées qu'à l'époque de l'expédition de Quiberon (1795). C'est sur ce territoire que fut défaite une division de cette armée rouge qui s'était recrutée de paysans bretons revêtus de l'uniforme anglais. Le chevalier de Tinteniac, qui commandait cette troupe, fut tué dans l'action.
Le département des Côtes-d'Armor occupe, avec celui du Morbihan, le milieu de la péninsule armoricaine, dont les départements d'Ille-et-Vilaine et du Finistère forment les extrémités. Il doit à cette situation la variété de caractères qui le distingue et qui peut, permettre de le diviser en trois régions différentes : le pays de Saint-Brieuc appartient à la haute Bretagne, celui de Lannion et de Tréguier à la basse, et l'on donne le nom de Bretagne moyenne au pays qui environne Dinan.
A mesure qu'on traverse le département de l'est à l'ouest, on sent que l'on approche du Finistère ; on le reconnaît à l'extérieur des habitants, à leurs mœurs, à leur langage. Suivant les expressions de M. Pitre-Chevalier, une ligne tracée de l'embouchure de la Vilaine à Châtelaudren (entre Saint-Brieuc et Guingamp) peut être considérée comme la muraille chinoise de l'idiome breton, et les brèches faites à ce rempart par le commerce et la civilisation n'ont guère enlevé au vieux langage que les villes, les ports et les endroits fréquentés de la côte.
La circonscription départementale des Côtes-d'Armor n'a donc d'autre unité que l'unité administrative. Aux temps les plus anciens, avant l'occupation romaine, plusieurs peuples s'en partageaient le territoire. C'étaient les Curiosolites, les Lexobiens, les Ambiliates, les Osismiens. Les Curiosolites avaient pour capitale une ville quia conservé la trace de leur nom dans le sien : c'est Corseul, dont nous aurons occasion de reparler dans un article spécial. Le domaine des Curiosolites s'étendait, selon d'Anville, jusqu'au pays d'Yffiniac, dont le nom aurait la même signification que ce terme latin ad fines, employé si souvent par les anciens géographes pour marquer des bornes et des limites. Les antiquités mégalithiques sont moins nombreuses dans le département des Côtes-d'Armor que dans ceux du Finistère et du Morbihan. Néanmoins, on y rencontre aussi des peulvens, des dolmens, des pierres branlantes, dont la plus remarquable est celle de l'île de Bréhat, et des tumulus, parmi lesquels on cite celui de Lancerf.
L'époque romaine a laissé plus de traces. Nous ne reviendrons pas ici sur la conquête de Jules César. Les Osismiens, les Curiosolites tes prirent leur part à la résistance générale de l'Armorique, et succombèrent dans la défaite commune. Incorporé dans l'empire romain, leur territoire fit partie de la troisième Lyonnaise. En revanche, ils eurent des édifices, des voies romaines. La disposition de ces voies, telle qu'on peut l'observer par leurs débris, indique clairement que Corseul fut considérée, sous l'empiré romain aussi bien qu'auparavant, comme le centre de la contrée ; c'est de ce point qu'elles rayonnent dans des directions différentes.
L'une se dirigeait vers Vannes et traversait les étangs de Jugon. Elle n'avait pas moins de 20 ou 24 pieds de largeur et était élevée de 4 ou 5 pieds au-dessus du sol environnant. Une autre conduisait à Quintin. Deux autres, enfin, à Dinan et à Dinart. D'autres souvenirs romains se rencontrent à Pordic, où l'on montre un camp de César, de forme triangulaire, situé sur de hautes falaises et flanqué, d'un côté, par la mer, de l'autre, par un profond vallon où coule la rivière d'Ik. À l'un des angles se voient les ruines d'u ne tour. Quoique César ne paraisse pas avoir passé en personne par le pays qui nous occupe, néanmoins il est fort possible, comme on l'a conjecturé, que son lieutenant Titurius Sabinus, qu'il envoya avec trois légions pour tenir en respect les Curiosolites et les Lexobiens, ait pris un campement dans le lieu auquel s'est attaché, par la suite, le nom immortel du conquérant.
C'est avec moins de vraisemblance qu'on a prétendu voir dans la petite ville de Binie le Portus Iccius où César s'embarqua pour passer dans la Grande-Bretagne, et que l'on place aujourd'hui, sans contestation, à Wissant, dans le département du Pas-de-Calais. On ne saurait nier, du reste, que Binic n'ait eu jadis une importance qu'elle a perdue depuis. A deux reprises, en 1808 et en 1824, la mer a laissé à découvert les ruines d'un vaste édifice, qui semblait sortir des flots pour en faire foi. Cet édifice avait 80 pieds de longueur sur 40 de largeur, et ses murs, que quelques savants croient de construction antique, recelaient 200 médailles d'empereurs romains et des pièces espagnoles à l'effigie de Charles-Quint. Corseul, Erquy nous ramèneront encore à l'époque romaine.
C'est sur ce rivage, où nous venons de signaler des débris de la puissance romaine, que mirent le pied les Bretons insulaires fugitifs qui vinrent s'établir, au IVe et au Ve siècle, dans l'Armorique. L'un d'eux, du nom de Fracan ou Fragan, qui faisait partie de la suite de Conan dit Mériadec, s'arrêta en 418 sur les bords du Gouët, petite rivière du département, dont le nom tragique semble cacher quelque mystérieuse horreur des temps inconnus à l'histoire. Gouët ou Gouat, en effet, dans la langue celtique veut dire sang, et le pays arrosé par cette rivière s'appelle Gouetlod où Gouello (Goëllo), c'est-à-dire Pays du sang.
C'est donc dans des lieux que s'établit Fragan avec ses compagnons, et l'endroit qu'il choisit pour sa résidence porte encore aujourd'hui le nom de Ploufragan, peuple de Fragan, plou ou plé ayant cette signification dans la langue bretonne. Ce lieu et ce personnage intéressent toute la Bretagne, qui leur doit un de ses saints les plus vénérés, le fameux saint Guignolé. C'est là, en effet, que Guen, femme de Fragan, mit au monde trois fils et une fille, qui eurent tous l'insigne honneur d'être inscrits au catalogue des saints. Les fils avaient nom Guignolé, Jacut et Guétenoc ; la fille, Creirvie. Mis fort jeune sous la conduite d'un saint homme appelé Ludoc, Guignolé y fit les progrès les plus rapides dans les voies de la sainteté, et, à son tour, eut des disciples. Sa renommée le rit choisir par le roi Gradlon pour diriger le fameux monastère de Landevenec, que ce prince venait de fonder. Saint Guignolé y établit une règle austère, qui paraît être la même que celle suivie à cette époque en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Saint Jactit, frère de Guignolé, fonda de son côté un monastère qui porta son nom. Ce sont les deux plus anciens qui aient été fondés en Bretagne.
Nous parlerons ailleurs d'Audren, chef puissant, qui résida dans la contrée vers la fin du Ve siècle. Vers la même époque se fondaient le monastère et la ville de Saint-Brieuc. Les autres chefs du pays qui se succédèrent vers ce temps nous apparaissent dans les légendes et les romans comme les compagnons de gloire d'Arthur et de Hoël le Grand. Quelquefois ils portaient le titre de roi, et l'on vit souvent les prétendants à la couronne de Bretagne obligés de traiter avec eux. A la mort du roi Salomon (874), les comtes de Goëllo, se prétendant issus des anciens souverains de Bretagne, prirent les armes pour soutenir leurs prétentions ; mais ils échouèrent, et la victoire demeura aux comtes de Vannes, leurs concurrents.
Un peu plus tard (939), on vit l'un d'eux contribuer puissamment an gain de la bataille livrée aux Normands près de Saint-Brieuc par Alain Barbe-Torte. C'étaient de puissants seigneurs qui gouvernaient presque en souverains une grande étendue de terre et de nombreux vassaux. L'usement de Goëllo, qui subsista jusque dans le XVIIIe siècle, est une preuve de l'indépendance dont ils jouissaient. Toutefois, leur puissance ne tarda pas à s'éclipser. Leur comté fut réuni à celui de Rennes, puis détaché, ainsi que Penthièvre, en faveur des cadets des comtes de Rennes. Son histoire se confondit dès lors avec celle de Penthièvre jusqu'en 1480, que le duc François Il le donna à François légitimé de Bretagne, comte de Vertus. En 1746, il passa par héritage au prince de Soubise.
La puissance déchue des comtes de Goëllo fut remplacée par la puissance naissante de la maison de Penthièvre. Cette ambitieuse maison date du XIe siècle. Le duc Geoffroy était mort en 1008, laissant deux fils, Alain qui lui succéda, et Eudon qui devint la tige de la branche cadette de la famille ducale, sous le nom de comte de Penthièvre. Eudon ne tarda pas à dévoiler les vues ambitieuses qu'il devait transmettre à ses descendants, et qui furent si longtemps une malheureuse cause de guerres civiles en Bretagne. Il fit la guerre à son frère, Alain V. Après la mort de ce dernier, au lieu d'exercer fidèlement la tutelle dont il avait été chargé sur son neveu, il l'emprisonna, et prit le titre de comte de Bretagne.
Cette maison de Penthièvre tirait son nom de la situation même de ses domaines entre le Leff et le Treff ou Trieux et de la position de son château principal au confluent de ces deux rivières. Ce château s'appelait Pontreff ou Pontreo (Pontrieux). Qu'on ne s'étonne plus de trouver quelquefois au nom de Penthièvre la variante Ponthièvre. Le pays s'appelait Penthévrie ou Ponthévrie. Ce comté comprenait la ville de Saint-Brieuc, où Eudon et son fils Étienne résidèrent et furent inhumés. Plus tard, il s'étendit encore et comprit, outre le diocèse de Saint-Brieuc, une partie de celui de Tréguier ; en un mot, près d'un tiers de la Bretagne. C'était comme une petite province à part, qui avait ses coutumes, ses princes particuliers ; ceux-ci, presque absolus, faisaient à leur gré la paix ou la guerre, levaient des tailles ou des aides, exerçaient plusieurs autres droits régaliens, tenaient une cour brillante et donnaient aux principaux d'entre leurs vassaux le nom pompeux de barons.
Le petit-fils d'Eudon, Alain le Noir, en épousant Berthe, héritière du duché de Bretagne, plaça le sang de Penthièvre sur le trône ducal, mais sans opérer la réunion des domaines de sa. famille qui demeurèrent à son frère aîné, Geoffroy Botherel. Cette alliance, qui eût semblé réconcilier la maison de Penthièvre et celle des ducs, ne fit qu'offrir de nouveaux motifs à la discorde. En effet, l'héritage des Penthièvre ayant passé plus tard à une branche collatérale, celle qui portait la couronne ducale se crut lésée, et Alix, héritière du duché, se sentit disposée à disputer ces riches domaines à celui qui les possédait, Henri d'Avaugour. La sage idée d'un mariage qui eût confondu les droits et terminé le différend avait été quelque temps adoptée, et même des fiançailles avaient eu lieu.
Mais le roi de France, alors très puissant (on était au XIIIe siècle), s'opposa à une alliance qui devait donner trop de puissance aux souverains bretons, Son influence fit rompre les fiançailles, et Alix épousa un prince français, Pierre de Dreux, surnommé Mauclerc. Les deux partis prirent aussitôt les armes : Henri pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, Pierre Mauclerc pour- faire valoir les prétentions de sa femme. La guerre se fit à l'avantage de ce dernier, qui s'empara des terres de Tréguier, Guingamp, Saint-Brieuc, Lamballe, et réduisit Henri à se contenter du titre d'Avaugour qu'il transmit à sa postérité dépouillé de tous les autres. Mauclerc fit don de Penthièvre à sa fille, Yolande de Bretagne (1236) ; plus tard, Jean III le donna en apanage à son frère Gui de Bretagne, mais avec des restrictions importantes : par exemple, il se réserva le fort château de Jugon, situé sur une hauteur appelée autrefois Jugum par les Romains ; telle est l'origine de ce nom, qui s'applique non seulement à la montagne, mais aussi aux vastes marais qui en défendent les approches, et qui sont formés par un épanchement des eaux de l'Arguenon. Jean III se réserva, outre le droit de bris, les émoluments de l'amirauté et la garde des églises ; par cette réserve, les églises cathédrales et les abbayes qui étaient dans l'apanage de Gui de Bretagne turent soustraites à sa juridiction et demeurèrent toujours dans la suite exemptes de la juridiction des Penthièvre.
Gui de Bretagne n'eut qu'une fille, et ce fut cette fameuse Jeanne la Boiteuse qui épousa Charles de Blois et lui porta deux magnifiques héritages : celui du comté de Penthièvre, qu'elle tenait de son père, et celui du duché de Bretagne, qui lui revint de plein droit à la mort de Jean III, mort sans postérité. Malheureusement, un autre prétendant saisit l'occasion de cette interruption de la ligne masculine sur le trône ducal pour se jeter à la traverse et faire valoir des droits que les coutumes féodales rendaient illégitimes.
C'était Jean de Montfort, et de ce moment commença, entre lui et Charles de Blois, cette lutte acharnée à laquelle Jeanne prit une part si active et si glorieuse. Montfort l'emporta, et Jeanne la Boiteuse, dont les enfants étaient retenus prisonniers en Angleterre, dut souscrire au traité de Guérande (1365), qui ne lui laissait que le comté de Penthièvre. Du moins, ce comté avait été constamment défendu avec succès contre l'allié des Anglais ; le château de Jugon avait même été repris et rattaché au comté. Comme il n'y avait pas de communes en Penthièvre, Montfort, qui partout ailleurs s'appuyait sur elles, n'avait là aucun parti et aucune prise.
Les Penthièvre trouvèrent bientôt un allié puissant. Le connétable de Clisson, ennemi mortel de Montfort, devenu Jean IV, usa de son influence pour faire mettre en liberté les enfants de Jeanne la Boiteuse, et Jean de Blois, l'un d'eux, épousa sa fille. Ce mariage important, qui réunit contre les nouveaux ducs de Bretagne les forces éloignées des deux plus puissantes maisons du duché, fut célébré à Moncontour en Penthièvre, en présence des plus illustres seigneurs de Bretagne, les sires de Laval, de Léon, de Derval, de Rochefort, de Beaumanoir et de Rostrenen. Jean IV ne pardonna pas à Clisson une alliance dont le but était si évident, et nous avons raconté ailleurs (Morbihan) comment il l'attira au château de l'Hermine pour le faire périr. N'ayant pas eu le courage de consommer son forfait, il eut à soutenir une guerre terrible dont le comté de Penthièvre fut le principal théâtre.
Tout le comté s'était soulevé. à l'instigation de la belle et vindicative Marguerite de Clisson, qui ne rêvait pour elle-même et pour ses enfants que cette couronne ducale injustement enlevée aux Penthièvre. Elle se lassa moins vite que son père et, tandis qu'il faisait la paix avec Jean IV, elle continua de soulever le pays, et s'efforça de l'entraîner lui-même dans de nouvelles entreprises ; elle ne craignait point de l'exhorter même à l'assassinat. Le connétable repoussa ces coin lots avec indignation ; mais il mourut, et Marguerite, dégagée d'une dépendance qui pesait à sa vengeance et à son ambition, prit les allures d'une souveraine, leva des impôts dans son comté, malgré les défenses du duc et des états de Bretagne, et refusa constamment d'acquiescer aux conditions d'arrangement négociées entre son fils Olivier et le duc.
Douze sergents lui furent envoyés pour l'ajourner à comparaître devant ce dernier. Plusieurs ayant eu l'audace de porter la main sur elle, elle les fit tuer sur-le-champ. Jean IV demanda des secours aux Anglais, qui débarquèrent dans l'île de Bréhat et la ravagèrent ; plusieurs places de Penthièvre tombèrent en son pouvoir. Marguerite céda, mais pour commencer aussitôt un autre genre de guerre, une guerre de perfidie et de guet-apens. Il ne fut point difficile à celle que les vieux historiens appellent la méchante Margot de feindre une réconciliation sincère et même un vif attachement pour les enfants de Jean IV. C'est par ces moyens odieux qu'elle réussit à attirer la duc au guet-apens de Chantoceaux et à se rendre maîtresse de sa personne. Mais c'était trop d'audace et de duplicité.
La Bretagne, lasse des troubles qu'excitait sans cesse une ambition avilie par les moyens mêmes qu'elle employait, s'indigna du forfait et comprit qu'il valait cent fois mieux conserver Jean IV que de s'exposer à tomber sous le joug de Marguerite. Les seigneurs prirent tous les armes. Le comté de Penthièvre fut envahi, la plupart des châteaux rasés, et les Penthièvre, dépouillés de tous leurs biens, allèrent porter en France leur orgueil humilié et leurs opiniâtres projets de vengeance (1420). Un accommodement ménagé par le connétable de Richemont rendit le comté de Penthièvre à Jean, frère d'Olivier et fils de Marguerite. Jean mourut sans enfants. Nicole de Bretagne, sa nièce et son héritière, porta le comté de Penthièvre à son mari, Jean de Brosse, vicomte de Boussac et maréchal de France.
Ce nouveau comte de Penthièvre, moins peut-être par les motifs de haine qui avaient animé les anciens comtes que par attachement à la couronne de France, se déclara pour le roi dans la guerre du Bien publie, et se fit ainsi dépouiller à son tour par le duc François Il. Le comté de Penthièvre passa successivement à plusieurs maîtres différents, et ne revint aux de Brosse qu'après la réunion définitive de la Bretagne à la France. En 1535, François Ier céda à Jean de Brosse, quatrième du nom, tout ce qu'il tenait du comté de Penthièvre, et ce seigneur abandonna au roi tous les droits qu'il pouvait avoir sur le duché par représentation de Nicole de Bretagne, sa bisaÏeule. Le comté de Penthièvre avait été diminué des châtellenies de Châtelaudren, Lanvollon, Painipol, érigées par le duc en baronnie sous le nom d'Avaugour.
En 1569, Charles IX, pour récompenser la fidélité des comtes de Penthièvre, érigea leur fief en duché-pairie, litre glorieux, mais qui ne rendait pas aux Penthièvre la puissance des anciens comtes. Peu de temps après, une alliance porta ce fief à Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, celui que la ligue de Bretagne a rendu si célèbre. Cela fut cause que le territoire de Penthièvre fut un des théâtres des guerres de religion. Nous dirons ailleurs comment Lanoue périt au siège de Lamballe. Françoise de Lorraine, fille et unique héritière de Mercoeur, épousa César, duc de Vendôme, fils légitimé de Henri IV.
C'est Louis-Joseph, fils de César, qui s'illustra, sous le nom de Vendôme, par tant de victoires vers la fin du règne de Louis XIV. N'ayant pas d'enfants, et d'ailleurs grand dissipateur, il vendit son duché de Penthièvre à la princesse de Conti, qui, à son tour, le revendit à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (1696). Enfin, au XVIIIe siècle, la petite-fille du comte de Toulouse le porta dans la maison d'Orléans par son mariage avec le duc de Chartres.
A cette époque, malgré tant de démembrements, le duché de Penthièvre formait encore une des plus belles seigneuries du royaume. Il s'étendait depuis les portes de Saint-Malo jusqu'à celles de Morlaix, moins quelques enclaves, et contenait environ trois journées de chemin de longueur et une de largeur. Il avait pour bornes, à l'est, l'évêché de Saint-Malo ; au sud, le duché de Rohan à l'ouest, le comté de Goëllo et la baronnie d'Avaugour, qui étaient des juveigneuries de Penthièvre. Plus de deux mille gentilshommes relevaient de ce duché, dont l'histoire, comme on en peut juger, est assez exactement celle du département des Côtes-d'Armor.
Nous y ajouterons cependant la mention d'une descente opérée sur la côte de Saint-Cast par les Anglais en 1758, descente qui ne tourna pas à l'avantage des envahisseurs. La duc d'Aiguillon les battit le 11 septembre de la même année, et les obligea de se rembarquer huit jours après leur débarquement. Une médaille fut frappée en mémoire de cet événement ; on y voyait, entre autres figures, celle d'un guerrier armé de la foudre avec cette légende : Virtus nobilitatis et populi Armorici. Pendant la Révolution, les Côtes-d'Armor ne prirent qu'une faible part à la guerre civile ; elles n'en furent troublées qu'à l'époque de l'expédition de Quiberon (1795). C'est sur ce territoire que fut défaite une division de cette armée rouge qui s'était recrutée de paysans bretons revêtus de l'uniforme anglais. Le chevalier de Tinteniac, qui commandait cette troupe, fut tué dans l'action.
Les département et... - La Cote d'Or - 21 -
Publié à 09:14 par acoeuretacris
la ville de Dijon
SUITE ET FIN
Cette alliance ajoutait à ses États les comtés de Bourgogne, d'Artois, de Flandre, de Rethel, de Nevers, et en faisait un des souverains les plus redoutables de l'Europe. Le roi de France eut recours à lui contre les attaques des Anglais et du roi de Navarre, Charles le Mauvais. Philippe sut arrêter et contenir l'ennemi ; il triompha de, la patriotique révolte des Gantois, commandés par l'héroïque Artevelde. Il reçut, à Dijon, le roi Charles VI avec une magnificence qui devint traditionnelle à la cour de Bourgogne. Il acquit le Charolais, en 1390, au prix de soixante mille écus d'or. Il envoya son fils aîné, Jean, comte de Nevers, avec une armée au secours de Sigismond, roi de Hongrie, menacé par les musulmans. Pendant la maladie de Charles VI, il avait été choisi par les états généraux, en 1392, pour gouverner le royaume Cette préférence, en excitant la jalousie de la maison d'Orléans, devint la source d'une haine irréconciliable qu'en mourant il légua, héritage funeste, à son fils Jean sans Peur. Ce prince succéda à son père en 1406 ; il avait épousé, en 1385, Marguerite de Bavière, dont la dot grossissait ses États de trois comtés : le Hainaut, la Hollande et la Zélande. Ses premiers actes furent ceux d'un prince habile, mais peu scrupuleux.
Après avoir remis un pou d'ordre dans les finances, compromises par les prodigalités de son père, il donna satisfaction à la haine qui couvait dans son cœur. Le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans, en sortant de l'hôtel Barbette, à Paris, où il avait soupé avec la reine Isabeau de Bavière, tombait, rue Vieille-du-Temple, sous les coups d'un gentilhomme normand, Raoul d'Octonville, écuyer du duc Jean.
La justice étant impuissante en face d'un si grand criminel, la guerre éclata entre Armagnac et Bourgogne ; le fils du duc d'Orléans avait épousé la fille du comte d'Armagnac, et celui-ci se posa en vengeur du duc d'Orléans La durée de cette triste guerre ne fut interrompue que par les périls extrêmes de la France et la désastreuse campagne qui aboutit à la journée d'Azincourt.
Ce jour-là les deux familles rivales combattirent encore sous le même drapeau ; mais la haine étouffa bientôt ce qui restait de patriotisme et de loyauté. Jean, par un traité secret signé en 1416, s'allia aux Anglais, et l'abandon de Rouen fut le gage de sa trahison. Une sédition payée (celle de Périnet-Leclerc, 1418) et un massacre lui ouvrirent même les portes de Paris, où il entra en triomphateur, salué par les acclamations du peuple égaré, qui criait sur son passage : Noël ! vive le duc de Bourgogne, qui abolit les impôts !
Mais ce triomphe fut de courte durée ; le crime appelait la vengeance ; elle fut digne du coupable, digne des mœurs du temps. Un projet de paix et de réconciliation générale fut proposé, une entrevue avec le dauphin fut convenue, et le rendez-vous fixé, pour le 10 septembre 1419, sur le pont de Montereau. L'entourage intime de Jean avait été gagné ; il partit donc sans défiance ; mais quand il se fut avancé sur le pont, escorté de dix chevaliers seulement, les complices du duc d'Orléans, Tanneguy du Châtel et le sire de Barbazan à leur tête, se précipitèrent sur les Bourguignons et percèrent Jean de leurs coups. Les assassins voulaient jeter son corps dans la Seine, mais le curé de Montereau obtint qu'il lui fût remis ; il le garda jusqu'à minuit, le fit alors porter dans un moulin voisin et le lendemain à l'hôpital, où on l'ensevelit dans la bière des pauvres.
La mort de Jean sans Peur mit Philippe, dit le Bon, en possession de ses États à l'âge de vingt-trois an§. Il était à Gand lorsqu'il apprit la fin tragique de son père. Brûlant du désir de le venger, il convoqua à Arras une assemblée de grands seigneurs,. à laquelle il invita le roi d'Angleterre, qui était à Rouen. C'est là que fut préparé, pour être conclu à Troyes en 1420, le monstrueux traité qui, de complicité avec Isabeau, épouse et mère dénaturée, déshéritait, au profit de l'étranger, le dauphin Charles VII, du vivant de son père en démence.
Les événements de cette période sont trop connus et d'un intérêt trop général pour que nous entrions ici dans leur récit détaillé. Philippe, qui par la fin de son règne racheta les fautes du commencement, fut alors le complice de tout ce qui se trama et s'exécuta contre la France. Son excuse est dans le souvenir encore récent du meurtre de son père ; mais on ne petit même pas lui faire un mérite de son repentir, car son retour à la. cause française fut déterminé surtout par les outrages dont les Anglais l'abreuvèrent dès qu'ils crurent ne plu s avoir besoin de lui.
C'est en 1434, et par l'intervention de Charles, duc de Bourbon, que furent posés les préliminaires d'une réconciliation trop tardive et cimentée définitivement par le traité d'Arras, le 21 septembre de l'année suivante. L'insolence des termes prouve à quel point la royauté de France était humble et faible devant ce vassal que dédaignaient les Anglais. Charles désavoue le meurtre de Jean, et Philippe, après l'énoncé des dédommagements qui lui sont accordés, s'exprime ainsi : A ces conditions, pour révérence de Dieu et pour la compassion du pauvre peuple, duc par la grâce de Dieu, je reconnais le roi Charles de France pour mon souverain. Hâtons-nous d'ajouter que jamais parole donnée ne fut mieux tenue, et qu'à dater de cette époque la conduite de Philippe fut aussi irréprochable qu'elle avait été jusque-là criminelle.
La prospérité de ses peuples, le développement des bienfaits de la paix devint son unique préoccupation. L'union des deux maisons de France et de Bourgogne fut resserrée par le mariage du comte de Charolais, héritier de Philippe, avec Catherine de France, fille de Charles VII. Lorsque Louis XI, dauphin, quitta la cour de son père, Philippe lui refusa un asile en Bourgogne, où ses intrigues pouvaient être un danger pour la couronne et lui offrit à Geneppe, dans ses terres de Flandre, une hospitalité digne de son rang. Lors de la sédition qu'occasionna, parmi les chefs de l'armée, la désorganisation de l'ancien système militaire, il intervint entre les rois et les rebelles, et obtint d'eux qu'ils renonçassent à leurs projets de guerre civile.
Quoique l'insubordination de ses sujets flamands le tînt le plus souvent éloigné de la Bourgogne, il y entretint toujours une administration éclairée et paternelle. Son règne fut l'apogée des prospérités de la province. « Il mit ses pays, dit Saint-Julien de Baleure, en si haute paix et heureuse tranquillité qu'il n'y avoit si petite maison bourgeoise en ses villes où on ne bût en vaisselle d'argent ». Ce témoignage naïf est un plus éclatant hommage à sa mémoire que toutes les splendeurs de sa cour et les magnificences de l'ordre de la Toison d'or, dont on sait qu'il fut le fondateur. Il mourut à Bruges d'une esquinancie, en 1467, à l'âge de soixante et onze ans ; son corps fut transporté plus tard aux Chartreux de Dijon. Peu de princes furent aussi profondément et aussi justement regrettés.
Charles le Téméraire, quoique son règne n'ait commencé qu'en 1467, suivait depuis plusieurs années une ligne de conduite indépendante et souvent même opposée aux intentions pacifiques de son père. Sa participation à la ligue du Bien public, ses violents démêlés avec Louis XI étaient certainement peu dans les vues de Philippe, déjà vieux et ami de la paix.
Aux qualités héréditaires de sa race, courage, franchise, générosité, Charles joignait des défauts qui lui étaient personnels et qui rendaient bien périlleuse la lutte engagée avec Louis, le plus habile politique de son temps. Charles était arrogant, présomptueux, plein de fougue et d'obstination, incapable de pressentir les pièges qui lui étaient tendus, plus incapable encore de tourner une difficulté ou de recourir à l'adresse pour sortir d'un mauvais pas. Il épuisa toute son énergie, toutes les ressources de sa puissance à lutter contre les embarras que lui suscitait le roi de France sans paraître soupçonner de quelle main parlaient les coups qui lui étaient portés.
Les révoltes de Gand et de Liège, victorieusement, mais trop cruellement réprimées, lui aliénaient les populations et ne lui laissaient pas la libre disposition de ses forces. Il eut en son pouvoir, à Péronne, son rival, convaincu de complicité avec les Liégeois rebelles, et au bout de trois jours il lui rendit sa liberté, se contentant d'une promesse de neutralité qu'il fut le seul à prendre au sérieux. Il s'empara des comtés de Ferrette et de Brisgau, sans se soucier de la rupture avec la Suisse, qui en était la conséquence inévitable ; l'hostilité de ce voisinage l'entraîna dans une guerre dont il n'entrevit pas un seul instant la portée. Battu à Granson, il lui fallut à tout prix une revanche, et la journée de Morat changea en désastre ce qui pouvait n'être qu'un échec. L'importance qu'il avait toujours donnée aux prestiges de l'apparat, aux formes extérieures de la puissance, devait rendre mortel l'affront que ses armes avaient reçu ; il le comprit bien, et on le vit périr de mélancolie et de chagrin plus encore que de sa dernière défaite sous les murs de Nancy.
Il avait été mortellement frappé le 5 janvier 1477 ; son corps, à demi engagé dans un étang glacé, ne fut reconnu que deux jours après à la longueur de ses ongles et à une cicatrice résultant d'une blessure qu'il avait reçue à la bataille de Montlhéry, en 1465. Avec lui finit le duché héréditaire de Bourgogne, dont les possesseurs avaient cinq duchés à hauts fleurons, quinze comtés d'ancienne érection et un nombre infini d'autres seigneuries, marchaient immédiatement après les rois, comme premiers ducs de la chrétienté, et recevaient des princes étrangers le titre de grands-ducs d'Occident.
Charles laissait pour unique héritière une fille, la princesse Marie. Louis XI s'en fit d'abord donner la tutelle ; puis, à force de séductions et de promesses, il obtint du parlement de Dijon la réunion du duché à la couronne de France. Une alliance du dauphin avec Marie aurait légitimé cette usurpation. Louis ne voulut pas y consentir ; c'est la faute la plus capitale qu'on puisse reprocher à sa politique ; d'ailleurs ce mariage eût été trop disproportionné, le jeune dauphin ayant à peine huit ans et Marie de Bourgogne étant dans sa vingt et unième année. L'archiduc Maximilien, étant devenu l'époux de la fille de Charles le Téméraire, revendiqua les droits de sa femme et- remit en question l'unité française, qu'il eût été si facile de constituer.
Mais ce qui échappa à la perspicacité des politiques, l'instinct public le comprit et la force des choses l'amena ; le lien qui venait de rattacher la Bourgogne à la France, quelque irrégulier qu'il fût, ne devait plus être rompu. Malgré les alternatives d'une longue lutte, malgré le péril qu'entretenait pour les frontières de la province le voisinage de la Comté demeurée en la possession de l'étranger, malgré l'espèce de consécration que donnait aux droits de Maximilien sa domination sur les Flandres, la Bourgogne demeura française, et ses destinées restent dès lors indissolublement unies à celles de la patrie commune. Le titre de duc de Bourgogne reste attaché à l'héritier direct de la couronne, et chaque jour, malgré la fidélité des souvenirs aux traditions de l'histoire provinciale, la similitude de langage, l'affinité des mœurs, la communauté des intérêts. rend plus complète la fusion des deux États.
La lutte de François Ier et de Charles-Quint, les guerres religieuses et les troubles de la Fronde sont les épisodes les plus marquants qui se rattachent à la période française des annales bourguignonne s. Les populations furent admirables de dévouement et d'héroïsme pendant la première de ces crises, luttant à la fois contre les Espagnols, l'Autriche et les Comtois, donnant par souscriptions volontaires des sommes considérables, outre celles votées par les états pour la rançon de l'illustre prisonnier de Pavie, et refusant d'accéder à la condition du traité de Madrid, qui cédait la Bourgogne à Charles-Quint, représentant à ce sujet qu'ayant par les droits de la couronne et par leur choix des maîtres nécessaires, il ne dépendait pas de la volonté du monarque de les céder ainsi. La noblesse ajouta que si le roi l'abandonnait, elfe prendrait le parti extrême de se défendre et de s'affranchir de toutes sortes de domination, et qu'elle répandrait pour ce dessein jusqu'à la dernière goutte de son sang.
La fierté de ces sentiments, puisés dans les glorieux souvenirs du passé, arrêta longtemps les progrès du protestantisme ; la Bourgogne voulait être la dernière à souffrir sur son sol une nouvelle religion, puisqu'elle avait été chrétienne avant tous les Français, qui ne l'étaient devenus que par le mariage de leur princesse Clotilde avec le fondateur de la monarchie française. Les fléaux que déchaîna le fanatisme sur tant d'autres provinces furent évités jusqu'à la déplorable organisation des ligues catholiques, et, grâce à l'intervention du digne président Jeannin, le plus grand nombre des villes de Bourgogne ne fut pas ensanglanté par les massacres de la Saint-Barthélemy. Cependant l'obstination de Mayenne prolongea jusqu'en 1595 les calamités de la guerre civile, à laquelle mit fin seulement la victoire remportée par Henri IV sur les Espagnols à Fontaine-Française. Le 6 juin de cette année, ce monarque fit son entrée à Dijon ; il assista à l'élection du maire, jura de respecter les privilèges de la ville, et se contenta de changer quelques magistrats municipaux et de faire fermer le collège des jésuites.
Les dernières épreuves que la Bourgogne eut à traverser furent, sous Louis XIII, une révolte des vignerons, qui se réunissaient au refrain, Lanturlu, d'une vieille chanson, ce qui fit désigner cette révolte, qui, d'ailleurs, fut bientôt apaisée, sous le nom de Révolte des Lanturlus. Puis vint l'invasion des Impériaux amenée par les révoltes de la noblesse contre Richelieu et le. siège mémorable de Saint-Jean-de-Losne, les agitations de la Fronde, auxquelles l'influence des Condé dans la province donna une certaine importance, mais auxquelles manqua, presque partout l'appui des populations.
Dans les époques plus récentes, la Bourgogne prit sa part de tous les événements heureux on funestes dont la France fut le théâtre. La Révolution de 1789 y fut accueillie comme' une ère réparatrice, qui devait faire disparaître les tristes abus financiers des derniers règnes, et assurer à chacun les libertés que l'on réclamait depuis longtemps. Les gardes nationales s'y organisèrent avec une rapidité merveilleuse, et, oubliant les vieilles rivalités qui les divisaient sous l'ancien régime, elles s'unirent à celles de la Franche-Comté et demandèrent à marcher ensemble les. premières contre l'ennemi.
Le département de la Côte-d'Or fournit donc un large contingent aux phalanges républicaines qui, après avoir refoulé l'ennemi, promenèrent le drapeau national dans toutes les capitales de l'Europe ; et lorsque, moins heureux, les soldats de Napoléon jar expièrent par les désastres de 1814 et 1815 les triomphes passés, nulle part ils ne trouvèrent un plus vaillant appui et de plus patriotiques sympathies que dans les populations de la Bourgogne. Depuis que les luttes de l'industrie et des arts ont remplacé dans la vie des peuples modernes les vicissitudes des champs de bataille, la Côte-d'Or, grâce au génie de ses habitants et aux richesses de son sol, a su conquérir une importance et une prospérité qui lui permettent de ne rien regretter des gloires et des grandeurs de l'ancienne Bourgogne.
Pendant la néfaste guerre de 1870-71, le département de la Côte-d'Or eut d'autant plus à souffrir de l'invasion allemande que Dijon fut successivement pris pour centre d'opérations et par les Français et par les Allemands. À la nouvelle que le passage des Vosges avait été forcé par l'ennemi et que la ligne de défense de Vesoul à Lure venait d'être abandonnée par le général Cambriels qui s'était retiré à Besançon, la résistance s'organisa à Dijon sous la direction du docteur Lavalle, membre du conseil général, tandis que Garibaldi, autorisé par le gouvernement de la défense nationale, formait un corps d'armée composé de quatre brigades dont il confiait le commandement à Bossack, Marie, Menotti et Ricciotti. Le général de Werder, commandant du 4e corps allemand, marchait sur Dijon et, le 27 octobre 1870, repoussait, à Talmay, les troupes françaises commandées par Lavalle, qui ne se composaient guère que de quelques bataillons de mobiles et de gardes nationaux.
Pendant ce temps, Garibaldi se portait sur la droite du côté de Poutailler pour essayer de rejoindre les troupes du général Cambriels. L'ennemi, ayant passé la Saône à Gray, se porta sur Dijon ; les troupes qui s'opposaient à sa marche furent repoussées à la bifurcation des routes de Gray à Dijon et à Auxonne. À la suite d'un nouveau combat livré à Saint-Apollinaire le 30 octobre, les Allemands entrèrent à Dijon. Garibaldi qui avait en vain essayé d'accourir à la défense de la ville, ce qu'il ne put faire, parce que le pont de Pontailler avait été rompu, voulut du moins protéger les autres grandes villes de la Côte-d'Or ; il fit occuper Saint-Jean-de-Losne et Seurre et lui-même revint à Dôle. Le 2 novembre l'ennemi, maître de Dijon, marchait sur Beaune et Chagny. Les troupes de Garibaldi gardèrent les rives de l'Oignon et de la Saône ; le 5 novembre, elles repoussèrent l'ennemi près de Saint-Jean-de-Losne.
A la suite de cet échec, les Allemands revinrent à Dijon pour s'y reformer et firent de cette ville le centre de leurs opérations dans l'Est. Ils reprirent bientôt l'offensive et repoussèrent d'abord, le 30 novembre, les troupes de Garibaldi ; mais le 3 décembre, celui-ci, appuyé parle général Cremer, les battit complètement à Arnay-le-Duc et à Bligny-sur-Ouche, les rejetant presque sous les murs de Dijon. Cette double victoire, qui empêchait l'ennemi de dépasser Chagny, sauva le reste du département et peut-être même Lyon. Le général de Werder revint une fois encore à Dijon pour reposer ses troupes et les reformer ; mais les événements avaient marché Au nord-est ; il dut envoyer ses troupes sous les murs de Belfort qui se défendait avec acharnement, et il ne laissa à Dijon que le général Glumer avec deux bataillons et à Semur une brigade badoise. Ces troupes furent ellesmêmes bientôt rappelées et, le 6 janvier 1871, Garibaldi rentrait à Dijon, y organisait de nouveau la défense ; il était temps, car une armée de 70 000 AIlemands s'avançait pour empêcher Bourbaki de se porter à la défense de Belfort.
Trois corps de cette armée furent successivement attaqués et battus dans les journées des 21, 22 et 23 janvier, par le général Pélissier et Garibaldi, d'abord à Fontaine et à Talant, puis à Plombières, à Daix, à Hauteville et au Val-de-Suzon. D'habiles dispositions permettaient d'espérer des succès plus décisifs lorsque, le 29 janvier, on apprit la capitulation de Paris et la notification de l'armistice. Par une fatalité encore mal expliquée, les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura n'étaient pas compris dans cet armistice ; l'armée de l'Est était refoulée vers la Suisse, la continuation de la lutte devenait impossible, il fallut se résigner à abandonner Dijon qui ne fut évacué par l'ennemi qu'après la signature des préliminaires de paix. Quant à Garibaldi, qui le 28 janvier était parvenu à réunir à Dijon près de 50 000 hommes et 90 canons, il avait agi si habilement et avec tant de promptitude qu'il put opérer sa retraite sans rien perdre de son matériel. L'invasion allemande avait coûté au département de la Côte-d'Or 14 464 427 fr. 29.
SUITE ET FIN
Cette alliance ajoutait à ses États les comtés de Bourgogne, d'Artois, de Flandre, de Rethel, de Nevers, et en faisait un des souverains les plus redoutables de l'Europe. Le roi de France eut recours à lui contre les attaques des Anglais et du roi de Navarre, Charles le Mauvais. Philippe sut arrêter et contenir l'ennemi ; il triompha de, la patriotique révolte des Gantois, commandés par l'héroïque Artevelde. Il reçut, à Dijon, le roi Charles VI avec une magnificence qui devint traditionnelle à la cour de Bourgogne. Il acquit le Charolais, en 1390, au prix de soixante mille écus d'or. Il envoya son fils aîné, Jean, comte de Nevers, avec une armée au secours de Sigismond, roi de Hongrie, menacé par les musulmans. Pendant la maladie de Charles VI, il avait été choisi par les états généraux, en 1392, pour gouverner le royaume Cette préférence, en excitant la jalousie de la maison d'Orléans, devint la source d'une haine irréconciliable qu'en mourant il légua, héritage funeste, à son fils Jean sans Peur. Ce prince succéda à son père en 1406 ; il avait épousé, en 1385, Marguerite de Bavière, dont la dot grossissait ses États de trois comtés : le Hainaut, la Hollande et la Zélande. Ses premiers actes furent ceux d'un prince habile, mais peu scrupuleux.
Après avoir remis un pou d'ordre dans les finances, compromises par les prodigalités de son père, il donna satisfaction à la haine qui couvait dans son cœur. Le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans, en sortant de l'hôtel Barbette, à Paris, où il avait soupé avec la reine Isabeau de Bavière, tombait, rue Vieille-du-Temple, sous les coups d'un gentilhomme normand, Raoul d'Octonville, écuyer du duc Jean.
La justice étant impuissante en face d'un si grand criminel, la guerre éclata entre Armagnac et Bourgogne ; le fils du duc d'Orléans avait épousé la fille du comte d'Armagnac, et celui-ci se posa en vengeur du duc d'Orléans La durée de cette triste guerre ne fut interrompue que par les périls extrêmes de la France et la désastreuse campagne qui aboutit à la journée d'Azincourt.
Ce jour-là les deux familles rivales combattirent encore sous le même drapeau ; mais la haine étouffa bientôt ce qui restait de patriotisme et de loyauté. Jean, par un traité secret signé en 1416, s'allia aux Anglais, et l'abandon de Rouen fut le gage de sa trahison. Une sédition payée (celle de Périnet-Leclerc, 1418) et un massacre lui ouvrirent même les portes de Paris, où il entra en triomphateur, salué par les acclamations du peuple égaré, qui criait sur son passage : Noël ! vive le duc de Bourgogne, qui abolit les impôts !
Mais ce triomphe fut de courte durée ; le crime appelait la vengeance ; elle fut digne du coupable, digne des mœurs du temps. Un projet de paix et de réconciliation générale fut proposé, une entrevue avec le dauphin fut convenue, et le rendez-vous fixé, pour le 10 septembre 1419, sur le pont de Montereau. L'entourage intime de Jean avait été gagné ; il partit donc sans défiance ; mais quand il se fut avancé sur le pont, escorté de dix chevaliers seulement, les complices du duc d'Orléans, Tanneguy du Châtel et le sire de Barbazan à leur tête, se précipitèrent sur les Bourguignons et percèrent Jean de leurs coups. Les assassins voulaient jeter son corps dans la Seine, mais le curé de Montereau obtint qu'il lui fût remis ; il le garda jusqu'à minuit, le fit alors porter dans un moulin voisin et le lendemain à l'hôpital, où on l'ensevelit dans la bière des pauvres.
La mort de Jean sans Peur mit Philippe, dit le Bon, en possession de ses États à l'âge de vingt-trois an§. Il était à Gand lorsqu'il apprit la fin tragique de son père. Brûlant du désir de le venger, il convoqua à Arras une assemblée de grands seigneurs,. à laquelle il invita le roi d'Angleterre, qui était à Rouen. C'est là que fut préparé, pour être conclu à Troyes en 1420, le monstrueux traité qui, de complicité avec Isabeau, épouse et mère dénaturée, déshéritait, au profit de l'étranger, le dauphin Charles VII, du vivant de son père en démence.
Les événements de cette période sont trop connus et d'un intérêt trop général pour que nous entrions ici dans leur récit détaillé. Philippe, qui par la fin de son règne racheta les fautes du commencement, fut alors le complice de tout ce qui se trama et s'exécuta contre la France. Son excuse est dans le souvenir encore récent du meurtre de son père ; mais on ne petit même pas lui faire un mérite de son repentir, car son retour à la. cause française fut déterminé surtout par les outrages dont les Anglais l'abreuvèrent dès qu'ils crurent ne plu s avoir besoin de lui.
C'est en 1434, et par l'intervention de Charles, duc de Bourbon, que furent posés les préliminaires d'une réconciliation trop tardive et cimentée définitivement par le traité d'Arras, le 21 septembre de l'année suivante. L'insolence des termes prouve à quel point la royauté de France était humble et faible devant ce vassal que dédaignaient les Anglais. Charles désavoue le meurtre de Jean, et Philippe, après l'énoncé des dédommagements qui lui sont accordés, s'exprime ainsi : A ces conditions, pour révérence de Dieu et pour la compassion du pauvre peuple, duc par la grâce de Dieu, je reconnais le roi Charles de France pour mon souverain. Hâtons-nous d'ajouter que jamais parole donnée ne fut mieux tenue, et qu'à dater de cette époque la conduite de Philippe fut aussi irréprochable qu'elle avait été jusque-là criminelle.
La prospérité de ses peuples, le développement des bienfaits de la paix devint son unique préoccupation. L'union des deux maisons de France et de Bourgogne fut resserrée par le mariage du comte de Charolais, héritier de Philippe, avec Catherine de France, fille de Charles VII. Lorsque Louis XI, dauphin, quitta la cour de son père, Philippe lui refusa un asile en Bourgogne, où ses intrigues pouvaient être un danger pour la couronne et lui offrit à Geneppe, dans ses terres de Flandre, une hospitalité digne de son rang. Lors de la sédition qu'occasionna, parmi les chefs de l'armée, la désorganisation de l'ancien système militaire, il intervint entre les rois et les rebelles, et obtint d'eux qu'ils renonçassent à leurs projets de guerre civile.
Quoique l'insubordination de ses sujets flamands le tînt le plus souvent éloigné de la Bourgogne, il y entretint toujours une administration éclairée et paternelle. Son règne fut l'apogée des prospérités de la province. « Il mit ses pays, dit Saint-Julien de Baleure, en si haute paix et heureuse tranquillité qu'il n'y avoit si petite maison bourgeoise en ses villes où on ne bût en vaisselle d'argent ». Ce témoignage naïf est un plus éclatant hommage à sa mémoire que toutes les splendeurs de sa cour et les magnificences de l'ordre de la Toison d'or, dont on sait qu'il fut le fondateur. Il mourut à Bruges d'une esquinancie, en 1467, à l'âge de soixante et onze ans ; son corps fut transporté plus tard aux Chartreux de Dijon. Peu de princes furent aussi profondément et aussi justement regrettés.
Charles le Téméraire, quoique son règne n'ait commencé qu'en 1467, suivait depuis plusieurs années une ligne de conduite indépendante et souvent même opposée aux intentions pacifiques de son père. Sa participation à la ligue du Bien public, ses violents démêlés avec Louis XI étaient certainement peu dans les vues de Philippe, déjà vieux et ami de la paix.
Aux qualités héréditaires de sa race, courage, franchise, générosité, Charles joignait des défauts qui lui étaient personnels et qui rendaient bien périlleuse la lutte engagée avec Louis, le plus habile politique de son temps. Charles était arrogant, présomptueux, plein de fougue et d'obstination, incapable de pressentir les pièges qui lui étaient tendus, plus incapable encore de tourner une difficulté ou de recourir à l'adresse pour sortir d'un mauvais pas. Il épuisa toute son énergie, toutes les ressources de sa puissance à lutter contre les embarras que lui suscitait le roi de France sans paraître soupçonner de quelle main parlaient les coups qui lui étaient portés.
Les révoltes de Gand et de Liège, victorieusement, mais trop cruellement réprimées, lui aliénaient les populations et ne lui laissaient pas la libre disposition de ses forces. Il eut en son pouvoir, à Péronne, son rival, convaincu de complicité avec les Liégeois rebelles, et au bout de trois jours il lui rendit sa liberté, se contentant d'une promesse de neutralité qu'il fut le seul à prendre au sérieux. Il s'empara des comtés de Ferrette et de Brisgau, sans se soucier de la rupture avec la Suisse, qui en était la conséquence inévitable ; l'hostilité de ce voisinage l'entraîna dans une guerre dont il n'entrevit pas un seul instant la portée. Battu à Granson, il lui fallut à tout prix une revanche, et la journée de Morat changea en désastre ce qui pouvait n'être qu'un échec. L'importance qu'il avait toujours donnée aux prestiges de l'apparat, aux formes extérieures de la puissance, devait rendre mortel l'affront que ses armes avaient reçu ; il le comprit bien, et on le vit périr de mélancolie et de chagrin plus encore que de sa dernière défaite sous les murs de Nancy.
Il avait été mortellement frappé le 5 janvier 1477 ; son corps, à demi engagé dans un étang glacé, ne fut reconnu que deux jours après à la longueur de ses ongles et à une cicatrice résultant d'une blessure qu'il avait reçue à la bataille de Montlhéry, en 1465. Avec lui finit le duché héréditaire de Bourgogne, dont les possesseurs avaient cinq duchés à hauts fleurons, quinze comtés d'ancienne érection et un nombre infini d'autres seigneuries, marchaient immédiatement après les rois, comme premiers ducs de la chrétienté, et recevaient des princes étrangers le titre de grands-ducs d'Occident.
Charles laissait pour unique héritière une fille, la princesse Marie. Louis XI s'en fit d'abord donner la tutelle ; puis, à force de séductions et de promesses, il obtint du parlement de Dijon la réunion du duché à la couronne de France. Une alliance du dauphin avec Marie aurait légitimé cette usurpation. Louis ne voulut pas y consentir ; c'est la faute la plus capitale qu'on puisse reprocher à sa politique ; d'ailleurs ce mariage eût été trop disproportionné, le jeune dauphin ayant à peine huit ans et Marie de Bourgogne étant dans sa vingt et unième année. L'archiduc Maximilien, étant devenu l'époux de la fille de Charles le Téméraire, revendiqua les droits de sa femme et- remit en question l'unité française, qu'il eût été si facile de constituer.
Mais ce qui échappa à la perspicacité des politiques, l'instinct public le comprit et la force des choses l'amena ; le lien qui venait de rattacher la Bourgogne à la France, quelque irrégulier qu'il fût, ne devait plus être rompu. Malgré les alternatives d'une longue lutte, malgré le péril qu'entretenait pour les frontières de la province le voisinage de la Comté demeurée en la possession de l'étranger, malgré l'espèce de consécration que donnait aux droits de Maximilien sa domination sur les Flandres, la Bourgogne demeura française, et ses destinées restent dès lors indissolublement unies à celles de la patrie commune. Le titre de duc de Bourgogne reste attaché à l'héritier direct de la couronne, et chaque jour, malgré la fidélité des souvenirs aux traditions de l'histoire provinciale, la similitude de langage, l'affinité des mœurs, la communauté des intérêts. rend plus complète la fusion des deux États.
La lutte de François Ier et de Charles-Quint, les guerres religieuses et les troubles de la Fronde sont les épisodes les plus marquants qui se rattachent à la période française des annales bourguignonne s. Les populations furent admirables de dévouement et d'héroïsme pendant la première de ces crises, luttant à la fois contre les Espagnols, l'Autriche et les Comtois, donnant par souscriptions volontaires des sommes considérables, outre celles votées par les états pour la rançon de l'illustre prisonnier de Pavie, et refusant d'accéder à la condition du traité de Madrid, qui cédait la Bourgogne à Charles-Quint, représentant à ce sujet qu'ayant par les droits de la couronne et par leur choix des maîtres nécessaires, il ne dépendait pas de la volonté du monarque de les céder ainsi. La noblesse ajouta que si le roi l'abandonnait, elfe prendrait le parti extrême de se défendre et de s'affranchir de toutes sortes de domination, et qu'elle répandrait pour ce dessein jusqu'à la dernière goutte de son sang.
La fierté de ces sentiments, puisés dans les glorieux souvenirs du passé, arrêta longtemps les progrès du protestantisme ; la Bourgogne voulait être la dernière à souffrir sur son sol une nouvelle religion, puisqu'elle avait été chrétienne avant tous les Français, qui ne l'étaient devenus que par le mariage de leur princesse Clotilde avec le fondateur de la monarchie française. Les fléaux que déchaîna le fanatisme sur tant d'autres provinces furent évités jusqu'à la déplorable organisation des ligues catholiques, et, grâce à l'intervention du digne président Jeannin, le plus grand nombre des villes de Bourgogne ne fut pas ensanglanté par les massacres de la Saint-Barthélemy. Cependant l'obstination de Mayenne prolongea jusqu'en 1595 les calamités de la guerre civile, à laquelle mit fin seulement la victoire remportée par Henri IV sur les Espagnols à Fontaine-Française. Le 6 juin de cette année, ce monarque fit son entrée à Dijon ; il assista à l'élection du maire, jura de respecter les privilèges de la ville, et se contenta de changer quelques magistrats municipaux et de faire fermer le collège des jésuites.
Les dernières épreuves que la Bourgogne eut à traverser furent, sous Louis XIII, une révolte des vignerons, qui se réunissaient au refrain, Lanturlu, d'une vieille chanson, ce qui fit désigner cette révolte, qui, d'ailleurs, fut bientôt apaisée, sous le nom de Révolte des Lanturlus. Puis vint l'invasion des Impériaux amenée par les révoltes de la noblesse contre Richelieu et le. siège mémorable de Saint-Jean-de-Losne, les agitations de la Fronde, auxquelles l'influence des Condé dans la province donna une certaine importance, mais auxquelles manqua, presque partout l'appui des populations.
Dans les époques plus récentes, la Bourgogne prit sa part de tous les événements heureux on funestes dont la France fut le théâtre. La Révolution de 1789 y fut accueillie comme' une ère réparatrice, qui devait faire disparaître les tristes abus financiers des derniers règnes, et assurer à chacun les libertés que l'on réclamait depuis longtemps. Les gardes nationales s'y organisèrent avec une rapidité merveilleuse, et, oubliant les vieilles rivalités qui les divisaient sous l'ancien régime, elles s'unirent à celles de la Franche-Comté et demandèrent à marcher ensemble les. premières contre l'ennemi.
Le département de la Côte-d'Or fournit donc un large contingent aux phalanges républicaines qui, après avoir refoulé l'ennemi, promenèrent le drapeau national dans toutes les capitales de l'Europe ; et lorsque, moins heureux, les soldats de Napoléon jar expièrent par les désastres de 1814 et 1815 les triomphes passés, nulle part ils ne trouvèrent un plus vaillant appui et de plus patriotiques sympathies que dans les populations de la Bourgogne. Depuis que les luttes de l'industrie et des arts ont remplacé dans la vie des peuples modernes les vicissitudes des champs de bataille, la Côte-d'Or, grâce au génie de ses habitants et aux richesses de son sol, a su conquérir une importance et une prospérité qui lui permettent de ne rien regretter des gloires et des grandeurs de l'ancienne Bourgogne.
Pendant la néfaste guerre de 1870-71, le département de la Côte-d'Or eut d'autant plus à souffrir de l'invasion allemande que Dijon fut successivement pris pour centre d'opérations et par les Français et par les Allemands. À la nouvelle que le passage des Vosges avait été forcé par l'ennemi et que la ligne de défense de Vesoul à Lure venait d'être abandonnée par le général Cambriels qui s'était retiré à Besançon, la résistance s'organisa à Dijon sous la direction du docteur Lavalle, membre du conseil général, tandis que Garibaldi, autorisé par le gouvernement de la défense nationale, formait un corps d'armée composé de quatre brigades dont il confiait le commandement à Bossack, Marie, Menotti et Ricciotti. Le général de Werder, commandant du 4e corps allemand, marchait sur Dijon et, le 27 octobre 1870, repoussait, à Talmay, les troupes françaises commandées par Lavalle, qui ne se composaient guère que de quelques bataillons de mobiles et de gardes nationaux.
Pendant ce temps, Garibaldi se portait sur la droite du côté de Poutailler pour essayer de rejoindre les troupes du général Cambriels. L'ennemi, ayant passé la Saône à Gray, se porta sur Dijon ; les troupes qui s'opposaient à sa marche furent repoussées à la bifurcation des routes de Gray à Dijon et à Auxonne. À la suite d'un nouveau combat livré à Saint-Apollinaire le 30 octobre, les Allemands entrèrent à Dijon. Garibaldi qui avait en vain essayé d'accourir à la défense de la ville, ce qu'il ne put faire, parce que le pont de Pontailler avait été rompu, voulut du moins protéger les autres grandes villes de la Côte-d'Or ; il fit occuper Saint-Jean-de-Losne et Seurre et lui-même revint à Dôle. Le 2 novembre l'ennemi, maître de Dijon, marchait sur Beaune et Chagny. Les troupes de Garibaldi gardèrent les rives de l'Oignon et de la Saône ; le 5 novembre, elles repoussèrent l'ennemi près de Saint-Jean-de-Losne.
A la suite de cet échec, les Allemands revinrent à Dijon pour s'y reformer et firent de cette ville le centre de leurs opérations dans l'Est. Ils reprirent bientôt l'offensive et repoussèrent d'abord, le 30 novembre, les troupes de Garibaldi ; mais le 3 décembre, celui-ci, appuyé parle général Cremer, les battit complètement à Arnay-le-Duc et à Bligny-sur-Ouche, les rejetant presque sous les murs de Dijon. Cette double victoire, qui empêchait l'ennemi de dépasser Chagny, sauva le reste du département et peut-être même Lyon. Le général de Werder revint une fois encore à Dijon pour reposer ses troupes et les reformer ; mais les événements avaient marché Au nord-est ; il dut envoyer ses troupes sous les murs de Belfort qui se défendait avec acharnement, et il ne laissa à Dijon que le général Glumer avec deux bataillons et à Semur une brigade badoise. Ces troupes furent ellesmêmes bientôt rappelées et, le 6 janvier 1871, Garibaldi rentrait à Dijon, y organisait de nouveau la défense ; il était temps, car une armée de 70 000 AIlemands s'avançait pour empêcher Bourbaki de se porter à la défense de Belfort.
Trois corps de cette armée furent successivement attaqués et battus dans les journées des 21, 22 et 23 janvier, par le général Pélissier et Garibaldi, d'abord à Fontaine et à Talant, puis à Plombières, à Daix, à Hauteville et au Val-de-Suzon. D'habiles dispositions permettaient d'espérer des succès plus décisifs lorsque, le 29 janvier, on apprit la capitulation de Paris et la notification de l'armistice. Par une fatalité encore mal expliquée, les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura n'étaient pas compris dans cet armistice ; l'armée de l'Est était refoulée vers la Suisse, la continuation de la lutte devenait impossible, il fallut se résigner à abandonner Dijon qui ne fut évacué par l'ennemi qu'après la signature des préliminaires de paix. Quant à Garibaldi, qui le 28 janvier était parvenu à réunir à Dijon près de 50 000 hommes et 90 canons, il avait agi si habilement et avec tant de promptitude qu'il put opérer sa retraite sans rien perdre de son matériel. L'invasion allemande avait coûté au département de la Côte-d'Or 14 464 427 fr. 29.