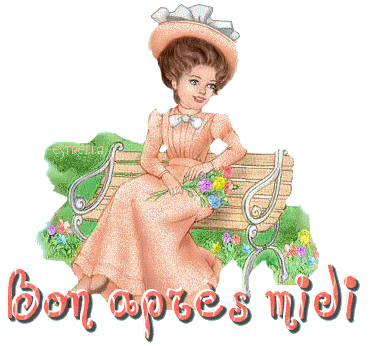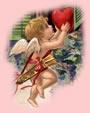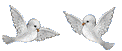animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
- · le symbolisme dans le roman la rose des vents
- · passage obligé minarik
- · les bienfaits et les mefaits des invertebres
- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman
- · valerie maurice est elle mariee
- · les bienfaits des invertebres
- · turfvoyance@yahoo.fr
- · gouran tchad
- · bamwisho muhiya jean
- · royauxnorvegiens
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Animaux - Oiseaux - La chouette des terriers
Elle apprécie les zones arides et les déserts.
Elle poursuit alors les petits mammifères ou les batraciens de rapides coups d’ailes ou, au sol, en courant sur leurs longues pattes.
L’entrée de l’abri est marquée par des débris de nourriture entassés. Dans cette « poubelle », on trouve des restes de lapins, de mulots et de rats.
Animaux - Oiseaux - L'Ibis sacré -
A cette époque, aucun roi, ni pharaon n’aurait accepté d’être enterré sans la présence à ses côtés de nombreuses momies du dieu-ibis.
C’est pourquoi on a retrouvé autant d’ibis sacrés momifiés dans les sépultures.
En revanche, cet oiseau est encore bien présent en Afrique et à Madagascar.
Il se nourrit de grenouilles, d’insectes, de larves, de serpents et de crustacés divers.
Charognard à l’occasion, il ne dédaigne pas un cadavre de petit mammifère ou de poisson mort.
Les ibis volent en cadence, planant, glissant et ondulant au rythme lent des battements de leurs larges ailes.
Le nid ressemble à une plate-forme plus ou moins volumineuse, constituée de branchages.
Les deux parents participent à sa construction et couvent à tour de rôle les 3 œufs environ de couleur blanc verdâtre pendant 23 à 25 jours.
Ils élèvent ensemble les petits pendant environ 7 semaines.
Phylum: Chordata
Classe: Aves
Ordre: Pelecaniformes
Famille: Threskiornithidae
Genre: Threskiornis
Espèce: Threskiornis aethiopicus
Vous etes 15 000...
à etre passés dans mon petit univers....
Les murs ne sont pas toujours au-dehors.
Dans tous les murs, il y a une lézarde,
dans toute lézarde, très vite, il y a un peu de terre,
dans cette terre la promesse d'un germe,
Dans ce germe fragile, il y a l'espoir d'une fleur
et dans cette fleur, la certitude ensoleillée d'un pétale de liberté.
Les murs les plus cachés sont souvent au-dedans
et dans ces murs aussi, il y a des lézardes...
laisse pousser les fleurs,
elles sont les germes de la vie à venir.
Jacques Salomé
(apprivoiser la tendresse)
Champignons - biologie -
Qu'est-ce qu'un champignon ?
Posée ainsi, la question peut paraître ridicule.
Il faut néanmoins savoir qu'il s'agit avant tout d'une moisissure avec tous les avantages et les inconvénients qui en découlent : mets délicieux, médicament, nettoyeur de milieu, parasite destructeur ou poison.
La planète recèlerait près d'un million et demi d'espèces ! Parmi celles-ci, il en en existe à peine quelques 5000 qui sont réellement répertoriées et beaucoup d'autres sont encore très peu connues : considérées dans le passé comme espèces comestibles, quelques-unes d'entre-elles se voient même passer dans la catégorie des toxiques. Comme quoi rien n'est jamais définitif, moins encore dans la connaissance de la nature qui nous réservera longtemps bien des surprises !
A l'instar des coquillages, le champignon accumule généralement les toxines du milieu où il vit. C'est pourquoi l'on signale ici et là des empoisonnements, heureusement souvent bénins, en des endroits où certains polluants ont été déversés, accidentellement ou non. L'exemple du nuage toxique de Tchernobyl en est l'illustration : l'Est et le Nord-Est de la France ont, près de 20 ans après l'accident, le triste privilège d'une teneur en radio-activité au-delà de la moyenne dans les champignons que l'on y récolte...quoique heureusement dans des limites très inférieures à celles d'autres pays plus proches du réacteur qui sont dans une situation réellement dramatique : le poison radio-actif y est nettement plus présent, parfois dans des proportions dangereuses !
Les métaux lourds, les engrais, pesticides et fongicides sont autant de matières absorbées et par conséquent transmises à ceux qui les dégustent !
C'est pourquoi il est déconseillé de ramasser des spécimens sur les bords de route (gaz d'échappement contenant du plomb), sur d'anciens dépotoirs ou terrains vagues, sur des sites industriels, dans des prés récemment traités.
Heureusement, dans un milieu sain, ce qui était auparavant considéré comme une plante, mais désormais classé dans une catégorie bien distincte, produit également des substances opposées : l'exemple de la pénicilline en est la preuve et grâce à cela, bien des vies sont régulièrement sauvées. Nombre d'antibiotiques ont été conçus grâce à ces moississures et certaines levures sont utilisées comme source de vitamines.

La fermentation est une des caractéristiques du champignon et l'industrie agro-alimentaire en bénéficie largement. L'élaboration du pain, des fromages, des yaourts, des boissons fermentées (vin, bière, etc.) en est tributaire.
Et l'on découvre encore aujourd'hui de nouvelles applications dans l'étude des champignons microscopiques largement étudiés en biotechnologie.
Biologie du champignon
Le champignon est un parfait éboueur, se nourrissant des matières organiques qu'il trouve dans le sol par l'intermédiaire du mycélium, produisant un humus dont bénéficie l'arbre sous lequel il se développe.
La spore est la base du champignon. Elle peut être considérée comme l'équivalent de la graine d'une plante.

Mycelium
Dans des conditions favorables, cette spore va germer et produire un filament microscopique qui va se développer. Généralement, celui-ci va rencontrer un autre filament émis par une autre spore, provoquant une sorte d'accouplement mais qui n'a rien de vraiment reproductif si ce n'est que se soudant l'un à l'autre, ils produiront un troisième filament. Celui-ci va se ramifier considérablement, formant une véritable toile formée de nombreux et fins autres filaments, près de la surface du sol, le même phénomène se produisant sous l'écorce des arbres morts. Il s'agit là du mycélium (dit secondaire) que l'on peut observer à l'automne en soulevant la couche des feuilles en décomposition.

mycelium
Blanche, cette toile ressemblant à un feutrage va, selon certaines conditions, atmosphériques, de milieu, de substances particulièrement favorables, etc, s'agglomérer pour former une sorte de petite pelote. C'est à partir de cette pelote que va se former progressivement notre champignon. Celui-ci va à son tour produire des spores, sous le chapeau. Ce dernier peut être constitué de lamelles, de plis, de tubes ou d'aiguillons. Cette partie reproductrice de spores s'appelle l'hyménium. Ceci étant valable pour les champignons à pied ; les autres produisent les mêmes spores à l'intérieur (comme les vesses) ou au fond de la coupe (pour les pézizes). Une fois émises, les spores vont germer et finir ainsi le cycle. D'une consistance très fine, elles sont presque invisibles à l'oeil nu. C'est en écrasant une vesse, par exemple, que l'on peut les observer : le fin nuage farineux qui s'en dégage est constitué d'un nombre considérable de celles-ci, plusieurs millions de "graines" mais rares sont celles qui permettront la reproduction de l'espèce. Heureusement d'ailleurs sinon nous en serions envahis !

Le champignon n'est, somme toute, que l'appareil reproducteur, d'une durée de vie très courte, d'un système très élaboré dont la partie essentielle est cachée dans le sol ou d'autres supports, tels que de vieilles souches, des végétaux en décomposition, du fumier, etc.
Son développement, pour arriver à l'érection tant convoitée, dépend d'une série de facteurs très divers : la chaleur, l'humidité, la lumière et, curieusement, pour les cèpes et bolets notamment, le choc thermique provoqué par une différence importante de température entre la nuit et le jour : une forme de stress ...
Cette érection marquera le départ d'une course frénétique entre les différents concurrents cherchant à s'approprier une nourriture qui, pour certains, telle cette limace des bois, constitue un mets de choix !

limace des bois
Les insectes, quant à eux, se réserveront le terrain non pas en mangeant le délicieux fruit mais en y pondant afin d'assurer la nourriture à leur progéniture ...
Si vous n'arrivez pas avant eux, ce sera trop tard pour vous : ils seront déjà à table ou auront littéralement squatté ce qu'ils considèrent comme leur garde-manger ...
Du début du développement hors sol jusqu'à la maturité (c'est-à-dire à l'état d'être récolté), il faut en moyenne 1 à 5 jours. Inutile de se précipiter dès leur éclosion : ils acquièrent l'essentiel de leurs qualités gustatives à l'état adulte. Avant cela, ils sont trop petits et difficilement reconnaissables pour certains ; après, ils abritent le plus souvent des larves d'insectes et deviennent impropres à la consommation.
Champignons - Lexique mycologique -
M à Z
******************
M
mamelonné: pourvu d'un mamelon (chapeau)
marcescent : qui se dessèche sans pourrir
marge : bord du chapeau, bord d'un bulbe quand celui-ci est net et forme un angle
marginé : limité par un bourrelet anguleux (pour un bulbe) ; arête bordée d'une autre couleur que celle des faces (pour une lame)
marginelle: extrême bord du chapeau
méchuleux: orné de petites mèches
membraneux : très mince et de consistance un peu papyracée
micacé: finement orné de particules plus ou moins brillantes ayant l'aspect du mica
mixte: tout à la fois ascendant et descendant (anneau)
moiré: chatoyant, présentant l'aspect de la moire
mordoré: de couleur rappelant celle de l'encre séchée
moucheté: finement orné de petites taches squamuliformes
muqueux : fortement visqueux
mycélium : partie végétative des champignons constituée de fins filaments
mycorhize : relation symbiotique entre un champignon et une plante autotrophe
myrorhizique : ayant rapport aux mycorhizes, contractant des mycorhizes
N
napiforme: en forme de tubercule de navet (volve et bulbe)
neutrophile: appréciant les endroits neutres (par rapport au pH du substrat)
nitrophile: appréciant les endroits riches en matière azotée
O
obèse : très fortement ventru (pied)
obtus : à extrémité arrondie (pour le chapeau, le mamelon)
ombiliqué: présentant une dépression assez nettement délimitée et assez étroite (chapeau)
ondulé: formant des ondulations (marge)
orbiculaire : bien rond et régulier (chapeau)
ovoïde : en forme d'œuf (chapeau)
P
papillé : orné de petites aspérités dures
papyracé: de consistance rappelant le papier
parasite : qui vit aux dépens d'un organisme vivant, en lui portant préjudice
pectiné : assez profondément sillonné
pélargonié: évoquant les feuilles de pelargonium zonale (géranium)
pelucheux : orné de peluches
pentu: descendant du bord du chapeau vers le pied en ligne droite (pour une lame)
péristome: excroissance conique s'ouvrant pour laisser échapper les spores (géastres)
persistant : ne disparaissant pas avec l'âge (anneau, cortine, etc)
pétaloïde: en forme de pétale, plus ou moins spatulé
phalloïde: en forme de phallus
piléé: pourvue d'un chapeau
piriforme: en forme de poire
pliciforme : en forme de pli
polymorphe : d'aspect variable
pore: extrémité des tubes chez les bolets et polypores, les ouvrant à l'air libre
poré : muni d'un pore (spore) ou de pores (hyménophore)
précoce: se développant tôt en saison
primordium: désigne le sporophore au moment où il commence à sortir du substrat
pruine: fine poussière plus ou moins farineuse, mêlée de minuscules gouttelettes de rosée
pruineux: couvert de pruine
pseudocollarié : lames libres et dont l'arête rejoint le chapeau à une certaine distance du pied, laissant un espace circulaire autour de celui-ci
pubescent : très finement et courtement poilu
pulvérulent: comme couvert de poussière
pulviné: en forme de coussin
purpurin: de couleur pourpre
R
raboteux: couvert de mèches grossières lui donnant un aspect rugueux
radicant: plus ou moins profondément enfoncé dans le substrat par une sorte de racine
raphanoïde: odeur rappelant celle du radis
rayé: orné de rayures nettes (pied)
récurvé : retroussé (marge, anneau)
réfléchi : récurvé (marge)
réseau: ensemble de lignes entrecroisées formant un maillage en surface (pied)
résupiné: attaché par le dessus du chapeau ou entièrement appliqué sur le support
réticulé: muni d'un réticule (chapeau, pied, spore)
retroussé : réfléchi, récurvé (marge)
reviviscent: retrouvant sa forme initiale en présence d'eau, après dessiccation
révoluté : se dit d'une marge enroulée à l'envers
rhizine : organe de fixation des thalles foliacés, simple ou ramifiée, formée d'un faisceau d'hyphes ± soudées et recouvertes d'une gaine mucilagineuse facilitant l'adhésion au substrat
rhizoïde : petit filament mycélien situé à la base de certains sporophores
rhizomorphe : agglomération de filaments mycéliens imitant des racines
ridé : orné de rides
ridulé: finement ridé
rimeux : orné de fines fibrilles radiales en surface (chapeau)
rivuleux: garni de craquelures irrégulières (chapeau)
rond de sorcières : développement de champignons créant une forme circulaire
rudéral: chemin, allée, zone de décombres, terrain vague, endroit riche en matières azotées par l'action humaine
rugueux : à surface irrégulière et assez rêche au toucher
ruguleux : finement rugueux
S
sablé: grossièrement parsemé de furfurations assez épaisses
sanie : liquide mou ou matière visqueuse exsudée
satiné: soyeux à brillant
scabre: rugueux
sciaphile: se développant dans les endroits sombres
scrobicule: fossette
scrobiculé: orné de scrobicules
serrulé: en dents de scie (lames)
sessile: greffé directement sur le support, sans pied
silicicole : appréciant les endroits siliceux
sillonné : parcouru de fins sillons
sinueux: ondulé, sinué
soralies: ensemble de sorédies
sorédies: granules élaborés par le thalle lichénique, constitués d'hyphes fongiques et d'algues généralement non concolores au thalle permettant la reproduction végétative des lichens en disséminant les deux partenaires de la symbiose
soyeux : présentant l'aspect de la soie, brillant, orné de très fines fibrilles serrées (chapeau)
spatulé: en forme de spatule (chapeau)
sphagnicole : se développant parmi les sphaignes
sphaigne : mousse particulière des tourbières acides
spongieux: ayant la consistance d'une éponge et souvent la propriété de retenir une certaine quantité d'eau
spore: élément reproducteur des champignons, équivalent de la graine pour les végétaux
sporée: dessin obtenu par sporulation et constitué de millions de spores
sporophore: appareil portant les cellules reproductrices des champignons et sur lequel sont produites les spores
squame: excoriation de la chair superficielle, en forme d'écaille volumineuse
squameux: orné de squames
squamule: petite squame
squamuleux : orné de squamules
squarreux: à squames fortement retroussées
stercoral: ayant rapport aux excréments
stipité : muni d'un pied
strié: orné de stries, généralement sans relief par opposition aux rides
strigueux : orné de poils raides
striolé : légèrement strié
sub- : préfixe signifiant "presque" ou "faiblement"
substrat : servant de support au champignon : terre, fumier, bois, humus, sable, etc
supère : descendant (pour un anneau) ; tourné vers le haut (pour l'hyménium)
sylvatique : se développant dans les forêts
T
tardif: qui se développe tard en saison
terricole: se développant sur la terre
tesselé: craquelures formant un dessin tel une mosaïque ou un vernis fissuré
thalle : appareil végétatif des végétaux inférieurs, où l'on ne peut distinguer ni racine, ni tige, ni feuilles
thermophile: appréciant les endroits chauds
tigrure: dessin rappelant celui de la fourrure des tigres
tomenteux: orné de poils très fins plus courts que sous l'adjectif "velouté"
tourbière : zone dans laquelle la décomposition des végétaux produit la tourbe
translucide: laissant passer la lumière mais sans être transparente
trichoïde : filaments mycéliens formant une touffe à la base du pied
tronconique : en forme de tronc de cône (chapeau)
tube: élément de l'hyménophore des bolets et des polypores
tuberculeux : orné de tubercules
tubuleux: muni de tubes
turbiné : en forme de toupie
U
ubiquiste : poussant dans des endroits très variés, sur le plan géographique ou écologique
umboné : pourvu d'un mamelon (chapeau)
unciné : possédant une dent de décurrence (lame)
V
vallécule : cavité circulaire ceinturant le sommet du pied et le séparant de l'hyménophore ou du chapeau
vélaire: relatif au voile
velouté : ayant l'aspect du velours
ventru: renflé (pour le pied) ; fortement convexe (pour l'arête d'une lame)
vergeté : présentant des vergetures plus sombres que le fond (chapeau)
vergeture : sorte de strie large ou à relief très faible
vernal : qui se développe au printemps
vernissé: donnant l'apparence d'être recouvert de vernis
verruqueux: orné de petites verrues (chapeau)
versicolore : de plusieurs couleurs ou de couleur variable selon les individus
villeux: courtement et densément poilu
vireuse: odeur nauséeuse, fétide ou rappelant celle des sclérodermes
viscidule: légèrement visqueux
visqueux: fortement lubrifié, glissant entre les doigts
voile général : enveloppe englobant l'ensemble d'un champignon au premier stade de développement
voile partiel : structure réunissant la marge et le pied et protégeant l’hyménophore juvénile, laissant souvent un anneau ou une cortine
volve : manifestation du voile quand celui-ci est membraneux (base du pied)
volviforme: en forme de volve
Z
zébré : pourvu de zébrures de deux couleurs
zoné: présentant des zones distinctes (souvent concentriques) de couleurs et/ou de relief (chapeau)
Champignons - Lexique mycologique -
A à L
*****************
A
acicole: qui se développe sur ou parmi les aiguilles de conifères
acidophile : appréciant les stations acides
âcre: brûlant, piquant, de saveur irritante
âcrescent : devenant âcre à la longue
aculéolé: hérissé de petits aiguillons
acuminé: terminé par une pointe effilée
adnée: fixée à angle droit sur le pied (lame)
adnexé : légèrement adné
aigu : fin (marge)
aiguillon: élément composant l'hyménophore des champignons hydnoïdes
alnicole : qui se développe sur ou au voisinage des aulnes
alutacé: de couleur fauve ochracé pâle
alvéolé: pourvu d'alvéoles creuses (pied)
amarescent: légèrement amer ou devenant amer à la longue
amer: d'un goût âpre et désagréable, développant de l'amertume
anastomosé : jointif, souvent de manière irrégulière (lame)
anneau : reste du voile partiel subsistant sur le pied sous forme de membrane
annelé : pourvu d'un anneau
annulaire : en anneau
annuliforme: en forme d'anneau
apothécie : fructification des ascolichens, le plus souvent en forme de coupe arrondie, contenant entre autres, l'hyménium au niveau duquel sont élaborées les ascospores
apical : relatif à l'apex, c'est-à-dire au sommet
appendiculé : muni de restes de voile accrochés et pendants (marge)
apprimé: fortement appliqué sur le support
aqueux : fragile, imbu
arachnéen: élément constitué de fils ténus entrecroisés comme une toile d'araignée (voile)
aréolé : orné de zones marquées de fines craquelures en surface (diminutif de tesselé) (chapeau)
arête : extrémité libre des lames
armille: voile partiel particulier formant une sorte de chaussette remontant sur le pied
armilliforme: en forme d'armille
arqué : courbé (pied) ; concave (lame ou arête de lame : partie axiale descendant vers le bas du pied)
ascendant : remontant (anneau)
atténué: affiné vers la base (pied)
aulnaie: zone dominée par les aulnes
B
bai : brun rougeâtre à brun chaud
baveux: fortement visqueux, à mucus très abondant
bétulaie: zone dominée par le bouleau
bétulicole : se développant sur ou près des bouleaux
bioluminescent: présentant spontanément une luminescence à l'obscurité
biotope: zone réunissant un certain nombre de caractères ecologiques particuliers
bombé : convexe, à large mamelon (pour le chapeau), ventru (pour une lame)
bosselé : présentant de petites bosses irrégulières (chapeau)
bulbe : renflement plus ou moins nettement délimité, situé à la base du pied
bulbeux : pourvu d'un bulbe
C
cabossé: présentant de petites bosses irrégulières (chapeau)
calciphile : qui apprécie les sols calcaires
campanulé : en forme de fleur de campanule ou de cloche (chapeau)
cannelé: orné de cannelures (de côtes, de saillies radiales sur un chapeau)
cantharelloïde : à silhouette évoquant la chanterelle
carné : de couleur chair
carpophore: chapeau du champignon
cartilagineux : assez ferme et flexible, comme du cartilage
caverneux: présentant des zones vides sans matière, visibles en coupe (pied)
cédricole : se développant sur ou près des cèdres
céracé: d'un aspect et d'un toucher semblables à de la cire
cespiteux: en touffe assez dense
chagriné : finement et irrégulièrement crispé ou ruguleux
charmaie(ou charmille) : zone dominée par les charmes charnu : dont la chair est épaisse
chênaie : zone plantée de chênes
chiné : orné de chinures, dessins colorés en zigzag sur fond de couleur différente
cilié : pourvu de cils, de poils (marge) cinabre : rouge légèrement orangé
circoncise: pour une volve, présentant un bourrelet net, à angle droit
cireux: ayant la consistance, le toucher ou l'aspect de la cire
clavé: s'épaississant vers la base, en forme de massue (pied)
collarié : présentant un collarium (lame)
collarium: formation membraneuse verticale et circulaire séparée du pied et sur laquelle les lames sont soudées
complexe: formé de plusieurs éléments superposés (anneau)
comprimé: aplati
concave: creux (chapeau)
concolore: de même couleur concrescents : se dit de champignons connés
confluent : se dirigeant vers un même point (lames, pieds, etc.)
conique: en forme de cône (chapeau)
connés : réunion de quelques individus avec une base soudée commune
convexe : de forme bombée (chapeau, lame)
coprophile : se développant sur ou à proximité des excréments
cordon mycélien : agglomérat d'hyphes mycéliennes visible macroscopiquement
corné : ayant la consistance, l'aspect de la corne
cortex: zone la plus externe d'un élément, généralement cylindrique
cortex(lichénique) : enchevêtrement d’hyphes fongiques, plus ou moins serrées, limitant les parties supérieure (cortex supérieur) et inférieure (cortex inférieur) du thalle
cortical : ayant rapport au cortex, c'est-à-dire à la zone la plus externe
cortine : restants de voile filamenteux formant souvent une fausse zone annulaire
cortiniforme: en forme de cortine
cortiqué: pourvu d'un cortex
costé: orné de côtes, de saillies plus marquées que des rides costulé : faiblement costé
coulissant: peu ou pas fixé sur le pied (anneau)
coumarinique: rappelant l’odeur de la coumarine, de la flouve odorante proche de celle du foin
cratériforme: en forme de coupe (chapeau)
crénelé : muni de créneaux ou de dents peu aiguës (lame)
creusé : concave, sans être infundibuliforme (chapeau)
crispé : à surface finement contractée
crustacé : forme une croûte fortement adhérente au substrat dans lequel pénètrent les hyphes de la médulle (thalle)
cuticule: peau recouvrant le chapeau des champignons
cyathiforme : en forme de coupe
cylindriforme : à peu près cylindrique
D
décurrent : fixé largement et bas sur le pied en formant un arc (lame)
déliquescent: qui fond en quelque sorte, se transformant en liquide
denticulé: présentant de petites dents (lame)
déprimé : plus ou moins creux (chapeau) descendant : descendant (pour un anneau), pentu ou arqué décurrent (pour une lame)
détersile: qui s'enlève en essuyant
détersion : action entraînant l'élimination des éléments peu adhérents ou une modification des couleurs
dichotomique : qui se divise en deux
diffracté : divisé, excorié
dimidié : à moitié développé, presque en demi cercle (chapeau)
discoïde: en forme de disque
disque : centre du chapeau duveteux : couvert de poils courts et très fins
E
écaille: ornementation constituée par la chair superficielle se déchirant et se redressant
écailleux : pourvu d'écailles
échancré : fixé sur le pied par une partie retrécie (lames, tubes, plis, aiguillons)
émarginé: échancré (lames, tubes, plis, aiguillons)
enroulée : fortement incurvé et formant presque une volute (marge)
évanescent : fugace (anneau, voile, etc.)
excédent: dépassant du support (cuticule par rapport au chapeau)
excentré : dont le point d'insertion n'est pas au centre du chapeau (pied)
excorié : écorché, rompu en squames, écailles, etc
exsudant : suintant des gouttelettes liquides
F
fagicole: se développant sur ou avec les hêtres
falciforme : arqué
farci : dont la partie centrale est constituée d'une moelle de structure plus molle que le cortex (pied)
farineux: comme saupoudré de farine, proche de pruineux
fasciculé : assemblé en faisceau
fastigié : dissocié radialement (chapeau)
festonné : présentant des ondulations assez serrées (marge)
feutré: densément fibrilleux, donnant l'aspect du feutre
fibreux : constitué de fibres et de consistance fibreuse (chapeau, pied, chair)
fibrilleux: couvert de fibrilles
filiforme : en forme de fil, très fin (pied)
fimbrié : découpé d'une manière fine et irrégulière, effiloché (chapeau)
fimicole : se développant sur le fumier ou les endroits fumés
fissuré: déchiré, le plus souvent radialement à partir de la marge (chapeau)
fistuleux: entièrement creux (pied)
flexueux: sinueux (marge, pied)
flocon: reste de voile général paraissant une écaille très légère, très labile
floconneux: garni de flocons généralement labiles (chapeau, pied)
foliacé : aplati en forme de feuille (chapeau)
foliacé(lichen) : thalle formé de lames ± lobées, facilement détachables du substrat auquel il est parfois fixé par des rhizines - les thalles foliacés possèdent un cortex supérieur et un cortex inférieur (thalle)
fongique : qui se rapporte aux champignons ; typiquement : parfum du champignon de Paris
fourchue: se divisant en deux ou plusieurs sections (lame)
fourré : zone dominée par des arbustes
frênaie: zone plantée de frênes
friable : se cassant, s'effritant facilement
frisé: fortement et densément crispé fruticuleux : thalle ± ramifié, ± buissonnant, non appliqué sur le substrat auquel il n'adhère que par une surface très réduite (thalle)
fugace: disparaissant rapidement (anneau, voile, cortine, pruine, etc)
fuligineux : cendré, couleur de suie, gris sombre à gris bistré
furfuracé : grossièrement pruineux-verruqueux (chapeau)
fusiforme : en forme de fuseau, atténué aux deux extrémités (pied)
G
gélatineux: mou comme de la gélatine
gélifié: dont la zone externe est couverte d'une substance visqueuse
glabre : dépourvu de toute pilosité
glauque : d'un vert bleuâtre ou seulement lavé de cette teinte
gléba: masse fertile contenue dans le péridium (surtout chez les gastéromycètes)
glutineux: recouvert d'une substance plus ou moins collante
gracile : élancé, fluet
graminicole : se développant parmi les herbes, les graminées
granuleux : présentant un aspect grenu, comme s'il était couvert de grosses poussières
grégaire: se développant en groupe
grenu: granuleux (pour un revêtement) ; se cassant net, comme un bâton de craie (pour la chair)
grumeleux: comme couvert de grumeaux
guttulé : marqué de petites taches arrondies, d'une autre couleur que le fond
H
héliophile: se développant dans les endroits ensoleillés (contraire : sciaphile)
hémicirculaire : en demi-cercle.
hêtraie : zone plantée de hêtres
hirsute: présentant des poils souvent raides et désordonnés
hivernal: qui vient à maturité durant l'hiver
humus: couche du sol enrichie en matière organique
hyalin : ayant plus ou moins l'aspect du verre, presque transparent
hydnoïde : formé de petits aiguillons
hygrophane : changeant de couleur par dessiccation
hygrophile: appréciant les endroits humides
hyménial : ayant rapport à l'hyménium
hyménien : ayant rapport à l'hyménium
hyménium: alignement de cellules fertiles, couche mono-cellulaire
hyménophore : partie fertile constituée des lames, tubes, aiguillons
hyphe: cellule fongique
hypogé: venant à maturité sous la surface du sol
I
imbu: gorgé d'eau
incisé : présentant des incisions, des coupures étroites
incurvée : descendant vers le bas (marge)
infère: ascendant (pour un anneau) ; tourné vers le bas (pour l'hyménium)
infléchi : incurvé
infundibuliforme : en forme d'entonnoir (chapeau)
inné : dessiné sur l'élément concerné, mais sans relief
interveiné Ecrire un commentaire J'aime10
Champignons - Anatomie et description -
La grande famille des champignons comporte des espèces aux formes les plus diverses parmi lesquelles se distingue la plus commune et la plus connue : un pied surmonté d'un chapeau (carpophore) généralement convexe.

coupe d'un champignon
Ce champignon typique comporte toutefois une très grande série de variantes. Afin de permettre une première approche visuelle qui pourra souvent amener à la détermination d'une espèce, les mycologues utilisent un certain nombre d'adjectifs généralement peu usités par le commun des mortels.
Certains de ceux-ci sont même ignorés des dictionnaires, ce qui pose parfois problème ...
Ces termes reviennent bien souvent dans la littérature mycologique.
Champignons - La mycologie -
Histoire de la mycologie
Au premier siècle de l'ère dite chrétienne, Pline l'Ancien sera le premier a aborder explicitement, quoique très succinctement, les premières notions d'une étude du règne fongique.
Il évoque notamment la confusion possible entre le bolet et d'autres champignons susceptibles d'être vénéneux. Est-ce ce début de connaissance de la toxicité de certaines espèces qui mènera au premier empoisonnement volontaire de l'histoire au moyen d'un champignon ? Le plat d'amanites des Césars (qui ne s'appelait pas ainsi à l'époque, évidemment ...) qui empoisonna l'empereur Claude en l'an 54 contenait-il d'autres espèces ?
Le souverain, particulièrement friand d'oronges, fut peut-être emporté non par un banal poison dont les conspirateurs de tous bords avaient le secret mais par quelques amanites phalloïdes incorporées dans son plat préféré par sa "chère et tendre" épouse Agrippine.

Voilà un mystère qui n'aura jamais été percé ...
Théophraste, disciple d'Aristote fera une première classification sommaire au 4ème siècle et marquera ainsi le départ d'un intérêt croissant pour l'étude de ce règne végétal dont très peu d'espèces sont alors connues.
La croyance populaire sera sans doute longtemps un frein à l'étude du règne mycologique : le champignon fut longtemps soupçonné d'être l'instrument de maléfices et paré de vertus démoniaques. Ce n'est qu'à partir du 16ème siècle que la diffusion des premiers documents imprimés provoquera un regain de curiosité et un partage des connaissances pour cette branche très peu connue de la botanique. A la fin de ce siècle paraît une première tentative de classification, en latin, sous la plume du français Charles de l'Ecluse : "Fungorum in Pannonis observatorum brevis Historia". Elle sera un premier ouvrage de référence décrivant 105 espèces illustrées par 86 planches. Deux autres auteurs publieront à la même époque leurs propres travaux, donnant ainsi une impulsion à un début de taxonomie d'une matière jusqu'alors fort peu connue. Les français Bauhin feront éditer leurs observations et le belge François van Sterbeeck se servira, notamment, de cette matière pour développer une nouvelle référence en matière de classification. Ce prêtre flamand précisera ainsi, dans un ouvrage écrit dans sa langue natale, les caractères spécifiques des espèces qu'il observera sur le terrain, dessinant et décrivant en détail les particularités de celles-ci. Tournefort décrit à son tour 160 espèces réparties en 7 genres dans son essai "Eléments de botanique" et évoque pour la première fois la culture d'une espèce dont la réputation d'excellence gastronomique fera le tour du monde : le champignon de Paris.

Le microscope, inventé au 18ème siècle, marquant le début d'une systémique plus précise, s'appuyant notamment sur l'observation des spores, ainsi que les centaines de planches patiemment dessinées par le français Bulliard aboutiront, enfin, aux prémices de la mycologie moderne. Le hollandais Persoon en sera l'instigateur et Fries en deviendra le père. Ce chercheur universitaire suédois publiera, au 19ème siècle, une série d'ouvrages décrivant déjà 2770 espèces de champignons et entraînera dans son sillage de nouvelles vocations qui s'illustreront dans la "découverte" de nouvelles espèces mais surtout dans leur classification ... presque définitive. C'est ainsi que bon nombre de celles-ci portent leurs noms : Becker, Bon, Bresadola, Galzin, Josserand, Heim, Konrad, Kühner, Lange, Maire, Patouillard, Quélet, Ricken, Romagnesi, Singer, etc. Les mycologues contemporains ne sont pas en reste, l'intérêt pour le développement de cette recherche ayant littéralement explosé dès la deuxième moitié du 20ème siècle.

Aujourd'hui, l'évolution de cette science et la classification du règne fongique est l'aboutissement d'un travail collectif dont les informations proviennent des quatre coins du globe. Elle est tout d'abord basée sur l'observation en milieu naturel par les mycologues avertis ... mais parfois aussi par de simples observateurs attentifs du règne fongique, les mycophiles. Ceux-ci font état de leurs découvertes en publiant, souvent modestement au sein de cercles mycologiques, les descriptions précises de "leur" specimen. Ces publications, faisant suite à un examen attentif sur le terrain puis à une recherche plus approfondie en atelier, sont ensuite transcrites sur des "fiches de détermination". Elles aboutiront, peut-être, à une autre publication, officielle celle-ci, d'un nouveau genre voire d'une nouvelle espèce qui comportera alors le suffixe de son "inventeur". Cette décision dépendra des mycologues professionnels régulièrement réunis en congrès afin de mettre à jour une nomenclature qui, pour longtemps encore, se verra enrichir de nouveaux noms et peut-être de nouvelles familles tant le règne fongique est riche ... et encore peu connu.
bonjour,bonne journée à tous
Que les jours aient des matins froids
Les nuits des attentes grimées,
Que soit la vie futile proie,
Il est toujours temps de s'aimer;
Au bout des routes sans voyage
Ou des chemins inanimés,
A l'aube, aux confins de tout âge
Il est toujours temps de s'aimer;
Qu'importe la désinvolture,
Les mots inertes et gommés,
Les gestes faux, les cris, les murs
Il est toujours temps de s'aimer;
Par dessus l'or de l'illusion,
Par de là le coeur abîmé,
S'il n'est de mot aux impressions
Il est toujours temps de s'aimer;
Et même lorsque, par mégarde,
L'on aurait mis son coeur au clou,
il serait quelqu'un qui s'attarde
Puisque à l'aimer... l'on a le goût.
Alain Girard
Bonne soirée à tous....
Ecrire...
C’est prendre le temps de faire partager
Un bonheur présent.
Ecrire...
Efface les distances et témoigne
De la valeur et de la vérité
De vos sentiments.
Ecrire...
C’est faire voyager vos joies
Et votre bien-être.
Ecrire...
Vos vacances
C’est penser à en faire profiter
Ceux que vous aimez...
Ecrire...
C’est faire des heureux !