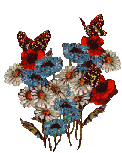animaux années 50 antiquité arbres archeologie astrologie astronomie au jardin boissons bonbons bonjour bonsoir
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Animaux - Oiseaux - (58)
· Mythologie Greco-romaine- (74)
· La(les)mode(s) - (17)
· Années 50 - (37)
· Arbres et arbustes (22)
· Préhistoire - (25)
· Bonjour + texte (589)
· Au Jardin - (27)
· Parcs , réserves naturelles, zoos... (49)
· Cadeaux de mes ami(e)s - (582)
- · le symbolisme dans le roman la rose des vents
- · passage obligé minarik
- · les bienfaits et les mefaits des invertebres
- · le symbolisme de la rose des vents dans le roman
- · valerie maurice est elle mariee
- · les bienfaits des invertebres
- · turfvoyance@yahoo.fr
- · gouran tchad
- · bamwisho muhiya jean
- · royauxnorvegiens
Date de création : 27.11.2008
Dernière mise à jour :
08.02.2013
5848 articles
Souverains Français - Capetiens -Louis VII le Jeune-
Louis VII le Jeune (1120 - 1180)
Louis VII succède à 17 ans environ à son père Louis VI le Gros le 1er août 1137, quelques jours après avoir épousé à Bordeaux la duchesse Aliénor d'Aquitaine. Celle-ci, qui a son âge, lui apporte en dot la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Périgord, le Limousin...
Les frontières du royaume capétien sont désormais repoussées jusqu'aux Pyrénées. En théorie seulement car, par son impéritie, le roi va compromettre ce cadeau du ciel et provoquer un conflit avec l'Angleterre qui perdurera pendant sept siècles !
Un roi triste
Le roi Louis VII le Jeune doit son surnom à ce qu'il est le fils cadet de Louis VI le Gros.
Il a été élevé à l'abbaye de Saint-Denis car il n'était pas destiné à régner avant que ne meure le 13 octobre 1131 son frère Philippe d'une chute de cheval provoquée par la divagation de porcs dans les rues de Paris (les porcs allaient être interdits de divagation suite à cet accident).
De son éducation, Louis a gardé l'empreinte monastique et peu de goût pour les armes. Pas de quoi enflammer le coeur d'Aliénor d'Aquitaine, sa jeune épouse.
Querelles en tous genres
Dans les premières années du règne, les maladresses du roi sont en partie contenues par l'abbé de Saint-Denis, Suger, qui fut le fidèle conseiller de son père et arrangea le mariage avec la duchesse d'Aquitaine.
Mais très vite surviennent les ennuis. En 1140, le roi s'implique dans un conflit lourd de conséquences qui oppose les petits-enfants de Guillaume le Conquérant, l'un et l'autre prétendant au trône d'Angleterre : Mathilde et Étienne de Blois. Louis VII prend le parti de Mathilde en échange du Vexin, aux limites de la Normandie et de l'Île-de-France et de la place forte de Gisors. Étienne de Blois débarquant en Normandie pour faire valoir ses droits, le roi lâche Mathilde et traite avec lui en se faisant confirmer la possession du Vexin ! Le conflit ne trouvera pas de conclusion avant la disparition des deux prétendants...
La même année, Louis VII se dispute avec l'influent abbé Bernard de Clairvaux en contestant l'élection de l'évêque de Poitiers. Dans le même temps, le roi se brouille avec son principal vassal, le comte Thibaut de Champagne pour une sombre histoire d'adultère entre la jeune soeur de la reine Aliénor et le mari de la nièce du comte !...
Affaire de coeur
Tout commence avec une histoire d'amour et de passion comme l'époque en connaît beaucoup ! Celle-ci concerne la jeune soeur de la reine, Alix ou Aelith (15 ans). Elle s'éprend du comte Raoul de Vermandois (30 ans), cousin du roi, et son sentiment est partagé. Il n'y a qu'un problème, c'est que Raoul est déjà marié. Qu'à cela ne tienne, Aliénor elle-même vient au secours des tourtereaux et convainc son mari de réunir un concile national pour faire annuler le mariage au motif de «consanguinité» (Raoul et Aelith sont cousins à un énième degré).
L'épouse répudiée, Gerberte, se réfugie auprès de son oncle, qui n'est autre que le puissant comte Thibaut II de Champagne, lequel demande au pape Innocent II d'annuler la décision du concile et le remariage de Raoul avec Aelith. Le pape donne raison à Thibaut.
Embarrassé, Louis VII en veut à Aliénor de l'avoir mis dans le pétrin mais son conseiller, le vieil abbé Suger, le convainc qu'il ne peut reculer, ce qui reviendrait à reconnaître la suprématie du pape sur un concile national... On peut être pieux et bon chrétien, on n'en est pas moins soucieux des intérêts nationaux ; c'est la laïcité avant la lettre !
Louis VII, jugeant Thibaut II responsable de tous ses malheurs, envahit ses terres. Le comte entame des négociations mais l'affaire s'embrouille car, dans le même temps, le roi tente d'imposer son chancelier Cadurc à l'archevêché de Bourges contre Pierre de la Châtre, élu par les prêtres du diocèse. Pierre de la Châtre se réfugie chez Thibaut de Champagne cependant que le pape Innocent II jette l'interdit sur le royaume !
Oradour médiéval
Louis VII reprend la guerre... Ses «bannières» (on appelle ainsi les troupes regroupées autour de la bannière d'un vassal) arrivent devant la petite ville de Vitry-en-Perthois, sur la Marne. Le roi, déstabilisé, cède aux extrémistes de son entourage qui réclament une punition exemplaire. La ville est assaillie et sa population aussitôt pourchassée par la soldatesque ivre de sang, de sexe et d'or. Un millier de personnes, peut-être davantage, croient trouver asile dans l'église. Que faire ? Qu'on y mette le feu ! suggère un proche du roi. Celui-ci, le regard vide, au milieu du carnage, ne dit mot. L'église est incendiée avec tous ses réfugiés. Oradour médiéval, Vitry sera désormais rebaptisée Vitry-le-Brûlé (aujourd'hui Vitry-le-François).
Retrouvant ses sens, le roi, pétri de remords, renonce à poursuivre la guerre et, reprenant la route de Paris, fait mander l'abbé de Clairvaux pour se confesser à lui et prendre conseil.
Une croisade pour pénitence
En route pour le camp royal, quelque part en Champagne, le saint abbé de Clairvaux, dont l'aura est immense dans la chrétienté occidentale, est gagné par une intuition ! Il vient d'apprendre que les Francs des États latins de Palestine ont subi un sérieux revers près d'Édesse de la part d'un chef sarrazin nommé Nour el-Dîn.
Depuis la première croisade, un demi-siècle plus tôt, les Francs établis en Palestine n'avaient cessé de recevoir des renforts d'Occident : petites troupes ou chevaliers isolés qui venaient gagner leur salut en combattant les infidèles. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, ils réclament un surcroît de renforts. Raymond de Poitiers, prince d'Antioche et frère cadet de Guillaume X d'Aquitaine, a même écrit à sa nièce, la reine Aliénor, dans ce sens-là.
Bernard de Clairvaux songe à tout cela et l'idée lui vient de proclamer une nouvelle croisade comme le pape Urbain II, en 1095, avec cette fois-ci la participation des souverains et du plus puissant d'entre eux : le roi capétien. Il fait part de son projet à Louis VII qui l'accepte d'emblée, en dépit de l'opposition de l'abbé Suger. Fin politique, tout le contraire de Saint Bernard, Suger craint que le royaume ne souffre de l'absence prolongée du souverain et doute au demeurant de l'intérêt des équipées en Terre sainte. Mais le roi, cette fois-ci, ne l'écoute pas.
À la demande de Bernard, il convoque toute la noblesse de France à Vézelay pour le jour de Pâques 1146. Sur le parvis de l'église, au sommet de la prestigieuse colline, Bernard prononce une vigoureuse allocution puis fixe une croix de drap rouge sur la poitrine du roi. La reine Aliénor se croise également et après elle, dans l'enthousiasme, les grands seigneurs du royaume, y compris le comte de Toulouse Alphonse Jourdain, deuxième fils de Raymond IV, héros de la première croisade, et Thibaut II de Champagne, ancien adversaire du roi.
La préparation de l'expédition prend du temps. Enfin, à la Pentecôte 1147, l'armée royale s'achemine vers Metz. Elle est rejointe à Worms par les Anglais. Au total plusieurs milliers de combattants et leurs suites. Français et Anglais s'engagent sur les traces de l'armée allemande, conduite par l'empereur Conrad III. Au pied des murailles de Constantinople, les croisés apprennent avec déception que le basileus (l'empereur byzantin), sur le concours duquel ils comptaient, vient de conclure une paix de douze ans avec les Turcs !
Le basileus les reçoit avec courtoisie mais s'empresse de les faire passer sur la rive asiatique du Bosphore. Bon débarras.
Nouvelle déconvenue : les Francs apprennent que les Allemands, qui avaient coupé au plus court à travers les montagnes d'Asie mineure, ont été assaillis et en bonne partie massacrés par les Turcs. L'empereur et les débris de son armée rejoignent les Francs à Nicée et les croisés, dès lors réunis, suivent avec prudence la côte. Le voyage est long et éprouvant : soif, faim, typhus et embuscades déciment les croisés. Finalement, après avoir été battus par les Turcs à Pisidie le 8 janvier 1148, ils trouvent à s'embarquer et gagnent par mer la citadelle d'Antioche, à l'embouchure de l'Oronte, en Syrie, où ils sont accueillis le 19 mars 1148 par Raymond de Poitiers.
Fiasco de la croisade
Louis VII et Conrad III tentent de façon brouillonne d'enlever Damas, mais le siège est un échec. Dépité, l'empereur abandonne la partie. Le roi s'en va faire ses dévotions à Jérusalem, puis reprend la mer pour la France au grand dépit des Francs de Terre sainte, qui ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour contenir la poussée turque.
À Paris, Louis VII retrouve Suger et Raoul de Vermandois auxquels il avait confié la garde du royaume. Ces conseillers vont mourir dans les mois suivants, privant le roi de leurs sages avis et Aliénor de leur amical soutien à un moment crucial de leur union.
Fiasco conjugal
Malgré la naissance d'une deuxième fille, Alix, le couple royal se déchire de plus belle. Irréfléchi comme à son habitude, le roi prend le parti de faire annuler son mariage sous le prétexte habituel de consanguinité et convoque à cet effet un concile à Beaugency-sur-Loire. Il retire qui plus est ses troupes et ses agents de l'Aquitaine et du Poitou.
Aliénor ne perd pas de temps. Puissante et dans toute la beauté de ses 30 ans, elle jette son dévolu sur Henri, fils aîné du comte d'Anjou Geoffroy Plantagenêt et de Mathilde, petite-fille de Guillaume le Conquérant, prétendante au trône d'Angleterre. Par un concours extraordinaire de circonstances, en quelques mois, Henri va hériter de la Normandie et être porté sur le trône d'Angleterre sous le nom de Henri II. C'est ainsi qu'Henri et Aliénor se retrouvent souverains de l'Angleterre et de tout l'Ouest de la France, de Calais à Bordeaux. Un véritable «empire angevin» qui ne va pas tarder à entrer en concurrence avec le royaume capétien.
Louis VII se venge comme il peut en enlevant à son vassal Henri Plantagenêt ses fiefs français sous prétexte de s'être marié sans sa permission mais il n'a aucun moyen d'appliquer la sentence ! Il se remarie de son côté avec Constance de Castille.
Capétiens contre Plantagenêts
En 1155, renouant avec la tradition carolingienne des ordonnances, le roi publie une ordonnance imposant la «paix du roi». L'année suivante, en signe d'apaisement, Henri II lui rend hommage pour ses fiefs français. Enfin, en 1158, un traité d'amitié est signé et Guillaume (5 ans), fils aîné d'Henri et Aliénor, est fiancé à Adélaïde (quelques mois), fille de Louis VII et de sa nouvelle épouse. La fiancée apporte en dot le Vexin normand. Elle est conduite à la cour d'Angleterre pour y être élevée auprès de son beau-père. Elle y connaîtra un triste destin...
La trêve, cependant, ne dure pas. Défiant Louis VII, Henri II tente d'imposer l'hommage au comte de Toulouse et entre en campagne contre lui. Mais il est battu et le roi de France en profite pour saisir trois de ses châteaux dans le bassin parisien.
Le 13 novembre 1160, 40 jours après la mort de sa deuxième épouse, Louis VII se remarie avec Adèle de Champagne, la fille de son ancien adversaire Thibaut II. Par cette union politique, il veut contrer les ambitions de l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse. Cette troisième union sera fructueuse : elle débouchera sur la naissance du futur Philippe Auguste, ainsi surnommé parce qu'il est né en août (21 août 1165) : il sortira la monarchie capétienne de la médiocrité et lui donnera le premier rôle en Europe. Mais on n'en est pas là...
En 1165, Louis VII signe avec l'empereur le traité de Vaucouleurs en vue de combattre ensemble les «Brabançons». Simultanément, il offre asile à Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, en conflit avec le roi d'Angleterre. Puis il offre assistance aux fils d'Henri II lorsque ceux-ci, alliés à leur mère Aliénor, entrent en conflit avec leur père ! La guerre reprend mais tourne au détriment du roi capétien. Celui-ci y met un terme avec l'appui du pape par la paix de Nonancourt, le 11 septembre 1177.
Frappé d'hémiplégie au retour d'un pèlerinage sur le tombeau de Thomas Becket, il ne peut assister au sacre de son fils et meurt peu après, le 18 septembre 1180, à l'abbaye de Saint-Port.
Histoire(faits marquants) -Le mur de Berlin-
1961-1989
De tous les murs construits par l'homme, celui de Berlin présente dans l'histoire une situation originale. C'est le seul mur dont les effets juridiques sont niés douze ans avant que sa construction soit entreprise. En effet, la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne (RFA), promulguée le 23 mai 1949, définit la nationalité allemande en se référant au territoire du Reich tel qu'il existait le 31 décembre 1937.
Selon l'article 116, « Sauf réglementation législative contraire, est Allemand au sens de la présente Loi fondamentale quiconque possède la nationalité allemande ou a été admis sur le territoire du Reich allemand tel qu'il existait au 31 décembre 1937, en qualité de réfugié ou d'expulsé appartenant au peuple allemand, ou de conjoint ou de descendant de ces derniers ». La Loi refuse implicitement d'accepter comme définitive pour les Allemands ainsi définis la nationalité de tout autre Etat existant ou susceptible d'être créé puisqu'ils conservent leur droit à la nationalité allemande. Cette Loi signifie donc que le rideau de fer déjà installé par les Soviétiques, le mur de Berlin ensuite n'ont aucun effet juridique privant les Allemands de leur nationalité au sein de la République fédérale d'Allemagne. Elle explique également pourquoi, dans la pratique, la réunification allemande de 1990, et aussi l'accueil des Aussiedler, ces personnes de souche allemande originaires de territoires de l'ex-URSS, se sont assez aisément effectués par simple application de la Loi fondamentale, sans qu'il soit nécessaire de discuter et de promulguer de nouveaux textes.
Bien que nié juridiquement, le mur a néanmoins été construit. Il convient donc de présenter les raisons expliquant sa réalisation sans toutefois la justifier. Ensuite, il faut préciser combien le mur était plus qu'un mur stricto sensu. Pourtant, en dépit des risques, il n'est pas resté infranchissable. Enfin, douze ans après son démantèlement, le mur demeure présent.
Le Mur avant le Mur
Pendant quarante ans, la République démocratique allemande (RDA), fondée le 7 octobre 1949 sous influence soviétique, refuse l'unité de l'Allemagne. Comme l'explique par exemple une brochure touristique distribuée en 1970, « la RDA entretient des relations particulièrement étroites avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes frères. Elle se prononce pour la reconnaissance des frontières actuelles en Europe ».
Cette position constante, bien évidemment conforme à celle de l'URSS, et d'ailleurs prévisible dès la construction du « rideau de fer » courant de Lubeck jusqu'en Tchécoslovaquie et au-delà, se cristallise au lendemain de la Seconde guerre mondiale à Berlin. Mais c'est également à Berlin que se cristallise le refus de l'Ouest d'accepter définitivement la partition de l'Allemagne. Il n'y aurait jamais eu de mur de Berlin si les Américains et les Anglais n'avaient réagi, avec un courage, une efficacité et une constance remarquables au blocus de Berlin.
Entrepris le 24 juin 1946 par les Soviétiques qui occupent Berlin-Est (406 km2, soit 45,6 % de la superficie de la ville), il consiste à couper, « pour des raisons techniques », les communications terrestres entre Berlin-Ouest, répartie en trois secteurs (anglais, américain et français), et l'Allemagne occidentale. La réussite du coup de force que représentait de blocus aurait signifié l'abandon par les alliés occidentaux de Berlin et son occupation par les Soviétiques. Mais, pendant près de onze mois, jusqu'au 12 mai 1949, les Américains et les Anglais organisent un pont aérien pour ravitailler les berlinois de l'Ouest, soit 277 728 vols en 322 jours. Le principal aéroport actuel de Berlin, Tegel, est d'ailleurs la conséquence de ce pont aérien puisqu'il est construit en secteur français d'août à novembre 1948 pour compléter les aéroports existants de Tempelhof en secteur américain et de Gatow en secteur britannique.
Et, contrairement à l'espoir de dirigeants soviétiques, le pont résiste et à l'hiver et aux brimades des Russes : projecteurs aveuglant les pilotes, interférences radio, tirs sol-sol, tirs de DCA. Il empêche ainsi Berlin-Ouest de tomber dans l'escarcelle soviétique, et son maintien coûte que coûte, malgré 76 morts et un coût financier considérable, finit par contraindre les Soviétiques à mettre fin au blocus, décision annoncée par l'agence Tass le 25 avril 1949. La première raison conduisant à la construction du mur de Berlin tient donc à la volonté des alliés occidentaux de ne pas abandonner Berlin-Ouest au totalitarisme soviétique. La seconde provient du comportement des Allemands de l'Est face aux soviétiques et à leurs nervis.
En 1950, le land de Berlin-Ouest est constitué au sein de la nouvelle République fédérale d'Allemagne même si son territoire reste démilitarisé, ce qui signifie notamment que les berlinois ne font pas de service militaire. En 1957, le statut de Berlin est conforté par son intégration dans le traité de Rome. Tout cela conforte l'existence d'une enclave occidentale au milieu d'un territoire contrôlé par la RDA.
L'existence de Berlin-Ouest continue d'être insupportable pour les soviétiques car les Allemands de l'Est y votent chaque jour « avec leurs pieds » en fuyant le régime soviétique. Il devient difficile de contrôler chaque jour, les 500 000 personnes qui traversent la ligne de démarcation berlinoise, à pied ou par les réseaux de communication ferroviaire et métropolitain pour se rendre au travail, pour faire des achats ou pour visiter de la famille. Berlin-Ouest est donc le principal espace de transit des Allemands de l'Est émigrant à l'Ouest. En 1958, déjà plus de trois millions d'allemands de l'Est ont fui pour la RFA, la plupart via Berlin. Pour le gouvernement de l'Est, cette hémorragie humaine privant le pays de main-d'ouvre et montrant à la face du monde la faible adhésion à la soviétisation de l'Allemagne de l'Est, est jugée insupportable d'autant que s'y ajoute le risque, si les flux se prolongent, de ne plus guère avoir de peuple à gouverner.
L'URSS tente un nouveau coup le 27 novembre 1958 en lançant un ultimatum exigeant le départ des troupes occidentales dans les six mois pour faire de Berlin une « ville libre » démilitarisée. Les alliés occidentaux refusent. Et l'émigration continue. En août 1961, et ce, depuis la création de la RDA, l'émigration atteint désormais 3,6 millions de personnes. Les Soviétiques prennent alors la décision de faire supprimer par la RDA la ligne de démarcation berlinoise afin d'empêcher toute nouvelle émigration : c'est le mur de Berlin, appelé rapidement le « mur de la honte ».
Ses prémices, que dans l'instant on ne parvient à interpréter, commencent en fait les 12 et 13 juin 1961 avec la pose de grillages et de barbelés autour de Berlin-Ouest, pose à laquelle il est difficile de s'opposer. Puis les Soviétiques choisissent une date idéale pour faire exécuter leur ouvre : le 13 août 1961, soit en plein pont estival pendant lequel nombre de chancelleries et de chefs d'Etat occidentaux sont en vacances et donc pris de cours. La RDA annonce avoir l'agrément du pacte de Varsovie et présente la construction, selon une rhétorique communiste courante, comme un « mur de protection antifasciste ». Aussi des unités armées de la RDA encerclent-elles Berlin-Ouest de façon hermétique et la construction du mur se réalise dans un temps record, ce qui signifie qu'il est le fruit d'une préparation longue et minutieuse.
Le mur est plus qu'un mur
Le mur est davantage qu'un simple mur car sa construction est complétée par d'autres réalisations et diverses décisions. Pour comprendre la volonté et le courage de tous ceux qui se sont exercés à le franchir, il faut comprendre qu'au mur stricto sensu, que l'on voit essentiellement de l'Ouest, sont adjoints huit installations parallèles, en commençant, au pied du mur côté Est, par la pose d'obstacles empêchant de l'approcher en voiture, pour une route pour les patrouilles, puis un réseau de lampes pour éclairer le mur et un réseau de tours de surveillance. Ensuite, toujours en allant vers l'Est, on trouve des mines anti-personnelles, des pièges pour tanks, des barrières d'alarme, et enfin un mur faisant barrière coté Est. Après 1965, le mur est rendu plus efficace encore : il est remplacé par des blocs de béton de 3,5 m de hauteur, surmontés d'un tuyau pour empêcher la prise de mains ou de grappins.
Au mur courant sur 155 km autour de Berlin-Ouest s'ajoutent ensuite les « murs » créés par la fermeture des réseaux de communication ferroviaire et métropolitain entre Berlin-Ouest et Berlin-Est.
En troisième lieu, l'encerclement réalisé par le mur est rendu plus efficace par la diminution considérable des points de passage : il y en avait 81 avant août 1961. 69 sont fermés dès le 13 août, avec des barbelés et des murs de briques. La porte de Brandebourg est fermée le 14 août et quatre autres le 23 août, il n'en reste plus que 7. Aussi les échanges économiques cessent-ils entre les deux Berlin : 63 000 berlinois de l'Est perdent leur emploi à l'Ouest, et 10 000 de l'Ouest perdent leur emploi à Berlin-Est. Après l'accord quadripartite de 1971, le nombre des points de passage est porté à dix.
En outre, le mur, ce sont également ces fenêtres murées des immeubles et maisons côté Est à proximité du mur.
La première conséquence du mur est de faire perdre encore davantage de vie au centre (Mitte) de Berlin qui se trouve du côté Est, et se trouve alors placé en quelque sorte en état d'hibernation, d'autant que l'entretien des bâtiments laisse à désirer quand il n'est pas abandonné. En particulier, les magnifiques bâtiments situés sur l'île des musées, y compris l'important musée de Pergame, souffrent du temps et des intempéries.
Certes, au fil des années, la RDA ressent le besoin de récupérer des devises touristiques. Elle décide d'accorder des permis de séjour journaliers valables 24 heures et autorise l'organisation de visites, essentiellement accompagnées, de Berlin-Est, moyennant le paiement d'une taxe pour les visiteurs étrangers et originaires de la République fédérale d'Allemagne. En outre, la RDA instaure une obligation de change lors de chaque « excursion » et, pour que les choses soient claires, le guide touristique précise : « des devises en deutschemarks ainsi que toutes les autres devises occidentales peuvent être emportées sans limitation. En revanche, la sortie de marks de la RDA ou de devises de pays du bloc socialiste de l'Europe de l'Est est interdite. » Tout cela s'apparente à une sorte de piratage organisé et accepté pour cause de curiosité par les touristes. Pour les visiteurs étrangers est assigné un point de passage unique situé Friedrich Strasse (Chekpoint Charlie), ouvert jour et nuit.
Et, pour illustrer sa supériorité et susciter une attirance touristique, Berlin-Est construit en 1965 une haute tour de télévision de 361,5 mètres sur l'Alexanderplatz, avec la boule de la tour, où se trouve un restaurant, pivotant toutes les heures sur son axe. La tour sert également de poste d'observation militaire.
Outre les différents aspects du mur précisés ci-dessus, le mur se dédouble d'une multitude de murs, fruits de la coupure géographique et politique de la ville : construction orientée vers des modèles de société différents, perte de l'unité du corps urbain, constitution d'une périphérie intérieure à la ville des deux cotés du mur, perte du centre-ville, pertes de structures économiques innovantes des deux côtés, coûts de fonctionnement élevés par le dédoublement des grands équipements concernant la culture (deux opéras), l'éducation (deux universités), les sciences (deux parcs zoologiques).
Les « passe muraille » du mur
Le général des armées RDA Karl-Heinz Hoffman définit le mur de Berlin comme le système de sécurité des frontières le meilleur au monde, en raison de ses qualités techniques incontestables et de l'ampleur des moyens de surveillance. Mais l'appel de la liberté reste constant tout au long des 28 ans de l'histoire du mur. Des milliers d'allemands de l'Est tentent de le franchir au péril de leur vie. Au total, d'août 1961 au 8 mars 1989, 5 075 personnes réussissent à s'évader de l'Est pour Berlin-Ouest par tous les moyens possibles : escalade pour la plupart d'entre eux, mais aussi souterrains, voitures spécialement transformées, fuites à la nage sur la Spree... Mais 588 périrent dans cette tentative.
Parmi les dernières victimes, Winfried Frundenbereg est mort de froid dans la nacelle d'un ballon en plastique qu'il avait fabriqué (13 février 1989). L'imperméabilité imparfaite du mur résulte donc de la volonté de fuir le régime liberticide de la RDA, et, en outre, de l'attitude de divers garde-frontières anonymes, négligeant de viser en faisant feu. Plusieurs d'entre eux désertèrent d'ailleurs pour ensuite apporter leur aide aux passeurs de l'Ouest, où une organisation d'aide se met en place. En particulier, le musée « Haus am Checkpoint Charlie », inauguré dès le 14 juin 1963, permet d'observer les mouvements des gardes et d'accueillir les clandestins.
Le mur après le mur
En 1989, le gouvernement de la RDA ne parvient plus à enrayer l'émigration car celle-ci utilise un nouvel espace de transit, la Tchécoslovaquie, qui finit, sous la contrainte des milliers de voitures fuyant l'Est, par ouvrir ses frontières avec l'Autriche. Aussi le 9 novembre 1989, Günter Schabowski, membre du bureau politique, annonce-t-il la décision du gouvernement de RDA vis-à-vis des Allemands de l'Est : « les voyages privés à destination de l'étranger peuvent désormais être demandés sans aucune condition particulière ».
Quelques heures plus tard seulement, les douaniers de Berlin ne parviennent plus à faire face à la demande et ne peuvent faire autrement de que de laisser simplement passer. Le mur est vaincu.
Puis, fin 1989 et en 1990, le mur est démantelé à raison de 100 mètres en moyenne par nuit, avant l'organisation d'une démolition officielle qui se termine fin 1991. Six pans de mur sont conservés pour mémoire. Berlin réunifiée semble avoir tourné la page d'autant qu'on circule sans problème de l'Est à l'Ouest sur des réseaux métropolitain, ferroviaire, et de bus totalement modernisés au cours des années 1990, tandis que la nouvelle gare centrale doit se terminer dans les années 2000. Pourtant le mur, c'est-à-dire la distinction entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, est toujours là pour tout observateur attentif.
À l'Ouest, le legs du nazisme marque les cicatrices de la ville et plus particulièrement avec cette ruine impressionnante de l'église commémorative de l'empereur Guillaume (Kaiser Wilhelm), appelée « dent creuse » par les Berlinois. Reste aussi le Reichstag incendié par Hitler le 27 février 1933, et transformé en ruine en mai 1945 lors de la bataille de Berlin. La non-reconstruction de la coupole à l'identique de l'initiale de la fin du XIXe siècle et la réalisation par Norman Foster d'une coupole en verre qui se visite de l'intérieur, se voulant symbole d'une démocratie transparente, laisse demeurer au cour de Berlin les stigmates de l'histoire de l'Allemagne. Le mur est également présent au musée du mur de Checkpoint Charlie, mais ce musée n'a pas d'apparence le rendant incontournable. À l'Est ne subsiste aucun trait du nazisme même si ce passé est désormais rappelé dans le quartier juif où la synagogue a été reconstruite.
Une deuxième différence entre les deux Berlin est également architecturale : à l'Ouest, les immeubles de grande hauteur se trouvaient de facto bannis et d'ailleurs en rien justifiés par la faible pression foncière sur un territoire de 484 km2, soit près de cinq fois la superficie de Paris. Ainsi Berlin-Ouest comporte-t-elle de vastes espaces de campagne et, évidemment, ne s'est pas étendue. En revanche, l'Est a voulu faire preuve de modernité par exemple avec l'Alexanderplatz et par la construction des «lambeaux successifs de banlieues grandiosement répétitives».
Le maintien de la division de Berlin se lit également dans la statuaire socialiste, bien entendu absente de l'Ouest, mais toujours présente ci et là à Berlin-Est avec Marx, Lénine, ainsi que la faucille et le marteau. L'empreinte de la RDA demeure en outre avec le triste et abandonné palais de la république (de RDA), bâtiment sans âme des années 1950, construit à la place de l'ancien palais impérial détruit en 1950 sur l'ordre de Walter Ulbricht, sur une place alors dénommée « Marx-et-Engels ». Un lambeau omis lors de la destruction et une exposition en plein air réalisée par les partisans de la reconstruction du palais impérial permet de juger des dégâts causés par cette destruction de bâtiments d'un grand intérêt architectural et artistique, mais les finances manquent pour la reconstruction, d'autant que Berlin se trouve lourdement déficitaire.
Car, en quatrième lieu, le mur demeure effectivement une cicatrice économique et humaine. Avant la guerre, Berlin était le plus gros et le plus innovant pôle économique et surtout industriel d'Allemagne. Puis Berlin-Ouest, en raison de son statut d'exception (accessibilité limitée, position par rapport aux fournisseurs et aux débouchés, départ de la population et des ouvriers qualifiés) se trouve contrainte et écartée de tous les secteurs d'entreprise innovants. L'économie berlinoise devient morose, reposant sur les prébendes de l'Ouest et prenant l'habitude d'être une économie aidée et protégée. À Berlin-Est, le système d'économie planifié socialiste, avec des entreprises étatisées et une organisation en grosses entreprises, entraîne déficience dans l'organisation et la rentabilité de l'économie.
Depuis 1990, Berlin bénéficie de l'apport croissant d'administrations politiques nationales, de l'implantation d'institutions allemandes diverses, de l'installation de marques connues et surtout d'un essor touristique. Berlin a retrouvé ses «Champs Elysées», avec l'avenue Unter den linden (sous les tilleuls), artère Ouest-Est allant de la porte de Brandebourg jusqu'à la place du château (détruit). Mais le développement économique de Berlin demeure modeste et plutôt inférieur à ce qui était généralement escompté. Car quarante années de régime soviétique ou d'économie bridée par le maintien du mur ne s'effacent pas rapidement. Sur l'île des musées ou à proximité, devenu un haut lieu touristique, toujours guère de commerces et, par exemple, pas de kiosques à journaux. En revanche, un marché périodique vous propose essentiellement tous les restes de la période socialiste (insignes militaires, sculptures miniatures de Lénine.). Les comportements ont la vie dure, les employés issus de l'Est conservent souvent une attitude peu ouverte, et peu inventive.
En outre, le démantèlement du mur a été pour les berlinois de l'Ouest l'élargissement de leur espace de liberté. Alors nombre d'entre eux sont partis habiter au-delà des frontières de Berlin et la population de la ville, 3,4 millions d'habitants début 2003, diminue avec un solde migratoire négatif, tandis que le solde naturel est également négatif en raison d'une faible fécondité comme l'ensemble de l'Allemagne.
Les murs entre les hommes sont faits pour être détruits, et celui de Berlin, atrocité communiste, n'a pas manqué pas à la règle. Mais il laisse dans l'histoire architecturale, économique, comportementale, démographique des traces visibles. Après les milliards d'euros dépensés pour relever Berlin depuis 1989, et bien que la ville connaisse une seconde chance, après la période 1871-1945, d'exercer la fonction de capitale de l'Allemagne, Berlin reste mutilée physiquement et moralement par le mur qui l'a transformée en Janus.
Berlin n'est encore qu'une grande métropole en devenir dont les distorsions socio-spatiales accentuées par le mur sont encore trop nombreuses pour favoriser un déploiement suffisamment efficace. La réunification n'ayant pu faire de miracles, face à la rémanence des comportements soviétiques d'une majorité de la population de l'Est, sa principale chance de mieux effacer le mur résulte désormais dans l'élargissement de l'Union européenne à l'Est, qui transforme son positionnement géographique excentré dans l'Union européenne en une place enviable.
Cadeau commun de Corinne
http://corinele.centerblog.net/
Merci Corinne pour ce joli cadeau
et tout ce que tu nous fait partager....
Bonjour tout le monde !!!!
Avoir un Ami
Avoir un ami c'est comme un trésor,
c'est une fleur qui montre son coeur,
c'est comme un enfant qui s'endort,
on ne peut bouger par peur qu'il pleure!
Avoir un ami c'est une fête sans fin,
une ivresse dans ce monde de brutes,
c'est un verre de chaleur entre copain,
une tendresse au milieu du tumulte.
Avoir un ami c'est se blottir contre son coeur,
sans doute, sans peur, sans hésitation,
affronter ensemble les malheurs,
et parfois lui dire pardon!
Avoir un ami c'est partager le monde,
découvrir les trésors cachés et les secrêts,
dire à nos pieds combien la Terre est ronde,
vivre des aventures sans arrêt.
Avoir un ami, c'est savoir lui dire merci,
pour ce que l'on partage et plus encore,
pour sa présence et tout ce que l'on vit,
et parce qu'il vous aime très fort.
(auteur inconnu)
Cadeau commun de Mumu
Je vous remercie à toutes et tous de votre fidélité à venir me visiter.
Déjà 9000 visites et tout ça grâce à vous.
http://mamatus.centerblog.net/
Merci ma Mumu...
pour ton cadeau, ton joli
blog et ton amitié...
Bonne soirée à tous....
Petit bisou
P'tit bisou !
Un tout petit bisou
Une offrande tendresse
Comme un joli bijou
Une douce caresse.
Garde le ce trésor
Il te porte bonheur
Un petit coeur en or
Te l'offre avec ferveur.
Contre un petit caillou
Un baiser sur ta joue
Mon amie
C'est toi qui vaux de l'or…
(auteur inconnu)
Cadeau en commun de Corinne...
http://corinele.centerblog.net/
Merci Corinne ...
tu nous offres de bien jolis cadeaux...
gros bisous
Bonne soirée à tous....
Un instant et pas plus.....
Si ma vie s’arrêtait aujourd’hui, tout de suite,
Est ce que je saurai comment j'ai survécu ?
Les jours et les années qui ont passés si vite
Ne sont plus que fumée à tout jamais perdue…
Regretterai-je alors mes colères soudaines
Les éclats de miroirs brisés d’un geste fou,
Les pleurs et les matins enveloppés de peine
Et ces petits baisers qui me semblaient si doux…
Écouterai-je encore la musique céleste
De tes mots de passion qui glissaient sur ma peau,
Ou bien le regard clos chasserai-je d’un geste
La vision de ce temps où tout me semblait beau…
Je suis là et le ciel est au bord de l’automne
Les gouttes de la pluie se mêlent à mes pleurs,
Le vent qui m’engourdit frissonne monotone
Et les feuilles s’envolent vers un lointain ailleurs…
Mon corps qui a souffert va retrouver l’espace
La douleur peu à peu fait place à l’harmonie,
Mais je sais que pour moi s’est effacée la trace
D’un monde où le bonheur fait place à la folie…
Je n’ai pas de regrets, j’ai marché sur les ondes
Et j’ai eu tant à voir avec si peu de temps,
Mon amour est en moi il me suivra dans l’ombre
Quand je reposerai dans l’oubli qui m’attend…
Non je ne suis pas prête à quitter ceux que j’aime,
Mais j’ai la certitude que mon instant venu,
Je saurai voir encore dans l’abandon extrême
Le visage de ceux qui m’auront soutenue…
Nomade ...
Animaux - Oiseaux - Le perroquet -
Capable d’imiter la voix humaine et d’effectuer des calculs élémentaires, le perroquet est l’un des oiseaux les plus intelligents.
Le plus beau parleur de la famille est sans conteste le perroquet gris du Gabon. Le record de taille est détenu par l' Ara Hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus). Après lui, les plus grands perroquets du monde se trouvent parmi le genre Ara.
Un perroquet peut mémoriser et reproduire jusqu’à 300 mots. Il sait les associer aux objets pour exprimer une demande ou un refus. Par exemple, un perroquet gris disait toujours quand son maître quittait la pièce : »Dieu vous garde ! ». Mais, quand le maître sortait accompagné de quelqu’un « Dieu vous garde tous ! ».
Les sons diffèrent également en fonction de la taille du larynx et de la langue.
Les résultats ont prouvé que les performances du perroquet peuvent se comparer à celles d’un enfant de 4 à 6 ans.
En réalité, seule une vingtaine d’oiseaux manifestent une réelle propension au langage humain.
- Une silhouette ramassée avec une tête assez grosse
- Un imposant bec crochu
- Les quatre doigts des pattes sont disposés d’une manière particulière : deux orientés vers l’avant et deux vers l’arrière. Cette conformation, dite zygodactile, permet une prise en pince très efficace.
- Le bec se singularise par une grande mobilité des mâchoires. Les facilités de mouvement des mâchoires et la puissance du bec permettent aux perroquets de broyer les graines les plus dures.
Les couples sont unis pour la vie. La société des perroquets repose sur l’absence de conflits et de hiérarchie.
Mais, les couples maintiennent des rapports de proximité toute leur vie.
Les espèces cohabitent mais ne se mélangent pas.
 Les perroquets d’Afrique : le groupe africain se résume à quelques perroquets de taille moyenne, comme le perroquet gris du Gabon. Il comprend également les neuf espèces d’inséparables.
Les perroquets d’Afrique : le groupe africain se résume à quelques perroquets de taille moyenne, comme le perroquet gris du Gabon. Il comprend également les neuf espèces d’inséparables. Les psittacidés d’Australasie : le groupe comprend de nombreuses perruches dont la perruche à collier rose, des loris et des loriquets.
Les psittacidés d’Australasie : le groupe comprend de nombreuses perruches dont la perruche à collier rose, des loris et des loriquets. Les psittacidés d’Amérique : c’est là que l’on trouve la famille des perroquets géants, les aras. Les aras peuvent mesurer jusqu’à 1 m de long. Leur longévité est d’environ 60 ans.
Les psittacidés d’Amérique : c’est là que l’on trouve la famille des perroquets géants, les aras. Les aras peuvent mesurer jusqu’à 1 m de long. Leur longévité est d’environ 60 ans.Pendant la période qui suit l’accouplement, la femelle est nourrie et protégée par le mâle. De son côté, elle s’occupe de l’édification du nid.
La plupart des femelles pondent entre 2 et 5 œufs. Les oeufs sont couvés entre 18 et 30 jours selon les espèces.
Les perroquets vivent en moyenne entre 30 et 60 ans mais certains sont morts centenaires !
Et un perroquet court vite.
Bien qu’en principe frugivore, il adore en fait tester toute sorte de nourriture. Il aime particulièrement la viande rouge et le blanc d’œuf.
Si vous craquez pour une perruche, ne le faite pas parce que ça fait bien d’avoir un oiseau exotique dans une cage. Ces oiseaux demandent beaucoup d’attention, de temps et de soins. Si vous le laissez dans un coin, il se recroquevillera sur lui-même, s’arrachera les plumes et finira par mourir de dépression et d’ennui.
Ces oiseaux vivent longtemps, il faut donc bien réfléchir avant de craquer.
Ce sont elles que vous trouverez dans le commerce.
Face à ce trafic, des actions ont été entreprises pour sauver les espèces de perroquets menacées d’extinction : parcs naturels, centre de soins et réserves.
Phylum : Chordata
Sous-phylum : Vertebrata
Classe : Aves
Ordre : Psittaciformes
Animaux - Oiseaux - Le rouge gorge -
L’adulte possède une large tâche roux orangé du front jusqu’au dessous de la poitrine.
A la différence de l’adulte, le jeune rouge-gorge est tacheté de brun et de jaune roussâtre.
Il est également présent aux Açores, aux Canaries et en Afrique du Nord.
C’est l’un des seuls passereaux à chanter pratiquement toute l’année. Il se tait seulement en été, au moment de sa mue.
Les zones d’hivernage atteignent le nord du Sahara. Ils partent en septembre-octobre pour revenir en mars-avril.
Cela ne l’empêche pas de pouvoir être assez agressif. Il lui arrive de s’en prendre à un simple morceau de papier en croyant qu’il s’agit d’un ennemi.
Il adopte fréquemment une attitude conquérante : lève la queue, déploie ses ailes et exhibe sa poitrine très colorée.
La femelle pond 4 à 7 œufs de 20 mm, blanchâtres pointillés de roux. Ils sont couvés 13 à 14 jours.
Pendant que la femelle couve, le mâle l’a nourrit et veille sur le nid. Les oisillons sont nourris par les deux parents.
Phylum: Chordata
Classe: Aves
Ordre: Passeriformes
Famille: Muscicapidae
Genre: Erithacus
Espèce: Erithacus rubecula